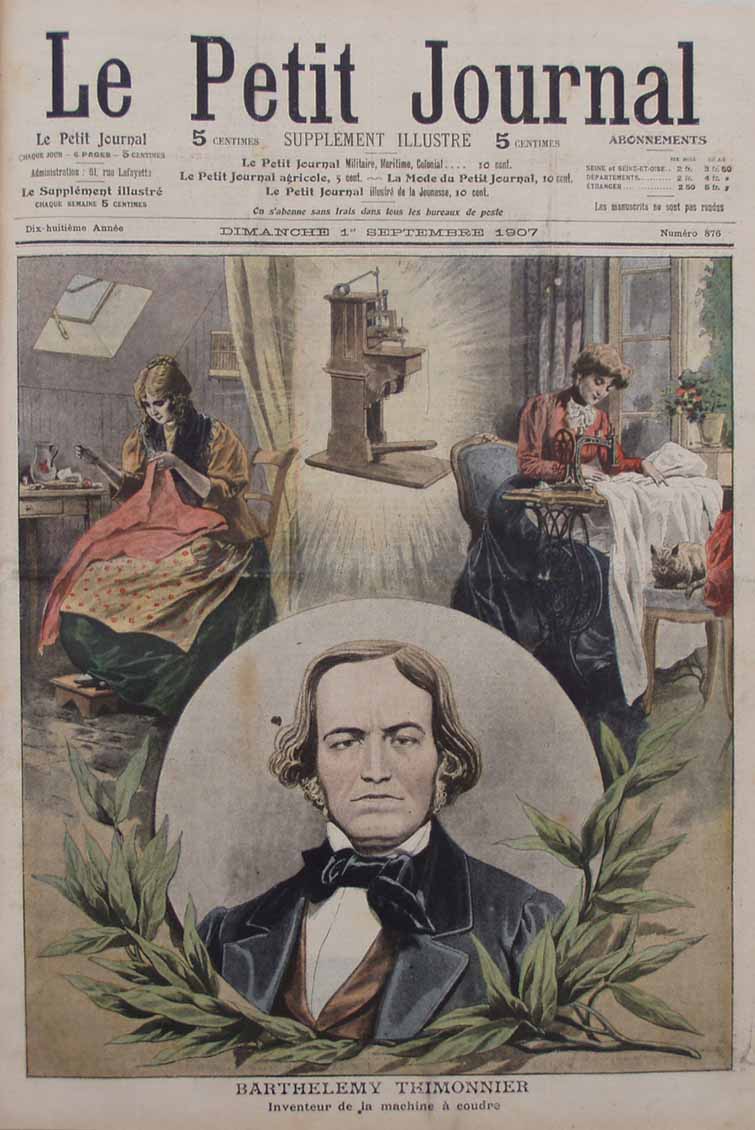BARTHÉLEMY THIMONNIER
Inventeur de la machine à coudre
L' homme dont nous donnons le portrait
fut un véritable apôtre du travail et du progrès.
Dans la gravure que nous consacrons comme un hommage à sa gloire
trop tardive, notre dessinateur a heureusement symbolisé les bienfaits
que l' ouvrière a retirés de l' invention de la machine
à coudre.
Amélioré, perfectionné sans cesse depuis un demi-siècle,
le « couso-brodeur » de Barthélemy Thimonnier est devenu
la jolie machine moderne, la compagne active de toutes les ménagères,
qu' on trouve aujourd' hui dans les plus modestes foyers.
L' inventeur, malheureusement, n' a pu assister au triomphe de sa création.
Il est mort à la peine ; et nos lecteurs verront, par là
simple et douloureuse histoire que nous contons plus loin, combien il
lui fallut d' énergie et de foi en son génie inventif pour
ne point désespérer de son oeuvre.
Aujourd' hui, l' heure de la réparation est venue, et bientôt
la statue de Barthélemy Thimonnier se dressera sur une des places
de la cité où l' humble tailleur conçut l' idée
de cet outil merveilleux qui devait ouvrir des voies nouvelles au travail
féminin.
VARIETE
A propos de Barthélemy Thimonnier. - L' inventeur de la machine à coudre. - Comment les ouvriers accueillirent ce progrès. - Misère et génie. - L' inventeur du téléphone est un Français. - Gaffes de savants. -- Philippe Lebon, Jouffroy d' Abbans et Sauvage. - Le vivisecteur Bouillaud et le phonographe. - Les inventions qui rapportent. - La chance.
Les inventeurs sont les martyrs du progrès. Combien d' entre eux
sont morts à la peine avant le triomphe de leurs découvertes
! Combien d' autres se sont vu arracher le bénéfice moral
et matériel de leur inventions et n' en ont retiré ni gloire
ni profit ...!
Combien nous sont inconnus, alors que nous jouissons chaque jour du fruit
de leurs travaux !... Combien furent bafoués, honnis, accusés
de folie, enfermés dans des cabanons, et dont le génie devait
être reconnu et proclamé plus tard... trop tard !...
C' est à eux surtout que peut s' appliquer justement le sic
vos non vobis de Virgile « Ainsi vous travaillez et ce n' est
pas pour vous »... et aussi le quatrain vengeur du poète
:
On les persécute, on les tue
Sauf, après un lent examen.
A leur dresser une statue
Pour la gloire du genre humain.
Il faudrait un volume pour faire l' histoire du martyrologe des inventeurs.
Ce serait un livre qui éclairerait d' un jour singulier la sottise,
la méchanceté et l' égoïsme humains, et ce serait
aussi le plus souvent un terrible réquisitoire contre la science
officielle, ses prétentions et sa routine.
***
L' inventeur dont nous donnons aujourd' hui le portrait et auquel on va
rendre enfin pleine justice devait, par sa découverte, révolutionner
toute une branche du travail. Près de trente ans, il s' acharna
à faire connaître la machine qu' il avait inventée
mais il ne rencontra dans son pays qu' indifférence, hostilité.
Et lorsque, épuisé, désespéré, il mourut
en 1857, il laissait femme et ses enfants dans un état voisin de
la misère.
Cet homme s' appelait Barthélemy Thimonnier. Il était né
à l' Arbresle, prés de Lyon, en 1793. Venu tout enfant à
Amplepuis, il y apprit l' état tailleur et s' y maria en 1813.
Mais tout en tirant son aiguille, le petit tailleur, qui avait l' intelligence
vive et l' esprit inventif, songeait à simplifier sa besogne par
la construction d' un métier capable de coudre et de broder mécaniquement.
En 1825, il vint s' établir à Saint-Etienne et s' appliqua
à réaliser son rêve. Quatre, années il y travailla.
Enfin en 1829, il réussit à fabriquer un métier à
coudre au point de chaînette, premier essai de la machine à
coudre que le musée historique des tissus de Lyon conserve aujourd'
hui, et dont nous donnons la reproduction dans la page où se trouve
le portrait de l' inventeur.
Un dessinateur de l' École des mines de Saint-Étienne, avec
lequel il s' associa, fit les dessins et fournit l' argent nécessaire
à la prise d' un brevet ; une Société fut constituée
pour l' exploitation, et les deux associés s' en vinrent à
Paris, pleins d' espoir.
Dans un local de la rue de Sèvres, ils installèrent en 1830
un atelier pour la confection des vêtements militaires. Quatre-vingts
métiers à coudre furent construits sur les modèles
de Thimonnier. Les commandes affluaient quand l' invention nouvelle déchaîna
contre elle une véritable émeute. Les ouvriers tailleurs,
voyant dans la machine de Thimonnier une concurrence de nature à
modifier à leur détriment les conditions de la main-d' oeuvre,
envahirent l' atelier, brisèrent les métiers et menacèrent
l' inventeur de lui faire un mauvais parti.
Épouvanté, ruiné, Thimonnier, qui n' avait pu sauver
à grand'peine qu' un seul de ses métiers, reprit tristement
la route d' Amplepuis où il rentrait en 1832, plus pauvre qu' il
n' en était parti.
Deux ans plus tard, ayant ,oublié ses déboires passés,
il revenait dans la capitale. Il avait apporté diverses améliorations
à sa machine, et il espérait bien, cette fois, voir le triomphe
de son invention... Plus malheureux encore que lors de son premier voyage,
il ne parvint pas même à y intéresser qui que ce fût.
Il lutta, dépensa jusqu' à son dernier sou, et quand il
fut à bout de ressources, il se, décida seulement à
regagner Amplepuis.
Mais comme il n' avait plus de quoi monter dans les voitures publiques,
le pauvre homme partit à pied. Il emportait sur son dos sa chère
machine et quelques marionnettes du guignol lyonnais avec lesquelles il
comptait gagner son pain en cheminant.
De fait, il s' arrêtait dans les villages et donnait des représentations
en plein vent ; et quand les paysans avaient bien ri aux facétie
de Guignol et de Gnafron, Thimonnier quittait la gaudriole
pour le genre sérieux. Il exhibait son métier à coudre
et le faisait fonctionner devant son auditoire. Et puis il faisait la
quête pour payer ses frais d' auberge et continuer sa route.
De retour à Amplepuis, le pauvre inventeur se remit au travail.
Il fabriqua des métiers et parvint même à en vendre
quelques-uns. Enfin, après plus de vingt ans d' efforts, il trouva
un commanditaire à Villefranche (Rhône) et put entreprendre
la fabrication en grand de sa machine qu' il n' avait cessé de
perfectionner. Mais peu après, la Révolution de 1848 vint
bouleverser une fois de plus les espérances et les projets de l'
inventeur.
C' est alors que, désespérant de pouvoir jamais imposer
son invention en France, Thimonnier s' en fut exposer sa machine en Angleterre.
En ce pays de sens pratique, elle eut tout de suite un grand succès.
Rentré en France, il l' envoya à l' Exposition de 1855.
Elle y remporta une médaille de 1er classe, et le rapporteur du
jury témoigna, dans son rapport, que c' était là
le type qui avait dû servir à toutes les machines du même
genre construites en Amérique et ailleurs.
Enfin, Thimonnier obtenait un témoignage officiel de la priorité
de son invention. Mais c' était tout ce qu' il devait obtenir.
Il n' en pouvait tirer aucun résultat pratique, aucun profit, et
il mourait deux ans plus tard dans une véritable détresse.
***
L' histoire si navrante que je viens de conter est trop souvent celle
des inventeurs... en France, du moins. Alors qu' en Amérique Edison,
par exemple, a dû à ses inventions la fortune et la gloire,
chez nous la plupart des inventeurs sont morts, comme Thimonnier, dans
l' indifférence ou dans l' oubli.
L' autre jour encore, alors que les Canadiens élevaient un monument
à Graham Bell, qui passe dans le monde entier pour l' inventeur
du téléphone, n' apprenions-nous pas que c' était
un Français, M. Charles Bourseul, qui avait, en réalité,
imaginé le premier ce merveilleux appareil ?
Charles Bourseul, qui vit encore, avait exposé son invention en
1854. Il était alors employé dans l' administration des
télégraphes. Lorsqu' il exposa ses idées à
ses chefs, ceux-ci lui rirent au nez. L' un d' eux, chef du service télégraphique,
lui déclara que c' était « de la blague » et
l' invita à se tenir tranquille.
Ainsi rebuté, l' inventeur se tint coi ; et c' est ainsi que Graham
Bell, qui ne fit connaître son invention qu' en 1872, recueillit
tout l' honneur qui aurait dû revenir à notre compatriote.
Que de fois le découragement, des inventeurs vint de la sottise
des chefs ou des savants qui, chargés d' examiner un projet ou
une machine ne savent manifester que méfiance ou mépris
et étouffent ainsi le génie !
En 1795, Philippe Lebon, l' inventeur du gaz, exposait son procédé
à un savant aréopage officiel. Voici comment ces doctes
personnages jugeaient l' invention :
« Un nommé Philippe Lebon prétend avoir fabriqué
une sorte d' air inflammable qu' il peut distribuer dans toute une ville
au moyen de tuyaux enfouis dans le sol, qu' il fait déboucher sur
les places publiques et dans les maisons particulières, procurant
ainsi partout une lumière d' un éclat incomparable.
» Mais c' est encore une de ces utopies pour lesquelles les vrais
savants doivent être sans pitié.
» Comme l' a si bien dit le professeur Z..., l' académicien
distingué : « A qui fera-t on croire qu' on puisse produire
une flamme au bout d' un tuyau dans lequel il n' y a pas de mèche
! »
En 1804, Fulton inventait la navigation à vapeur, dit-on. Or, en
1784 vingt ans plus tôt ! - le marquis Claude de Jouffroy d'Abbans
avait fait naviguer, sur le Doubs, un petit bateau mû par la vapeur.
Mais personne n' y avait pris garde.
Citerai-je encore le cas de Sauvage, l' inventeur de l' hélice,
qui fut jeté dans un cabanon et mourut fou, pendant que les Anglais
s' appropriaient son invention et en tiraient parti ?
Il se trouva même chez nous un savant (?) pour nier l' évidence
en face du phonographe. Lisez ce procès-verbal de la séance
de l' Académie des sciences du 12 Mars 1878 :
« Un inventeur américain nommé Édison a présenté
un appareil singulier, qu' il nomme phonographe, et au moyen duquel il
prétend reproduire la voix humaine. Mais le savant M. Bouillaud,
traduisant l' indignation de ses collègues, a rappelé cet
inventeur (?) au respect dû à l' Académie cri s' écriant
« Monsieur, nous ne sommes pas dupes d' un habile ventriloque !
»
Il est vrai que le Bouillaud dont il est ici question était un
étrange savant. Médecin, professeur à la Faculté,
il ne se plaisait qu' au milieu des plus ignobles vivisections. C' est
lui qui trépanait le crâne des chiens et leur enfonçait
des fers rouges dans le cerveau. C' est lui qui racontait qu' un chien
auquel il faisait subir cette affreuse torture hurlait sans cesse. «
Nous essayâmes, disait-il, de le faire tenir tranquille en le battant,
mais il cria encore plus fort. Il ne comprit pas la leçon : il
était incorrigible... » On conçoit qu' une invention
comme celle du phonographe n' ait pu être comprise d' un pareil
individu.
L' ingéniosité d' un inventeur, d' un véritable savant
ne pouvait éveiller que méfiance et mépris dans cette
âme de bourreau.
***
Pourtant, il faut bien reconnaître que tous les inventeurs ne sombrent
pas dans la misère et le désespoir. On en a vu tirer grand
profit de leurs trouvailles. Mais il est un fait presque constant, c'
est que les inventions qui rapportent le plus à leurs auteurs ne
sont pas celles qui rendent le plus de services à l' humanité.
Ainsi l' individu qui, le premier, eut l' idée du porte-crayon
muni d' un morceau de gomme à effacer, gagna avec ce simple objet
plus de 500,000 francs.
Celui qui imagina le pince-cravate est devenu millionnaire.
Samuel Fox, qui remplaça les baleines des parapluies par une ossature
métallique, amassa 6 millions.
De même, l' idée de la semelle en métal et du bout
de fer destiné à renforcer la solidité des souliers
d' enfants rapporta à ses auteurs 15 millions environ. En une seule
année, on vendit 187 millions de ces ingénieuses semelles.
Le créateur du patin à roulettes qui, après avoir,
pendant plusieurs années, connu la misère la plus noire
et vécu de la générosité des passants qui
le contemplaient, ahuris, tournoyer sur la place de la Concorde, vit soudainement
la mode favoriser son invention et laissa, à sa mort, 3 ou 4 millions.
Il y a une soixantaine d' années, à Paris, un inventeur
n' a-t-il pas gagné plus de 100,000 francs - véritable fortune
pour l' époque avec un morceau de papier léger soutenu par
trois bouts de fil, qui constituait un parachute-jouet dont le succès
fut considérable !
On dit qu' Harvey Kennedy, qui lança le lacet de soulier, gagna
12 millions à cette opération. L' inventeur de l' épingle
de sûreté, qui, paraît-il, trouva son modèle
sur une fresque de Pompéi et eut l' idée vraiment géniale
de le faire breveter, gagna facilement une soixantaine de millions. L'
inventeur de la plume d' acier fit une fortune énorme.
Et, pourtant, la plupart de ces inventions ne présentaient pas
un caractère d' utilité indéniable. Mais il faut
croire que leurs auteurs surent les lancer et qu' ils eurent la chance.
La chance, tout est là !... Mais pourquoi cette heureuse fatalité
ne favorise-t-elle pas plus souvent les hommes dont les découvertes
géniales marquent les étapes du progrès humain ?
Ernest LAUT.
Le Petit Journal illustré du 1er Septembre 1907