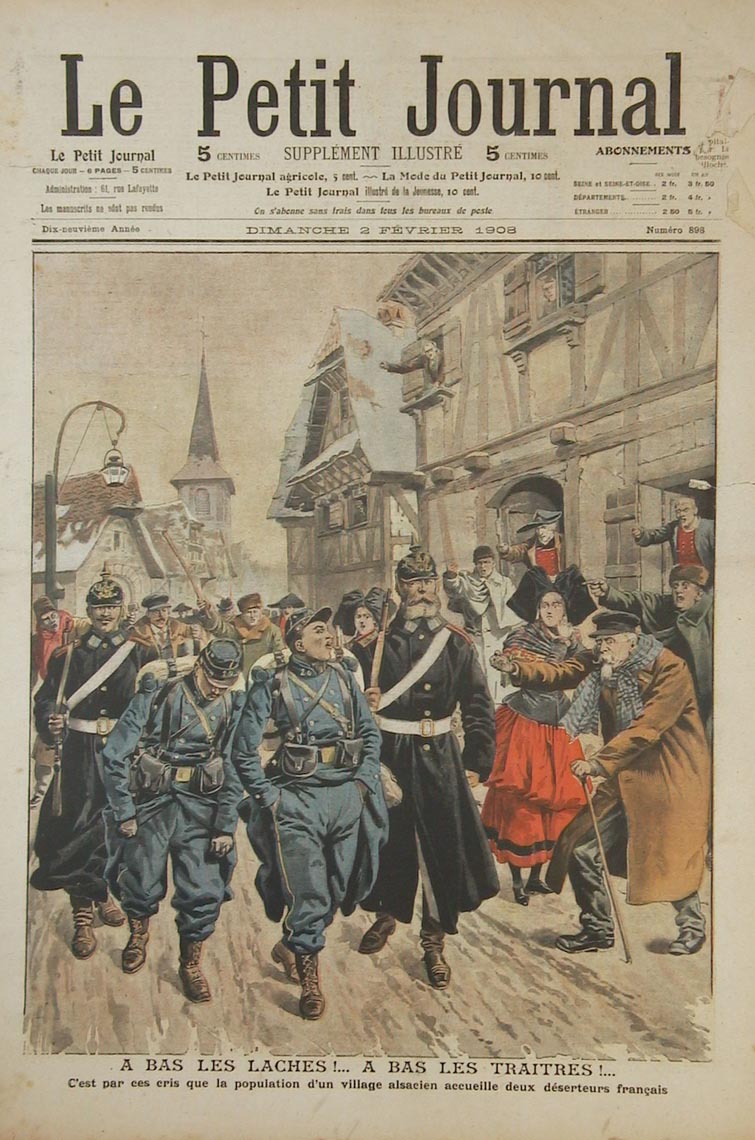A BAS LES LACHES ! ..
A BAS LES TRAITRES !...
C' est par ces cris que la population d' un village alsacien
accueille deux déserteurs français.
Un de ces derniers jours, la population
de Saint-Georges (Alsace) a été péniblement impressionnée
par l' arrivée, en tenue et sabre-baïonnette au côté,
de deux chasseurs à pied du 20e bataillon (Baccarat).
Ces deux malheureux, originaires de Paris, étaient encadrés
par deux gendarmes allemands, qui les conduisirent à la mairie
au milieu des cris hostiles des habitants.
« A bas les lâches ! A bas les traîtres ! »
leur criaient les braves Alsaciens. On les cacha, pendant toute la journée,
dans une geôle ; puis, la nuit venue, on les expédia, revêtus
de haillons, sur le grand-duché de Luxembourg.
Les journaux allemands impriment, à ce sujet, que le bataillon
manoeuvrait aux environs de la frontière quand les deux déserteurs
prirent la fuite ; des officiers se lancèrent à leur poursuite,
mais ils ne purent les rejoindre que lorsqu' ils avaient déjà
traversé la frontière. Ils les appelèrent et tentèrent
de les faire revenir à de meilleurs sentiments. Mais en vain.
Tout ce qu' ils purent obtenir, ce fut qu' ils rejetassent leur lebel
sur le sol français.
Ces deux soldats, disciples déplorables d' Hervé, étaient
des recrues de cette année et s' étaient déjà
fait remarquer par leur mauvaise attitude.
***
VARIETE
On demande des ténors
Un concours original. - Cent mille francs dans le gosier. - Toulouse
triomphe. - Ténors de naguère. - Élleviou et Ponchard.
- La rivalité de Nourrit et de Duprez. - Un ténor héroïque.
- Vers la fortune et vers la gloire.
Au temps jadis, réunions de
famille, agapes familiales ne se terminaient jamais sans chansons...
Est-ce que tout, en France, ne finit pas par des chansons ?... Et lorsqu'
un convive poussait la note avec aisance, il se trouvait toujours quelqu'
un dans l' assistance pour s' écrier, d' un ton rempli d' admiration
:
- Ce gaillard-là a cent mille francs dans le gosier !...
Cent mille francs !... C' était la forte somme, en ce temps-là.
Mais qu' est-ce, aujourd' hui, pour un chanteur illustre ?... Cent
mille francs !... Le fameux ténor Caruso les gagne en dix représentations.
Aujourd' hui, ce n' est plus cent mille francs, c' est des millions
qu' un grand chanteur a dans le gosier. Seulement, les grands chanteurs,
les grands ténors surtout, sont rares. On prétendait même
que la race en était quasiment éteinte et que, même
à Toulouse, on n' en trouvait plus.
Funeste perspective !... Songez-vous à ce que deviendrait le
monde le jour où le dernier ténor aurait poussé
son dernier ut ?
Le ténor, en effet, est un phénomène nécessaire
à l' admiration des foules. Il est inutile à la vie sociale
et, comme presque toutes les choses superflues, il coûte très
cher, mais nous ne pouvons nous en passer.
Conséquemment, l' Amérique ne se contentant plus d' enlever
à l' Europe ses œuvres d' art et les rejetons de ses vieilles
familles, mais lui prenant encore ses ténors, force fut d' aviser.
Et deux feuilles parisiennes, Comoedia et Musica,
résolurent d' instituer un grand concours national à l'
effet de découvrir et de lancer sur la piste de gloire les ténors
encore inconnus que peuvent recéler la capitale et les provinces.
Et la première épreuve du concours eut lieu, ces jours
derniers, à Paris et dans divers grands centres musicaux de France...
Or, savez-vous combien se présentèrent de concurrents
?... Deux cent soixante quinze...Ça n' est pas mal pour un pays
où l' on prétend qu' il n' y a plus de ténors...
Et notez, au surplus, que tous les ténors de France n' étaient
pas là... Il y a encore ceux que leur modestie a empêchés
de se présenter. Et ceux-là doivent être bien plus
nombreux, car chacun sait que le ténor est l' être modeste
par excellence.
Deux cent soixante-quinze !... Mais rendons, avant tout, hommage à
Toulouse... Toulouse est toujours la patrie des ténors... Sur
ce chiffre, à elle seule, Toulouse en produit cent cinquante-six...
Connaissez-vous une ville au monde qui soit capable, sur une simple
appel, de vous exhiber cent cinquante-six ténors ?... A Toulouse,
il y a des ténors dans toutes les professions, libérales
ou autres. On entendit, l' autre dimanche, à côté
d' un ténor docteur en droit, un ténor tondeur de chiens.
Mais attendez, Toulouse a mieux encore... Toulouse a une femme-ténor...
Parfaitement !... Avez-vous jamais entendu une femme-ténor ?...
Non !... Moi non plus,.. Mais j' espère bien que, pour la rareté
du fait Toulouse nous enverra sa femme ténor et que nous l' entendrons
à Paris.
***
« La France, disait naguère un Allemand, la France est
un pays de ténors. »
Vous entendez ce que voulait dire par là cet Allemand. Il prenait
le mot ténor dans un sens figuré et croyait porter ainsi
un jugement sévère sur notre-orgueil national. Dédaignons
son injure et prenons dans le sens propre son affirmation. Oui, la France
est un pays de ténors. L' Italie produit parfois des voix plus
puissantes, plus tonitruantes, comme celles de Tamagno ou de Caruso,
mais aucun pays n' en produit de plus belles que le nôtre.
Presque tous les ténors illustres, dont les noms restent attachés
à la création et à l' interprétation des
grandes oeuvres de l' art lyrique, sont des Français.
J' ai parlé naguère, ici même, de quelques ténors
d' autrefois ( voir Supplément du Petit Journal du 10
Novembre 1906 ) Jélyotte, qui fut la coqueluche des belles dames
du temps de Louis XV ; Garat, qui enthousiasma la cour et la ville sous
l' Empire et la Restauration. Depuis lors, que de chanteurs admirables
ont illustré les scènes de l' Opéra et de l' Opéra-Comique
!
Elleviou, l' émule de Garat, avait commencé par avoir
une voix de basse-taille.
Le fait est plus commun qu' on ne le croit. La métamorphose se
fit par un travail méthodique, et jamais l' Opéra-Comique
n' eut de plus parfait ténor. Mais ses contemporains l' accusent
d' avoir été ténor jusque dans le sens figuré
de l' expression. Au théâtre, on l' appelait l' Empereur,
tant il tranchait du maître et avait de morgue pour ses inférieurs.
Elleviou fut le premier chanteur qui toucha de gros cachets. Vers la
fin de sa carrière, il gagnait environ 80,000 francs par an.
En 1812, il prétendit se faire donner 120,000 francs. Mais Napoléon
qui, en pleine campagne de Russie, trouvait le temps de régenter
la Comédie-Française, ne négligeait pas non plus
de s' occuper de l' Opéra-Comique. Il s' opposa tout net aux
prétentions d' Elleviou, et le ténor, froissé par
son refus, donna sa démission.
Il se retira dans un superbe domaine qu' il avait acheté près
de Tarare, dans le département du Rhône, et fit de la politique.
Maire de sa commune, conseiller général, décoré
de la Légion d' honneur, il allait se présenter à
la députation lorsqu' il mourut d' une attaque d' apoplexie,
en 1842.
Elleviou avait été décoré comme magistrat
municipal. Ponchard, qui fut presque son contemporain, Ponchard, le
célèbre créateur de la Dame Blanche, fut
décoré comme chanteur par Louis-Philippe, en 1845... Vous
voyez que la coutume de donner la Légion d' honneur aux gens
de théâtre n' est pas aussi récente qu' on le croit
communément.
***
Ce fut une rivalité épique
que celle des deux grands ténors Nourrit et Duprez.
Nourrit régnait en maître sur la scène de l' Opéra.
lorsque parut Duprez, en 1837. Quelques années auparavant, celui-ci
n' était qu' un médiocre ténorino. Il était
parti en Italie, y avait étudié l' art du chant et revenait
en vainqueur, précédé du bruit de ses triomphes
sur les théâtres de Naples et de Milan.
Quand Duprez eut chanté Guillaume Tell, Nourrit comprit
que ses succès étaient finis. Il lutta quelque temps -
lutte inégale, car Dupiez était dans toute la force de
l' âge et du talent, tandis que Nourrit ressentait les premières
fatigues d' une carrière déjà longue - puis il
quitta l' Opéra.
Déjà sa voix avait eu d' inquiétantes défaillances.
Il partit en province. Un soir qu' il jouait la Juive, à
Marseille, un enrouement subit le prit au moment de chanter son grand
air. La fatigue, l' émotion le paralysaient... Pâle et
tremblant de douleur, il se frappa le front, fit un geste de désespoir
et sortit dans une agitation inexprimable. Des amis, qui se trouvaient
dans la salle, se précipitèrent vers sa loge ..
Plus de doute, raconte l' un d' eux, notre malheureux ami était
fou !... Je n' oublierai de ma vie cette effroyable scène. L'
oeil en feu, le visage égaré, Nourrit marchait à
grands pas, frappait les murs avec violence et poussait des sanglots
qui déchiraient le coeur... Dans cet affreux désordre,
il ne put nous reconnaître.
» - Qui êtes vous ?... Que me voulez-vous ? Laissez-moi...
» - Ce sont vos amis qui viennent vers vous.
» - Mes amis... C' est impossible... Si vous êtes mes amis,
tuez-moi... Ne voyez-vous pas que je ne puis plus vivre, que je suis
perdu, déshonoré !
» En disant ces mots, il courut vers la fenêtre avec une
impétuosité foudroyante. Nous nous précipitâmes
vers lui, et, le saisissant avec force, nous l' entraînâmes
vers un fauteuil où, brisé par les efforts d' une lutte
inégale, il se laissa tomber sans résistance, dans un
accablement profond...
La fenêtre !... C' est par là que Nourrit devait périr.
Déjà, ce soir-là, il avait eu l' attirance du suicide.
Rentré à Paris, il se soigna, se crut guéri. Puis
il partit pour l' Italie. A Naples, où les succès de Duprez
étaient encore dans toutes les mémoires, il accepta un
engagement au théâtre San-Carlo. Le 7 Mars 1839, comme
il chantait la Norma, sa voix le trahit de nouveau. Des «
chut ! » nombreux se firent entendre. Nourrit rentra dans la coulisse,
la figure bouleversée, en murmurant :
- Chutez, mes amis, demain vous ne me chuterez plus !
En rentrant chez lui, il soupa tranquillement, se montra bon et affectueux
envers sa femme et ses enfants. Rien ne faisait prévoir la déplorable
résolution à laquelle il allait se laisser entraîner.
Puis, à l' aube, se levant furtivement, il ouvrit sa fenêtre
et se précipita du haut de son balcon dans la cour du palais
Barbaja qu' il habitait.
***
Raille qui voudra les chanteurs, leur
amour-propre parfois excessif, je ne sais rien de plus tragique que
le suicide de cet artiste qui se tue parce que sa voix l' a trahi, parce
que le public l' a sifflé, parce que sa carrière est finie.
Si fait, cependant : il y a l' histoire de l' accident de Roger, dont
un détail montre quelle force d' âme peut avoir un artiste
au milieu des plus terribles souffrances.
Roger est cet illustre ténor qui fit, au milieu du dernier siècle,
les beaux soirs de l' Opéra-Comique et de l' Opéra, où
il créa le Prophète, et que son bras mécanique
avait rendu aussi célèbre que sa voix.
« Donc, raconte Roger dans son Carnet d' un ténor,
c' était le 27 Juillet 1859, à sept heures du matin. J'
avais tué, la veille,
deux tout petits faisans. Nous étions dans notre château
de Villiers-sur-Marne, où Fiorentino et Mme Borghi-Mamo devaient
venir passer la journée avec nous.
» Je dis à Fanny ( sa femme )
» - Vois donc ces faisans ! Comme ils ont pauvre mine ! Je vais
tâcher d' en tuer encore deux.
» Et je prends mon fusil, je vais dans le parc. A cent mètres
de l' entrée principale, je mets mon fusil au pied d' une haie
pour franchir un fossé.
» Quand je veux le reprendre, je le saisis par le canon et je
le tire à moi. Les broussailles opposent de la résistance,
font jouer la gâchette, et je reçois la décharge
dans l' avant-bras droit.
» Ma pauvre Fanny ! En me voyant rentrer ensanglanté, mutilé,
elle ne sut que crier. La douleur l' avait clouée sur place.
»Mon bras était horriblement fracassé. Le coup avait
fait balle, les os étaient broyés sur une longueur de
dix à quinze centimètres.
» René Lordereau, qui était au château, envoya
vite chercher, à Paris, les docteurs Laborie et Huguet. En les
attendant, le médecin du pays fit un premier pansement qui me
calma. Je pus même chanter. Dans un pareil état, c' était
ma voix qui m' inquiétait. J' attaquai un motif des Huguenots.
» - La voix est bonne, dis-je à Fanny, ce ne sera rien...
»
Eh bien, que dites-vous de ce ténor qui, le bras en lambeaux,
une heure avant l' amputation, pense à sa voix et a le courage
de chanter ?... Je le trouve, pour ma part, tout simplement héroïque.
***
Mais que nous voilà loin du concours où Toulouse triompha
et des deux cent soixante-quinze concurrents qui rêvent déjà,
je le gage, de la gloire de Duprez et des profits de Caruso.
Quand on court à la poursuite des anecdotes, sait-on jamais où
l' on s' arrêtera ?
Revenons à nos moutons... je, veux dire à nos ténors.
Combien d' entre eux sortiront vainqueurs de l' épreuve finale
qui aura lieu sur une grande scène parisienne, en Avril prochain
?... Combien resteront sur le carreau et retourneront à leur
métier, emportant les débris de leurs illusions ?... Le
plus grand nombre, assurément.
Mais, pour les premiers, que de gloire, que de lauriers, que de millions
en perspective !
La plupart sont aujourd' hui d' obscurs employés ou des ouvriers
modestes, qui gagnent trois francs par jour, comme naguère, à
Sidi-Bel-Abbès l' ouvrier fondeur Rousselière, devenir,
en quelques années, le ténor célèbre auquel
on donne en Amérique, des cachets de 8,000 francs par soirée.
La plupart n' avaient point osé, jusqu' ici, envisager l' espoir
d' un avenir de triomphes et de fortune. Une belle voix, quelques années
d' études, un peu de chance le leur assureront, cet avenir. Ils
connaîtront la griserie des enthousiasmes populaires ; ils auront,
comme Tamagno, des salons aux murailles desquels s' accrocheront d'
innombrables couronnes ; ils entasseront les millions sur les millions,
traiteront d' égal à égal avec les têtes
couronnées, et quand un souverain leur demandera de chanter devant
lui pour la gloire, ils pourront lui répondre, comme le ténor
dont Banville a tracé le portrait clans une de ses pièces
funambulesques :
Eh quoi !... Chanter pour rien.
Comme égrène son air de flûte
Le rossignol aérien...
Je veux mille francs par minute !
Et on les leur donnera, les mille francs.. avec beaucoup de compliments,
de rubans et de croix par-dessus le marché.
Heureux ténors !...
Ernest LAUT.
Le Petit Journal illustré du 2 Février 1908