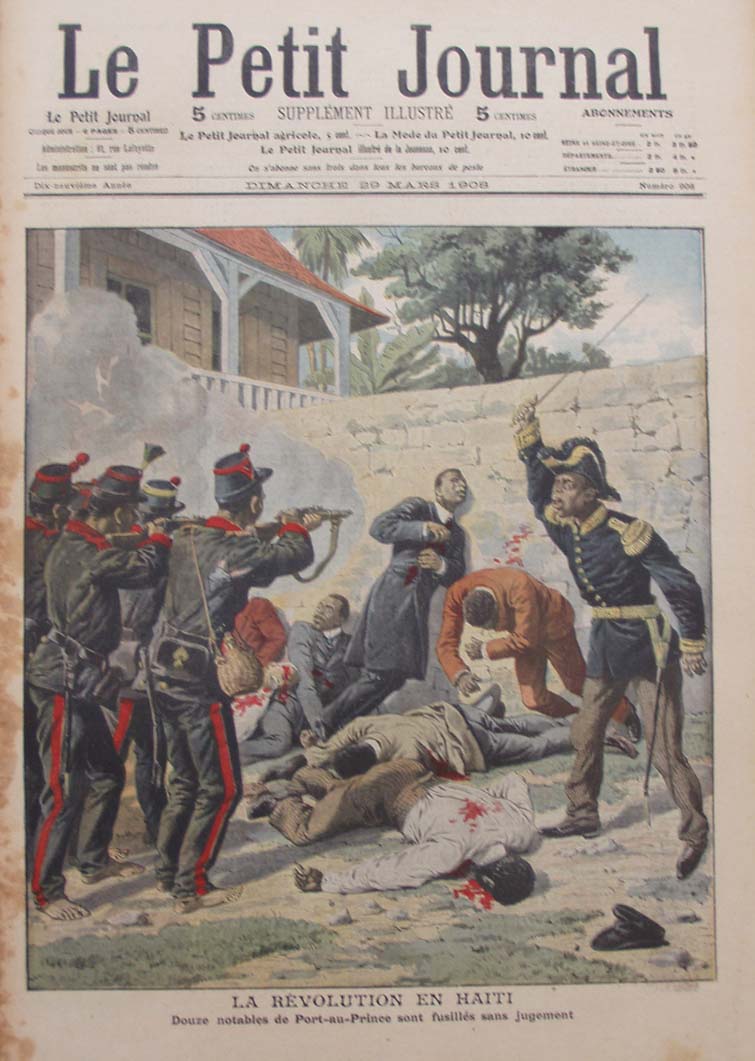LA RÉVOLUTION EN HAITI
Douze notables de Port-au-Prince
sont fusillés sans jugement
On sait que, depuis quelques mois,
la révolution sévit à Haïti. L' Europe n'
y avait pas prêté grande attention, ce pays étant
depuis un siècle, ainsi que nous le démontrons plus loin
dans notre « Variété », en état de
convulsion permanente.
Le général Firmin essaie de renverser le général
Nord-Alexis qui détient en ce moment la présidence de
la République haïtienne. Les insurgés, vaincus, s'
étaient réfugiés dans les consulats de France,
d' Espagne et d' Allemagne. Mais quelques-uns de leurs partisans étaient
demeurés à Port-au-Prince ; ce sont eux que le général
Nord - Alexis a fait saisir et fusiller sans autre forme de procès.
En outre, le président de la République haïtienne
a émis la prétention de se faire livrer par les consuls
les personnes qui ont cherché un asile sous la protection des
pavillons européens.
Les consuls ont refusé de se prêter à sa volonté.
Des vaisseaux de guerre français, anglais, allemands et américains
sont partis en toute hâte pour les ports haïtiens.
Et cette démonstration énergique suffira. il faut l' espérer,
à ramener pour un temps le calme dans la République nègre
et à empêcher d' autres massacres et d' autres séditions.
VARIÉTÉ
Le Pays des Révolutions
Haïti. - - Une ère de tranquillité et de richesse. - La prospérité d' une colonie française. - Les effets de la Révolution. - Comment les nègres d' Haïti profitèrent de la liberté. - Toussaint Louverture et Dessalines. - La cour de Soulouque. - L' incendie de Port-au-Prince. - Le gendarme est sans pitié. - Le président Nord-Alexis ne tient pas ses promesses.
Le pays des révolutions, c'
est cette île de Saint-Domingue ou de Haïti qu' un soulèvement
politique, suivi d' exécutions sommaires, vient encore d' ensanglanter.
Depuis cent quatre ans que l' indépendance de ce malheureux pays
fut proclamée, les révolutions, les troubles, les émeutes,
les séditions s' y sont succédé presque sans discontinuer.
C' est la terre élue des agitations politiques, du désordre,
de l' anarchie. Alternativement, Haïti a vécu sous des présidents
de République, des rois, des empereurs, mais, qu' elle que fût
la forme du gouvernement, le pays n' en était ni plus calme ni
plus heureux. Il semble qu' un ferment d' agitation s' y renouvelle
sans cesse et y entretienne la révolution à l' état
permanent.
Je n' entreprendrai pas de conter par le menu l' histoire de ces innombrables
et perpétuels soulèvements. Il faudrait un fil l' Ariane
pour se retrouver au milieu des intrigues de tous ces généraux
- car Haïti est aussi le pays des généraux - qui,
depuis un siècle, se disputèrent continuellement le pouvoir.
Je risquerais, en l' essayant, de m' égarer dans ce dédale
de guerres civiles et d' insurrections, et j' aurais tôt fait
de lasser la patience du lecteur.
Au surplus les événements qui, depuis cent ans se déroulèrent
à Haïti, pour violents qu' ils aient été,
ont manqué de variété. C' est surtout à
propos de cette î1e qu' on peut dire l' histoire est un éternel
recommencement. Un général occupe le pouvoir, un autre
général fomente une révolution et tente de le renverser.
Les trois quarts du temps, les partis opposés ne différent
nullement d' opinions politiques.
A Haïti, on ne se bat pas pour des principes, mais bien plutôt
pour des questions de personnes... « Ote-toi de là que
je m' y mette ! » Voilà la grande raison des révolutions
haïtiennes. Et le présent soulèvement est un exemple
frappant de cette politique simpliste autant que violente.
***
Ce pays connut pourtant une ère de tranquillité et de
richesse... Et ce fut - j' en demande pardon aux mânes des grands
théoriciens antiesclavagistes - ce fut au temps de l' esclavage
des nègres, au dix-huitième siècle. Saint-Domingue
appartenait alors, par parties inégales, à deux puissances
européennes : l' Espagne et la France.
La colonie espagnole comprenait 48,000 kilomètres carrés
la colonie française n' en avait que 28,000. Et cependant, tant
était développé chez nos pères cet instinct
colonisateur qu' on nous dénie aujourd' hui, la colonie française
de Saint-Domingue était considérée comme le type
des colonies à plantations, et de beaucoup la plus riche du Nouveau
Monde. Bien que beaucoup moins vaste que sa voisine espagnole, elle
était quatre à cinq fois plus peuplée.
En 1776, époque où l' on fit la délimitation entre
les deux colonies, la française possédait prés
de 12,000 plantations, tandis que l' espagnole n' en avait que 5,500.
Le recensement de 1788 donnait, pour le Saint-Domingue français,
plus de 455,000 habitants, soit 27,717 blancs, 21,808 gens de couleur
libres et 405,564 esclaves. Le Saint-Domingue espagnol n' avait que
125,000 habitants, dont 15,000 esclaves seulement.
On cultivait, dans les plantations françaises, l' indigo et surtout
la canne à sucre. Les planteurs y faisaient des fortunes considérables.
Les plus beaux nègres, les plus forts étaient, sur tous
les marchés des Antilles, achetés pour les plantations
françaises de Saint-Domingue.
Pendant les vingt à vingt-cinq années qui précédèrent
la Révolution française, la colonie jouit d' une extraordinaire
prospérité. En 1789, la production du café atteignait
43,000 tonnes ; en 1791, celle du sucre montait à plus de 73,000
tonnes. C' est de Saint-Domingue que l' Europe tirait presque tout son
sucre et son coton. En 1789, l' exportation de l' île vers la
France dépassait 135 millions de francs.
La Révolution française, qui eut son contre-coup dans
le monde entier, devait bouleverser de fond en comble le régime
de Saint-Domingue. Mulâtres et Nègres, alliés contre
les Blancs, se soulevèrent. Les planteurs furent massacrés,
les plantations saccagées. Une ère de troubles commençait
à Saint-Domingue, une ère de troubles qui ne devait plus
finir.
La Convention avait proclamé, en 1794, la liberté et l'
égalité politique des Noirs. Ceux-ci, sous la conduite
d' un chef habile et courageux, Toussaint Breda, dit Toussaint Louverture,
surent assurer leur indépendance. Ils chassèrent les Anglais
et les Espagnols qui avaient envahi Port-au-Prince et massacrèrent
ou expulsèrent jusqu' au dernier des anciens colons de l' île.
En 1795, le traité de Bâle ayant reconnu à la France
le droit de souveraineté sur toute l' île, le Directoire
nomma Toussaint Louverture général en chef des troupes
de Saint-Domingue. Celui-ci en profita pour se rendre indépendant.
Il se fit élire gouverneur à vie et donna au pays une
constitution. Son gouvernement était modéré ; le
calme était revenu dans l' île Saint-Domingue espérait
enfin des jours heureux, lorsqu' un nouvel orage éclata sur l
'île.
Les planteurs dépossédés n' avaient pas perdu tout
espoir de reconquérir leurs terres et leurs fortunes. Ils intriguèrent
dans ce but auprès de Bonaparte, premier consul. Joséphine,
en sa qualité de créole, partageait leurs espérances
et soutenait leurs prétentions. Bonaparte entra dans leurs vues
et décida de reconquérir Saint-Domingue. Il y expédia
une armée sous les ordres de son beau-frère, le général
Leclerc.
On sait quelle fut la triste fortune de cette expédition. Leclerc
s' empara par surprise de Toussaint Louverture et l' envoya prisonnier
en France. Mais l' insurrection ne fut point vaincue pour cela. Elle
se ralluma, au contraire, plus violente, sous la conduite du nègre
Dessalines.
Le climat, les maladies épidémiques, si terribles en ces
régions tropicales, semblaient conspirer avec les Noirs la défaite
des Blancs. Une épouvantable épidémie de fièvre
jaune décima l' armée française. Leclerc fut parmi
les victimes. Des 35,000 hommes débarqués, près
de 25,000 moururent en quelques semaines. Le 30 Novembre 1803, les misérables
débris de l' armée s' embarquaient et regagnaient la France.
Une fois de plus, les Nègres de Saint-Domingue avaient conquis
la liberté.
***
La proclamation officielle d' indépendance de l' île eut
lieu aux Gonaïves. le 1er Janvier 1804... Depuis lors, l' histoire
de Haïti ne fut plus, sauf quelques courtes périodes de
tranquillité, qu' un long enchaînement de drames, de crimes,
d' émeutes et de révolutions de palais.
Dessalines, qui s' était si vaillamment conduit lorsqu' il s'
était agi de chasser l' étranger de l' île, perdit
la tête dès qu' il se vit au pouvoir. Après avoir
rendu à l' île son ancien nom de Haïti, il
se fit proclamer empereur sous le nom de Jacques Ier et se conduisit
en véritable tyran, faisant assassiner, sans aucune forme de
procès, ceux qu' il considérait comme ses ennemis politiques.
A un siècle d' intervalle, le président Nord-Alexis vient
de nous montrer que, à ce point de vue, les moeurs ne se sont
guère modifiées en Haïti, et que ces exécutions
sommaires y sont toujours en honneur.
En 1806, une émeute éclata, conduite par le mulâtre
Pétion et le nègre Henri Christophe, et Dessalines fut
assassiné à son tour.
Mais aussitôt les deux vainqueurs se brouillèrent et la
guerre civile continua.
Christophe, établi au Nord de l' île, s' y fit proclamer
roi sous le nom de Henri Ier ; Pétion, maître des contrées
du Sud, y maintint le régime républicain.
A la mort de ce dernier, en 1818, le mulâtre Jen-Pierre Boyer,
qui lui succéda, reprit la campagne contre Christophe qui se
suicida pour ne pas tomber entre des mains de ses ennemis. Boyer réussit,
en 1822, à conquérir l' île tout entière.
La tranquillité allait-elle enfin régner à Haïti
?... Hélas ! non. Aux crises politiques succédèrent
les crises financières. Le malheureux pays, épuisé
par tant de soulèvements, ne put payer une indemnité due
à la France pour les anciens colons expropriés. Les insurrections
recommencèrent. Boyer dut s' enfuir et vint mourir en France.
En 1844, l' unité de l' île était brisée.
Un nouvel État se formait à l' Est, qui prenait le nom
de République Dominicaine. En même temps, des soulèvements
éclataient de tous les côtés à la fois :
Le général Salomon s' insurgeait dans le Sud ; le général
Dalzon, à Port-au-Prince ; le général Pierrot -
que de généraux ! - au Nord de Cap-Haïtien. Le président
de la République s' inquiétait d' ailleurs fort peu de
tous ces soulèvements. C' était alors un vieux nègre
ivrogne, le général - lui aussi ! - le général
Guerrier, qui passait sa vie à se gorger de tafia au fond de
son palais.
Ce Guerrier, qui n' avait, jamais manié d' autres armes que les
bouteilles de rhum qu' il vidait sans souci des affaires de son pays,
ne tarda pas à succomber dans une crise d' alcoolisme. Un président
sage et pacifique, Jean-Baptiste Riché, lui succéda et
ramena la paix dans l' île. Mais il mourut trop tôt, et,
le 1er Mars 1847, le Sénat haïtien lui donna pour successeur
le nègre Faustin Soulouque.
***
Jusqu' ici, l' histoire de Haïti
s' est déroulée dans le désordre et l' horreur.
Avec Soulouque, elle prend un caractère nouveau : elle entre
de plein pied dans le grotesque.
Après divers massacres et des campagnes malheureuses contre la
République Dominicaine, ce tyran ridicule, qui se faisait appeler
Faustin-Soulouque-Napoléon-Robespierre, s' avisa de se faire
proclamer empereur sous le nom de Faustin Ier. Tourmenté par
la gloire de Napoléon, il voulut une cour calquée sur
celle du Premier Empire. Il se fit sacrer dans la cathédrale
de Port-au-Prince, eut une garde impériale, des maréchaux,
créa une noblesse. Tous les uniformes démodés d'
ambassadeurs, de préfets, d' académiciens partaient d'
Europe à destination d' Haïti.- Soulouque en affublait ses
dignitaires... Et quels dignitaires !... Il y avait, à la cour
de Port-au-Prince, des ducs, des marquis, des comtes et des barons qui
ressemblaient merveilleusement, avec leurs panaches et leurs chamarrures,
aux singes savants de chez Corvi... Le grand-chambellan de Soulouque
s' appelait M. le duc de la Marmelade, le grand-panetier était
duc de la Limonade, et le grand maréchal de la cour marquis de
Trou-Bombon.
Ce personnage d' opérette - je parle de Soulouque - exaspéra
tellement son peuple par ses folies, ses exactions et ses dilapidations
que, à la fin, on l' expulsa et on l' envoya à la Jamaïque.
Sous ses successeurs, Geffrard, Salnave, Nissage-Saget, Domingue, les
émeutes, les fusillades, les soulèvements continuèrent.
En 1879, on se battit jusque dans la chambre des représentants
haïtiens. Quarante députés furent tués ou
blessés. Tous les dix ans, à peu près, la malheureuse
capitale, Port-au-Prince, a dû être reconstruite, à
la suite d' incendies allumés par les révolutionnaires.
On n' a pas oublié la terrible révolution qui accompagna,
en 1888, la chute du général Salomon. Sans le dévouement
des marins français du Bisson, la ville de Port-au-Prince
eût été alors détruite de fond en comble.
Il n' en alla guère mieux sous la présidence du général
Hippolyte, qui succéda au président Salomon. Il n' en
va guère mieux aujourd' hui sous la férule du président
Nord-Alexis, qui vient de se manifester comme un gaillard fort peu respectueux
du droit des gens.
« Le gendarme est sans pitié », a dit Courteline.
Cette affirmation, qui ne saurait s' appliquer à nos braves Pandores
français, semble, au contraire, faite tout exprès pour
le président Nord-Alexis. Ce personnage peu endurant est, en
effet, un ancien gendarme. Âgé aujourd' hui de quatre-vingt-huit
ans, il a fait sa carrière militaire dans la gendarmerie haïtienne.
Il était, en 1843, officier de gendarmerie, chef d' escadron
; deux ans plus tard, aide de camp du président de Haïti,
adjudant de place à Cap-Haïtien ; il recevait, en 1847,
les premiers ordres de noblesse.
Pendant la révolution de 1865, il défendit, avec Salnave,
Cap-Haïtien ; en 1868, il devenait ministre de la guerre, sous
la présidence Saint-Marc. Depuis lors, il fut mêlé
fort activement à tous les événements politiques
et militaires qui survinrent dans la République haïtienne.
Il se présenta au moins une dizaine de fois à la présidence
sans pouvoir parvenir à la magistrature suprême. Enfin,
il réussissait, il y a deux ans, à se faire proclamer
président par un Parlement à sa dévotion ; il était
élu par 100 voix sur 115 votants.
En prenant le pouvoir, il avait tracé ainsi la politique que
devait suivre son gouvernement : « Il faut demeurer en paix, pour
conserver l' indépendance du pays, pour le faire prospérer,
pour se développer et pour prendre enfin notre place parmi les
nations civilisées. »
Mais le président Nord-Alexis n' a pas tenu sa promesse : depuis
son arrivée à la magistrature suprême, les troubles
ont, en Haïti, succédé aux troubles pour aboutir
au régime de terreur qui, depuis quelque temps, sévit
là-bas.
De tout ceci, une conclusion, se dégage. Et elle n' est point,
il faut bien le dire, tout à fait conforme aux idées des
négrophiles à tous crins qui, depuis cent ans, prônèrent
sans relâche le principe de l' égalité des races.
C' est que ces grands enfants noirs, tant qu' ils seront livrés
à eux-mêmes, se laisseront aller à tous les mauvais
instincts des êtres primitifs. Ils ont besoin que les Blancs veillent
sur eux d' un peu plus près et les dirigent avec quelque énergie,
ou sinon ils ne sont pas près de prendre, comme le dit si plaisamment
le président NordAlexis, leur place parmi les nations civilisées.
Ernest LAUT.
Le Petit Journal illustré 29 Mars du 1908