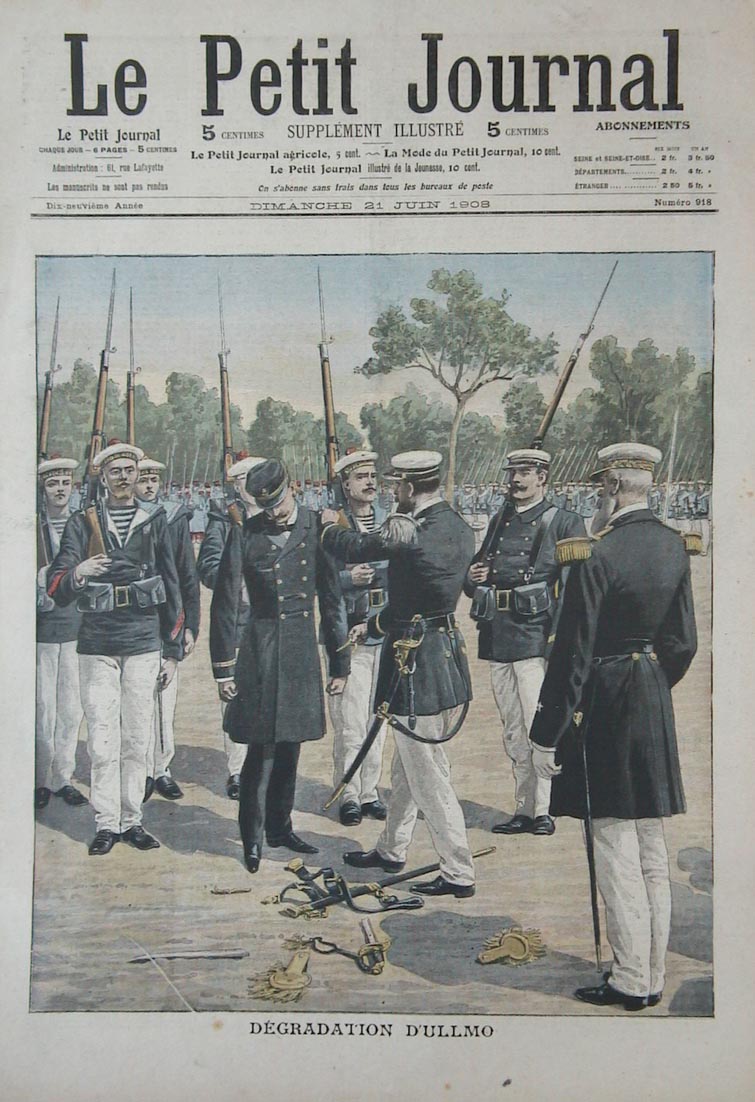DÉGRADATION D'ULLMO
La dégradation militaire d' Ullmo
a eu lieu vendredi dernier, à huit heures du matin, sur la place
Saint-Roch, à Toulon.
L' amiral Marquis en avait, depuis plusieurs jours, arrêté
toutes les dispositions.
Les équipages de la flotte avaient fourni trois compagnies et
les régiments coloniaux une compagnie chacun ; l' artillerie
de forteresse et coloniale un peloton et une batterie. Les troupes étaient
placées sous les ordres du capitaine de vaisseau Dutheil de la
Rochère. Les tambours et les clairons du 111e de ligne firent
les sonneries réglementaires.
Ullmo était au centre du carré, en face de la délégation
d' officiers de tous grades, du sous-lieutenant au colonel et de l'
aspirant au capitaine de vaisseau, placés sur deux rangs, la
marine devant l' armée de terre et l' armée coloniale
en arrière. Ce carré avait 50 mètres sur 75. Le
plus ancien premier-maître avait été désigné
pour dégrader le traître.
Ullmo ignora jusqu' au dernier moment que la date de la dégradation
était si rapprochée. L' ex-enseigne Recoules, son compagnon
de cellule, lui avait persuadé que la dégradation n' avait
jamais lieu avant deux ou trois mois à compter du rejet du pourvoi
et il n' en fut averti que lorsqu' on lui donna l' ordre de revêtir
sa tenue. Un tailleur du 5e dépôt était venu chercher,
à la prison, la casquette et la redingote du traître pour
préparer les galons et les boutons à être arrachés
facilement.
Aussitôt après la dégradation, Ullmo endossa des
habits civils et fut conduit à la maison d' arrêt par la
gendarmerie départementale.
Il y séjournera en attendant son transfert à l' 'île
de Ré.
VARIÉTÉ
LA DÉGRADATION MILITAIRE
AU TEMPS JADIS
La chevalerie. - Comment on devenait chevalier. - Comment on cessait de l' être. - La dégradation du capitaine Franget. - Les armes brisées. - Conseils de guerre d' autre-fois. - Exécutions militaires. - Tout un régiment dégradé. - Les châtiments contre les lâches et les traîtres.
De même qu' on chasse aujourd'
hui de l' armée les soldats qui ont forfait à l' honneur
ou trahi la patrie, de même on chassait jadis, de l' ordre de
la chevalerie, les gentilshommes qui avaient manqué à
leur devoir, commis quelque faute grave, quelque lâcheté
ou quelque trahison. Et le cérémonial de cette dégradation
n' a guère varié depuis sept ou huit cents ans. Il est,
pour l' officier du vingtième siècle coupable de trahison,
à peu près le même que pour le chevalier du temps
de saint Louis convaincu de félonie.
La chevalerie, c' était l' armée d' autrefois. On n' y
était admis qu' à certaines conditions et après
certaines épreuves. Dès l' âge de sept ans, l' enfant
de famille noble destiné à devenir chevalier était
retiré des mains des femmes et son éducation guerrière
commençait. Le premier office qu' il remplissait était
celui de page, varlet ou damoiseau.
Les pages rendaient à leurs maîtres et à leurs maîtresses
les services ordinaires des domestiques ; ils les accompagnaient à
la chasse, dans leurs voyages, dans leurs promenades, portaient leurs
messages et même les servaient à table. Ils apprenaient
ainsi, dès l' enfance, à obéir.
A quatorze ou quinze ans, le jeune homme passait au rang d' écuyer.
On disait alors qu' il était « hors de page ». Son
père et sa mère le menaient à l' autel, où
le prêtre le ceignait d' une épée. Dès lors,
l' écuyer accompagnait son maître au combat. Sa mission
consistait à le suivre comme son ombre, à lui passer,
en cas d' accident, de nouvelles armes, à parer les coups qu'
on lui portait, à lui donner un cheval frais. Mais l' écuyer
devait se tenir toujours dans les bornes étroites de la défensive
et ne prendre aucune part active au combat.
A vingt et un ans, enfin, l' écuyer pouvait être admis
dans l' ordre de chevalerie. Il s' y préparait par des jeûnes
austères et des nuits passées en prières dans les
églises en compagnie de ses parrains. Au jour prévu, vêtu
d' une robe blanche, il se présentait à l' église
et s' avançait vers l' autel, portant son épée
passée en écharpe à son cou. Le prêtre bénissait
cette épée. Puis le néophyte allait, les mains
jointes, se mettre à genoux aux pieds de celui ou de celle qui
devait l' armer. Il jurait que ses voeux ne tendaient qu' au maintien
et à l' honneur de la chevalerie. Alors le seigneur lui donnait
sur l' épaule trois coups du plat de son épée nue,
en disant : « Au nom de Dieu, de saint Michel et de saint Georges,
je te fais chevalier... »
Cela fait, les chevaliers présents et les dames lui passaient
les pièces de son armure. On lui donnait d' abord les éperons,
en commençant par le gauche, le haubert en cotte de mailles,
les brassards et les gantelets, après quoi on lui ceignait l'
épée. On lui présentait ensuite le heaume, l' écu
et la lance et on lui amenait un cheval qu' il montait sur-le-champ.
Et, pour faire parade de sa nouvelle dignité autant que de son
adresse, il se mettait à caracoler en brandissant sa lance.
***
Mais si le chevalier se montrait infidèle à ses serments,
s' il commettait quelque action vile, quelque félonie à
l' égard de son suzerain, s' il se rendait coupable de lâcheté
au combat, s' il trahissait son pays ou la cause de son seigneur, on
le dégradait dans une cérémonie non moins solennelle
que celle où on l' avait armé chevalier, et on lui enlevait
une à une toutes les pièces de son armure, comme on enlève
aujourd' hui à l' officier coupable de trahison ses insignes
militaires et ses galons.
Oyez plutôt comment, au temps du roi François 1er, fut
dégradé publiquement, sur une place publique de Lyon,
le capitaine Franget, coupable d' avoir rendu sans combat à l'
ennemi une place de guerre dont il avait la garde.
Le capitaine Franget était un vieux gentilhomme qui passait pour
vaillant et duquel on n' eût pu attendre pareille félonie.
Le roi l' avait nommé capitaine de cinq cents hommes d' armes,
et le maréchal de Chabannes lui avait confié la défense
de Fontarabie. Cette place était solide, bien garnie d' hommes
et bien pourvue de vivres. Pourtant, lorsque le connétable de
Castille s' y présenta, Franget la lui rendit « sans avoir
soutenu aucun assaut ni fait aucun résistement, par une lâche
et honteuse capitulation ».
Or, voici comment se déroula la cérémonie de la
dégradation du capitaine félon.
D' abord, l' accusé fut traduit devant un tribunal composé
de vingt chevaliers sans reproche, auxquels son crime fut exposé
par un héraut d' armes. Sur quoi, convaincu de trahison, le capitaine
fut condamné à mort par lesdits chevaliers, et, préalablement,
il fut dit qu' il serait dégradé de l' honneur de chevalerie.
Pour l' exécution, on fit monter sur un échafaud le chevalier
condamné armé de toutes pièces comme pour un jour
de bataille. Devant lui, son écu blasonné de ses armes
était planté à l' envers, la pointe en haut. A
l' entour du coupable étaient assis douze prêtres, revêtus
de leurs surplis, qui chantaient à haute voix les vigiles des
morts. A la fin de chaque psaume, les prêtres s' arrêtaient
un instant et, pendant ces pauses, on dépouillait le condamné
de ses armes. On lui enleva d' abord son casque. Et les hérauts
criaient : « Ceci est le bassinet du traître et déloyal
chevalier. » Ils firent de même pour sa chaîne d'
or qu' ils mirent en pièces ; pour sa cotte d' armes, qu' ils
rompirent en plusieurs morceaux, pour ses gantelets, son baudrier, sa
ceinture, son épée qui fut brisée en deux tronçons,
et, finalement, pour l' écu portant ses armoiries qu' ils écrasèrent
avec une énorme masse de fer.
Après le dernier psaume, les prêtres se levèrent
et chantèrent, sur la tête du chevalier agenouillé,
le 109e psaume de David qui contient ces impitoyables malédictions
:
« Que ses enfants deviennent orphelins et que sa femme devienne
veuve ; que ses enfants deviennent vagabonds et errants, qu' ils soient
contraints de mendier et qu' ils soient chassés de leurs demeures...
» Qu' il ne se trouve personne pour l' assister, et que nul n'
ait compassion de ses orphelins ; que ses enfants périssent,
et que son nom soit effacé dans le cours d' une seule génération.
» Que son iniquité revive dans le souvenir du Seigneur...
Que sa mémoire soit exterminée de dessus la terre... »
Et, quand ces chants lugubres prirent fin, le plus ancien des juges
se leva et déclara que, par sentence des chevaliers présents,
le capitaine félon était déclaré indigne
du titre de chevalier, dégradé de noblesse et condamné
à mort.
Les chevaliers-juges descendirent alors de l' échafaud, revêtirent
des robes et des chaperons de deuil et se rendirent à l' église.
Le dégradé fut descendu ensuite au moyen d' une corde
qu' on lui attacha sous les aisselles ; on l' étendît sur
une civière et on le couvrit d' un drap mortuaire, puis on le
porta à l' église au milieu des prêtres qui chantaient
sur lui les orémus pour les trépassés.
Enfin, on le livra au prévôt au juge royal qui, lui-même,
le remit au bourreau... Et justice fut faite suivant la sentence.
L' exécution terminée, les hérauts d' armes déclarèrent,
à tous les carrefours, les enfants et descendants du dégradé
ignobles et roturiers, indignes de porter les armes et de se trouver
et paraître en joutes, tournois, armées, cours et assemblées
royales, sous peine d' être dépouillés nus et battus
de verges comme vilains et nés d' un père infâme.
J' oubliais un détail typique : le cheval du condamné,
le cheval lui-même subit une mutilation dégradante : on
lui coupa la queue et l' on en sema les poils sur un fumier...
C' est ainsi qu' on traitait les traîtres, en France, au temps
de Bayard, le bon chevalier sans peur et sans reproche.
***
Dans les siècles suivants, la cérémonie de la dégradation
se simplifia : l' élément religieux en disparut ; mais
elle demeura l' accompagnement obligé et comme le prologue de
toute peine infamante subie par les soldats et les officiers.
Dès l' année 1665, les conseils de guerre sont établis
régulièrement dans les villes de garnison. Le gouverneur
de la place en a la présidence. Il est assisté de sept
juges militaires choisis parmi les officiers et les bas officiers. L'
accusé est devant eux, assis sur une sellette s' il est passible
d' une peine afflictive ; il reste debout s' il est passible d' une
peine infamante. Pendant la lecture de la sentence, l' accusé
doit se tenir à genoux s' il est condamné à une
peine corporelle ou à la peine de mort.
Dans ce dernier cas, l' exécution est presque immédiate.
Le condamné est passé par les armes le jour même
de sa condamnation. Il n' y a ni appel ni sursis. Les troupes sont assemblées
pour la parade et la dégradation. Elles doivent garder un silence
absolu. Il leur est défendu de crier « Grâce ! »
sous peine de la vie.
Tout soldat condamné à une peine infamante doit être,
au préalable, dépouillé de sa qualité de
soldat. La formule dit : « Te trouvant indigne de porter les armes,
nous t' en dégradons. » Et un sous-officier lui arrache
ses insignes militaires et les jette à terre.
Dans son intéressant ouvrage sur l' Armée de l' ancien
régime, M. Léon Mention a noté la fréquence
de ces exécutions au cours des siècles passés.
Les brigandages sont si nombreux, les armées comptent tant de
soldats pillards que la justice militaire doit se montrer impitoyable.
Ces sacripants ne respectent rien. Une ordonnance de 1651 dénonce
des soldats qui, « portant leurs mains sacrilèges aux saints
tabernacles, ont volé les saints ciboires, jeté à
terre et foulé aux pieds les hosties avec une profanation si
abominable qu' elle serait capable d' attirer sur nous et sur notre
peuple la colère et la rigueur divines ».
Ce ne sont que « volleries, larcins, meurtres, rançonnements
et autres excès ».
« La répression de ces excès est d' autant plus
difficile que les officiers en sont parfois complices. Un arrêt
du 16 Décembre 1638 ordonne au maréchal de La Force de
casser à la tête de son armée le régiment
de Chanceaux tout entier, « tant à cause des viollences,
exactions, volleries et désordres commis par les officiers et
les soldats que par la faiblesse et le mauvais état d' icelui
(M. de Chanceaux) qui le rend du tout inutile et l' opprobre de l' armée.
»
En 1650, on est obligé, pour les mêmes raisons, de licencier
le régiment de Conti, et, comme il refuse d' obéir, il
faut armer les gardes bourgeoises pour lui courir sus et le détruire.
Heureusement, contre ces brigandages, la justice militaire est solidement
armée. Elle a à sa disposition tout un arsenal de peines
redoutables.
« Tous soldats qui s' écartent pour aller à la picorée
sont réputés vagabonds et voleurs ». Ordre aux prévôts
des maréchaux de leur courir sus au son du tocsin et de les mettre
à mort.
» Tout soldat convaincu d' avoir pris les vivres de l' hôte
chez lequel il est logé est puni de la peine de l' estrapade.
Pendu celui qui brise les meubles de son hôte, prend ses hardes
ou son argent. Pendu et étranglé celui qui malmène
femme ou fille, pille les boutiques. détrousse les vivandiers
ou les marchands ou lutte contre les prévôts et les archers
dans l' exercice de leurs fonctions. Pendus et étranglés
sur l' heure les soldats coupables d' attentats contre les prêtres,
les religieuses, les églises, et brûlés vifs s'
il y a eu profanation des objets du culte..»
Quant aux maraudeurs qui prennent les poules et les pigeons, volent
les légumes et les fruits dans les jardins, ils sont passés
par les verges.
C' est la mort pour ceux qui abandonnent leur poste en bataille ou en
marche, qui ne se rallient pas à l' enseigne en cas d' alarme,
pour les sentinelles qui s' endorment ou, abandonnent la faction. Le
soldat qui fait connaître le mot d' ordre à l' ennemi est
pendu et étranglé ; celui qui conspire contre le service
du roi et la sûreté de l' État est rompu vif.
Les châtiments ne sont pas moins sévères pour les
nobles et les officiers coupables de faiblesse, de lâcheté
ou de trahison.
« En 1636, les sieurs du Bec, gouverneur de La Capelle, et de
Saint-Léger, gouverneur du Catelet, pour avoir rendu ces places,
sont condamnés à être tirés à quatre
chevaux en place de Grève et démembrés en quatre
pièces. Ce fait, les quatre membres seront pendus et attachés
à quatre poteaux plantés sur le chemin de Picardie, hors
les portes de cette ville, leurs testes fichées au bout d' une
pique... »
» En 1629, le sieur de la Valette, atteint et convaincu d' avoir,
par lâcheté et perfidie, abandonné le service de
Sa Majesté et être sorti du royaume sans sa permission,
est condamné à avoir la tête tranchée sur
un échafaud, en place de Grève. Il est exécuté
en effigie. Même peine à un sieur Danisy, qui a rendu la
place de Lens, et au capitaine Chambor, qui a passé aux ennemis,
« le » crime estant si atroce et si notoire qu' il n' est
pas besoin d' employer beaucoup de temps pour ce vérifier ni
pour condamner le dit Chambor comme criminel de lèse- majesté.
» Les gens de naissance qui abandonnent l' enseigne au combat
sont dégradés des armes, déclarés «
ignobles », et, comme roturiers, assis et imposés à
la taille. Leurs maisons sont rasées, leurs futaies abattues,
leur blason brisé par la main du bourreau. »
Voilà quelles sévérités l' on employait
jadis à l' égard des traîtres. Ullmo peut se féliciter
de n' avoir pas vécu il y a deux ou trois siècles... Il
est probable qu' il ne s' en serait pas tiré à si bon
compte et que sa dégradation n' eût été que
le préambule d' une peine plus grave et qui ne comporte point
de pardon.
Ernest LAUT.
Le Petit Journal illustré du 21 Juin 1908