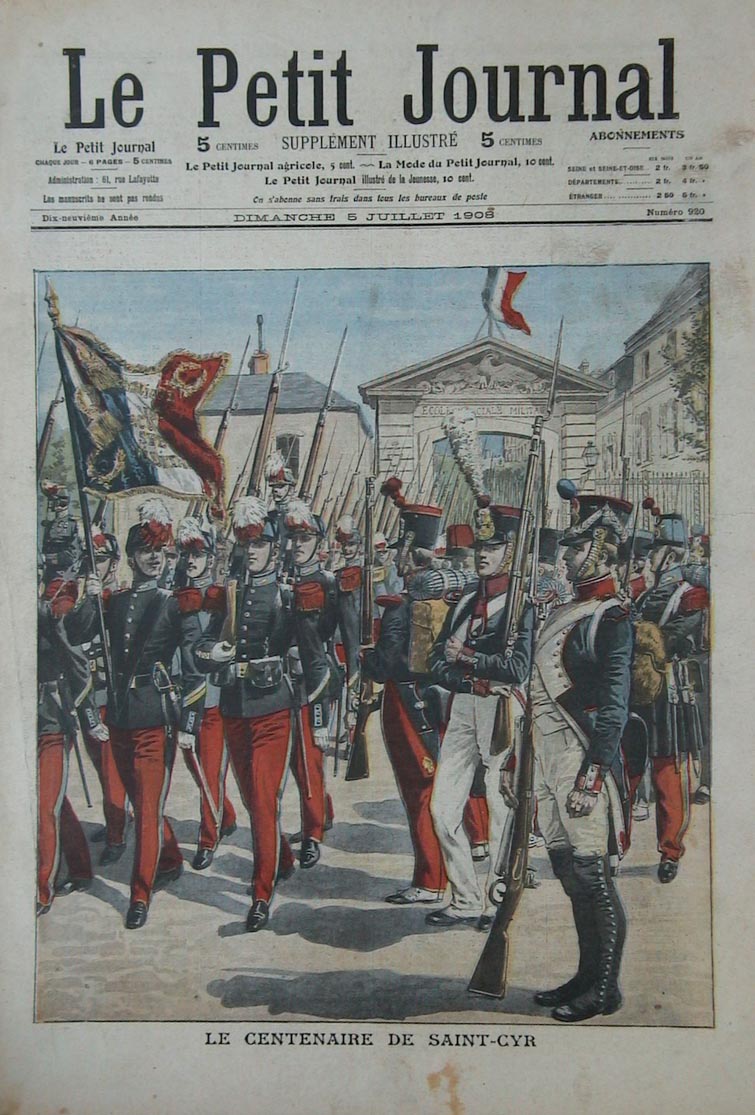LE CENTENAIRE DE SAINT-CYR
L' École de Saint-Cyr fête
le centenaire de sa fondation. A cette occasion, notre dessinateur a
réuni , dans l' intéressante gravure de notre première
page, les uniformes les plus caractéristiques que portèrent,
depuis cent ans, les soldats du premier bataillon de France et les saint-cyriens
d' autrefois, saluant le glorieux drapeau de l' École, semblent
ainsi regarder
passer les saint-cyriens d' aujourd'hui.
Nous avons, en outre, consacré notre « Variété
» aux fastes de Saint-Cyr et rappelé le souvenir des grands
faits littéraires et militaires dont l' établissement
créé par Mme de Maintenon fut le témoin. Le comité
du Centenaire de Saint-Cyr a fait frapper, pour commémorer ce
grand anniversaire, la très belle et très artistique plaquette
que nous reproduisons ; il publie, en outre, sur l' École, un
ouvrage historique du plus haut intérêt.
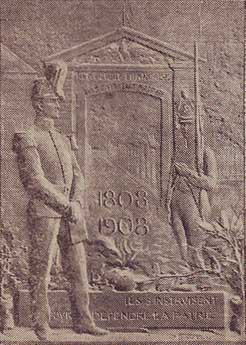
VARIETE
Les Fastes de Saint-C r y
Mme de Maintenon et la Maison des Dames de Saint-Louis. - L' éducation des jeunes filles. - Le théâtre à Saint-Cyr. - Les premières d' « Esther » et d' « Athalie ». - L' École spéciale militaire. - A quoi rêvaient les jeunes gens au temps de l' Empire. - Le centenaire de Saint-Cyr. - Un souvenir de l' abbé Lanusse.
Le nom de Saint-Cyr fut, de tout temps,
inséparable de la gloire militaire de la France. Avant d' être
la pépinière où se recrutent les officiers de notre
armée, l' école fut, durant un siècle, l' asile
réservé aux filles nobles dont les parents avaient versé
leur sang pour le pays. C' était la Maison des Dames de Saint-Louis.
Mme de Maintenon en fut la fondatrice. Par son ordre, Hardouin Mansart
éleva, en 1685, les bâtiments de l' école. Deux
mille cinq cents ouvriers furent employés à cette construction.
Un an après, la maison était en état d' être
meublée. Le roi avait pris à sa charge toutes les dépenses.
Il dota l' établissement de Saint-Cyr de revenus considérables
et décida que deux cent cinquante jeunes filles nobles y seraient
gratuitement reçues, élevées, nourries et entretenues
de toutes choses jusqu' à l' âge de vingt ans, aux dépens
de la fondation. Mme de Maintenon fut déclarée, par le
roi, supérieure perpétuelle de cette communauté
pour le temporel comme pour le spirituel.
La haine de « ce vilain hibou de Saint-Simon », comme l'
appelait Mme de Créquy, a singulièrement nui à
Mme de Maintenon dans le jugement de la postérité. L'
histoire a enregistré avec un peu trop de complaisance ses attaques
contre l' épouse morganatique de Louis XIV. On ne saurait cependant
méconnaître la belle oeuvre d' éducation accomplie
par elle à Saint-Cyr, et l' on devrait aujourd' hui encore -
aujourd' hui plus que jamais - mettre entre les mains des jeunes filles
ces entretiens, ces conversations, ces proverbes, ces lettres, toutes
ces pages écrites par la fondatrice de Saint-Cyr en vue de cultiver
l' intelligence et le coeur des jeunes pensionnaires de la maison royale.
Cette éducation-là, à coup sûr, était
préférable à celle qui nous vaut à présent
tant de bas-bleus et tant de petites « suffragettes » arrivistes
et prétentieuses.
C' était une éducation conçue dans un esprit d'
indulgence et de bonté, de simplicité et d' humilité.
Dans les préceptes qu' elle rédigea de sa main, Mme de
Maintenon recommande aux maîtresses de former à leurs élèves
« une conscience simple, droite et ouverte ».
Elles doivent, dit-elle, être toutes traitées également.
Il ne faut les distinguer que par la sagesse, sans égard au plus
ou moins de naissance, ni- aux protections qu' elles pourraient avoir,
ni aux agréments naturels.»
Il faut, ajoute-t-elle encore, les rendre simples et ingénues
à tout dire, en les reprenant avec raison et douceur ; diversifier
leurs instructions, les faire courtes et fréquentes ; les égayer
souvent ; se servir de tout, jusque dans les jeux, pour former leur
raison ; les habituer à écrire et à parler simplement
et éviter tout ce qui pourrait trop exciter leur esprit et leur
curiosité... »
Ces prétextes excellents, la fondatrice les mettait elle-même
en action. Elle paraissait souvent dans les classes, se plaisait interroger
et à instruire les élèves. Plus tard, elle les
suivait dans la vie et les aidait de ses conseils. Elle leur consacra,
pendant les quarante dernières années de sa vie, non pas
seulement toutes les ressources de sa fortune, mais encore toutes les
pensées d' un esprit vraiment supérieur.
***
Il n' y a point que de grands souvenirs d' éducation et de glorieuses
traditions militaires qui se rattachent à Saint-Cyr. Il y a aussi
d' illustres souvenirs littéraires. C' est là que, pour
la première fois, furent représentés deux des plus
beaux chefs d' œuvre de Racine : Esther et Athalie.
Les demoiselles de Saint-Cyr avaient auparavant Les demoiselles de Saint-Cyr
avaient auparavant joué Andromaque, mais Mme de Maintenon
craignait que l' interprétation de ce genre de pièces
profanes fît naître en elles des sentiments peu en rapport
avec l' éducation qu' on leur donnait. Et elle écrivit
à Racine : « Nos petites filles viennent de jouer Andromaque,
et l' ont si bien jouée qu' elles ne la joueront plus, ni aucune
de vos pièces. » Mais dans cette même lettre, elle
le priait de lui faire, dans ses moments de loisir, quelque espèce
de poème moral ou historique dont l' amour fût entièrement
banni...
Un an après, on jouait Esther sur le théâtre
improvisé de la maison de Saint-Cyr.
Mme de Caylus nous a laissé, dans ses Souvenirs le charmant
récit de cette « première » ; Mme de Caylus
fut chargée de dire le prologue sur la Piété que
Racine avait écrit pour elle.
« Jamais, dit Saint-Simon, un visage si spirituel, si touchant,
si parlant, jamais une fraîcheur pareille, jamais tant de grâce
ni plus d' esprit, jamais de créature plus séduisante.
Elle surpassait les plus fameuses actrices à jouer des comédies.
» Et Mme de Sévigné écrivait de Mme de Caylus,
quand elle joua Esther dans la suite : « Mme de Caylus fait mieux
que la Champmeslé. »
La scène avait été dressée au second étage
du grand escalier, dans un spacieux vestibule qui précédait.
les dortoirs. On avait partagé ce vestibule en deux parties,
l' une pour la scène, l' autre pour les spectateurs. Là,
deux amphithéâtres avaient été adossés
aux murs, le plus petit réservé à la communauté,
le plus grand aux jeunes pensionnaires ; les plus petites, qui formaient
la classe rouge et qui étaient âgées, de moins de
douze ans, furent placées sur les gradins d' en haut ; au-dessous
d' elles, les vertes, qui n' avaient pas encore quatorze ans ; au-dessous
des vertes, les jaunes, parmi lesquelles on était rangée
de quatorze à dix-sept ans ; enfin, sur les gradins du bas, les
plus grandes, les bleues. Entre les deux amphithéâtres
étaient les sièges pour les spectateurs du dehors.
Les habits des actrices étaient magnifiques : ils avaient coûté
plus de quatorze mille livres ; c' étaient des robes à
la persane, ornées de perles et de diamants, qui avaient servi
autrefois dans les ballets.
Lorsque le roi fut monté dans le vestibule, du théâtre,
il regarda avec satisfaction les demoiselles qui étaient rangées
sur leurs bancs, et, lorsqu' il se fût mis à sa place avec
Mme de Maintenon, qui avait un fauteuil un peu en arrière pour
être à portée de répondre à ses questions,
le spectacle commença.
Le succès de la première représentation enchanta
le roi, qui trouva la pièce admirable. Trois jours après,
il fit donner une seconde représentation, où furent conviés
les princes et les plus grands personnages de la cour. D' autre représentations
eurent lieu. On joua Esther tout l' hiver. Si bien, dit Mme
de Caylus, « que cette pièce, qui devait être renfermée
dans Saint-Cyr, fut vue plusieurs fois du roi et de toute la cour, toujours
avec le même applaudissement ».
Il n' y avait pas d' amour dans la pièce cela n' empêcha
pas certaines interprètes d' en inspirer aux spectateurs. Mlle
de Marsilly parut si gracieuse au marquis de Villette dans le rôle
de Zarès qu' elle jouait, qu' il s' éprit d' elle follement
et l' épousa peu après.
L' année suivante, une autre jeune actrice de Saint-Cyr, Mlle
de Saint-Osmane, qui tenait, elle aussi, un rôle dans Esther,
inspira une folle passion à un jeune page. L' amoureux imprudent
lui fit connaître sa flamme en lui adressant des billets par l'
entremise de l' un des machinistes du théâtre: Elle y répondit.
Mais on découvrit l' intrigue et Mlle de Saint-Osmane fut mise
en un couvent bien clos où l' on ne jouait pas, hélas
! la tragédie et dont les galants ne pouvaient approcher.
Cet incident excita la bile des dévôts. Ils protestèrent
violemment contre les représentations de Saint-Cyr et parvinrent
à les faire supprimer, bien que jamais la décence n' eût
cessé d' y régner. Il fut cause aussi du peu d' apparat
avec lequel, en 1691, on joua Athalie. Les représentations
de cette tragédie eurent lieu dans une classe, sans décorations
et sans costumes. Ainsi l' avait voulu Godet Desmarais, l' évêque
de Chartres. Et Mme de Maintenon n' avait point osé résister
aux scrupules du prélat.
***
La Révolution supprima Saint-Cyr
et profana de tombeau de la fondatrice de l' établissement. Les
bâtiments d' Hardouin Mansart furent transformés en hôpital
militaire, puis en un hôtel d' invalides, enfin, en une école
militaire nommée le Prytanée français.
Le 24 Mars 1808, un décret de Napoléon Ier transférait
ce prytanée à La Flèche et plaçait à
Saint-Cyr l' école spéciale militaire qui existait auparavant
à Fontainebleau. Depuis lors, l' École a pris une importance
prépondérante dans de recrutement de nos officiers d'
infanterie et de cavalerie, et Saint-Cyr se glorifie justement d' avoirs
fourni à l' armée la plupart de ses illustrations.
Sous l' Empire, le fonctionnement de l' école fut assez irrégulier
; les études ne s' achevaient guère ; des réquisitions
anticipées réclamaient sans cesse les élèves
officiers pour les besoins de la guerre. Mais que d' admirables soldats
en sortirent !
C' était cette génération belliqueuse dont parle
Alfred de Vigny, cette génération qui. « nourrie
de bulletins par l' empereur, avait toujours devant les yeux une épée
nue ». Les enfants, alors, ne rêvaient que gloire et combats.
Dès le collège, ils songeaient à la carrière
militaire. N' avaient-ils pas, pour les entraîner, l' exemple
de tous ces fils du peuple devenus généraux, maréchaux
d' empire, et qu' ils voyaient passer, fiers et superbes, caracolant
dans le cortège éblouissant du nouveau César ?...
« Notre but, écrit le général de Brack, c'
était la gloire. Il était vaste, ce but, comme l' époque
immense à laquelle vivait notre jeunesse, et cette ambition était
permise à une carrière si chanceuse où, chaque
jour, la mort et la gloire pesaient également dans la balance.
»
Être officier... tel était le rêve de tout jeune
Français... « Tout soldat, dit le général
Foy, sachant lire et écrire, exerçant sur ses camarades
une influence quelconque d' opinion, et qui ne sourcillait pas à
l' approche du danger, était sûr d' arriver, si la mort
lui en laissait le temps... Être officier, c' était alors
être homme de qualité devant l' habit militaire, tout.
s' inclinait devant la. gloire militaire, toutes les autres gloires
s' agenouillaient et se reconnaissaient vassales... »
On conçoit que Saint-Cyr ait exercé sur toutes ces jeunes
imaginations un attrait irrésistible. Malheureusement, les élèves,
en ce temps-là, n' avaient pas le temps de parfaire leur éducation,
qu' il leur fallait aussitôt se mettre en route pour l' armée.
En 1807, l' École fut à peu près vidée par
les réquisitions. Sur tous les champs de bataille de l' Empire
les anciens de Saint-Cyr se couvrirent de gloire. En 1814, les élèves,
formés en bataillons, firent bravement leur devoir. Ils se distinguèrent
sur tout à Montereau et à Nemours.
La Restauration essaya vainement de désorganiser l' École
et d' en faire une institution nobiliaire. Saint-Cyr, forte de ses traditions
consacrées déjà par tant d' héroïsme,
résista. L' École suivit ses destinées.
Son histoire ne saurait être ici résumée. C' est
celle de nos conquêtes et de nos gloires, de nos triomphes et
de nos douleurs. Dans toutes les campagnes de l' armée française
depuis un siècle, Saint-Cyr a eu sa large part d' héroïsme.
On sait quels services rendirent les élèves officiers
en 1870 et avec quelle vaillance ces jeunes gens menèrent parfois
les vieux soldats au feu...
***
Saint-Cyr, aujourd' hui, fête
l' accomplissement de son premier siècle d' existence. Tous ceux
qui ont passé par l' École s' associeront du fond du coeur
à la célébration de cet anniversaire. Mais plus
d' un regrettera qu' un homme ne soit plus là pour s' y associer
avec eux, un homme qui a passé plus d' un tiers de siècle
à Saint-Cyr et qui a aimé l' École par-dessus tout,
le digne abbé Lanusse, mort deux ans et demi trop tôt pour
jouir de cette grande joie.
Fils d' un soldat du Premier Empire, ce prêtre avait une âme
de soldat. Il contait aux jeunes gens de Saint-Cyr les histoires des
vieux grognards qu' il avait connus dans son enfance. Il leur disait
la fin de son voisin Penoul, l' ancien tambour des grenadiers de la
garde qui avait reçu ses baguettes d' honneur au pied des Pyramides,
des mains de Bonaparte.
Quand Penoul se sentit mourir, leur contait-il, il appela sa femme
- Femme, lui dit-il, apporte-moi mes baguettes d' honneur !
Il prit les baguettes et les approcha de ses lèvres.
- Femme, apporte-moi ma croix d' honneur !
Il la prit, la regarda et la baisa plusieurs fois... Une gravure, placée
en face de son lit, représentait Napoléon Ier en redingote
grise.
- Femme, apporte-moi l' empereur !
Il demanda qu' on le dressât sur son lit, ôta son bonnet
et colla ses lèvres sur l' image sacrée. Et puis retomba
:
- Maintenant, je peux mourir, dit-il.
Et quand l' abbé Lanusse avait conté de ces belles histoires
aux saint-cyriens, il leur disait encore :
- Comme vos pères, vous voulez la grandeur de notre patrie bien-aimée.
Comme eux, vous voulez des victoires. Sachez le bien : pour des victoires,
il faut des dévouements et des courages. Il ne faut pas que chacun,
dans l' armée, cherche à avoir la place la plus commode
et la moins périlleuse. En un mot, il faut des hommes de sacrifice,
ce qui signifie des hommes de devoir...
C' était un vrai troupier sans peur et sans reproche. Il avait
pris part à maintes campagnes. Il avait été en
Crimée, au Mexique, à Mentana, à l' armée
du Rhin, à l' armée de la Loire, à l' armée
de l' Est, à l' armée de Paris en 1870-1871. Il allait
sur le champ de bataille, dans la boue sanglante, parmi les râles.
Il allait vers qui appelait, se penchait sur les blessés, les
soignait, les réconfortait et donnait aux mourants les suprêmes
consolations.
-Après la guerre fatale, on. le nomma aumônier de Saint-Cyr.
Il y demeura trente-quatre ans et vit passer dans les vieux bâtiments
de Mme de Maintenon plus de dix mille élèves qui, tous,
de quelque religion qu' ils fussent, n' eurent pour lui que respect
et admiration.
Lorsqu' il fêta ses noces d' argent avec l' École de Saint-Cyr,
le général de Monard, qui y commandait à cette
époque, publia un ordre du jour dans lequel il disait de lui:
« Gaîté et loyauté, délicatesse et
élévation des sentiments, esprit militaire, culte du drapeau,
patriotisme ardent, une parole chaude au service d' une intelligence
d' artiste, toutes les vertus sacerdotales, autant de moyens d' action
que M. l' abbé Lanusse, avec un tact parfait, a su mettre en
oeuvre pour le bien de chacun et pour le renom de l' École. »
Les anciens saint-cyriens n' ont certes point oublié le vénérable
aumônier. Et je gagerais que, le jour de la fête du centenaire
de l' École, plus d' un donnera une pensée émue
à la mémoire de l' homme de bien qui joignait, dans une
âme profondément française, la charité, du
prêtre à l' héroïsme du soldat.
Ernest LAUT
Le Petit Journal illustré du 5 Juillet 1908