LA FRANCE PROTÈGE LE DRAPEAU NATIONAL CONTRE L'ANTIPATRIOTISME
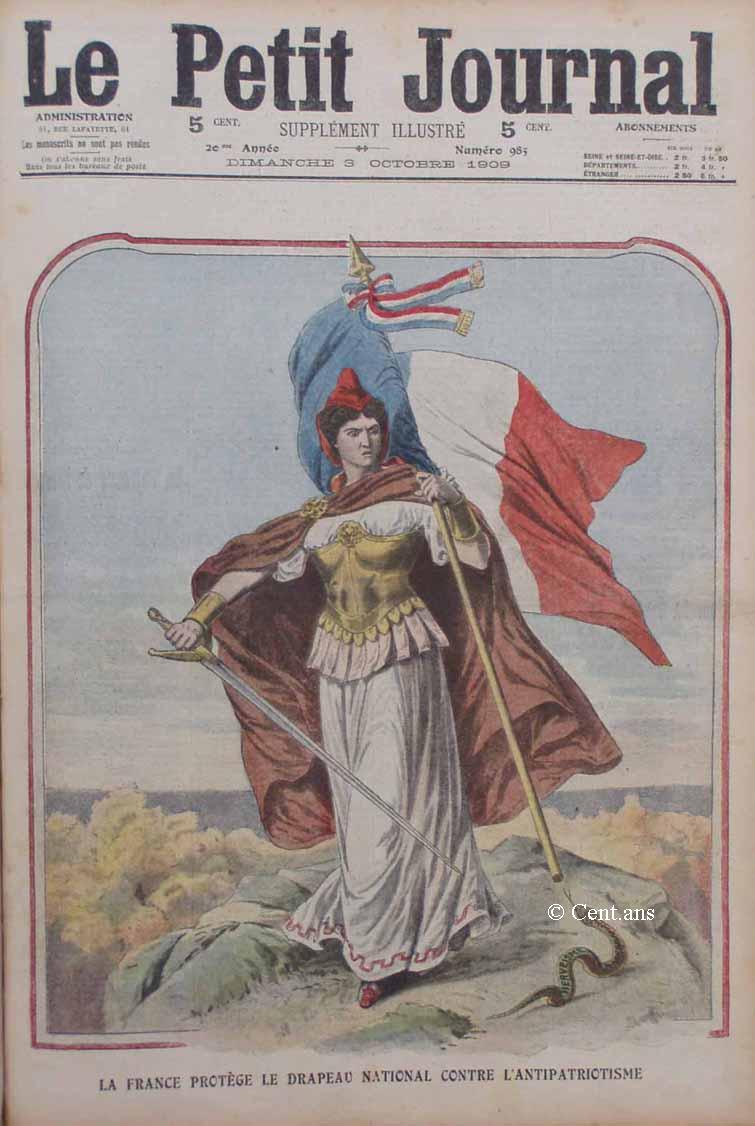
On sait quelle indignation a jailli de tous les coeurs à la nouvelle
que le drapeau d'un de nos régiments avait été
souillé. L'amour du drapeau qui anime tous les bons Français,
s'est manifesté à cette occasion avec un élan passionné.
C'est ce sentiment que nous avons voulu symboliser dans notre gravure,
où l'on voit la France émue et grave tenant haut et ferme
le drapeau dont la vipère hervéiste essaie en vain de
mordre la hampe.
Nous avons voulu, en outre, consacrer notre « Variété
» à l'histoire du drapeau et publier quelques-unes des
plus belles pièces de la littérature, en vers et en prose,
inspirées par les couleurs nationales.
Nos lecteurs jugeront à coup sûr que c'est là la
meilleure réplique à faire aux attaques d'une poignée
d'anarchistes et de fous.
VARIÉTÉ
Pour la défense et l'amour du Drapeau
Réponse à un acte abominable et à d'odieuses paroles. - Histoire du symbole de la patrie. - Le drapeau inspirateur d'héroïsme.- Cent vingt blessures. - Un trait de générosité. - Comment on inculque à la jeunesse l'amour du drapeau. - Une campagne infâme.
Fanatisé sans doute par
les exhortations des sans-patrie, un misérable, ayant volé
dans une caserne le drapeau d'un de nos régiments, a commis cet
acte abominable et stupide de jeter aux latrines le symbole de la France.
Crime anonyme dont la lâcheté a soulevé l'indignation
du pays tout entier.
Mais, ce qui est pis, c'est que, quelques jours plus tard, il s'est trouvé
deux hommes de nationalité française pour exalter, dans
une réunion publique, cette action révoltante et pour déclarer,
le premier : « Je suis ravi qu'on ait fait subir au drapeau français
les derniers outrages » ; et le second : « Il faut souiller
la patrie comme on a souillé le drapeau du 334e ».
A cet acte criminel, à ces paroles infâmes, il n'est qu'une
réponse à faire : c'est de rappeler les hauts faits d'héroïsme
inspirés aux Français d'autrefois et de naguère par
le culte de la patrie et l'amour du drapeau.
Mais le seul récit de ces hauts faits emplirait un volume. Tâchons,
du moins, de résumer ici les plus caractéristiques et les
plus glorieux.
***
Qu'est-ce que le drapeau ?... C'est le vivant symbole de la patrie. Le
général Aubert disait :
« Le drapeau, c'est le clocher du village, il abrite le régiment
; on vit sous son ombre et sous son ombre on meurt. Dans ses plis glorieux,
il renferme l'honneur de la France. Il est le point lumineux où
se rencontrent tous les regards. Loin de la famille et de la patrie, il
rappelle la famille et la patrie ; il est la relique, il est l'arbre généalogique
du régiment. »
Et il ajoutait :
« Pour ces hommes, si divers, qui composent une armée, hommes
venus de pays lointains, parlant vingt langues différentes, professant
plusieurs religions, appartenant à des races tranchées,
les uns doctes, les autres ignorants, il
est un symbole qui les réunit en un seul faisceau, qui parle à
leurs coeurs une langue universelle, c'est le drapeau !... »
C'est pourquoi le drapeau existait avant même que se fît jour
chez les peuples le sentiment de la patrie. L'origine de ce symbole national
se perd dans la nuit des temps ; et, à toutes les époques,
le drapeau a suscité les mêmes enthousiasmes et les mêmes
dévouements.
Le mot relativement moderne, nous vient d'Italie. Il fut, paraît-il,
rapporté en France par les soldats de Charles VIII. Mais la chose
est fort ancienne. Tous les peuples avaient, lorsqu'ils partaient en guerre,
leurs enseignes fixées au bout de hampes, afin qu'elles fussent
vues et suivies par la foulé des guerriers. Le plus souvent cette
enseigne était la représentation de quelque animal symbolique.
Les Israélites avaient le lion ; les Égyptiens, l'ichneumon
; les Chaldéens, la colombe ; les Athéniens, la chouette
; les Romains, l'aigle ou la louve ; les Gaulois, le sanglier.
Autour de ces figures sculptées, ou brodées sur des étoffes,
les combattants se ralliaient sur le champ de bataille. C'étaient
là des équivalents de notre drapeau d'aujourd'hui.
Quelle merveilleuse histoire serait celle de ce symbole national de la
France, depuis la chape de Saint-Martin qui menait au combat les soldats
de Clovis jusqu'à nos trois couleurs !
Gonfalons du temps de Charlemagne, bannières de Saint-Louis, oriflammes
des Valois, cornettes blanches de Henri IV, drapeaux fleurdelisés,
étendards aux angles tricolores des demi-brigades, aigles du premier
Empire, drapeaux d'à présent aux trois couleurs égales,
furent tour à tour, pour nos soldats de France, l'emblème
sacré que l'on défend jusqu'à la mort.
Sauver le drapeau, l'empêcher de tomber dans les mains ennemies,
tel doit être le but suprême du soldat dans la bataille.
Et combien de Français se couvrirent de gloire, combien firent
héroïquement le sacrifice de leur vie pour remplir ce but
sacré !
A Mons-en-Puelle, le vaillant chevalier Auseau de Chevreuse est trouvé
mort tenant encore l'oriflamme dans ses bras.
A Hoclhstedt, le régiment de Navarre, forcé de capituler,
détruit ses drapeaux plutôt que de les livrer à l'ennemi.
A Rivoli, le sergent Bernard, du 14e de ligne, voyant le drapeau de sa
demi-brigade enlevé par les Autrichiens, se précipite, leur
reprend le trophée et tombe frappé de vingt blessures en
criant à ses camarades : « Mes amis, sauvez le drapeau et
je meurs content.''
Les mêmes sentiments patriotiques animent nos soldats et nos marins.
Le 1er juin 1794, le Vengeur sombre glorieusement. Avant qu'il
disparaisse dans les flots, les matelots
ont grimpé à la pointe des mâts et cloué le
pavillon tricolore pour empêcher les ennemis de s'en emparer. C'est
le dernier acte de leur héroïque résistance que Lebrun
a retracé dans une ode vibrante :
Voyez ce drapeau tricolore
Qu'élève en périssant leur courage indompté:
Sur le flot qui le couvre, entendez- vous encore
Ce cri : «Vive la Liberté !»
***
Napoléon savait entretenir dans les régiments le culte du
drapeau. Ses soldats avaient pour leurs aigles un attachement passionné.
On vit des régiments qui avaient perdu leur étendard se
faire hacher dans un héroïque désespoir.
Tel le 4° de ligne. Ce régiment, à Austerlitz s'était
laissé enlever son aigle. Les soldats, fanatisés par cette
perte, avaient accompli des prodiges de valeur et avaient pris six drapeaux
à l'ennemi. Cependant, l'empereur passant le lendemain devant le
front du régiment, s'écria :
- Soldats, qu'avez-vous fait de l'aigle que je vous avais donnée
?...
Le colonel, sans répondre, s'approcha et lui présenta les
six drapeaux pris aux Russes et aux Autrichiens.
- Je sais bien, reprit Napoléon, que vous n'avez par été
des lâches, mais vous avez pu être imprudents ; ces six drapeaux
ne me rendent pas mon aigle.
A la bataille suivante, le régiment se faisait décimer pour
conquérir un nouveau drapeau.
M. Désiré Lacroix qui, dans son « Histoire anecdotique
du drapeau français » a rapporté ce trait, reproduit
également un passage du vingt-cinquième bulletin de la Grande-Armée
dans lequel l'empereur dépeint la joie éprouvée par
un autre régiment, le 76° de ligne, retrouvant à Inspruck
deux drapeaux qu'il avait perdus au cours d'une campagne précédente.
« Les deux drapeaux que le 76e de ligne avait perdus dans les Grisons,
ce qui était pour ce corps le motif d'une affliction profonde,
ces drapeaux, sujets d'un si noble regret se sont trouvés dans
l'arsenal d'Inspruck : un officier les a reconnus ; tous les soldats sont
accourus aussitôt. Lorsque le maréchal Ney les leur a fait
rendre avec solennité, des larmes coulaient des yeux de tous les
vieux soldats. Les jeunes conscrits étaient fiers d'avoir servi
à reprendre ces insignes enlevés à leurs aînés
par les vicissitudes, de la guerre...»
Et l'empereur conclut :
« Le soldat français a pour ses drapeaux un sentiment qui
tient de la tendresse ; ils sont l'objet de son culte, comme un présent
reçu des mains d'une mère. »
Et c'est là ce qui explique tant de
traits d'héroïsme, tant de sacrifices accomplis pour sauver
le drapeau en péril. En pareil cas, il n'est point de dangers qui
comptent pour un soldat français.
Rappelez-vous, dans le récit de la bataille de Solférino,
l'histoire du drapeau du 91e de ligne. Ce régiment occupait un
plateau après en avoir délogé une batterie ennemie.
Le sous-lieutenant Groiseul venait de planter le drapeau au sommet du
mamelon quand des réserves autrichiennes opérèrent
tout à coup un retour offensif. L'officier porte-drapeau, atteint
par une balle, tombe grièvement blessé. Un de ses camarades,
le sous-lieutenant Follet, ramasse le drapeau dont la mitraille à
brisé la hampe ; mais lui-même est frappé à
mort. Alors, le sergent Bourraqui prend le drapeau des mains du mourant
: il est blessé à son tour. Mais les débris du régiment
parviennent à se rassembler ; une lutte corps à corps s'engage
; l'ennemi est repoussé : le 91e a sauvé son drapeau.
Notre histoire militaire abonde en épisodes de ce genre. Que de
fois l'héroïsme des régiments s'inscrivit en traces
glorieuses sur les drapeaux !... Citons un seul exemple, celui du drapeau
de Mazagran.
Aucun Français n'a oublié la défense fameuse que
cent vingt-trois soldats de la 10e compagnie du 1er bataillon d'infanterie
légère d'Afrique opposèrent, en 1840, à plus
de 8.000 Arabes dans ce petit village de Mazagran. Cette poignée
de héros, sous les ordres, du capitaine Lelièvre, tint pendant
cinq jours et quatre nuits contre les attaques sans cesse renouvelées
de l'ennemi. Le drapeau arboré sur le fortin où ces héros
s'étaient réfugiés fut à plusieurs reprises
abattu par les projectiles des assaillants. Chaque fois il fut relevé,
et jusqu'au bout il flotta sur la redoute. Enfin, la garnison de Mostaganem
vint délivrer les assiégés.
On compta alors les blessures du glorieux étendard. Elles étaient
au nombre de cent vingt-sept. Le drapeau de Mazagran avait reçu
cent vingt balles et quatre boulets ; sa hampe avait été
brisée trois fois.
En 1870, enfin, on sait comment plusieurs de nos généraux
de l'armée de Sedan se refusèrent à livrer leurs
drapeaux à l'ennemi et préférèrent les brûler
que de les voir tomber entre les mains des Prussiens.
La gravure a popularisé le fait. Tout le monde se rappelle l'impressionnant
tableau dans lequel le général de Lapasset est représenté
assistant sombre et tragique à la destruction des drapeaux de sa
brigade.
Les drapeaux de la division du général de Laveaucoupet furent
également brûlés.
D'autres, notamment ceux du 1er grenadiers et des zouaves, furent détachés
de la hampe, découpés, et les
officiers et les soldats s'en partagèrent les morceaux qu'ils gardèrent
pieusement, comme les reliques de la patrie vaincue.
Et les hommes pleuraient en recevant ces lambeaux du drapeau sous lequel
ils avaient si vaillamment combattu.
L'amour du drapeau, c'est un sentiment profondément ancré
au cœur de tous les peuples qui ont une fierté nationale et
des traditions. Et c'est un sentiment qui, non seulement crée l'héroïsme,
mais aussi la générosité. Qu'on en juge par cet épisode
peu connu de la bataille de Waterloo.
C'était à l'attaque de la ferme d'Hougoumont, au début
de la lutte de géants qui se déroula le 18 juin 1815 dans
les plaines de Waterloo : une rafale de mitraille abat le porte-aigle
du 10° léger avec la garde du drapeau. Le régiment est
forcé de battre en retraite. Mais, la fumée dissipée,
le colonel Cubières, qui commande le 10° léger, voit
le drapeau de son régiment gisant à terre auprès
de l'officier mort. Or, une colonne anglaise s'avance : le drapeau va
être pris par l'ennemi. Le colonel n'hésite pas. Il s'élance
seul pour reprendre son aigle et l'officier anglais, qui commande la colonne
ennemie, témoin de cet acte d'héroïsme, fait aussitôt
cesser le feu pour permettre au colonel Cubières d'aller ramasser
son aigle.
N'est-ce pas admirable, au milieu d'une bataille, ce trait de vaillance
d'une part, ce trait de générosité de l'autre, tous
deux inspirés par l'amour et le respect du drapeau ?
***
Cet amour et ce respect, c'est là ce qu'il faudrait inculquer dès
l'enfance aux citoyens.
En maints pays, le drapeau national est arboré dans les écoles
au-dessus de la chaire du maître. C'est sous son égide qu'on
élève et qu'on éduque les générations.
Aux Etats-Unis, dans les classes, on chante chaque jour des chants patriotiques.
Une loi de l'État de New-York exige que le drapeau flotte durant
les heures d'étude à l'intérieur et à l'extérieur
des bâtiments scolaires. Chaque matin, on adresse un salut au drapeau,
et tous les enfants répètent devant lui une formule de fidélité.
Les autorités américaines assurent que ces cérémonies
impressionnent même les enfants de nationalité étrangère,
qui deviennent bientôt aussi fiers de l'Amérique et de sa
liberté que ceux qui sont nés en Amérique.
En Angleterre, la glorification du drapeau national est aussi un thème
fréquemment développé dans les écoles. Et
cet enseignement n'est point perdu, si l'on en juge par ce trait de courage
et d'abnégation qu'accomplirent de jeunes soldats anglais et dont
la presse fit dernièrement le récit :
Un violent incendie venait d'éclater à la caserne du 4°
bataillon de fusiliers royaux, à Mullingar, et déjà
le mess des officiers était en flammes.
Plusieurs hommes s'élancèrent pour sauver le drapeau du
bataillon, qui y était déposé. Ils furent tous cruellement
brûlés, et l'un d'eux, nommé Inglefield, reçut
de telles blessures qu'il ne tarda à mourir. Mais le drapeau avait
pu être retiré des flammes.
Quant à l'Allemagne, on sait de quelle solennité elle entoure
le serment de fidélité prêté par les recrues
au drapeau.
Ainsi, tandis qu'à travers les siècles et chez tous les
peuples, le respect du drapeau demeurait la vertu primordiale, il s'est
trouvé chez nous, en ces dernières années - et rien
que chez nous, hélas ! - des hommes pour oser insulter à
ce sentiment et cracher le mépris sur cet emblème sacré...
Alors qu'au passage du drapeau dans nos villes et nos villages, tous,
d'un mouvement spontané, se découvrent, on vit. un jour,
au scandale général, un représentant du peuple rester
obstinément couvert ; alors que tous ceux qui ont au coeur l'amour
du sol natal ne parlent du drapeau qu'avec enthousiasme et vénération,
on a entendu un homme, qui fut un éducateur de la jeunesse, M.
Hervé, déclarer que l'on devrait « planter le drapeau
français dans le fumier ».
Et, depuis lors, cet homme continue librement sa campagne abominable d'injures
contre le symbole national, d'outrages contre la patrie.
Cette campagne n'a entraîné, il est vrai, qu'une infinie
minorité d'anarchistes. De tels actes et de telles paroles que
la démence et la haine seules peuvent inspirer, ne sauraient trouver
d'écho dans un pays de saine raison.
L'amour de la patrie demeure en France assez puissant pour garantir l'attachement
au drapeau. Nous ne sommes point assez oublieux de notre passé
pour renier ce symbole qui flotta tour à tour sur nos splendeur
et sur nos ruines; et pour ne point nous souvenir que, suivant un mot
célèbre, « le drapeau de la France a fait le tour
du monde avec nos gloires et nos libertés ».
Ernest Laut.
Le Petit Journal illustré du 3 Octobre 1909