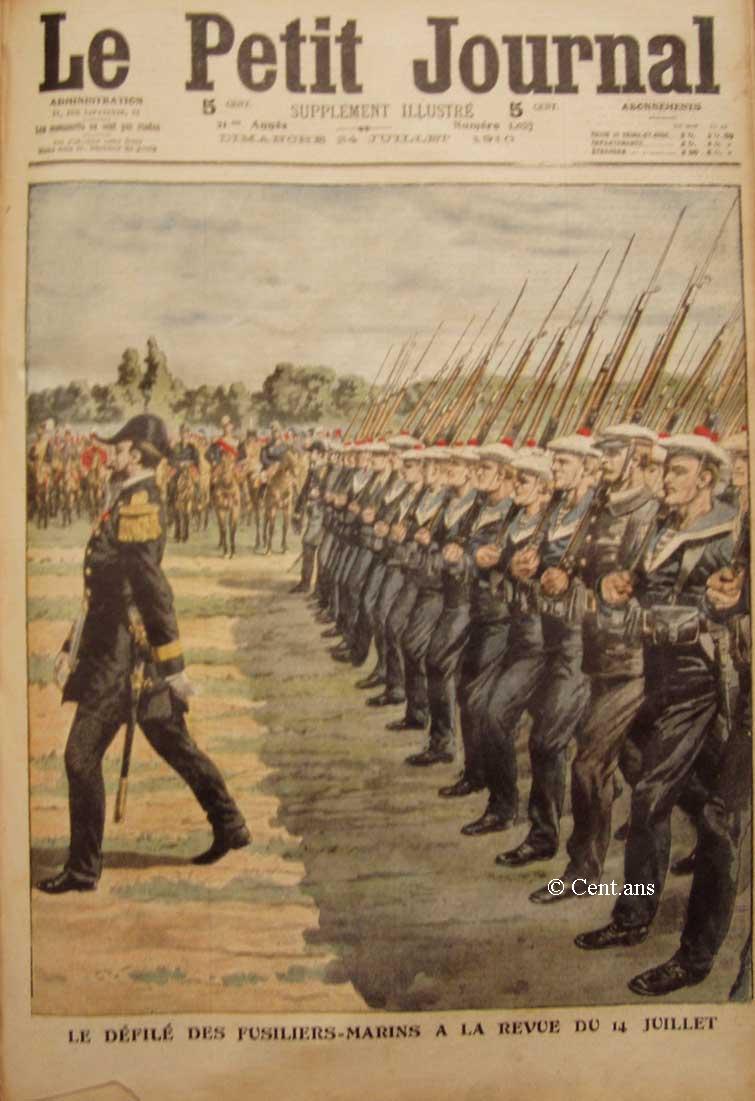LE DÉFILÉ DES FUSILIERS MARINS A LA REVUE DU 14 JUILLET
L'amiral de Lapeyrère a eu l'heureuse idée
d'associer la marine à la revue de Longchamp. Les Parisiens ont
vu défiler à la revue, au milieu des troupes métropolitaines
et coloniales, un bataillon de fusiliers marins, avec leur artillerie
de campagne et leur matériel de débarquement. Ce n'est
pas la première fois que le fait se produit : il y a une vingtaine
d'années, les marins ont paru, à la revue mais la tradition
s'en était perdue. Espérons que, cette fois, elle sera
conservée.
Nos braves mathurins ont reçu un accueil enthousiaste. Même
après quarante ans passés, Paris n'a pas oublié
quelle part glorieuse les fusiliers marins ont prise à sa défense
en 1870-71 ; il sait l'héroïsme qu'ils ont déployé,
Bretons, Normands, Provençaux; pendant le terrible bombardement
qu'eurent à subir les forts de la capitale et dans les divers
combats livrés sous les murs de la place, au Bourget, où
le corps de marine engagé fut presque anéanti, au plateau
d'Aviron, à Saint-Denis, à Châtillon.
Le bataillon qui défila le 14 juillet venait de Lorient ; il
comprend quatre cents hommes et est sous les ordres du capitaine de
frégate André Fouet, un brave qui a fait brillamment ses
preuves dans la dernière campagne du Maroc.
VARIÉTÉ
LA SAISON DES EAUX
Triste saison. - Stations thermales d'autrefois. - Renaissance des villes d'eaux au XVIIe siècle. - L'attrait du jeu. - Les plaisirs de Bade. - Une eau qui fait engraisser ou maigrir au choix.
Peut-on dire que la saison des eaux bat son
plein ? Le cliché, cette année, ne s'impose guère.
A la vérité, la saison des eaux est languissante. De toutes
nos stations thermales, les plaintes affluent contre le mauvais temps
qui retient les baigneurs au logis. Les eaux célestes font tort
aux eaux minérales. Il a tant plu, il a fait si froid que beaucoup
d'égrotants n'ont pas osé quitter le coin de leur feu
pour aller chercher au loin, sinon la santé, du moins l'espoir
de quelque adoucissement à leurs souffrances.
Or, savez-vous qu'il y a en France 392 établissements thermaux
où l'on soigne toutes les maladies qui désolent notre
pauvre humanité. Tel est le chiffre que nous donne la dernière
statistique, laquelle nous apprend encore qu'on exploite dans ces établissements
1,927 sources, dont 784 ne sont utilisées qu'en boisson, 396
en boisson et en bains, et 243 consacrées exclusivement à
ce dernier usage.
La statistique ajoute que les départements les mieux partages
au point de vue thermal sont : le Puy-de-Dôme, les Vosges, l'Ardèche
et les Pyrénées-Orientales ; le premier a 94 sources,
le dernier 54.
Vous jugez quel concert de malédictions s'élève
de ces trois cent quatre-vingt-douze stations thermales contre l'inclémence
du temps et la trop grande abondance des célestes cataractes.
Car il n'y a pas que les établissements thermaux qui souffrent
de cette température anormale : il y a les hôtels; les
casinos et tout le commerce de ces villes qui vivent uniquement des
baigneurs et doivent faire en quatre mois le profit de leur année.
L'industrie balnéaire représente aujourd'hui des intérêts
considérables. Tout le monde va peu ou prou dans les villes d'eaux
ou aux bains de mer. La facilité des communications a développé
le goût de ces villégiatures. A la veille de la Révolution,
on mettait dix-sept jours pour se rendre dans les villes d'eaux des
Pyrénées.
Quelques heures suffisent aujourd'hui, et le coût du voyage est
dix fois moindre qu'il y a cent vingt ans.
Il est vrai que le séjour est dix fois plus coûteux qu'alors.
On vivait à peu près pour rien dans les stations balnéaires
françaises éloignées de Paris... Nous sommes loin,
hélas ! du temps où Mme de Sévigné écrivait
de Vichy à sa fille qu'elle achetait « deux poulets pour
trois sols. » et que le reste était en proportion. La vie
aux eaux est ruineuse aujourd'hui, et elle le sera d'autant plus que
le mauvais temps, comme il est advenu cette année, rendra la
saison favorable plus courte, et que les tenanciers d'établissements
thermaux, de casinos, d'hôtels, auront moins de temps pour tirer
le profit qu'ils escomptent de leurs exploitations.
***
La mode des saisons thermales n'est point, comme d'aucuns se l'imaginent,
une pratique de notre civilisation moderne. Elle remonte même
plus haut, beaucoup plus haut que le XVIIe siècle, qui en vit,
non point la naissance, mais la renaissance.
Nos lointains ancêtres les Gaulois appréciaient la vertu
des eaux thermales et la mettaient à profit. Ils connaissaient
la plupart des stations aujourd'hui célèbres et en fréquentaient
même quelques autres qui disparurent au cours des siècles
par suite de catastrophes naturelles : tremblements de terre, éruptions
de volcans, avalanches, etc., et aussi par le fait du vandalisme des
hommes.
L'invasion des Romains en Gaule ne fit qu'y développer l'exploitation
des eaux thermales. Les conquérants apportaient aux vainqueurs
leurs connaissances sur la matière. Depuis longtemps, en effet,
les sources d'Italie étaient scientifiquement exploitées.
Des archéologues ont recherché par toute la France thermale
les traces de nos ancêtres. Ces traces sont nombreuses. Les Romains
connurent Uriage, Aix-les-Bains, Plombières, Luxeuil, Bourbonne,
maintes autres stations encore, que les Gaulois, d'ailleurs, avaient
fréquentées avant eux.
Certaines de ces stations étaient même, à l'époque
gauloise, le siège d'un culte spécial en l'honneur de
divinités qui, dans le panthéon de nos ancêtres,
symbolisaient l'influence bienfaisante des eaux thermales. Le docteur
P. Rodet, dans un savant travail sur ce sujet, nous dit que la principale
de ces divinités était un dieu nommé Borvo, du
celtique Berw, qui signifie « bouillant ».
Borvo, devenu Borm en latin, était adoré à Aix-les-Bains,
à Aix-en-Provence, Bourbon, Bourbonne, la Bourboule sont autant
de noms de lieux dérivés du nom du dieu Borm ou Borvo.
Une cure thermale se doublait alors d'un acte religieux. On invoquait
la divinité tout en utilisant les eaux sur lesquelles s'étendait
sa protection. Dans l'espoir de la guérison, on dédiait
au dieu des inscriptions louangeuses et on lui faisait des offrandes
votives, statuettes, pièces de monnaie, etc. C'est ainsi qu'on
a retrouvé dans le fond d'un grand nombre de piscines antiques
tant de souvenirs du passé. C'étaient les ex-voto que
les égrotants jetaient dans la source en offrande au dieu pour
se le rendre favorable.
MM. Bonnard et Percepied, deux archéologues qui ont, dans un
ouvrage sur la « Gaule thermale », dressé la liste
des sources et stations thermales et minérales de la Gaule à
l'époque gallo-romaine, signalent ce fait curieux que certaines
des stations les plus fréquentées par les Romains sont
aujourd'hui tout à fait secondaires, et qu'il en est même
qui ont totalement disparu.
Ainsi, Moind, près de Montbrison, était une station à
la mode. Il y avait un théâtre, une immense hôtellerie,
dont on a retrouvé les ruines. Les thermes avaient une importance
considérable. Et tout autour se développait une grande
ville pleine de monuments. C'était là, assure un historien
de cette localité aujourd'hui réduite à l'état
de bourgade, un peu ce qu'était Baïes pour Rome, une ville
de plaisir, le Vichy du temps. Lors d'une invasion, au IIIe siècle,
cette grande cité périt par le feu, et jamais elle ne
se releva de ses ruines.
Les invasions des Barbares semèrent la destruction parmi les
villes d'eaux gallo-romaines. Ces villes étaient toutes florissantes,
ornées de monuments superbes, peuplées de riches habitants.
Elles devaient exciter la convoitise des envahisseurs.
Ceux-ci, disent les auteurs de la « Gaule thermale », entrent
en scène dès 213. Tout de suite les villes thermales attirent
« ces peuples innombrables et féroces », comme les
appelle saint Jérôme. Les hordes passent, pillent d'abord,
détruisent ensuite. Les monuments sont saccagés, puis
brûlés. « Luxeuil semble avoir été
détruit par Attila en 451, après avoir beaucoup souffert
en 275. En 590, saint Colomban n'y trouva que des ours, des buffles
et des loups, au milieu des restes des thermes et des statues. Il prit
d'ailleurs son parti de ces quadrupèdes, ne voyant dans les ruines
que les signes de la disparition du « culte exécré
des païens ». A Néris, il y a eu deux destructions,
avec réfection intermédiaire. Evaux aussi a été
brûlé ; le Mont-Dore, écrasé et saccagé
; Balaruc, saccagé ; Rennes-les-Bains, brûlé ; Aix-en-Provence,
pillé et brûlé, de même que Royat, une des
plus riches stations des Gaules. » Ce fut un recul au point de
vue médical. Les Romains avaient acquis des connaissances sur
les indications thérapeutiques des eaux : elles furent perdues.
Ils ne voyaient pas uniquement dans les sources des réservoirs
d'eau chaude fournie gratuitement par la nature : Pline, Hérodote,
Salien, Aëtius savaient les effets particuliers des diverses sources
; déjà, à l'époque romaine, c'est à
Vichy que les goutteux et les surnourris allaient soulager leurs reins,
leur goutte, et leur tube digestif ; c'est à Luchon, à
Amélie, et au Mont-Dore qu'on allait pour les maladies respiratoires
; à Aix, Evaux, Royat, la Bourboule, Plombières, Bourbon,
pour les douleurs, les plaies, les affections de la peau ; à
Néris, pour les nerfs... »
Certaines stations oubliées par les Barbares furent victimes
de cataclysmes naturels. Menthon, sur le lac d'Annecy, était
une station importante des Romains. Ce n'est qu'en 1865 qu'on a retrouvé
l'établissement et la source, perdus depuis dix-huit siècles.
Menthon fut probablement enfoui sous une avalanche de terre et de rochers.
Saint-Galmier fut ravagé par une inondation ; Aulus fut noyé
également. Ydes, dans le Cantal, paraît avoir été
précipité dans un trou.
Aix-les-Bains était parmi les grandes stations gallo-romaines.
Son établissement fut détruit par la chute d'un amas de
boue et de rocs tombé du mont Revard. En 1776, on l'a remis au
jour et, dans une baignoire antique, on a trouvé le squelette
d'un baigneur qui, venu là pour chercher la guérison de
ses maux, n'y trouva que la mort. La catastrophe dut être si soudaine
que le malheureux n'eut même pas le temps de sortir de sa baignoire.
Il y demeura plus de quinze siècles.
***
Victimes de la nature et du vandalisme humain, la plupart des stations
thermales passèrent de longs siècles enfouies sous leurs
ruines. Elles traversèrent ainsi la nuit du moyen âge.
Ce n'est guère qu'au XVIIe siècle qu'elles s'éveillèrent
de leur long sommeil et qu'on vit renaître la saison des eaux.
A cette époque, plusieurs médecins, notamment le fameux
Delorme en qui Mme de Sévigné avait toute confiance, se
mirent à ne jurer que par la vertu des eaux. Quelle que fût
la maladie pour laquelle on les appelait, ils envoyaient leur malade
en quelque station thermale. Ce fut la renaissance de la plupart des
villes d'eaux qu'avaient connues les Romains et qui sont aujourd'hui
parmi les plus fréquentées. Vichy, Plombières,
Spa, Bourbon-Archambault, le Mont-Dore, maintes autres encore, commencèrent
dès lors à se développer. Paris même se paya
le luxe d'être ville d'eaux. Il y avait à Passy des sources
très fréquentées et, à Auteuil, une autre
source « vitrioleuse et ferrugineuse » qu'on disait «
apéritive, détersive, laxative, désopilant surtout
le foie et la rate ».
En ce temps là, on n'allait guère aux eaux que pour se
reposer et se soigner. Ce n'est que dans le premier tiers du XIXe siècle
que, dans certaines villes d'eaux, on s'avisa d'ajouter aux charmes
de la nature et aux espérances de guérison, les attraits
du jeu.
Bade fut dans ce genre la station type. Ce n'était qu'une modeste
bourgade lorsqu'en 1837 le gouvernement français interdit les
jeux de hasard. Il y avait alors à Paris, boulevard Montmartre,
un grand établissement de jeu, nommé Frascati, qui dut
fermer ses portes. Le fermier des jeux de cet établissement,
le sieur Bénazet, se demanda alors où il irait planter
ses pénates. On lui fit à Bade quelques ouvertures ; et
il partit, émigrant avec sa clientèle et emportant dans
la petite ville de la Forêt Noire la roue de la Fortune qui, suivant
le mot spirituel d'un Parisien du temps, « n'était qu'une
roulette entre ses mains ».
Dès lors, la prospérité de Bade ne cessa de s'accroître.
Elle dura jusqu'en 1870. Ce fut la station élégante au
temps de Louis-Philippe et surtout du second empire. Il fallait aller
à Bade comme il faut aujourd'hui aller à Trouville, sous
peine de n'être pas du Tout-Paris.
On ne voyait là que des Français ; en n'y parlait que
français. Un guide disait de Bade : « C'est une ville française
située en Allemagne et où l'on peut voir Paris tout l'été
».
Alfred de Musset, qui fréquenta Bade comme tout bon dandy de
son temps, nous en a fait une description pittoresque et narquoise :
Bade est un parc anglais fait sur une montagne,
Ayant quelque rapport avec Montmorency
Vers le mois de juillet, quiconque a de l'usage
Et porte du respect au boulevard de Gand,
Sait bien que le bon ton ordonne absolument
A tout être créé, possédant équipage,
De se précipiter sur ce petit village,
Et de s'y bousculer impitoyablement
Les dames de Paris savent, par la gazette,
Que l'air de Bade est noble et parfaitement sain.
Comme on va chez Herbault faire un peu de toilette,
On fait de la santé là-bas : c'est une emplette
On y faisait autre chose que de la santé.
On y faisait aussi de la misère et du drame.
Les salons de jeu y étaient ouverts à tout venant
L'abreuvoir est publie et chacun y vient boire,
disait encore Musset. Et les incidents tragiques
troublaient souvent les joies des baigneurs.
La guerre de 1870 marque la fin des succès de Bade... Depuis
lors, d'ailleurs, le Français qui veut perdre son argent sur
le tapis vert n'a plus besoin de passer la frontière.
***
Il y a des gens qui ne croient pas à la vertu des eaux. Ceux-là,
j'imagine, prendront quelque plaisir à lire une jolie anecdote
que rapporta jadis Alphonse Karr. Leur scepticisme s'en réjouira.
Citons-la leur en terminant :
« L'acteur Perlet , raconte le spirituel pamphlétaire,
était triste et malade ; quelques personnes lui conseillèrent
les eaux d'Enghien. Perlet alla trouver le docteur Bouland, médecin
des eaux, et lui exposa piteusement sa situation en lui demandant franchement
son avis.
» - Croyez-vous, lui dit-il, que vos eaux me donneront un peu
d'embonpoint ?...
» - Certainement, monsieur, certainement ; baignez-vous et vous
engraisserez.
» Perlet se baigne, se baigne, et n'engraisse pas ; il se plaint
au docteur.
» - Oh ! mais, monsieur Perlet, il faut de la persévérance,
il faut un peu de temps; baignez-vous, monsieur, baignez-vous, et vous
engraisserez.
» Mais un jour que, conformément aux conseils du docteur
Bouland, Perlet était dans sa baignoire, il entend parler dans
le cabinet voisin et reconnaît la voix du docteur.
» - Certainement, monsieur, disait le docteur.
» - Mais, répondait l'interlocuteur, j'ai beau me baigner,
je ne maigris pas. Je crois que je suis plus énorme encore qu'à
mon arrivée.
» - Ah ! mais, monsieur, il faut de la persévérance,
il faut du temps ; baignez-vous et vous maigrirez.
» Perlet se leva effrayé, jeta un regard sur lui-même
; il lui semble qu'il était maigri. Il se précipita hors
de son bain et s'enfuit. »
Ernest LAUT
Le Petit Journal illustré du 24 Juillet 1910