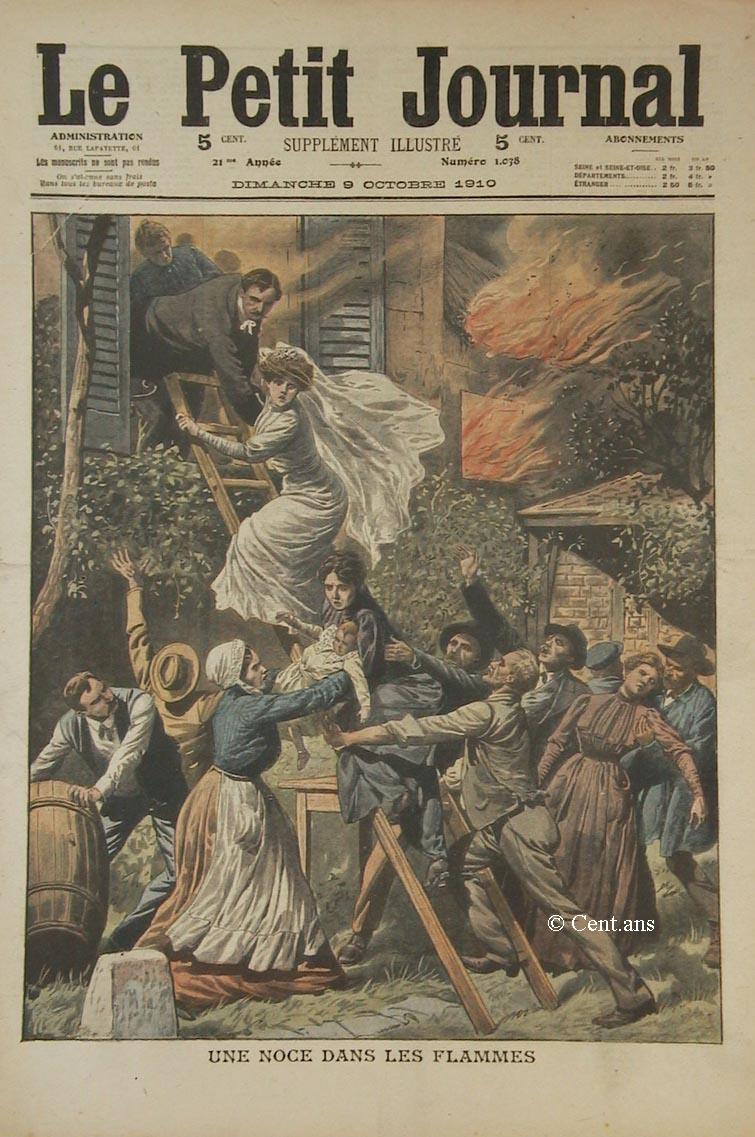UNE NOCE DANS LES FLAMMES
Une noce comprenant quarante-huit convives, festoyait
dans une salle du premier étage de la maison d'un cultivateur
de Chassiers, dans le Rhône, quand une fillette poussa des cris,
en apercevant des flammes qui léchaient la porte d'entrée
de la salle.
Le premier moment d'affolement passé, tous les invités
cherchèrent à sortir. Par la porte, c'était impossible,
le feu dévorait les escaliers ; par le toit, la même difficulté
se présentait, car on se trouvait en présence d'un brasier.
Le seul moyen était de sauter par les fenêtres, deux jeunes
hommes se dévouèrent et sautèrent. Ils appliquèrent
une échelle contre le mur et, l'un après l'autre, les
invités quittèrent le corps de bâtiment en flammes
; à peine le dernier avait-il mis pied à terre, que la
toiture de l'immeuble s'écroulait.
VARIÉTÉ
Les Chiffonniers
L' inquiétudes des « biffins ». - physiologie
du chiffonnier. - Les Philosophes du ruisseau. - L'éloquence
de Christophe . - Chiffonnier polygotte et chiffonnier médecin.
- Les biffins d'aujourd'hui.
La corporation des chiffonniers est inquiète
: on la menace, tantôt au nom de l'hygiène, tantôt
au nom de la sécurité.
Il y a un an ou deux, ne fut-il pas question d'interdire aux chiffonniers
de trier et de secouer sur la voie publique les ordures ménagères.
Un trust allait se former pour l'enlèvement des dites ordures
pendant la nuit... Et c'en serait fait de l'industrie du biffin.
Les chiffonniers se défendirent. Ils firent valoir leurs droits,
leurs privilèges dont la tradition se perd en la nuit des temps.
Et le projet, momentanément du moins, fut abandonné.
Aujourd'hui, ce sont d'autres griefs qu'on élève contre
la corporation chiffonnière. On l'accuse d'abriter dans son sein
de mauvais garçons qui, sous prétexte de chiffonnage,
se livrent à des jeux d'apaches ou à une besogne de cambrioleurs.
D'aucuns ont prétendu que la présence des cités
de chiffonniers à Saint-Ouen, Levallois, Asnières, Gennevilliers,
Montreuil, partout où ces petits industriels du pavé ont
planté leur tente, était une cause de désordre
et d'insécurité.
Les chiffonniers se sont défendus encore et victorieusement.
Les maires des communes qu'ils habitent ont en général
témoigné de leur honnêteté et de la pureté
de leurs moeurs.
« Nous sommes, disait l'autre jour le secrétaire du syndicat
des chiffonniers à l'un de nos confrères, nous sommes
des travailleurs, des honnêtes gens, et ce n'est pas notre faute
si de prétendus chiffonniers commettent des méfaits que
nous sommes les premiers à déplorer... »
Les chiffonniers forment une corporation étroitement unie ; ils
font tête à leurs adversaires. En dépit de maintes
et maintes ordonnances des préfets de police qui, depuis une
trentaine d'années, ont battu en brèche leurs privilèges,
malgré les efforts des hygiénistes, ils subsistent, ils
continuent de chiffonner. Mais il n'est pas douteux que leur profession
est de celles qui sont appelées à disparaître devant
les progrès de l'hygiène.
Traçons donc, avant que se produise cette échéance
fatale, la monographie rapide de chiffonnage et, comme on disait naguère,
la « physiologie » du chiffonnier.
***
Le chiffonnier illustré par les dessins de Cham ou de Gavarni,
célébré par Savinien Lapointe, mis au théâtre
par Félix Pyat, le chiffonnier portant l'énorme hotte
sur le dos et s'en allant la nuit, le long des ruisseaux, la lanterne
d'une main et le crochet de l'autre, le chiffonnier classique, en un
mot, comme il est loin de nous déjà !
Ce chiffonnier là, beaucoup de Parisiens ne l'ont pas connu.
C'est celui dont la légende faisait volontiers un philosophe
de l'école de Diogène.
Tous les romantiques l'ont décrit à l'envi. Savourez ce
portrait du chiffonnier tracé par la plume de Théophile
Gautier :
« Les mains gantées de boue, la bouche égueulée,
le nez vineux, la barbe inculte, les sourcils en broussailles ; les
loques où tout ce qui n'est pas trou est tache prenant, grâce
à la force de la couleur, un aspect puissant, sauvage et mystérieux
; un éclair de philosophie luisant sous cet oeil en arcade ;
un sarcasme rabelaisien retroussant le coin de cette lèvre calleuse...
»
Voilà du pittoresque... Le chiffonnier pourtant n'avait pas toujours
cette physionomie truculente , et sa prétendue philosophie n'était
le plus souvent que dans l'imagination des auteurs qui parlaient de
lui. Pauvre diable de chiffonnier, a-t-il assez servi aux gens de lettres,
et aux moralistes ?...
Janin, moins lyrique que Gautier, le décrit à son tour
:
« C'est, dit-il, un être au port grave, solennel, muet,
qui dort le jour, qui vit la nuit, qui travaille, qui spécule
la nuit ; c'est le dernier être de la création qui fasse
justice de tout ce qui se dit ou s'imprime dans le monde. Le chiffonnier
est inexorable comme le destin. Il attend : mais quand le jour du croc
est venu, rien ne peut retenir son bras, tout un monde a passé
dans sa hotte. Les lois de l'empire, dans cette hotte immense, courent
rejoindre les décrets républicains. Tous nos poèmes
épiques depuis Voltaire y ont passé. La hotte du chiffonnier
c'est la grande voirie où viennent se rendre toutes les immondices
du corps social... Le chiffonnier est mieux qu'un industriel, le chiffonnier
est un magistrat, magistrat qui juge sans appel, qui est tout à
la fois le juge, l'instrument et le bourreau... »
Ainsi, la description du chiffonnier, ce prétendu philosophe,
était surtout pour les écrivains une occasion facile de
philosopher.
A vrai dire, le chiffonnier se souciait fort peu de l'honneur qu'on
lui faisait en lui attribuant tant de réflexions morales sur
la vanité de toutes choses. Quand il allait la nuit par les rues,
projetant sur les pavés la lueur de sa lanterne, ou fouillant
de son croc la fange des ruisseaux, il y a gros à parier qu'il
ne pensait à rien ou que, du moins, il ne pensait pas à
épiloguer dans son for intérieur sur chacune de ses trouvailles.
Les réflexions qu'il eût pu se faire fassent devenues à
la fin singulièrement monotones.
Elles se fussent résumées dans ces deux vers de la ronde
fameuse qui se chantait dans un drame intitulé la Fille des
Chiffonniers :
Tout s'use et s'efface
Et n'est plus que chiffon.
***
Mais on conçoit que la littérature
ait volontiers exploité le personnage. Il était pittoresque,
un peu étrange et mystérieux. Misérable, il restait
libre cependant. On reculait devant son aspect sordide et l'on était
attiré par cette fierté dans la misère. «
Il y a dans cette profession de chiffonnier, disait un écrivain,
je ne sais quel mélange d'indépendance fantasque et d'humilité
insouciante, je ne sais quoi d'intermédiaire entre la dignité
de l'homme libre et l'abaissement de l'homme abject ; il y a dans ces
contrastes enfin, quelque chose qui intéresse, captive et fait
penser. »
Si tous les chiffonniers ne sont pas forcément des philosophes,
il y en eut au moins un naguère qui philosopha par les rues tout
en besognant de son crochet. Ce chiffonnier fut célèbre
parmi les noctambules vers 1850. Il s'appelait de son vrai nom Liard
et était connu dans la corporation sous le prénom de Christophe.
C'était apparemment un déclassé. Il était
instruit et ne manquait pas d'une certaine éloquence débraillée.
Ses confrères l'avaient surnommé le Philosophe, parce
qu'il discourait volontiers et qu'il discourait bien. Beaucoup d'écrivains
du temps ont parlé de lui.
L'un d'eux, L.-A. Berthaud, qui décrivit les types et les aspects
pittoresques de Paris, disait de Christophe :
« C'est un homme à part au milieu des siens ; il est fier,
il ne s'enivre pas, il marche seul, il vit seul. Christophe tient à
la fois de Diogène et de Chodruc-Duclos. Les personnes qui ont
été à même de l'apprécier ont voué
à ce pauvre chiffonnier une estime spéciale... »
Les dessinateurs d'alors ont tous fait le portrait de Christophe. On
retrouverait dans le Charivari maints croquis dans lesquels
Traviès le représenta dans le double exercice de son métier
de chiffonnier et de philosophe.
« On rencontre souvent Christophe, dit encore Berthaud, allant
par les rues de paris, au milieu d'un groupe serré autour de
lui et prêtant l'oreille à ses étranges discours.
De sa main gauche, fortement nouée, il soutient sur son épaule
une large sac, et tout en pérorant avec ceux qui l'entourent,
il fait jouer à sa main droite le rôle du crochet qui lui
manque. Christophe a dû bien souffrir avant de dépouiller
sa dignité d'homme, avant de se retirer chez les chiffonniers.
Aussi, voyez, il raille, il accuse, il insulte les passants et les curieux;
et pourtant il fouille à pleins doigts le fumier sur lequel il
s'est établi. Quand il s'éloigne, il vous jette avec dédain
un ricanement magnétique dont les vibrations retentissent longtemps
dans votre sein et vous font mal... »
Christophe, vous le voyez, était bien le cynique, le moderne
Diogène, le chiffonnier selon l'imagination romantique. Il fut
en un mot la personnification typique du
chiffonnier suivant l'idée qu'on s'en faisait naguère.
Au surplus, Christophe n'est pas le seul déclassé qui
ait sombré dans la profession chiffonnière. Ce métier,
où l'homme garde du moins son indépendance, a dû.
attirer de tout temps bien des êtres qui, pour avoir rompu avec
les traditions de leur classe sociale, n'avaient pas perdu leurs instincts
de liberté.
M. Claretie a raconté naguère qu'il avait eu parmi ses
camarades de collège un brave garçon qui était
devenu chiffonnier.
« Je le voyais souvent, dit-il, ce bachelier devenu « biffin
» et j'étais allé un jour le visiter dans sa cahute...
Il y avait, dans sa chute, un peu de maladresse, des fautes sans doute
et beaucoup de malechance. Les « enfoncés » de la
vie parisienne ne sont pas tous des responsables. »
L'académicien eut la curiosité de connaître les
tribulations de la vie de son ancien condisciple et ses impressions
de coureur de tas d'ordures. Il le pria de lui en faire le récit.
Le chiffonnier y consentit.
« Il m'écrivit, dit M. Claretie, une centaine de pages
auxquelles il mit en grec une épigraphe de Sophocle : «
Nul mortel ne peut être déclaré heureux avant sa
mort ». Il ajoutait encore à cette citation d'Œdipe
Roi une citation du Dante, le classique : Lasciate ogni speranza...»
Ce biffin polyglotte, en chiffonnant dans les tas d'ordures n'avait
pas oublié ses humanités.
Dans son pittoresque livre, les Rois du Ruisseau, consacré
aux chiffonniers de Paris, M. Georges Renault raconte :
« J'ai connu des êtres bizarres parmi ces chiffonniers.
L'un d'eux avait été professeur d'histoire, un autre médecin-major.
Il n'y a pas encore longtemps, dans une réunion publique où
M. le docteur Hellet, maire de Clichy, développait des arguments,
un contradicteur se leva tout à coup - c'était un chiffonnier
- et s'écria :
« - Monsieur le maire, si vous êtes docteur en médecine,
je suis, moi, docteur en droit. »
Le même auteur rapporte encore l'anecdote suivante :
Un homme de lettres, voulant faire des études sur les chiffonniers,
avait pris le parti de s'affubler de leur costume et d'aller boire avec
eux. Une nuit, en pénétrant dans un de ces antres, il
aperçut au milieu de la salle et gravement assis devant une table,
un homme à la figure hâve et amaigrie, mais au regard perçant
et intelligent : cet homme était un chiffonnier. A la lueur d'une
chandelle fichée dans un goulot de bouteille et placée
à la gauche de cet être mystérieux, l'écrivain
vit successivement s approcher de la table des femmes, des enfants et
des hommes dont les vêtements déguenillés et bizarres
trahissaient à la fois la misère et le métier.
A chacun d'eux, le chiffonnier adressait des demandes, tâtait
le pouls, examinait la langue, et selon la gravité du mal, condamnait
son client au repos ou lui donnait une ordonnance écrite sur
un morceau de papier qu'il tirait de sa hotte.
Ce chiffonnier était un médecin, un authentique docteur
de la faculté de Paris, que les vicissitudes de la vie avaient
jeté dans la triste et pénible profession des biffins.
***
Le fameux arrêté de Poubelle enjoignant aux propriétaires
parisiens d'avoir dorénavant à faire usage de boîtes
en métal dans lesquelles les locataires devraient déposer
les ordures ménagères porta un coup terrible à
la profession des chiffonniers. C'était en 1884. Les Parisiens
se rappellent à coup sûr combien cet arrêté
déchaîna de colères. On crut que c'était
la mort du biffin. Mais le biffin résista. N'était-il
pas accoutumé depuis des siècles à lutter contre
les exigences de la police et les mille petites tyrannies exercées
contre lui au nom de l'hygiène et de la sécurité
des rues ?
Cette date, cependant, marqua la disparition du chiffonnier solitaire,
du philosophe nocturne. On en vit de moins en moins dans les rues de
Paris. Mais la corporation, loin de disparaître, s'organisa et
se modernisa. Les chiffonniers, à présent, sont syndiqués
comme toutes les autres corporations, et leur syndicat veille jalousement.
au maintien de leurs privilèges.
Le chiffonnier, néanmoins, est aujourd'hui comme autrefois un
travailleur indépendant. Il est son maître, travaille quand
il veut et ne s'occupe ni du repos hebdomadaire ni de la durée
de la journée de travail.
Mais là, comme partout ailleurs, il y a une hiérarchie.
Parmi les chiffonniers, le « placier » est le personnage
important de la profession. Les placiers sont des commerçants
qui ont cheval et voiture. Chacun d'eux a sa « place »,
ou plutôt son quartier, avec le droit exclusif de visiter les
boîtes de tel à tel numéro d'une rue. Il arrive
le matin, aide le concierge à sortir les poubelles sur le trottoir,
fait son choix, empile ses trouvailles dans des sacs qu'il entasse sur
sa charrette, après quoi il file vers son logis au trot de son
petit cheval maigre. Et là il trie sa récolte avant de
la vendre au chiffonnier en gros. Le placier peut gagner jusqu'à
400 francs par mois. Après le « placier » vient le
« coureur ». C'est l'isolé de la corporation. Il
glane dans les boîtes après que le placier a passé
et emporte ce que celui-ci n'a pas voulu. Son gain est encore d'environ
5 francs par jour.
Puis viennent les « tombereautiers » qui chiffonnent dans
le tombereau même. Enfin les « secondeurs », divisés
en « gadouilleurs», qui vont dans les champs après
l'épandage des gadoues, et en « broyeurs », qui peuvent
entrer dans les usines de broyage et tenter de faire une dernière
récolte avant la destruction des ordures ménagères.
Tous ces travailleurs du chiffon sont en général de braves
gens. Ils ont le sentiment de solidarité corporative très
développé, non moins que l'esprit de famille. Il suffit
de parcourir leurs cités pour s'apercevoir que ce n'est pas chez
eux que sévit le fléau de la dépopulation.
Des vieilles traditions de leur métier, ils ont gardé
l'habitude de vivre sans se mêler aux autres travailleurs; Ils
se marient entre eux, se réjouissent entre eux ; ils sont un
peuple à part parmi le peuple.
Mais, s'ils évitent le contact des autres classes de la population,
cela ne les empêches pas d'être sociables ; et leur organisation
corporative témoigne assez qu'ils ne sont nullement hostiles
au progrès.
Ils font un rude métier et un métier utile en débarrassant
la grande ville de ses détritus ; et, si nous en croyons le Bulletin
municipal de la Ville de Paris, leur travail introduit chaque année
dans la circulation une somme qui atteint près de quinze millions.
Cela vaut bien, en somme qu'on les laisse vivre et travailler en paix.
Ernest LAUT.
Le Petit Journal illustré du 9 Octobre 1910