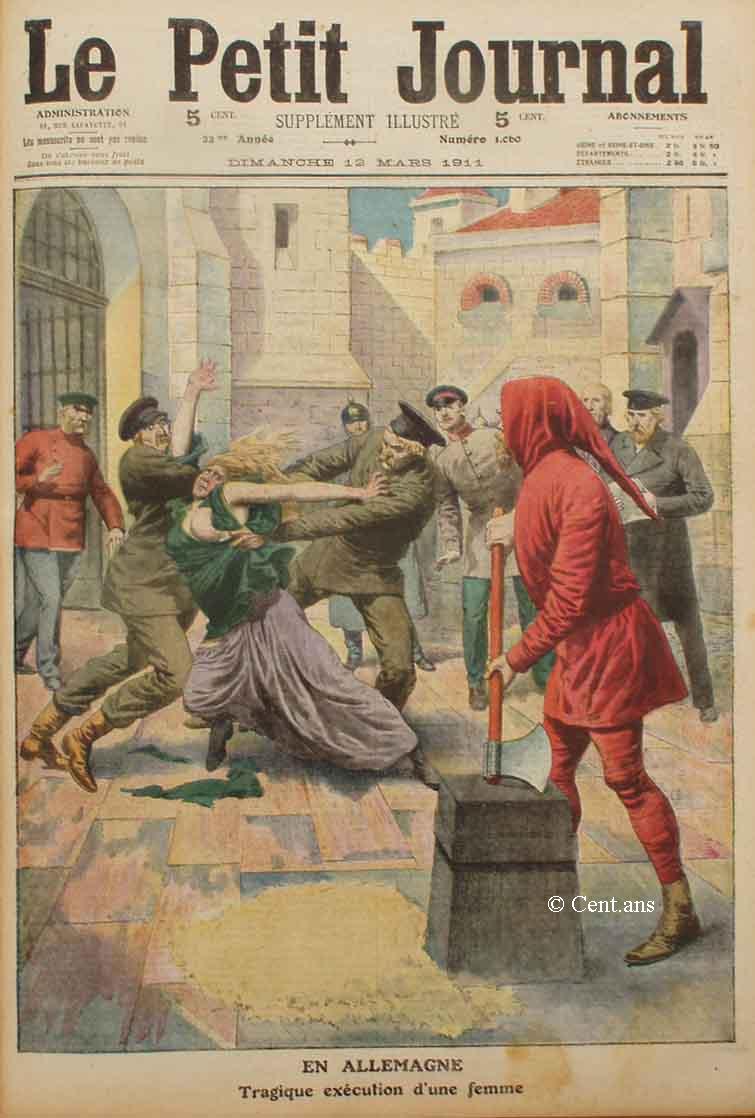EN ALLEMAGNE
Tragique exécution d'une femme
Dans la prison d'Insterburg, une femme, convaincue
d'empoisonnement, devait être exécutée.
La malheureuse fut conduite au supplice seulement vêtue d'une
jupe, le buste insuffisamment couvert par une blouse qui lui avait été
jetée sur les épaules. C'est ainsi que, grelottante de
froid, pleurant à chaudes larmes, elle écouta la lecture
du jugement.
Mais lorsque les aides du bourreau voulurent la saisir, elle eut comme
une crise de folie et se jeta à terre en poussant des cris affreux
Pendant longtemps, elle opposa la résistance la plus acharnée
; finalement, les forces lui manquèrent. Les aides du bourreau
en profitèrent pour lui lier les mains derrière le dos.
On la coucha sur le billot, et le bourreau, énervé par
cette scène, abattit sa hache avec une telle force que la lame,
après avoir tranché la tête, resta fichée
dans le billot.
VARIÉTÉ
Propos de Carême
Abstinences et mortifications d'autrefois. - Le hareng, mets de carême. - Histoire de Guillaume Beukels. - Comment on punissait les mangeurs de viande sous le Grand Roi. - La tradition du carême dans toutes les religions.
Nous voici donc en plein carême... Vous
me direz qu'il n'y paraît guère : les abattoirs ne chôment
pas ; les boucheries, les charcuteries, les boutiques de marchands de
volailles ne sont pas moins achalandées qu'en temps ordinaire.
C'est que la pratique du carême est une tradition qui s'en va,
comme s'en sont allées tant d'autres traditions d'autrefois.
Au temps jadis, quand le carnaval était vraiment une époque
de folies et de bombances, le carême était tout naturellement
le correctif du carnaval.
Aux saturnales succédaient les jours austères ; aux festins
pantagruéliques le jeûne et l'abstinence.
Ainsi la vie d'autrefois était faite de contrastes.
A présent que le carnaval n'existe plus, le carême a presque
complètement disparu comme lui. Et plus rien, à cette
époque de l'année, ne vient modifier notre façon
de vivre.
Les théologiens, familiers avec l'histoire des origines du christianisme,
vous diront que le carême fut institué en souvenir des
quarante jours de jeûne que Jésus-Christ subit dans le
désert. Mais ils ajouteront à coup sûr que ce n'est
pas Jésus lui-même qui l'institua, car il s'éleva
toujours, au contraire, contre les jeûnes et les mortifications
exagérées que s'imposaient ses fidèles.
Au début, le carême n'eut point un caractère obligatoire.
Quelques chrétiens fervents s'avisèrent d'imiter le Maître
en jeûnant quarante jours comme lui, et l'Église encouragea
cette abstinence toute volontaire. Ce n'est qu'au septième siècle
seulement qu'elle imposa le jeûne durant les quarante jours qui
précèdent la fête de Pâques.
Les rigueurs du carême ne furent pas toujours acceptées
sans lutte. Du temps de Charlemagne, elles étaient si peu respectées
que a « l'empereur à la barbe fleurie » dut promulguer
contre ses sujets réfractaires aux douceurs de l'abstinence un
édit qui les menaçait de mort.
Plus tard, Luther et Calvin abolirent le carême et pourtant l'église
anglicane le maintint en dépit d'eux-mêmes, et pour une
cause assez typique d'ailleurs et qui n'a rien de religieux. L'Angleterre
étant un pays maritime et, par conséquent, peuplé
de nombreux pêcheurs, on craignit, en supprimant le carême,
de réduire la vente du poisson et de porter ainsi un coup funeste
industrie nationale.
Ainsi l'intérêt économique prima la volonté
des réformateurs.
On ne saurait imaginer avec quelle gravité les conciles d'autrefois
discutèrent à perte de vue sur les mille et une abstinences
édictées pendant le carême. Il est telles questions,
celles du « beurre » et des « oeufs », par exemple,
qui donnèrent lieu à des controverses sans fin.
Dans le principe, le beurre n'était pas permis. On devait assaisonner
les aliments avec de l'huile. C'était fort bien pour l'Italie
et le Midi de la France, où les oliviers poussaient en abondance.
Mais, dans les pays du Nord, l'embarras était grand. Le concile
d'Aix-la-Chapelle, en l'an 817, fut saisi de la question. Il décida
que l'huile végétale pourrait être remplacée
par « l'huile de lard », qui n'était autre chose
que la graisse. Mais le concile d'Angers ne partagea pas cette manière
de voir ; il eut des scrupules et condamna d'un seul coup l'huile de
lard, le beurre et le lait, obligeant ainsi les fidèles à
ne manger que leur pain sec et leurs légumes cuits à l'eau.
Les rois, alors, donnaient l'exemple et étaient les premiers
à s'incliner devant la discipline rigide.
Charles V, dont la santé était faible, supplia le pape
de lui accorder un adoucissement aux duretés de ce régime.
Le pape y consentit mais il demanda. l'attestation solennelle du médecin
et du confesseur du roi et il exigea, de lui, en retour de cette faveur,
un grand nombre d'aumônes et la fondation de plusieurs oeuvres
pieuses.
D'autre part, la reine Anne, duchesse de Bretagne, émue de la
détresse de ses paysans qui ne pouvaient, ni pour or, ni pour
argent, se procurer de l'huile d'olive, dépêcha un ambassadeur
auprès du souverain pontife, et obtint l'autorisation pour elle
et pour ses Bretons de remplacer l'huile par le beurre.
Ce fut la porte ouverte aux relâchements. Le beurre étant
autorisé, on tâcha d'obtenir les oeufs. Rome opposa d'abord
une résistance opiniâtre. Mais en 1555, le pape Jules III
se laissa fléchir. Et dès lors, la réjouissance
des oeufs de Pâques n'eut plus d'objet, puisqu'elle n'avait
été instituée qu'en souvenir des privations du
carême.
***
Comment eut-on pu vivre au moyen âge en temps de carême,
si l'on n'avait pas eu le hareng ?... Songez que les légumes,
à cette époque de l'année, sont rares ; que, d'autre
part, la pomme de terre était inconnue, ou plutôt dédaignée
des habitants des villes ; car il est maintenant prouvé que dès
le Xe siècle, les paysans de certaines régions françaises
connaissaient ce délicieux tubercule, le cultivaient et le consommaient.
En quoi ils étaient plus avisés que les citadins.
Le poisson d'eau douce ne manquait pas, mais il était d'un prix
fort élevé. Dans le livre de comptes de messire Jean de
Blois, l'un des plus puissants châtelains du XIVe siècle,
nous trouvons mention d'un brochet payé 10 sous, qui feraient
aujourd'hui 36 francs, et d'une lamproie flanquée de quatre anguilles,
payées 74 sous, c'est-à-dire, en monnaie moderne, 266
francs. A ce prix-là. vous pensez que tout, le monde ne pouvait
pas s'offrir du poisson à volonté.
Heureusement, il y avait le hareng, suprême ressource en temps
de carême.
Or, le hareng était fort abondant dans la mer du Nord, et, dès
l'aurore du IXe siècle, avant les invasions des Normands, les
pêcheurs de la Bretagne, de la Flandre, de la Zélande et
de la Frise en faisaient un grand commerce.
Les immenses quantités de harengs qu'ils rapportaient chaque
année de leurs campagnes de pêche faisaient la richesse
de ces pays. On vendait, comme un aliment exquis, ce poisson délicat,
dans toutes les contrées des Pavs-Bas, dans la Picardie, et jusque
dans l'Île-de-France. Mais comme on ignorait le moyen de le conserver
longtemps, c'était une primeur qui n'avait que sa saison.
Les harengs, qu'on pêchait alors étaient simplement salés,
ce qui permettait seulement de les conserver une quinzaine de jours,
temps suffisant pour les transporter assez loin dans l'intérieur
des terres.
Or, en l'an 1397, il arriva que la pêche du hareng fut si abondante
qu'on ne savait qu'en faire. Les pêcheurs de l'embouchure de l'Escaut
rentraient au port avec leurs bateaux surchargés et se lamentaient
à l'idée qu'il leur faudrait perdre la plus grande part
de cette pêche miraculeuse.
- Ah ! disaient-ils, si l'on pouvait conserver ce poisson, l'expédier
en Allemagne, dans le Midi de la France, quelle fortune ce serait pour
nous !
Un jeune pêcheur de Biervliet, nommé Guillaume Beukels,
les écoutait et songeait.
Depuis plusieurs années, il étudiait les moyens de conserver
le hareng ; il avait fait maintes expériences sans en rien dire
à personne; et, cette foi, il croyait bien tenir le secret tant
cherché.
Et il avait résolu d'expérimenter son procédé
de conservation et de l'éprouver à ses risques et périls
avant de le communiquer à ses camarades.
Donc, tandis que les autres pêcheurs vendaient les produits de
leur grande pêche lui garda les siens et emmagasina d'énormes
quantités de harengs. Il déclara qu'il faisait, un essai
pour le bien général qu'il ne vendrait que trois mois
plus tard et que, s'il réussissait dans son expérience,
tous les pêcheurs, ses concitoyens, connaîtraient, pour
la saison prochaine, une découverte qui ne manquerait pas de
les enrichir.
Je vous laisse à penser si cette déclaration excita l'émotion
générale sur les rives de l'Escaut. Ceux qui connaissaient
Guillaume Beukels avaient confiance dans son expérience. Quelques-uns
riaient de lui et le blâmaient de perdre ainsi de gaieté
de coeur tous ces harengs dont il eût pu tirer, malgré
le bon marché, un profit assez considérable, et que, bientôt,
il serait forcé de rejeter à la mer.
Guillaume laissait dire. Les trois mois écoulés, il ouvrit
ses magasins. Ses harengs étaient dans un parfait état
de conservation. Dans chaque maison du village de Biervliet, l'ingénieux
pêcheur fit remettre un des poissons conservés suivant
sa méthode. Les sceptiques furent ainsi confondus ; les autres
purent se féliciter d'avoir eu confiance.
Et Guillaume Beukels, ayant assemblé les pêcheurs, tint
parole et leur dévoila son procédé.
Ce procédé est celui qu'on emploie toujours depuis lors
pour conserver le hareng.
Aussitôt que le poisson est sorti de l'eau, le caqueur lui coupe
la gorge, en tire les entrailles, laisse les laites et les oeufs, les
lave en eau douce, et lui donne la sauce, en le mettant dans une cuve
pleine d'une forte saumure d'eau douce et de sel marin où il
demeure douze à quinze heures. Au sortir de la sauce, on le «
varaude », on l'écaille, si vous l'aimez mieux. Une fois
varaudé, on l'encaque, bien couvert au fond et par dessus d'une
couche de sel. C'est là ce qu'on appelle le hareng blanc, .le
hareng salé, et quelquefois, dans le commerce, le hareng peck.
Pour le hareng qui doit être saur et fumé, on le laisse
le double de temps dans la sauce ; on le brochette, c'est-à-dire
qu'on l'enfile par la tête à de menues broches de bois
; on le pend dans des cheminées faites exprès qu'on nomme
« roussables » ; on fait dessous un peu de bois vert qui
donne beaucoup de fumée et peu de flamme. Le hareng reste dans
le roussable jusqu'à ce qu'il soit suffisamment saur et fumé,
ce qui se fait ordinairement en vingt-quatre heures.
Guillaume Beukels fit par ce procédé la fortune de ses
compatriotes en même temps que la sienne. Il mourut en 1449, sans
avoir jamais quitté la profession qu'il avait créée
et enrichie. Les pêcheurs de son pays n'oublièrent pas
ce qu'ils lui devaient et élevèrent un monument sur sa
tombe.
Collin de Plancy, dans ses « Légendes des origines »,
auxquelles nous empruntons quelques traits de cette histoire, rapporte
qu'en l'an 1536, l'empereur Charles-Quint visitant les travaux fortifiés
des côtes de la Flandre zélandaise, accompagné de
toute sa cour, demanda au pilote qui le guidait ce qu'il y avait à
voir par là.
- Sire, répondit l'homme, il y a à voir, à Biervliet,
une grande chose : le monument de Guillaume Beukels.
En prononçant ce nom, le marin ôta son chapeau goudronné.
Une vive expression de respect animait son visage.
- Qui est ce Beukels ? demanda Charles-Quint.
Le pilote rougit ; il semblait peiné de la question. Il ne concevait
pas qu'on pût ignorer un nom si vénéré.
- Sire, répondit-il, avec une certaine solennité, Guillaume
Beukels est l'homme qui inventa l'art de saler, de parfumer et d'encaquer
le hareng.
Il a fait la richesse de la Flandre et de la Hollande, répondit
gravement Charles-Quint. Honneur aux hommes utiles ! Nous irons saluer
la mémoire de Guillaume Beukels.
Et l'on vit dans le petit cimetière de Biervliet le puissant
empereur, suivi de toute sa cour, s'incliner sur la tombe d'un modeste
pêcheur.
***
C'est donc à Guillaume Beukels que nos aïeux durent de pouvoir
manger à leur faim pendant le carême. On faisait de harengs
une consommation formidable. Au XVe siècle, dans un château
de Flandre, on mange trois mille harengs pendant la période du
carême.
A Paris, sous Henri IV, Louis XIII et Louis XIV, le hareng, en carême,
est sur toutes les tables. C'est qu'on n'a guère autre chose
à se mettre sous la dent. Les ordonnances sont d'une extrême
sévérité. Défense de manger gras sous peine
d'être appréhendé ou, tout au moins, condamné
à l'amende.
Dans son étude sur « le Carême sous l'ancien régime
», le docteur Cabanès rapporte maints traits de cette sévérité.
Il était interdit « à toutes personnes, de quelque
qualité, conviction ou pays qu'elles soient » de porter
ou de conduire à Paris « aucuns bestiaux ni viande vive
ou morte, volaille ni gibier, soit par terre ou par eau ».
Le 28 avril 1659, une sentence du Châtelet condamnait un sieur
Gardy à être attaché au carcan, devant le Grand
Châtelet, « avec une fressure de veau pendue au col, puis
à être réintégré en prison »,
pour avoir vendu de la viande publiquement pendant le Carême.
Louis XIV avait même établi l'inquisition à domicile,
et la police avait le droit de pénétrer partout, aussi
bien dans les hôtels des ambassadeurs, des princes et des seigneurs
de la cour, que dans les auberges et hôtelleries, pour y saisir,
s'il y avait lieu, toute viande de boucherie ou de gibier qu'on y recelait.
Notons, en terminant, que la coutume du carême se trouve dans
presque toutes les religions. Les juifs n'ont que six jours de jeûne
obligatoire, mais ils doivent rester jusqu'à vingt-quatre heures
sans manger
Le carême des mahométane dure l'espace d'une lune : c'est
le Ramadan chez les Turcs et le Moharrem chez les Persans. Mais les
sectateurs du Phophète ne jeûnent que le jour et se rattrapent
en fêtes et bombances, dès que le soleil est couché.
Dans l'inde, le jeûne accompagne toute les pratiques des fakirs.
Il n'est pas rare de rencontrer des fanatiques capables de rester huit
et dix jours sans prendre la moindre nourriture. Au Thibet, les pénitents
bouddhistes, soumis aux longs jeûnes n'ont pas même le droit
d'avaler leur salive, ce qui entraîne pour eux non seulement l'interdiction
de manger et de boire, mais encore la défense de parler...
Quel dommage qu'on ne puisse en France imposer pareille abstinence à
tant de politiciens bavards et goulus, qui se laissent si volontiers
entraîner par « la chaleur communicative des banquet ! »
Ernest LAUT
Le Petit Journal illustré du 12 Mars 1911