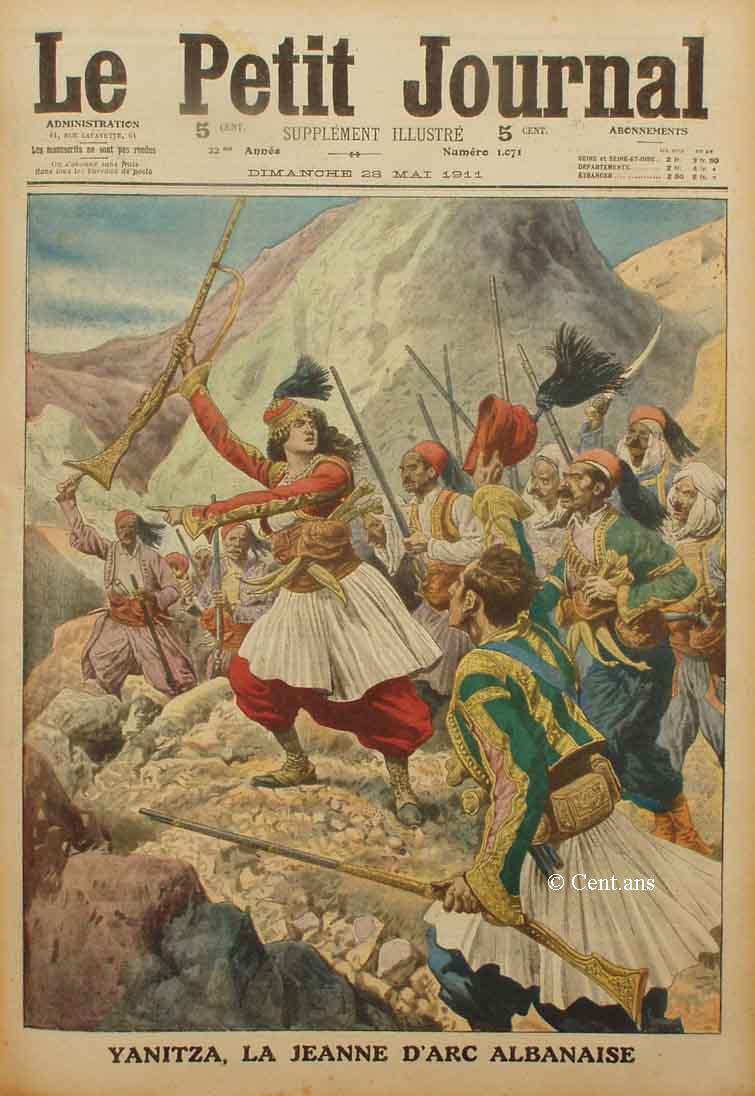YANITZA, LA JEANNE D'ARC ALBANAISE
Une guerrière vient de se révéler
dans l'insurrection albanaise.
Yanitza (Jeanne) Martinay est la fille d'un chef de clan. Son père,
ayant trouvé la mort dans une rencontre récente, le fils
aîné était appelé à lui succéder.
Mais l'héritier du noble albanais est un enfant de huit ans.
Que faire ?
- Suivez-moi ! s'écria Yanitza, après avoir réuni
les soldats de son père, je vous conduirai à la gloire.
Et la Jeanne d'Arc albanaise, âgée de 22 ans, s'élançait
vers l'ennemi.
Yanitza est grande et forte. Sa beauté séduit les insurgés.
Armée d'un vieux fusil incrusté d'argent et d'ivoire,
elle dirige les opérations, avec une audace rare.
Et, ces jours derniers, on la vit, à la tête du parti d'insurgés
qu'elle commande, attaquer les redoutes ottomanes et mettre en fuite
les troupes du sultan.
VARIÉTÉ
Les Émules de Jeanne d'arc
A propos d'une guerrière albanaise.-Les Amazones. - Emilie Plater, l'héroïne de l'insurrection polonaise. - Les femmes du Transvaal. - Une Jeanne d'Arc, chinoise.
On signalait dernièrement parmi les insurgés
mexicains la présence d'une femme ; on signale aujourd'hui une
autre guerrière parmi les insurgés albanais.
Et c'est un fait remarquable que, chez toutes les nations, dans tous
les soulèvements populaires, dans toutes les guerres nationales,
chaque fois qu'il s'est agi de défendre la patrie, la foi ou
d'intégrité du foyer, il s'est trouvé des femmes
pour prendre part à la lutte et, parfois même, pour diriger
la résistance.
Sans parler des innombrables femmes que le goût des aventures
précipita aux armées, tenons-nous en à celles dont
le seul patriotisme inspira l'ardeur belliqueuse, à celles que
l'amour du pays arracha à leur famille, pour les transformer,
non point seulement, en guerrières, mais en inspiratrices d'héroïsme,
à celles qui furent, en un mot, les véritables émules
de Jeanne, la bonne Lorraine.
On en rencontre chez tous les peuples et dans tous les temps. Il en
est même dans la légende.
Du lointain des temps préhistoriques, ces noms sonores sont venus
jusqu'à nous : Penthésilée, Thomyris, Ménélippe,
Sphione. Ont-elles vraiment existé, ces femmes belliqueuses qui,
pour mieux tirer de l'arc, se mutilaient le sein droit ; ou ce mythe
n'est-il que le fruit de l'inépuisable imagination des anciens
?
Quoi qu'il en soit, la fable des amazones tient une large place dans
la mythologie et dans l'art de la Grèce antique. Les sculpteurs
nous les ont représentées, ces farouches guerrières,
aussi belles qu'indomptables, et leurs luttes contre les héros
et les hommes ont inspiré les plus grands artistes.
Nous les retrouvons aussi dans les mythologies orientales, dans les
traditions de l'Inde ancienne, dans celles du Siam, où, de nos
jours encore, le roi possède un bataillon sacré d'amazones.
Les Scythes eurent leurs amazones ; et les Walkyries des mythologies
scandinaves sont leurs soeurs.
Enfin, dans les temps modernes, tout près de nous, nos soldats
n'ont-ils pas trouvé, au Dahomey, les amazones de Behanzin, défendant
leur pays et leur maître avec une énergie désespérée
?
C'est pour défendre la foi qu'au temps des Croisades, suivant
ce que nous rapporté l'historien byzantin Cinname, les femmes
nobles de France et d'Allemagne suivirent l'empereur Conrad, en Palestine,
et formèrent un corps spécial sous le commandement de
la plus intrépide d'entre elles. Quels étaient les noms
de ces femmes ? Nul ne le sut Elles étaient toutes bardées
de mailles, comme les chevaliers ; celle qui les conduisait avait une
armure éclatante, et les soldats l'appelaient la « dame
aux jambes d'or ».
Combien d'autres, après elles, se sacrifièrent et prirent
les armes pour le salut de leur Patrie !
Ce sont les femmes de Bohême, qui combattent sous Vlasto pour
la liberté de leur pays ; ce, sont les amazones de la Floride,
qui se dressent, en 1540, contre l'invasion espagnole et tiennent en
échec les troupes aguerries de Fernand de Soto ; ce sont les
guerrières du Nizam, qui défendent le Deccan contre les
Anglais... Et, si nous rentrons en France, c'est une longue et glorieuse
théorie d'héroïnes qui, à toutes les époques,
nous apparaissent, montées sur leur cheval de bataille.
Avec Jeanne d'Arc, l'une des plus pures gloires féminines dont
s'illustre notre histoire est celle de Velléda, cette prêtresse
gauloise qui souleva toute une région de la Gaule contre la puissance
romaine et fut, pour l'amour de son pays, sacrifiée et traînée
en esclavage à Rome.
N'est-ce pas aussi une admirable figure d'héroïsme que celle
de Boadicée, cette reine des Icènes (peuple puissant de
la Grande-Bretagne) qui, chassée par l'invasion romaine, fomente
la résistance et fait honte de leur faiblesse à ses sujets
qui tremblent devant les conquérants :
« Vaincre ou périr, s'écrie-t-elle... A vous, hommes,
de voir si vous voulez imiter une femme ou si vous préférez
vivre esclaves !... »
***
C'est surtout dans les grandes crises nationales, à l'heure où
l'invasion étrangère menace l'existence même de
leur pays que le patriotisme des femmes s'exalte et donne souvent aux
hommes l'exemple salutaire.
Dans ce genre, un des plus beaux exemples de dévouement à
la patrie donné par une femme est celui de la comtesse Emilie
Plater, l'héroïne de l'insurrection polonaise de 1821.
Qui se souvient aujourd'hui d'Emilie Plater ? Son nom fut pourtant alors
illustre dans le monde entier. Il s'est effacé depuis comme le
souvenir même du malheureux pays qu'elle défendit avec
toute la passion de son patriotisme, avec toute la force de son désespoir.
Dans son livre sur « les Amazones », M. Paul Lacour a conté
son héroïque histoire. Il rapporte que, toute jeune encore,
au château de Lixna, en Livonie, qu'habitait sa famille, Émilie,
un jour, découvrit, au fond d'une armoire, un pauvre vieux livre
recouvert d'un parchemin usé. C'était une vie de Jeanne
d'Arc. La. jeune fille lut et relut l'épopée de la Pucelle
avec une admiration fiévreuse.
Dès lors, Jeanne, sainte image de la Patrie, est sa patronne.
« Elle lui voue un culte, et rassemblant comme un collectionneur
passionné, toutes les gravures qui mettent en scène l'héroïne
française, elle en décore les murs de sa chambre, la transforme
en une sorte de chapelle consacrée à la Vierge de Domrémy.
« Excitée définitivement à l'action par un
tel exemple, elle s'y prépare ardemment. Les exercices violents,
le maniement du cheval et de l'épée deviennent ses passe-temps
favoris. Ce sont chaque jour des chevauchées à grande
allure par les sentiers des montagnes qui bordent la Dwina, par ces
mystérieuses forêts où chantent et où parlent
les arbres, et les oiseaux. Ils lui disent qu'un souffle de révolte
passe sur les peuples asservis, que le moment, de se dévouer
approche... »
A ce moment, l'Europe entière se passionne pour la cause des
Hellènes soulevés contre le joug dès Turcs. Là-bas,
une héroïne joue son rôle glorieux, une héroïne
bien oubliée, elle aussi. Elle s'appelait Bobolina. Femme d'un
armateur de Spetzia assassiné par les Turcs, elle avait juré
à ceux-ci une haine éternelle. Lorsqu'éclata la
guerre, elle arma trois vaisseaux pour soutenir la cause des Grecs.
Elle assista au siège de Tripolitza, concourut au blocus de Nauplie,
combattit à Missolonghi avec un courage égal , à
celui des plus vaillants guerriers.
Émilie Plater, dans son château livonien, suivait de loin
les péripéties de la guerre turco-grecque. La conduite
de l'héroïne enflammait son ardeur
« Les hommes, s'écriait-elle, font leur devoir et n'affrontent
que la mort. Bobolina fait davantage, puisqu'elle brave l'opinion. Elle
aussi, bientôt, allait braver l'opinion.
La révolution polonaise éclata le 29 novembre. Les Lithuaniens
l'attendaient et l'espéraient. Ils étaient prêts
à tendre la main aux Polonais.
Émilie se mit immédiatement en campagne. Elle s'en fut
à travers les villages prêcher aux paysans, qui la connaissaient
et l'aimaient, l'évangile de la Liberté. Puis elle partit
pour Wilna ,demander des instructions au Comité directeur de
l'insurrection. On refusa de là recevoir et de l'entendre.
Alors, elle s'en revint, bien décidée à agir seule
et à faire éclater la révolution au coeur de la
Livonie et de la Russie blanche.
Ayant coupé ses cheveux et revêtu des habits d'homme, elle
monte à cheval et se dirige avec une faible escorte sur le village
de Dousiaty, où elle est attendue.
« C'était un dimanche, dit M. Paul Lacour. La vue de la
jeune amazone transporte d'enthousiasme toute la population.
On l'acclame, on la suit, on l'escorte, car, ayant pris en main le drapeau
national, elle harangue la foule. D'une voix chaude et pénétrante,
elle parle au coeur de ces braves gens. Se laisseront-ils plus longtemps
persécuter, accabler d'impôts, priver de leurs enfants
qu'on arrache à la famille, dès qu'ils deviennent des
hommes, pour les courber sous là joug barbare du despotisme ?...
« Aux accents de cette parole vengeresse, la colère étincelle
dans les yeux, rugit dans les âmes les plus pacifiques. De chaque
paysan, la haine réveillée fait un révolté,
un soldat armé, qui d'une faulx, qui d'une pique. Plusieurs ont
des fusils. Tous se groupent autour d'Émilie : ils ne veulent
pas d'autre chef que cette frêle créature ; et, à
côté d'elle, avec elle, ils demandent à combattre
pour la cause sainte de la Patrie... »
La campagne commence. Successivement, Émilie Plater et ses partisans
mettent en déroute une compagnie puis un régiment russe
envoyés contre eux. Mais bientôt une véritable armée
arrive avec du canon. Repoussée, dispersée, l'héroïque
troupe est obligée d'abandonner les villages conquis.
Émilie, alors, gagne l'armée polonaise. La renommée
de ses hauts faits l'y a précédée. Malgré
le mauvais vouloir des chefs, on l'accueille, car les soldats la connaissent
et sa présence leur apparaît comme un gage de victoire.
Elle excite, en effet, parmi eux, une chevaleresque émulation
génératrice d'actions héroïques.
Mais que peut la vaillance des troupes contre l'incapacité des
généraux ?... On sait combien les chefs polonais furent
alors au-dessous de leur tâche. Le général Chlapowski,
sous les ordres duquel Émilie est venue prendre du service, ne
voit pas tout le parti qu'il pourrait tirer de la présence de
cette femme héroïque parmi ses soldats. Il tente de la décourager,
lui conseille de quitter l'armée, de prendre un repos bien gagné
après tant de fatigues.
« Ma vocation est d'être soldat, lui répond l'héroïne,
tant que la Pologne demeurera asservie. Ce n'est pas à l'heure
où grandit le danger que je puis songer à me séparer
des défenseurs de ma patrie. »
Force est aux généraux de s'incliner devant cette volonté.
On donne à Émilie le commandement d'une compagnie. A Kowno,
elle fait des prodiges de valeur. Mais les défaites succèdent
aux défaites. L'armée recule devant les Russes vainqueurs
; et l'héroïne, déçue dans sa fière
espérance de délivrer son pays comme la vierge de Domrémy,
sent que désormais tout effort est vain. Elle lutte jusqu'au
bout, cependant ; et, quand Chlapowski entraîne ses soldats vers
la frontière prussienne, elle refuse de s'associer à sa
fuite honteuse et quitte l'armée après avoir violemment
reproché au général l'indignité de sa conduite.
Presque seule, elle franchit le Niémen, réussit à
traverser les lignes moscovites, et va échouer, malade, mourant
de faim, dans la maison d'un garde forestier où, reconnue ou,
du moins, soupçonnée d'être la jeune héroïne
dont parle toute la Pologne, elle est entourée des soins les
plus diligents.
Peu de temps après, elle apprenait que l'insurrection était
définitivement vaincue. Cette nouvelle hâta sa fin.
« La seule idée du dévouement à la patrie
avait fait battre son coeur de vierge, dit M. Lacour ; ce dévouement
étant devenu inutile, ce coeur cessa de battre. Émilie
mourut donc sans regret de la vie, tenant en ses bras défaillants
ses armes vaines, et demandant qu'on les mît dans sa tombe. »
Telle fut la fin de cette femme héroïque, « digne
émule de notre Jeanne d'Arc, dont elle avait l'âme ardente
et la foi invincible. »
***
On trouve dans les guerres contemporaines plus d'un exemple de ces dévouements
féminins à la patrie.
En 1870, que de femmes françaises supportèrent, comme
l'a dit Victor Hugo, toutes les atrocités de la guerre :
La famine, l'horreur, le combat sans rien voir
Que la grande patrie et que le grand devoir.
Au Transvaal, on sait quelle fut l'oeuvre de
ces femmes boers dignes compagnes des héros de l'indépendance
sud-africaine.
Quand la guerre fut finie, le général Dewet leur disait
: « Il y a longtemps que nous aurions été obligés
de renoncer à la lutte, ô femmes, si vous ne vous étiez
pas montrées si fidèlement attachées à la
patrie ».
Les unes firent le coup de feu auprès de leurs maris, telle la
femme du général Joubert, celle que les Boers appelaient
« la Tante ». Elle maniait le fusil aussi bien que les meilleurs
tireurs et, plus d'une fois, les ennemis de son pays éprouvèrent
son adresse.
Les autres se consacrèrent aux soins à donner aux blessés,
ou au ravitaillement de l'armée. Toutes firent preuve du plus
ardent patriotisme.
Je retrouve le texte d'une lettre d'une jeune fille afrikander publiée
alors par un journal du Transvaal. C'est une page admirable d'abnégation
et d'ardent patriotisme :
« Frères, frères, écrivait-elle, je ne suis
qu'une faible jeune fille afrikander mais le sang bout dans mes veines.
» Quels sont alors les sentiments qui doivent vous agiter, vous
autres hommes ! Partez donc avec votre courage et défendez nos
droits de toutes les forces que Dieu vous donne. Aussi longtemps qu'il
vous les accordera, combattez pour la liberté et le droit ; avec
Dieu à votre tête, il vous réservera la victoire.
» Mon père et mon frère, deux êtres qui me
sont chers, sont partis vers les champs de bataille et peut-être
- que Dieu veille sur eux - ne reviendront-ils pas ! Je me consolerai
pourtant à la pensée qu'ils ont sacrifié leur vie
pour le droit et la liberté, qu'ils ont cru à la promesse
du Seigneur d'être le vengeur des veuves et le père des
orphelins.
» Donc, pères et frères, partez, avec courage, combattez
vaillamment pour le droit et la liberté, gardez le ferme espoir
en Dieu. Songez à ceux qui survivront et qui prieront pour vous.
»
Quand les femmes entendent ainsi leur mission, que ne peuvent faire
les hommes combattant pour la liberté de leur pays.
Dans la guerre russe-japonaise, on cita à maintes reprises le
nom de femmes engagées dans les régiments russes et qui
firent vaillamment leur devoir.
Lors de la dernière insurrection cubaine, une femme défendant
son foyer, la seniora Clava Santos se mit à la tête d'un
corps de partisans et battit les troupes du président Palma.
Même en Chine, où pourtant la population féminime
se désintéresse de toute question politique, on signalait
dernièrement une jeune agitatrice nommée Sieh-King-King,
qui parcourait le pays, ameutant le peuple, lui parlant de la patrie
dévastée et morcelée et invitant ses compatriotes
à « bouter » dehors les étrangers.
Qui sait si dans le soulèvement qui se produira fatalement quelque
jour, en Chine, contre les « Diables d'Occident », nous
ne verrons pas Sieh-King-King entraîner les populations fanatisées
et jouer le rôle de Jeanne d'Arc ?
Ernest LAUT.
Le Petit Journal illustré du 28 Mai 1911