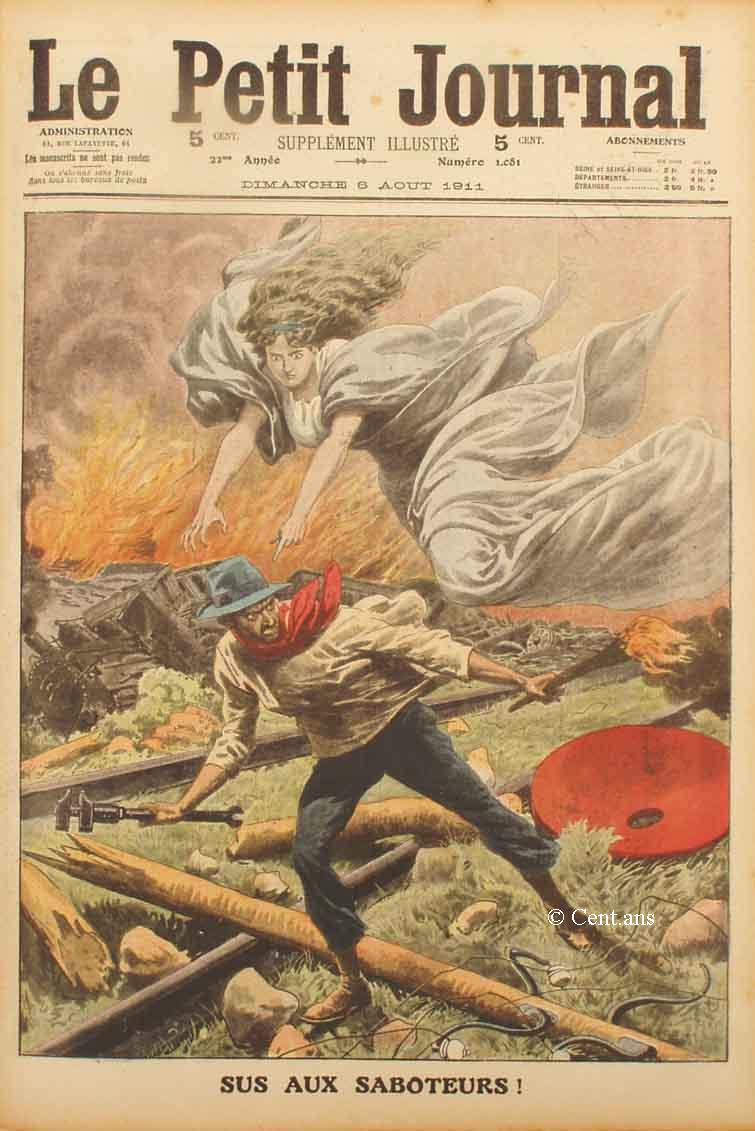SUS AUX SABOTEURS !
Il n'est point de crime plus abominable et plus
lâche que celui du saboteur. Et, par une anomalie singulière,
il n'en est pas qui jusqu'ici ait joui d'une pareille impunité.
On nous répète sans cesse que le parlement va voter des
mesures de répression, et le parlement ne vote rien.
Au surplus, à quoi bon des lois nouvelles ? N'avons-nous pas
tout ce qu'il faut dans nos codes pour punir les gredins qui coupent
les fils ou déboulonnent les rails ?.. N'avons-nous pas la loi
de 1854 sur les chemins de fer, qui punit de travaux forcés «
la destructions des voies et tous autres actes connexes, de nature à
causer des déraillements » ? N'avons-nous pas les lois
contre les anarchistes votées pendant la période d'attentats
qui se déroula de 1891 à 1894 ?
Ces lois ont tout prévu. Elles punissent et très sévèrement,
et très justement, le sabotage et les provocations directes au
sabotage. Il ne s'agit donc pas de nous fabriquer de nouvelles lois,
mais bien d'appliquer celles qui existent.
L'opinion publique exige qu'on agisse énergiquement contre ceux
qui excitent au sabotage et contre ceux qui le pratiquent, et c'est
d'un coeur unanime que tous les honnêtes gens de France crient
: « Sus au saboteurs ! »
VARIÉTÉ
Comment nos pères accueillirent le choléra
Une maladie moderne. - Le choléra
à Paris en 1832. - Son arrivée en Carnaval.
Folie tragique. - La médecine impuissante. - Ne nous frappons
pas.
Le choléra dont on nous menace chaque
année et qui, espérons-le, ne viendra pas encore jusqu'à
nous cette fois, est, pour l'Europe du moins, une maladie moderne. Les
Français du Moyen Âge ne le connurent pas. Il est vrai
qu'ils avaient la peste, qui, à certaines époques, les
décimait régulièrement tous les deux ou trois ans
et faisait des ravages auprès desquels ceux que fait aujourdhui
le bacille virgule ne sont plus que de la Saint-Jean.
C'est en 1832 que nous eûmes la première invasion du choléra.
Jusqu'alors c'était un mal peu connu et peu étudié.
On en entendit parler en Europe pour la première fois en 1823
; il désola la Russie en 1830 et 1831 ; il envahit ensuite l'Allemagne
et l'Angleterre ; enfin, le 15 mars 1832, il entrait en France par Calais,
et le 26 mars il éclatait à Paris.
Rendons cette justice aux pouvoirs publics d'alors : ils n'avaient point
attendu que la maladie arrivât chez nous pour chercher les moyens
de se prémunir contre elle. En 1831, le gouvernement avait envoyé
en Pologne une commission médicale chargée de l'étudier.
En même temps, des commissions spéciales furent créées
à Paris avec mission de rechercher et de signaler toutes les
causes d'insalubrité pouvant favoriser la marche de l'épidémie.
Un médecin parisien, le docteur Poumiès de la Siboutie,
dont on a publié récemment les curieux Souvenirs,
raconte qu'il fit partie de l'une de ces commissions.
« Nous visitâmes l'une après l'autre, dit-il, toutes
les maisons de nos circonscriptions respectives. Ce que nous vîmes
ne peut s'imaginer : des maisons fétides, délabrées,
croulantes ; des logements privés d'air et de lumière
; des immondices partout. ; des enfants à demi-vêtus, en
plein hiver, de vêtements sordides ; partout la propreté
et l'absence complète de choses les plus nécessaires à
la vie. Nos rapports et nos procès-verbaux ont fait connaître
tous ces faits affligeants, dans les plus grands détails..»
Et, le médecin ajoute mélancoliquement :
« Selon sa coutume, l'administration a entassé ces documents
dans ses cartons. »
Manque d'hygiène, indifférence administrative ; Vous voyez
que nos pères étaient assez mal préparés
à affronter l'attaque du choléra...
Cette attaque, au surplus, ils ne la croyaient pas redoutable. Le choléra
fut accueilli sans émotion. On ne le prit pas au sérieux
tout d'abord. Henri Heine, dans ses Lettres de France, a constaté
le fait. La peinture qu'il fait de l'aspect de Paris et de l'état
des esprits au début de l'épidémie caractérise,
tristement cette imprévoyance.
« On s'était préparé avec d'autant moins
de soin contre le fléau, dit-il, qu'on avait reçu de Londres
la nouvelle qu'il n'avait enlevé que peu d'individus, proportionnellement.
On parut même, d'abord, avoir pris le parti de s'en moquer, et
l'on pensa que le choléra, ainsi que les grandes réputations,
se réduirait ici à peu de chose. Il ne faut donc pas trop
en vouloir à cet honnête choléra si, dans la crainte
du ridicule, il eut recours à un moyen que Robespierre et Napoléon
avaient trouvé efficace, et si, pour se faire respecter, il décima
le peuple. Par la grande misère qui règne ici, par l'immense
malpropreté qu'on y trouve ailleurs que dans les classes les
plus pauvres, par l'irritabilité du peuple, surtout par sa légèreté
sans bornes, par le manque total de dispositions et de mesures de prévoyance,
le choléra devait s'étendre avec plus de promptitude et
d'horreur qu'en aucun autre lieu...
C'est là, en effet, ce qui devait se produire. Mais le Français,
né jovial et malin, ne voulait pas y croire. Et, comme pour ajouter
au macabre de la situation, c'est en pleine saturnale qu'il accueillit
le choléra et qu'il s'ingénia à le narguer.
Depuis deux eu trois jours le fléau commençait à
manifester timidement sa présence lorsqu'arriva la fête
de la Mi-Carême.
« Comme il faisait beau soleil et un temps charmant, dit encore
Henri Heine, les Parisiens se trémoussèrent avec d'autant
plus de jovialité sur les boulevards, où l'on aperçut
même des masques qui, parodiant la couleur maladive et la figure
défaite, raillaient la crainte du choléra et la maladie
elle-même. Le soir du même jour, les bals publics furent
plus fréquentés que jamais ; les rires les plus présomptueux
couvraient presque la musique éclatante ; on s'échauffait
beaucoup au chahut, danse peu équivoque ; on engloutissait à
cette occasion toutes sortes de glaces et de boissons froides, quand
tout à coup le plus sémillant des arlequins sentit trop
de fraîcheur dans ses jambes, ôta son masque, et découvrit
à l'étonnement de tout ce monde un visage d'un bleu violet.
On s'aperçut tout d'abord que ce n'était pas une plaisanterie,
et les rires se turent, et l'on conduisit bientôt plusieurs voitures
de masques du bal immédiatement à l'Hôtel-Dieu,
hôpital central, où, en arrivant sous leurs burlesques
déguisements, le plus grand nombre moururent...
« Comme, dans le premier moment l'épouvante, on croyait
à la contagion et que les anciens hôtes de l'hôpital
avaient élevé d'affreux cris d'effroi. on prétend
que ces morts furent enterrés si vite, qu'on ne prit pas le temps
de les dépouiller des livrées bariolées de la folie,
et qu'ils reposent dans la tombe gaiement, comme ils ont vécu
. »
Le fléau eût tôt fait de changer en terreur cette
inconcevable insouciance. Il se répandit par la ville avec une
effrayante rapidité. Le 3 avril, le nombre des morts allait déjà
à plus de cent ; le 9, huit cent quatorze personnes périrent
; enfin, dix-huit jours après l'invasion de l'épidémie
(14 avril), on comptait douze à treize mille malades et plus
de sept mille morts.
***
Alors la peur succéda à l'indifférence. Et avec
la peur, vinrent les soupçons mauvais, les accusations folles.
Le peuple, d'abord avait accueilli l'épidémie avec scepticisme.
Il ne voulait pas y croire. On vit des gens protester par la débauche
contre la venue du fléau, le défier dans leur ivresse.
On accusait les médecins d'exagération. D'aucuns prétendaient
que le choléra n'était sorti tout armé de leur
imagination que pour leur permettre de faire fortune.
Et puis quand les décès succédèrent aux
décès, quand il fallut se rendre à la tragique
évidence, le peuple nia encore l'épidémie ; il
voulut ne voir dans l'amoncellement des morts que le résultat
des plus abominables combinaisons de la perversité humaine. On
parla d'empoisonnement des fontaines. Le bruit courut qu'un complot
avait été tramé contre la population indigente.
Des gens rôdaient par les rues, inquiets, cherchant partout les
empoisonneurs, épiant les gestes des passants. Cette panique
causa des crimes. De pauvres diables qui s'étaient trop approchés
des fontaines publiques payèrent cette imprudence de leur vie.
Henri Heine a dépeint quelques-unes de ces scènes tragiques.
« Nul aspect, dit-il, n'est plus terrible que cette colère
du peuple, quand il a soif de sang et qu'il égorge ses victimes
désarmées. Alors roule dans les rues une mer d'hommes
aux flots noirs, au milieu desquels écument çà
et là les ouvriers en chemise comme les blanches vagues qui s'entrechoquent;
et tout cela, gronde et hurle sans parole de merci, comme des damnés,
comme des démons.
» J'entendis dans la rue Saint-Denis le fameux cri « A la
lanterne ! » Et quelques voix, pleines de rage, m'apprirent qu'on
pendait un empoisonneur. Les uns disaient que c'était un carliste
et qu'on avait trouvé dans sa poche un brevet de lys. Les autres,
que c'était un prêtre et qu'un pareil misérable
était capable de tout. Dans la rue de Vaugirard, où l'on
massacra deux hommes qui étaient porteurs d'une poudre blanche,
je vis un de ces infortunés au moment où il râlait
encore, et les vieilles femmes tirèrent leurs sabots de leurs
pieds pour l'en frapper sur la tête jusqu'à ce qu'il mourût.
il était entièrement nu et couvert de sang et de meurtrissures
; on lui déchira non seulement ses habits, mais les cheveux,
les lèvres et le nez ; puis vint un homme dégoûtant
qui lia une corde autour des pieds du cadavre et le traîna par
les rues en criant sans relâche : « Voilà le choléra-morbus!
» Une femme admirablement belle, le sein découvert et les
mains ensanglantées, se trouvait là : elle donna un dernier
coup de pied au cadavre quand il passa devant elle ».
Et le poète allemand ajoute : « Qui a vu ces bacchanales
de sang et de mort ne les oubliera jamais. »
***
Cependant, de toutes parts, on cherchait les moyens de se garantir contre
le fléau.
« Dans l'espérance de se préserver, dit le docteur
Poumiès, chacun se munit abondamment d'aromates, de boites, de
flacons, de sachets, de drogues de toute espèce. Il y avait des
gens qui portaient dans leur poche une sorte de pharmacie. On vendait
des élixirs préservatifs, curatifs, de convalescence.
On plaça dans tous les endroits publics des vases remplis d'eau
chlorurée. Cette odeur de chlore nous poursuivait partout. Me
trouvant juré en 1832, je demandai au président de faire
enlever au moins une partie de ces vases placés en profusion
dans la salle d'audience. On ne pouvai pas respirer ; et j'ai toujours
pensé que l'abus du chlore dut occasionner bien des accidents...
»
Or, ainsi que l'observe fort justement un écrivain de l'époque,
« rien n'entretient la crainte comme une nomenclature de préservatifs
et de précautions ». Les médecins, titulaires de
la confiance administrative avaient publié leur charte de santé.
On la retrouvait partout, à Chaque pas qu'on faisait dans la
ville. Et chaque minute de ce régime préventif a ramenait
incessamment la pensée sur le danger qu'on voulait éviter.
L'attention générale se portait uniquement sur l'horrible
fléau.
« Chez soi, dit ce même écrivain, l'on avait à
remplir toutes les prescriptions médicales. Il fallait empuantir
sa maison pour l'assainir. On sentait partout le choléra dans
l'odeur sépulcrale du chlore. On le retrouvait dans la ceinture
de flanelle, dans les chaussettes de laine ; on s'habillait du choléra.
Dehors, vous le rencontriez embusqué. au vitrage de chaque boutique,
vous menaçant de son gigantesque nom, si vous n'entriez pas bien
vite acheter des flacons, des sachets, des gants, des pommades, des
bonbons, des gâteaux, du vin de rancio, du tabac ; que sais-je
? tout ce dont les magasins voulaient se dégarnir...»
Mais, à la vérité, on n'avait aucun moyen de se
préserver à coup sûr. La maladie était toute
nouvelle. On ne la connaissait pas. C'était pour la science médicale
un problème dont personne jusqu'alors n'avait. tenté de
rechercher la solution. On tâtonnait, et, pendant ce temps, le
fléau poursuivait ses ravages.
L'auteur des « Souvenirs d'un médecin de Paris »
constate en ces termes l'incohérence qui présidait à
la lutte contre la maladie :
« Il régnait une grande diversité de traitements
dans les hôpitaux comme dans la pratique particulière.
Le froid, le chaud, les calmants, les excitants furent employés
avec des succès et des revers à peu près égaux.
Tant que l'épidémie fut à sa période d'acuité,
le nombre des morts fut à peu prés le même, quels
que fussent les milliers de volumes écrits sur le choléra,
dans lesquels chacun préconise l'excellence de son traitement.
Un jeune médecin, fort instruit, envoyé dans un canton
pauvre, où tout manquait, gorgea ses malades d'eau froide à
laquelle il ajouta, suivant le cas, un peu de vin du pays et plus tard
un peu d'alcool. Il résulte de ses notes et observations tenues
avec une grande exactitude que, malgré la violence de la maladie,
il ne perdit pas plus de malades qu'ailleurs... »
Un point sur lequel tous les médecins étaient d'accord,
c'est qu'il fallait avant tout se garder d'avoir peur. Craindre le choléra,
disait-on, c'est le plus sûr moyen de l'attirer.
Et c'était là la première recommandation du médecin.
Quand la thérapeutique médicale est impuissante on se
rejette sur la thérapeutique morale.
Surtout, point de panique, disait la Faculté, point, de panique
et point de tristesse ; Il ne faut rien changer à la vie de Paris
; il faut que Paris travaille et s'amuse comme en temps normal.
Et Paris s'efforçait, de suivre l'ordonnance de ne point laisser
abattre son courage.
J'ai là, sous les yeux un article écrit par un journaliste
parisien en pleine période du choléra. Et cet article
nous dépeint la vie de Paris tandis que le fléau sévissait.
Les morts étaient innombrables, le deuil était sur la
ville et l'on essayait de penser à autre chose.
« Malgré les tristes pensées, les récits
désolants, les funestes rencontres, dit l'auteur de cet article,
rien n'était suspendu dans le mouvement des affaires, et l'on
affichait même chaque matin les plaisirs du jour. Les marchands
ouvraient leurs boutiques, les restaurants tenaient leur fourneaux allumés,
les cafés se contentaient d'ajouter le tilleul et la menthe à
leurs préparations habituelles ; les fiacres roulaient: les bourgeois
montaient leur garde, les journaux se remplissaient de discussions et
de nouvelles, la justice poursuivait son cours, la Bourse avait ses
mouvements de hausse et de baisse, la politique ses espérances
et ses mécomptes... »
L'auteur constate seulement qu'il y eut alors un certain fléchissement
dans le chiffre des mariages... On n'était plus assez sûr
de sa vie pour la lier à celle d'un autre. Mais, à part
cela, rien de changé.
« Toutes les industries allaient leur train comme pour ne pas
se désaccoutumer de produire. Mais un courage que l'on doit admirer,
c'est celui des théâtres. Il ouvraient leurs portes tous
les soirs, et là, devant un simulacre de public, plus attentif
peut-être à sa digestion qu'aux jeux de la scène,
il fallait que de pauvres comédiens, inquiets eux-mêmes
de leurs entrailles, ou frappés dans leurs affections, vinssent
débiter leur rôle; grimacer la gaité ou feindre
un autre trouble que celui dont ils étaient émus. Tout
cela pour qu'il ne fût pas dit que l'épouvante était
dans la citée...«
***
Voilà comment Paris, en 1832, accueillit
le choléra. A l'insuffisance des moyens médicaux, on remédia
par de la belle humeur.
Ce fut, à coup sûr, très beau. Mais cela n'empêcha
pas le choléra de faire, en six mois, 18.400 victimes sur une
population qui n'était alors que de 645,698 âmes, soit
plus de 23 décès par 1.000 habitants.
L'exemple de nos pères est sans doute bon à retenir, mais
si, ce qu'à Dieu ne plaise, un tel fléau devait fondre
sur Paris, nous aurions pour le recevoir autre chose que de la bonne
humeur. Nous aurions tout le formidable arsenal de notre hygiène
moderne.
Et le choléra serait bien audacieux s'il ne reculait pas devant
ces armes-là.
Ernest LAUT.
Le Petit Journal illustré du 6 Août 1911