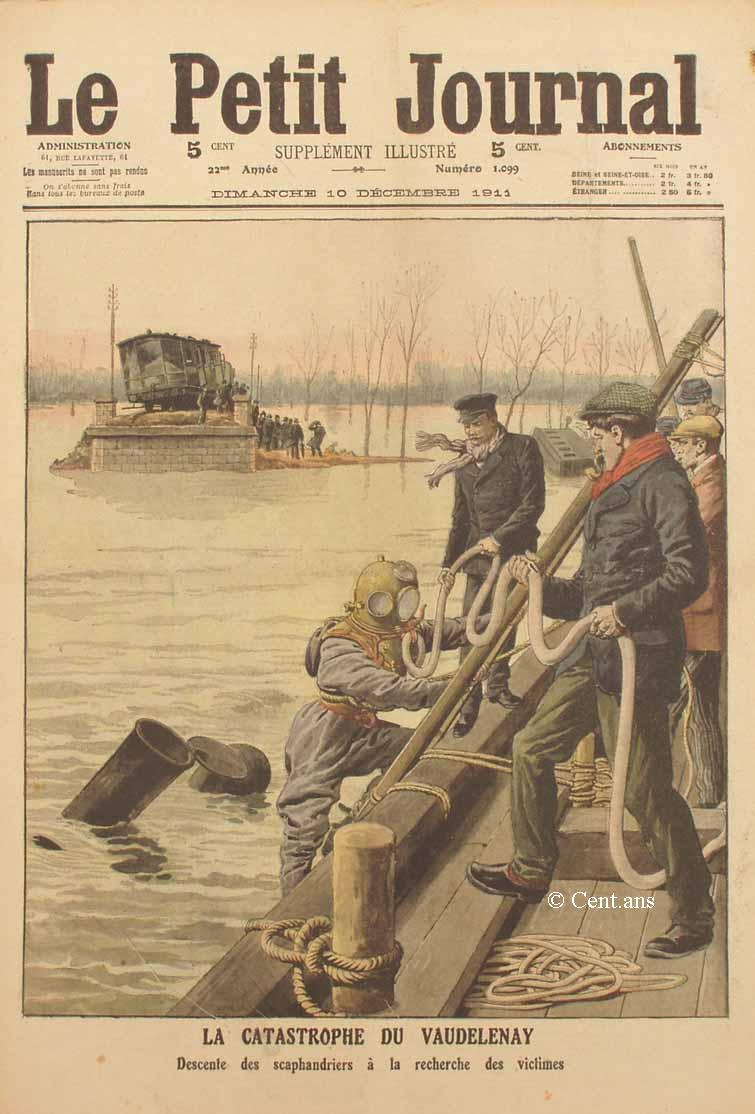LA CATASTROPHE DU VAUDELENAY
Descente des scaphandriers à la
recherche des victimes
Ce n'est que plusieurs jours après l'épouvantable
accident du Vaudelenay qu'il fut possible de faire explorer le fond
de la rivière par les scaphandriers pour rechercher les corps
des victimes.
On sait que sous le poids du train, l'unique pilier soutenant le tablier
métallique du pont s'était écroulé, entraînant
avec lui dans la rivière, les deux locomotives qui traînaient
le convoi, les tenders, un wagon de première et deux wagons des
troisième classe. Un autre wagon de troisième classe avait
été entraîné, mais étant tombé
près de la levée, il se renversa sur le côté
et les voyageurs purent se hisser sur le toit. Après plusieurs
heures d'attente et d'angoisse, ils purent être sauvés
grâce au dévouement héroïque des soldats du
6e génie d'Angers.
La crue de la rivière ayant rendu le courant extrêmement
violent, les opérations de sauvetage furent des plus difficiles
et des plus dangereuses. Ce n'est que trois jours plus tard que, les
eaux ayant baissé, on se décida à réclamer
le secours des scaphandriers, et que ceux-ci, descendus dans la rivière
qui charriait encore toutes sortes de débris, purent reconnaître
enfin exactement l'endroit où gît l'épave tragique..
VARIÉTÉ
Les Ponts qui s'écroulent
Interventions diaboliques. - Histoire de quelques ponts tragiques. -- Un train qu'on n'a jamais revu. - Les Ponts-de-Cé et Montreuil-Bellay. - Le réseau maudit.
Au temps jadis, la construction d'un pont n'allait
jamais sans l'accomplissement de certains rites traditionnels. Nos lointains
aïeux avaient gardé, des temps du paganisme, la tradition
des sacrifices expiatoires ; et, quand ils avaient construit un pont,
pour obtenir des divinités mystérieuses de l'onde et du
sol qu'elles assurâssent sa solidité, ils leurs sacrifiaient
volontiers quelques animaux de basse-cour. Moyennant quoi, les dieux,
satisfaits, permettaient aux hommes de passer sur le pont sans danger.
Le diable s'occupait beaucoup de la construction des ponts. Dans toutes
les légendes relatives à nos anciens ponts, le Malin joue
son rôle. Témoin la fameuse légende du Pont du Diable,
trop connue pour être rapportée ici, et dans laquelle,
comme chacun sait, le démon fut finalement victime de ses propres
machinations.
M. Dupont-Ferrier, qui connaît mieux qu'homme au monde l'histoire
de nos vieilles traditions populaires, observe qu'autrefois, en effet,
les ponts qui s'écroulaient tombaient bien souvent par la faute
du Malin.
« Chacun savait à Saint-Jean-de-Mont, rapporte-t-il, que
saint Martin avait construit un pont pour relier la terre ferme à
l'île d'Yeu ; un beau jour, un coup de pied du diable anéantit
le pont dans la mer. A la pointe du Raz, c'était saint Guénolé
qui avait jugé bon de jeter un pont jusqu'à l'île
de Sein. Mais le saint aimait trop les âmes de cristal. Il imagina
de faire son pont en belle glace, bien transparente. Le diable voulut
le traverser et, tout aussitôt, la brûlure de ses pieds
produisit son effet. Il enfonça ses sabots fourchus dans la glace
qui fondit. L'arche se troua lamentablement et, à l'endroit où
tomba Satan, tous les poissons, incontinent, se trouvèrent frits...
»
Voilà de belles histoires qui n'auraient plus cours aujourd'hui.
Quand un pont s'écroule, nous ne songeons plus à nous
en prendre au démon. A surplus, le Malin peut-il se dispenser
de ces besognes funestes : l'administration des Chemins de fer de l'État
s'en charge bien pour lui.
La récente catastrophe du pont de Montreuil-Bellay, causée
par son incoërcible incurie, évoque forcément le
souvenir des accidents du même genre qui se produisirent au cours
du siècle dernier, depuis l'époque de l'invention des
chemins de fer. Ils sont plus nombreux qu'on ne le croit généralement.
L'écroulement d'un pont est une de ces catastrophes qui imposent
à l'imagination des visions d'horreur tragique et qui impressionnent
profondément l'âme populaire. C'est une de ces catastrophes
dont on se souvient.
C'est ainsi que je me souviens, dans ma jeunesse, d'avoir entendu, à
maintes reprises, des vieillards rappeler l'écroulement du pont
d'Angers, événement qui s'était produit cependant
plus d'un demi-siècle auparavant, mais dont chacun avait gardé
le douloureux souvenir.
Il ne s'agissait pas d'ailleurs d'un pont de chemin de fer. Ce pont
d'Angers était un pont suspendu. Il s'écroula, le 16 avril
1850, au passage d'un bataillon du 11e léger, qui se rendait
par étapes en Algérie. Le bataillon, entraîné
par la musique militaire, et composé de vieux soldats habitués
à marcher ensemble en cadence, ne put rompre le pas, malgré
le commandement qui en avait été fait. Le tablier du pont
prit donc un mouvement oscillatoire accentué, bascula et se rompit
en précipitant les infortunés soldats dans la rivière
où beaucoup périrent, soit noyés, soit percés
par les baïonnettes, qui étaient aux canons des fusils.
Parmi les écroulements de ponts de chemins de fer, il en est
de non moins tragiques.
M. H. Gossin, dans son livre sur les chemins de fer, en cite deux qui
se produisirent à peu près dans les mêmes conditions
que la catastrophe récente du Vaudelenay.
Le premier eut pour théâtre les environs d'Antibes. Près
de cette ville, se trouve le ruisseau de La Brague, qui, chaque hiver,
au moment de la fonte des neiges, se transforme en torrent. Le chemin
de fer traverse ce ruisseau sur un pont. Or, en raison du manque de
cohésion du sol sur lequel reposaient les fondations de ce pont,
on avait cru devoir, pour assurer la solidité, en multiplier
les arches. Ce pont, qui n'avait que quatorze mètres de long,
comptait quatre arches. De plus, il était précédé
et suivi d'un remblai de deux kilomètres de long.
Cependant, la force du torrent était telle qu'en dépit
de ces précautions, des affouillements se produisirent et entraînèrent
la chute d'une pile du pont.
C'était le 5 janvier 1872. Il était six heure du soir
quand l'accident eut lieu. Un train venant de Nice devait passer à
Antibes quelques minutes plus tard. Le chef de gare de cette ville fit
tout ce qu'il put pour l'arrêter. Il se porta au devant de lui
avec tout son personnel armé de lanternes rouges. Mais la plaine
était inondée jusqu'à quatre kilomètres
du pont. « On eut beau, dit M. Gossin, entrer jusqu'aux épaules
dans l'eau glacée et agiter les fanaux rouges, il fut impossible
d'attirer à si grande distance, l'attention des agents du train.
Celui-ci, arrivé au pont, s'abîma dans le torrent. Neuf
wagons sur treize furent engloutis. »
Par bonheur, le train ne contenait qu'un petit nombre de voyageurs.
On dut, à cette circonstance, de ne compter que huit morts et
une dizaine de blessés. Chose inouïe après un tel
plongeon, sept voyageurs sortirent sains et saufs de cette effroyable
aventure.
Le 8 septembre de la même année, un accident pareil, et
dû aux mêmes causes, se produisit, en Espagne, sur la ligne
de Barcelone à Valence. Le torrent de Saint-Georges qui passe
à Fraga, entre Tarragone et Tortosa, emporta une pile d'un pont
du chemin de fer, et un train, arrivant quelques minutes après,
fut précipité dans l'abîme d'une hauteur de huit
mètres. Tour les wagons, sauf deux, dont la chaîne se rompit,
tombèrent dans le torrent. On, compta seize morts et vingt-cinq
blessés.
***
Mais le pays où se produisit le plus grand nombre d'accidents
de ce genre, c'est, comme bien vous pensez, l'Amérique. Dès
les commencements de l'exploitation des chemins de fer aux États-Unis,
plus d'un pont avait été construit sans que fussent prises
les précautions nécessaires pour assurer sa solidité
et sa résistance aux charges de plus en plus lourdes imposées
par le développement du transit.
D'autre part. sur les grands fleuves d'Amérique, il fallait,
tout en construisant des ponts pour les trains, se préoccuper
de laisser également la voie libre aux bateaux de fort tonnage
qui remontent ces fleuves assez profondément dans l'intérieur
des terres.
C'est dans ce but qu'on construisit un grand nombre de ponts tournants.
Mais il arriva que l'ouverture intempestive de ces ponts causa parfois
les plus terribles catastrophes.
Telle, par exemple, celle qui se produisit dans la nuit du 27 au 28
juin 1864, sur la rivière Richelieu, entre Québec et Montréal,
au Canada.
Un train spécial, parti de Québec et portant cinq cents
émigrants européens, s'engagea sur le pont à un
moment où celui-ci était ouvert pour le passage d'un train
de bateaux. Malgré les signaux, le mécanicien ne s'arrêta
pas, et le convoi fut précipité dans le gouffre d'une
hauteur de quarante-cinq pieds. Il y eut près de cent morts et
trois cent quatre-vingts blessés. Une vingtaine de personnes
seulement échappèrent indemnes à la catastrophe.
Le mécanicien qui l'avait causée, s'en tira sain et sauf.
En 1887, le pont de Forest-Hills, dans la banlieue de Boston, s'écroula
au passage d'un train. Ce pont franchissait une route. Plusieurs voitures
furent précipitées dans le vide. Il y eut vingt-six personnes
tuées sur le coup et cent quinze blessées. Les victimes
étaient, pour la plupart, des ouvriers et des demoiselles de
magasin qui se rendaient à leur travail dans la grande ville
voisine.
Une catastrophe particulièrement horrible, c'est celle qui eut
lieu, en Amérique encore, sur le chemin de fer de Toleda-Victoria.
and Western. Un train, chargé de 960 excursionnistes allant visiter
les cataractes du Niagara, franchissait en pleine nuit un pont de bois,
sur une petite rivière alors desséchée. En arrivant
au pont, le mécanicien s'aperçut qu'il était en
feu. En vain essaya-t-il de bloquer ses freins. Trop tard ! Le pont
s'écroula et tout le convoi fut précipité dans
le ravin.
Les flammes du pont qui éclairaient ce tableau sinistre ne tardèrent
pas à se communiquer aux débris des wagons amoncelés,
de sorte que les malheureux voyageurs qui n'étaient que blessés
risquaient de périr carbonisés.
M. Gossin cite cet incident dramatique : Une famille, le père,
la mère et l'enfant restaient pris sous les décombres.
Quand, au matin, on arriva pour les secourir : « Ne vous occupez
pas de moi, dit le père, sauvez ma femme ; quant à mon
enfant, je crois qu'il est mort. » La mère fut retirée,
mais des tronçons de bois brisé avaient pénétré
dans sa poitrine et elle expira dès qu'on les eut arrachés
; l'enfant était mort ; le père avait les deux jambes
brisées. « Je n'ai plus rien à faire dans cette
vie et, avant qu'on eût pu l'en empêcher, il saisit son
revolver et se fit sauter la cervelle.
Il y eut près de deux cents morts et autant de blessés.
En ramassant les uns et les autres, on s'aperçut que tous avaient
été dépouillés de leur argent, de leurs
montres et de leurs bijoux. On trouva même des cadavres auxquels
on avait coupé les doigts pour prendre les bagues. Et l'on apprit
alors que c'était une bande de malfaiteurs qui avaient mis le
feu au pont afin de provoquer la catastrophe et de pouvoir piller à
leur aise les morts et les blessés.
***
En Europe, le plus tragique accident qu'on ait eu à déplorer
dans ce genre, est celui du pont de la Tay, survenu en Ecosse le 28
décembre 1879
Ce viaduc de la Tay se trouvait au delà de Dundee, presque à
l'embouchure de la rivière. Il avait trois kilomètres
de de long. Le jour où se produisit la catastrophe, une effroyable
tempête soufflait sur la côte. Le train venant d'Édimbourg
et se dirigeant vers Dundee contenait environ deux cents voyageurs.
Il était 7 heures 1/2 du soir quand il aborda le viaduc.
L'employé de service, à l'entrée du pont, le vit
passer devant lui et le suivit du regard comme il faisait chaque soir.
Tout à coup, les feux de l'arrière disparurent à
ses yeux. Inquiet, et ne recevant pas le signal qui devait lui annoncer
l'entrée du train en gare de Dundee, l'homme prit une lanterne
et s'engagea sur le pont. Malgré la pluie et le vent qui faisait
rage, il suivit la voie, obligé de se cramponner au parapet pour
n'être pas emporté. Tout à coup, le vide, apparut
à quelques pas devant lui. Une partie du tablier du pont s'était
écroulée, entraînant le train dans la rivière.
L'homme n'avait entendu aucun bruit. Le fracas de l'ouragan avait couvert
celui de la catastrophe. Quelques personnes placées sur la rive
opposée, racontèrent qu'elles avaient vu comme une étoile
filante tombant dans le fleuve. C'étaient les feux du train qui,
décrivant une courbe pendant la chute, leur avaient donné
cette impression.
Quant au train, enlizé dans la vase très épaisse,
dans laquelle il pénétra comme un projectile, on n'en
a jamais rien retrouvé. Ce fut la perte corps et biens dans toute
son horreur.
Depuis lors, les deux accidents les plus graves de cette nature ont
eu lieu chez nous, dans la même région, et sur le même
réseau, celui de l'État.
Le 4 août 1907, par un beau dimanche, un train chargé de
promeneurs qui s'en venaient d'Angers et des environs passer une journée
à la campagne, dérailla sur le pont métallique
qui traverse la Loire aux Ponts-de-Cé, à quelques centaines
de mètres en amont des fameux ponts qui ont donné leur
nom à la petite ville. Soudain, on entendit un terrible craquement.
La locomotive tombait sur le tablier du pont et celui-ci, cédant
sous le poids, s'effondrait. La machine, le tender, le fourgon et une
voiture de 3e classe tombèrent dans le fleuve qui, à cet
endroit, a une profondeur de trois à quatre mètres. La
voiture de 3e classe était pleine de voyageurs, et cinquante
malheureux se débattaient sous l'eau.
Quand on put leur porter secours, quand les riverains arrivèrent
dans des barques à l'endroit où le wagon était
submergé, il était trop tard : la mort avait fait son
oeuvre. Sous l'action du courant, les cadavres, un à un, se détachaient
de l'îlôt à peine visible formé par les débris
du train et s'en allaient au fil de l'eau.
Après cette catastrophe, on eût pu croire que tous ces
ponts du réseau de l'État, construits autrefois, au temps
des locomotives légères, et pour un trafic infiniment
moins important que celui d'à présent, seraient examinés,
consolidés, refaits entièrement, même, s'il était
nécessaire. On pouvait croire que la vigilance administrative
s'exercerait pour empêcher le retour de pareille catastrophe.
Il n'en fut rien. Et l'affreux accident du pont de Montreuil-Bellay
est une nouvelle conséquence d'une incurie que rien ne saurait
excuser.
Et ce n'est pas tout. Après les Ponts-de-Cé, après
le pont de Montreuil-Bellay, faudra-t-il s'attendre à d'autres
catastrophes ? De toutes parts, on signale d'autres ponts des chemins
de fer de l'État qui menacent ruine ou sont trop faibles pour
supporter les charges excessives qu'on leur impose. L'anxiété
règne chez toutes les personnes obligées de voyager sur
ce réseau maudit.
Attendra-t-on que d'autres ponts s'effondrent, faudra-t-il encore le
sacrifice d'autres vies humaines, pour qu'on décide enfin et
les travaux et les sanctions également nécessaires ?...
Ernest LAUT.
Le Petit Journal illustré du 10 décembre 1911