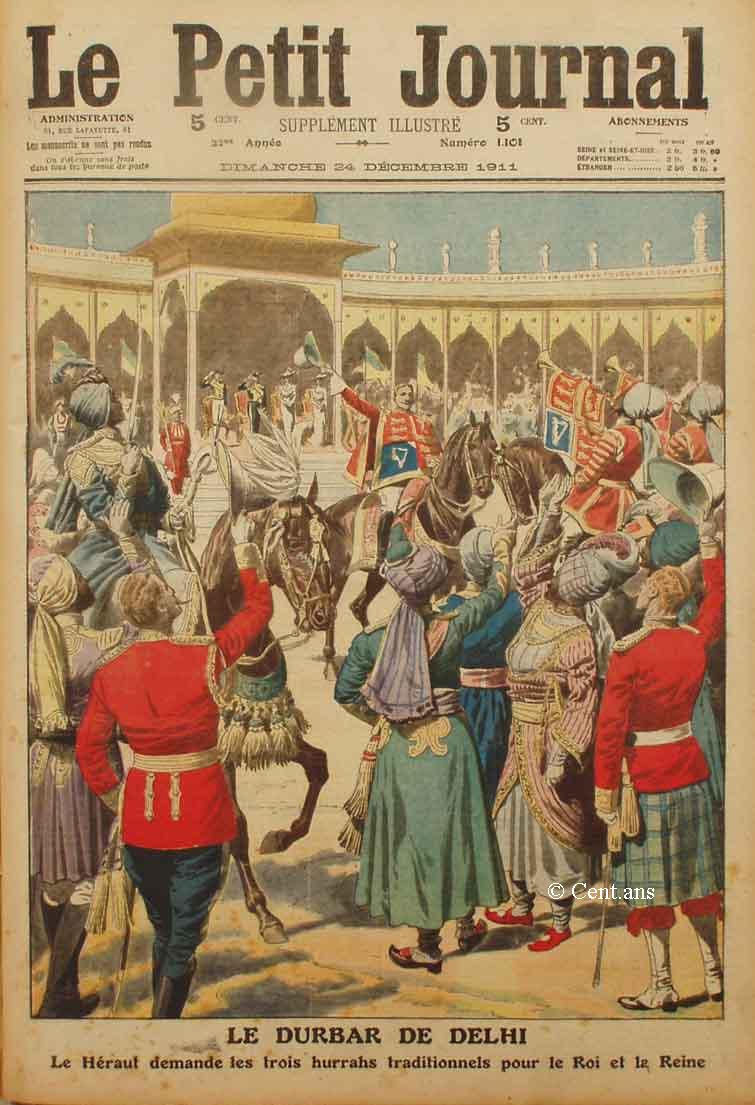LE DURBAR DE DELHI
Le Héraut demande les trois hurrahs
traditionnels pour le Roi et la Reine
Le Durbar de Delhi a eu lieu le 12 décembre
avec une grandiose solennité.
Dans l'immense plaine du durbar se pressait la foule pittoresque venue
de tous les points de l'Inde.
Après que « 35 catégories différentes »
de fonctionnaires et grands personnages hindous eurent prêté
hommage, l'Empereur Roi et l'Impératrice-Reine se rendirent processionnellement
au Pavillon Royal. Après d'éclatantes sonneries de trompettes,
les Hérauts d'armes et les trompettes à cheval firent
face au Pavillon Royal, et le Héraut Impérial lut en anglais
la Proclamation annonçant le couronnement de Sa Majesté
à Londres le 22 juin. Elle fut ensuite lue en Urdu. Nouvelles
sonneries, les troupes présentèrent les armes, nouvelle
salve de cent un coups de canon, « feu de joie » par les
troupes à pied. Nouvelle sonnerie. Le Héraut leva alors
son casque et demanda trois hurrahs pour leurs Majestés, le général
commandant les troupes fit de même pour les soldats. Nouvelle
sonnerie, et le Maître des Cérémonies déclara
le Durbar terminé. Tous les cortèges s'en furent avec
la même pompe.
VARIÉTÉ
Les Splendeurs de l'Inde
Le pays des merveilles.- Une grande civilisation .- Durbars de naguère et d'aujourd'hui. - Les éléphants.
L'lnde fut de tout temps le pays des merveilles.
Dix siècles avant l'ère chrétienne, alors que notre
pauvre Europe était encore plongée dans les ténèbres
de la barbarie, ce pays jouissait déjà de tous les bienfaits
d'une civilisation avancée. Six cents ans avant J.-C. cette civilisation
avait même atteint son apogée, et le pays était
en proie à cette décadence morale qu'amènent fatalement
l'excès du bien-être et des richesses, et dont la plupart
des nations européennes souffrent aujourd'hui. C'est même
cet état avancé de la civilisation hindoue qui suscita
la réforme plus morale que religieuse du Bouddhisme. Car le Bouddha
était bien plutôt qu'un prophète, un moraliste préoccupé,
non de créer une religion, mais de ramener les peuples de l'Inde
à la simplicité des moeurs et à la vertu.
A l'époque où nos ancêtres vivaient dans des huttes
et des cavernes, l'Inde comptait des villes immenses toutes peuplées
de palais de marbre. Les hautes castes des Brahmanes et des Kshatryas,
c'est-à-dire des prêtres et des guerriers, étaient
éminemment polices ; la femme, loin d'être comme dans nombre
de civilisations anciennes, réduite au rang d'esclave, était,
au contraire, dans l'Inde antique, entourée de respect. La science
et la poésie lui étaient également familières.
La peinture et la sculpture créaient des chefs-d'oeuvre ; quant
à l'architecture, les ruines qui subsistent encore de ce lointain
passé suffisent à en attester l'originalité, la
richesse, la splendeur. La littérature avait produit déjà
les plus somptueux poèmes qui soient sortis de l'imagination
des hommes.
L'art du théâtre même était arrivé
à un degré de perfection dont nous pouvons nous rendre
compte, car d'anciennes pièces hindoues sont venues jusqu'à
nous. Et ces drames, tels Sacountala ou le Chariot de Terre
cuite sont des oeuvres d'une puissance comparable à celle
des plus fameux chefs-d'oeuvre des littératures dramatiques de
l'Europe.
Rousselet, dans son célèbre ouvrage sur l'Inde des
Rajahs, a noté cette antériorité de la civilisation
hindoue sur toutes les civilisations européennes, de même
que l'ancienneté des familles royales qui occupent la plupart
des trônes de l'Inde.
« Si l'on compare, dit-il, l'antiquité et l'illustre origine
des dynasties qui ont régné ou qui règnent encore
sur les différents royaumes du Rajesthan, avec les plus célèbres
de l'Europe, il est aisé de voir que la supériorité
sur ce point reste incontestablement aux Rajpouts. Déjà
maîtres d'un immense empire dans les premiers siècles de
notre ère, nous les voyons encore régner sur de vastes
et riches contrées, au milieu de villes embellies de superbes
monuments, dans le même temps où quelques peuplades incultes
de l'occident élèvent leur premier souverain sur le pavois...
»
Or, l'Inde a gardé à travers les siècles les traditions
somptueuses de son antique civilisation. Rien n'a pu les abolir, ni
l'invasion du mahométisme, ni la conquête européenne.
L'Inde est restée aujourd'hui, comme aux temps qui précédèrent
le Bouddhisme, le pays de toutes les magnificences et de toutes les
splendeurs.
***
Le Durbar qui vient de se tenir à Delhi en l'honneur du roi et
de la reine d'Angleterre en est un éclatant témoignage.
Mais, me direz-vous, qu'est-ce qu'un durbar ?
Demandez-le à un de nos confrères, M. Chauvelot, qui a
longuement voyagé dans l'Inde et assisté à quelques
durbars.
Un Durbar hindou, dit-il, c'est mieux qu'une fête et
encore beaucoup mieux qu'un gala. A vrai dire, le vocable hindoustani
demeure intraduisible... comme intraduisible bien souvent l'ésotérisme
des brahmanes et des bonzes bouddhiques !
» Le Durbar procède à la fois de la fête
religieuse, de la fête militaire et de la fête mondaine.
Le peuple est admis seulement aux deux premières. Et c'est pour
lui l'occasion de grandes réjouissances : danses, spectacles
dramatiques et surtout festins... le tout « aux frais de la princesse
» quand le souverain est une Bégum, comme à Bhopal,
ou bien « aux frais du prince quand le dispensateur de ces largesses
est un nabab musulman, comme le Nizzam d'Hyderabad, ou un Maharajah
hindou, comme S. A. Jagaiit Singh, à Kapurthala.
» Lorsque ces festivités sortent du cadre national au delà
des frontières des États indépendants, lorsqu'elles
deviennent impériales, -disons anglaises, - la « douloureuse
» atteint un chiffre exorbitant, elle devient l'occasion de prodigalités
ruineuses... Témoin le grand Durbar de Delhi, en 1903,
qui coûta au gouvernement anglo-indien la somme de 200.000 livres
sterling (cinq millions de francs) et à propos duquel le vice-roi
d'alors, lord Curzon, qui faisait bien les choses, dépensa de
sa cassette particulière la somme coquette de 15.000 livres (425.000
francs).
Et M. Chauvelot conclut :
» Ceci prouve que l'Inde d'aujourd'hui n'a pas démérité
d'elle-même, et que toujours elle demeure la terre, peut-être
unique, des splendeurs, des ruissellements et des éblouissements...
»
Le premier grand durbar impérial qui eut lieu dans l'Inde se
tint à Agra, en l866. .
Auparavant, les représentants anglais de la Compagnie des Indes
avaient à diverses époques présidé des Durbars
où s'étaient trouvés réunis un certain nombre
de rois hindous alliés ou vassaux de l'honorable compagnie, mais
en 1866, le vice de l'Inde, qui était alors sir John Lawrence
avait pour mission de représenter non plus une compagnie de marchands
anglais, mais la reine Victoria, qui portait depuis 1858 le titre d'impératrice
des Indes.
En 1857, une terrible révolte avait bouleversé l'Inde.
L'Angleterre l'avait vaincue.. Neuf années de calme et de prospérité
venaient de s'écouler, pendant lesquelles la puissance anglaise
s'était affermie. Vingt-six princes souverains et un très
grand nombre de feudataires puissants avaient répondu à
l'appel du vice-roi. Un seul refusa d'assister au durbar. C'était
le Maha Raina d'Oudeypour. Lui dont les ancêtres n'avaient jamais
courbé la tête devant un vainqueur, lui qui portait parmi
ses innombrables titres celui de « Soleil des Hindous »
devait-il sacrifier l'honneur de vingt siècles devant l'orgueil
britannique ? Pouvait-il venir se mettre aux pieds, d'un Anglais ?
On n'osa pas insister pour obtenir sa présence. Mais à
l'occasion du durbar, devaient être distribués aux principaux
souverains le grand cordon d'un ordre : l'Étoile de l'Inde. On
ne pouvait oublier le Maha Rana, et, puisqu'il ne venait pas, on lui
envoya le sien. Nouveau refus.
- Mes ancêtres, répondit l'orgueilleux rajah, n'ont jamais
porté d'emblème de servitude.
Et il renvoya le grand cordon à Agra.
Eh bien, l'Angleterre ne fit pas d'éclat. Elle est patiente et
confiante en ça force. Avec raison. Aujourd'hui tous les princes
hindous ont accepté sa suprématie, et c'est avec enthousiasme
qu'ils se précipitent à toutes les manifestations en l'honneur
de la puissance anglaise.
Au second grand durbar impérial qui se tint à Delhi en
1877, tous étaient là.
« Jamais peut-être, écrivait alors un journaliste
français qui assista à ces fêtes, jamais , peut-être,
l'auguste capitale de l'Hindoustan n'avait vu pareille affluence de
maharajahs, rajahs, maharanas, ranas, maharaos et nawabs, pas même,
dit-on, sous les règnes des illustres empereurs Chah Djahan,
Aureng Zeb et Djahan Ghir. Tous les princes alliés et vassaux
à divers degrés de la Grande-Bretagne dans la péninsule
hindoue, jouissant encore d'une certaine indépendance, avaient
répondu à l'appel du vice-roi, sauf deux ou trois petits
chefs dont l'absence équivalait sans doute à une disgrâce,
et les royaumes conquis et cédés étaient représentés
par leurs gouverneurs anglais, plus puissants que bien des rois dans
le reste du monde..»
Cette fois le Maha Rana d'Oudeypour était venu sans se faire
prier. En l'espace de onze ans, l'habile diplomatie anglaise avait triomphé
de son orgueil et de ses scrupules, et le « Soleil des. Hindous
» avait pâli devant la puissance britannique.
A côté de lui, à côté du roi de Cachemire,
du maharajah Scindia de Gwalior, du gaïcovar de Baroda, de la Bégum
de Bhopal, des rois d'Indore, de Mysore, de Djaïpour, etc., on
voyait le riche nizzam du Deccan, roi de Haïderabad, qui, deux
années auparavant, malgré les efforts des agents politiques
anglais, n'avait même pas voulu se déranger pour aller
saluer le prince de Galles, lors du voyage que le futur Édouard
VII avait fait dans les Indes.
On peut juger par là de l'habileté avec laquelle la politique
anglaise sut de tout temps poursuivre son oeuvre en ce pays des Indes.
***
On se rappelle ce que fut le dernier grand durbar, celui du 5 janvier
1903, pour la proclamation d'Édouard VII, empereur des Indes.
Dans la plaine de Delhi, cent mille tentes avaient été
dressées ; elles abritaient trois cent mille hommes, venus de
tous les points de l'immense empire.
Six cent trente rajahs, défilèrent devant le vice-roi
lord Courson et le duc de Connaught qui représentait le roi d'Angleterre.
On vit passer des rois couverts d'or et de pierreries, comme des souverains
de légende. Le Marajah d'Alwar parut dans sa voiture toute ornée
de sculptures d'argent, traînée par quatre éléphants
dont les défenses d'ivoire étaient plombées d'or
massif. Le marajah de Patiala conduisait lui-même son char d'or
dont les portières sont incrustées de dessins de pierreries.
Le maharajah de Kishangara était précédé
de sa meute de faucons apprivoisés, derrière lesquels
quatre hommes portaient la trompette de ses aïeux, une immense
trompe d'argent de trois mètres de long, dont le son, dit la
légende, égale en puissance le bruit du tonnerre. Le marajah
de Karauli vint dans sa voiture traînée par des dromadaires
aux cous cerclés de topazes. Le marajah de Baroda se présenta
dans un palanquin d'ivoire porté par vingt femmes couvertes d'améthystes.
Et l'on vit dans le cortège, mille autres splendeurs du même
genre.
Une ligne immense d'éléphants, fermait la plaine de Delhi.
Quand apparurent le duc et la duchesse de Connaught sur le terrain du
Durbar, les hérauts firent un signe de leurs bâtons, et
la muraille d'éléphants s'écroula d'un seul coup.
Toutes les bêtes étaient tombées à genoux.
Ce jour-là les représentants des souverains anglais montèrent
sur des éléphants « Le vice-roi et lady Curzon,
suivant ce que rapporte un de nos confrères qui assista à
cette fête merveilleuse, prirent place sur une bête énorme,
célèbre dans toutes l'Inde et qui appartenait au rajah
de Bénarès . On l'appelait Luchman Prosad. Le
duc et la duchesse de Connaught furent placés sur le seul rival
connu de Luchman Prosad, Mula Bux, appartenant au
rajah de Djaïpour, Puis les souverains de l'Inde, également
montés sur leurs éléphants, firent la haie. Quand
les deux couples anglais furent engagés entre ces remparts vivants,
les hérauts firent un nouveau signe. Et les grands éléphants
saluèrent. Ils saluèrent en barrissant et en rejetant
leurs trompes en l'air.
» Puis la double muraille se referma. s'ébranla, et ce
fut un défilé comme on n'en avait peut-être pas
vu depuis le temps du Grand Mogol.
» Chacune des énormes bêtes qui, marchant par couples,
portaient avec lenteur les souverains de l'Inde était couverte
jusqu'à terre de soies précieuses. Ces étoffes
rutilaient de pierreries ou de broderies d'or. Les défenses étaient
ornées d'anneaux d'or et émaillées en toutes couleurs.
Sur son front puissant chaque éléphant portait une énorme
plaque d'argent travaillé. De longues chaînes de métaux
précieux. ou de gemmes, pendaient de ses oreilles. Des cloches
d'église sonnaient à son cou. Sur son dos, il portait
un howdah ou vaste siège d'or et d'argent, quelque chose
comme un trône qui marche où le rajah, ruisselant de diamants,
se trouvait assis.»
Ce dut être un spectacle d'une prodigieuse grandeur.
Or, ce spectacle ne s'est pas renouvelé cette fois et ne se renouvellera
plus, paraît-il. On a enlevé au durbar cet attrait en exilant
désormais les éléphants.
Dès que la population hindoue apprit qu'on avait décidé
cette suppression, elle manifesta tout haut son émotion et un
vif mécontentement. Elle tenait en effet à la tradition
fastueuse et à la collaboration des éléphants.
L'autorité anglaise jugea donc utile de lui donner de bonnes
raisons pour la calmer, et elle chargea de ce soin un écrivain
hindou.
Voici l'explication donnée par lui :
« Une procession d'éléphants est chose des anciens
temps, d'une époque où l'on attachait peu de prix à
la vie humaine.
» Aux jours d'autrefois, les rajahs employaient des brahmanes
pour conduire leurs éléphants. Seuls, le sacrés
brahmanes semblaient dignes de s'asseoir en tournant le dos aux rois
et aux chefs. Mais, maintenant, la coutume de monter sur les éléphants
a presque complètement disparu. Il serait donc très difficile
pour l'empereur-roi de découvrir un saint évêque,
entièrement versé dans l'art de manier un éléphant
et qui, d'après l'étiquette d'Orient, aurait, seul, le
droit de tourner le dos à Sa Majesté Impériale.
» De plus, l'éléphant est une bête sur laquelle
on ne peut point compter.. Une foule nombreuse, le fracas des canons,
ou un subit accès de colère lui font perdre la tête,
qui constituerait un grand péril pour des milliers de vies humaines.
Aussi notre bon et gracieux souverain a-t-il agi très sagement
en décidant de ne pas recourir à un animal aussi dangereux.
Une telle décision de sa part trouve l'intérêt et
toute la sollicitude qu'il porte aux vies de ses fidèles sujets.
»
Les Hindous ne pouvaient que se rendre à d'aussi bonnes raisons.
Puisque c'est dans leur intérêt qu'on a pris le parti de
supprimer les éléphants du durbar, ils ne peuvent qu'en
remercier leur gracieux souverain. Mais il paraît qu'ils eussent
souhaité qu'on leur marquât un peu moins de sollicitude
et qu'on leur rendit leurs éléphants.
Ernest LAUT.
Le Petit Journal illustré du 24 Décembre 1911