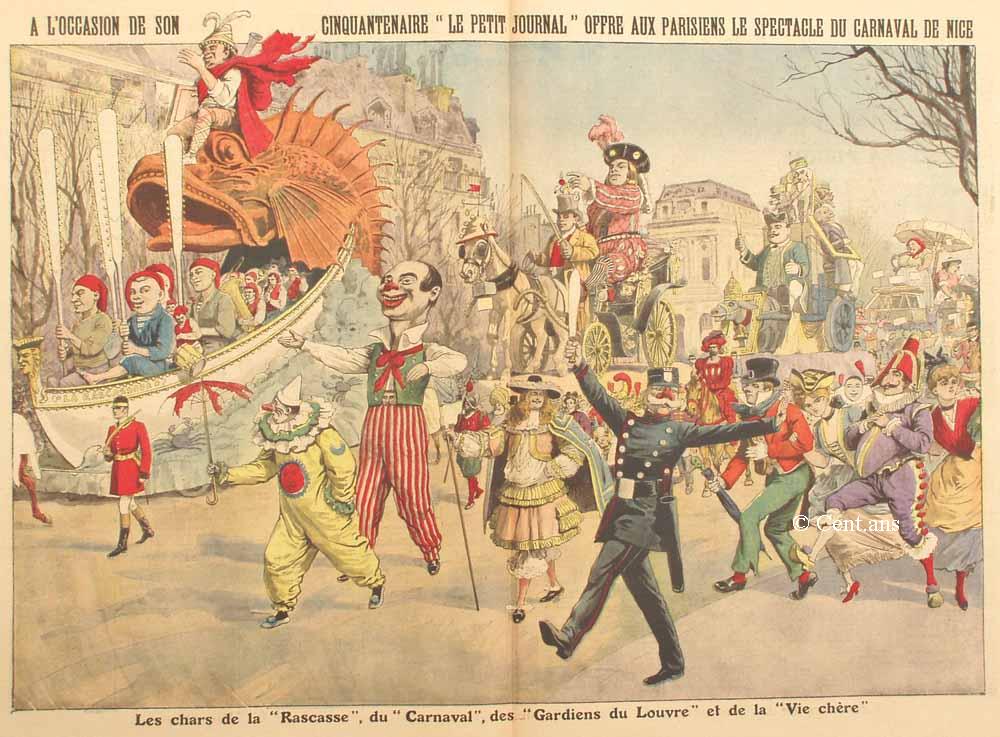Le Cinquantenaire du “Petit Journal ”
Un demi-siècle de succès.
- Le journalisme avant le « Petit Journal .». -L'idée
de Polydore Millaud.- Timothée Trimm. - L'oeuvre de Marinoni.
- Comment le Petit Journal a voulu fêter son cinquantenaire.
Le Petit Journal vient d'atteindre
son cinquantenaire ; et c'est, pour fêter ce demi-siècle
de succès, qu'il offre, à Paris le superbe spectacle du
carnaval de Nice transporté sur les rives de la Seine.
Il a voulu que le Paris d'aujourd'hui fût associé à
l'anniversaire d'un des événements qui marquèrent
le plus profondément dans la vie du Paris de naguère.
Car la fondation du Petit. Journal, il y a cinquante ans, est
autre chose, qu'un simple épisode dans l'histoire de la presse
française, c'est une date mémorable qui marque une véritable
révolution non pas seulement dans le journalisme, mais encore
à dans les moeurs.
Les générations actuelles ne peuvent imaginer ce qu'était
la presse avant l'apparition du journal à cinq centimes, du journal
populaire mis à la portée de toutes les bourses.
La presse ne jouissait d'aucune liberté.
Des législateurs ombrageux lui avaient fait un code bizarre et
l'avaient reléguée hors du droit commun. Son état
était un état d'exception. Le gouvernement ne souffrait
d'elle rien qui pût non pas même le blesser, mais simplement
l'égratigner.
On exigeait des journaux de lourds cautionnements ; une censure jalouse
les surveillait de près ; à la moindre critique, à
la plus petite allusion politique, les amendes tombaient sur eux dru
comme grêle ; à la récidive, c'était l'interdiction.
Défense était faite de colporter les feuilles périodiques
et de les vendre sur la voie publique ; les chemins de fer ne pouvaient
en assurer le transport en colis, Pour lire un journal, il fallait être
abonné, et de coûteux tarifs postaux faisaient monter,
l'abonnement à un taux exorbitant
C'est assez dire que la masse du peuple, les ouvriers, les employés,
les petits bourgeois étaient condamnés à ne point
lire de journaux: Les gens aisés eux-mêmes y regardaient
à deux fois avant de s'abonner à un journal. Les uns allaient
lire la gazette au cabinet de lecture ; d'autres s'entendaient entre
voisins pour prendre un abonnement à quelqu'une des grandes feuilles
qui se vendaient cinq, quatre, ou trois sous le numéro, et, moyennant
une quote-part de trois, cinq ou dix francs, suivant le nombre des associés,
on pouvait lire le journal qui circulait ainsi de mains en mains.
***
Il semble que, dans de pareilles conditions, c'eût été
folie de vouloir créer le journal bon marché, le journal
destiné au peuple et dont l'existence eût été
subordonnée à l'espoir des gros tirages.
Un homme pourtant eut cette idée et parvint à la réaliser.
Il s'appelait Polydore Millaud. Financier habile, il avait auparavant
lancé quelques feuilles qui, pour la plupart, n'avaient pas résisté
longtemps aux difficultés et aux tracasseries que le gouvernement
et l'administration multipliaient contre les journaux.
Le Petit Journal fut plus heureux. Millaud n'avait, en le créant,
d'autre intention que de donner au peuple tous les jours un écho
de la vie nationale. Informations, faits divers, chroniques inspirées
par les événements d'actualité, causeries sur le
théâtre, variétés, romans, mais pas de politique...
La politique c'était la mort certaine. Et il fallait vivre.
Le Petit Journal vécut.
J'ai là, sous les yeux, son premier numéro. Qu'il est
petit comparé à notre Petit Journal d'aujourd'hui
!. Déjà la mise en pages en est claire et bien ordonnée
: c'est une qualité que le Petit Journal a su garder
de tout temps.
J'y vois un extrait du Moniteur ou gazette officielle, annonçant
que le pain blanc, se vend à Paris 36 centimes le kilo et le
pain bis 28 centimes. Viennent ensuite les échos, les nouvelles
des départements et de l'étranger, les tribunaux, les
théâtres : une variété sur « Un voyage
au long cours dans les rues de Paris », les nécrologies,
le programme des spectacles, la mercuriale des marchés. Le feuilleton
intitulé : Une assurance sur la vie; est signé
Charles Dickens.
Bientôt, les noms les plus célèbres de la littérature
et du journalisme flamboient au bas des colonnes du Petit Journal.
On y lit d'étincelantes chroniques de Jules Janin, de Charles
Monselet, d'Emile Souvestre, d'Alexandre Dumas, d'Emmanuel Gonzalès,
d'Etienne Enault, de Pitre-Chevalier.
Dès l'année 1864 Timothée Trimm y fait. chaque
jour sa chronique... Timothée Trimm !... Les vieux lecteurs du
Petit Journal ont conservé à coup sûr le
portrait, qui fut vendu alors par milliers d'exemplaires, de notre célèbre
chroniqueur. L'un d'eux m'envoyait il y a quelques jours ce précieux
document. On y voit Timothée Trimm, vêtu de son fameux
partalonà la houzarde, de sa redingote et de son classique gilet
de velours que barre une longue chaîne de montre, Timothée
Trimm, pittoresque et chevelu, tenant d'une main le Petit Journal
et de l'autre un sou, un petit sou, prix de la feuille populaire qui
déjà gagnait les provinces, pénétrait jusque
dans les plus humbles logis, et, franchissant les frontières,
portait à l'étranger un écho de la vie française
et du génie parisien.
Au 1er mars, deux ans, après sa naissance, le Petit Journal
tirait déjà à plus de 190.000 exemplaires. Le 1er
mai suivant, il atteignait les 200.000.
Tout ce que la presse compte d'illustre collabore alors au Petit
Journal Méry, poète, romancier, chroniqueur, y dépense
sans compter les trésors de sa verve inépuisable ; Lamartine,
Sandeau, Léon Gozlan, Alphonse Karr y publient des variétés.
Et voici que le Petit Journal va donner naissance à
une forme littéraire nouvelle : le grand roman populaire, le
roman aux péripéties inattendues pour lequel la France
entière va se passionner.
***
Qui n'a entendu parler de Rocambole, de ce fantastique Rocambole
dont les extraordinaires aventures enflammèrent , alors toutes
les imaginations. Rien ne peut donner une idée du retentissement
qu'eut le roman de Ponson du Terrail publié par le Petit
Journal. Dans Paris on ne rencontrait que des gens lisant Rocambole.
On ne parlait que de Rocambole : si bien que Rocambole est resté
dans le langage courant et qu'on dit encore et qu'on dira toujours d'une
aventure extraordinaire, où il y a de l'étrangeté,
de l'audace, du fabuleux, d'une aventure qui confond l'imagination,
que c'est une aventure « rocambolesque ».
Après Ponson du Terrai, le Petit Journal va révéler
d'autres romanciers dont le succès ne sera pas moindre. Et, d'abord,
Émile Gaboriau
Que de gens, aujourd'hui, s'imaginent que nous devons à l'Angleterre
et à l'Amérique la révélation du roman policier
dont la vogue s'est si vivement manifestée depuis quelques années.
C'est la pure erreur. Le roman policier, comme tant d'autres formes
de la littérature, est né chez nous.
Consultez vos parents. Ils n'ont certainement pas oublié des
romans publiés au Petit Journal par Émile Gaboriau
vers 1865 : l'Affaire Lerouge, le Crime d'Orcival et surtout cet étonnant,
ce merveilleux Monsieur Lecoq, le chef-d'oeuvre du genre, Monsieur
Lecoq qui devint non moins populaire parmi les lecteurs du Petit
Journal que l'avait été naguère Rocambole.
Les Anglais et les Américains ont renouvelé le genre du
roman policier. Nous pouvons admirer leurs oeuvres, mais nous ne devons
pas oublier qu'avant Sberlock Holmes il y a eu Monsieur Lecoq.
Ainsi le Petit Journal poursuivait ses heureuses destinées.
A tant de noms illustres dans la presse venaient s'ajouter ceux de Pierre
Véron, qui faisait, et de façon magistrale, la chronique
humoristique ; et d'Edmond About chargé du compte-rendu des expositions
de Beaux-Arts.
Timothée Trimm continuait d'une plume aussi alerte qu'infatigable
sa chronique de chaque jour.
Comment cet homme étonnant, disaient les lecteurs, peut-il trouver
chaque jour un nouveau sujet ? Un jour, Émile de Girardin posa
la question à l'inépuisable chroniqueur.
- C'est bien simple, lui répliqua Timothée Trimm en riant,
c'est bien simple, je parle de tout ce que je ne connais pas. Vous voyez
que le champ est vaste.
Mais ce que le prodigieux journaliste n'ajoutait pas c'est que sur toutes
les choses qu'il ne connaissait pas, il savait se documenter parfaitement
avant d'écrire et que, doué de la plus merveilleuse faculté
d'assimilation, il en parlait ensuite avec la plus parfaite compétence.
***
Se souvient-on encore de l'affaire Troppmann ? Toute une famille alsacienne,
la famille Kinck, assassinée et trouvée enfouie dans un
champ aux portes de Paris. Seul le père Kinck n'est pas parmi
les victimes. La police en conclut qu'il est l'assassin. Ce crime horrible
passionne la France entière.
Le Petit Journal inaugure alors un genre de reportage nouveau
et qui est aujourd'hui pratiqué de façon constante par
maints grands journaux d'informations. Parallèlement à
l'enquête, de la police, il conduit la sienne. Ses meilleurs reporters
se mettent en quête. Bientôt, par ses découvertes
et ses révélations, l'affaire s'éclaire ; les agents
de la Sûreté retrouvent le cadavre du père Kinck
enfoui dans un bois en Alsace, la police est mise sur la trace du vrai
coupable et Troppmann est arrêté.
Cette sensationnelle affaire fit monter le tirage à plus de 400.000
exemplaires.
Mais la guerre va arrêter l'essor du journal populaire. Le Petit
Journal, cependant, en dépit des difficultés de l'heure,
ne ralentit pas un instant son activité. Des éditions
sont organisées en province : à Bordeaux, à Lyon,
à Caen. A Paris, le Petit Journal ne fut pas un jour
sans paraître. On tira sur des papiers de tous les formats, de
toutes les couleurs, mais on parut tout de même et la vie du journal
fut assurée.
Le directeur Polydore Millaud, épuisé par une existence
dévorante, s'étant retiré, la direction passe à
Émile de Girardin; le plus étonnant journaliste du siècle,
l'homme qui avait une idée par jour.
Marinoni, bientôt succède à Girardin, à et
c'est à lui que le Petit Journal va devoir son éclatante
prospérité.
Polydore Milland avait commencé la grande réforme du journalisme
moderne en créant le journal à un sou ; Marinoni l'acheva
en inventant la machine rotative grâce à laquelle furent
atteints bientôt les tirages formidables de plus d'un million
d'exemplaires.
Ainsi, c'est dans cette maison du Petit Journal que s'accomplit
entièrement ce progrès. Aujourd'hui, sous la direction
de M. Charles Prevet, le Petit Journal poursuit son oeuvre,
toujours jeune en dépit de son demi-siècle, et toujours
fidèle à ses traditions d'indépendance.
Par le concours de ses dix mille correspondants, il reçoit chaque
jour des nouvelles de tous les pays ; chaque jour, par le canal de ses
vingt-cinq mille dépositaires, il pénètre jusque
dans les moindres villages, jusque dans les plus lointaines contrées
du monde.
Au cours du demi-siècle écoulé, il a été
associé à tous les progrès de la science et de
l'industrie française ; le premier il a concouru à vulgariser
la bicyclette, l'automobile ; ses initiatives pour le développement
de l'aviation sont trop près de nous pour qu'il faille y insister.
Bref, à l'instant où il offre à Paris un peu de
joie pour fêter son cinquantenaire, il peut considérer
avec une légitime fierté ce passé fécond,
ce passé de labeur et de loyauté, et se glorifier à
juste titre d'avoir été l'instrument d'un des plus merveilleux
progrès accomplis par l'intelligence humaine.
Ernest Laut.
Le Petit Journal illustré du 17 Mars 1912