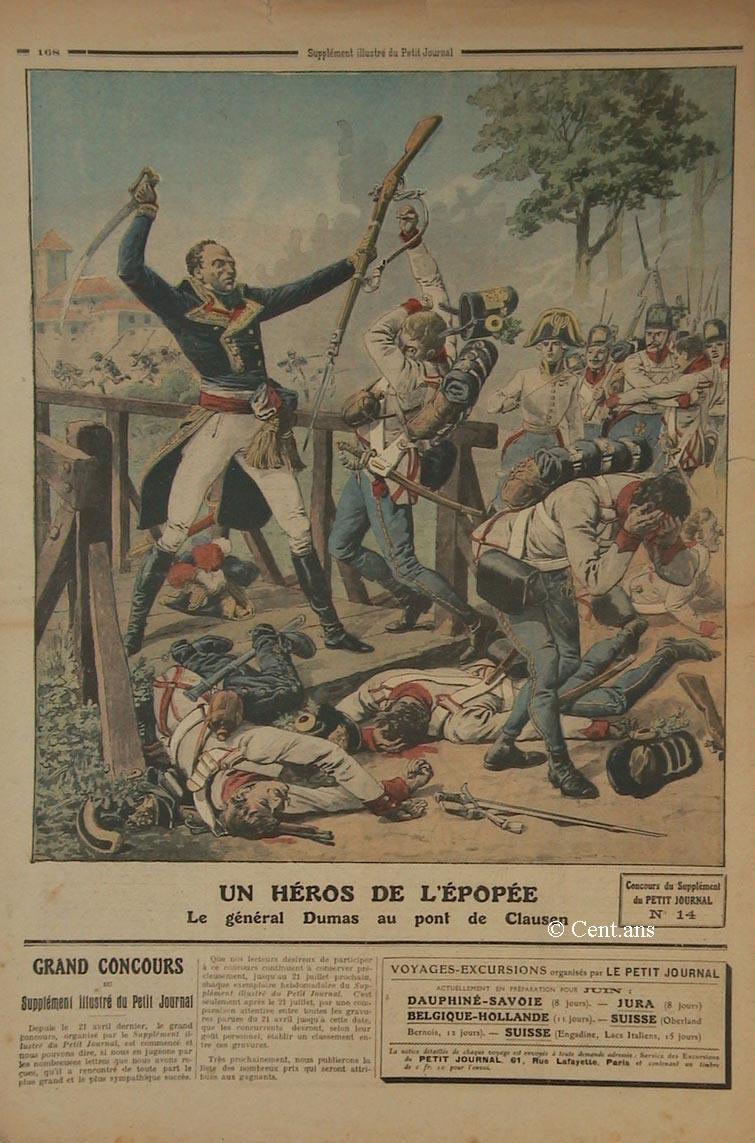UN HÉROS DE L'ÉPOPÉE
Le général Dumas au pont de Clausen
Sur la place Malesherbes à Paris, se
trouvent déjà deux statues, l'une d'Alexandre Dumas père,
l'auteur immortel des Trois Mousquetaires, de Monte-Cristo,
de cent autres romans fameux et d'un non moins grand nombre de pièces;
dont plusieurs sont des chefs-d'oeuvre; l'autre, d'Alexandre Dumas fils,
l'inventeur, pourrait-on dire, du théâtre à thèse,
du théâtre social, l'un des plus puissants tempéraments
dramatiques de tous les temps.
Il manquait encore, pour compléter l'ensemble, la statue du troisième
Dumas, ou plutôt du premier, le général, le héros
du camp de Maulde, du Mont-Cenis, du Tyrol, de la révolte du
Caire.
Celui-ci, n'a pas écrit de drames. Il s'est contenté de
vivre le plus étonnant de tous, le drame des guerres de la Révolution
; il en a été l'un des principaux acteurs. Et, n'eût-il
pas donné à la France deux de ses plus grands génies
littéraires, qu'on lui devrait l'hommage d'une statue pour l'héroïsme
dépensé par lui au service du pays.
Cette statue sera érigée bientôt; et ce jour-là,
la place Malesherbes changera de nom pour s'appeler Place des Trois-Dumas.
Nous avons voulu joindre notre hommage à celui que Paris s'apprête
à rendre au vaillant soldat et nous avons dans notre «
Variété », résumé sa glorieuse carrière,
en même temps que nous faisions revivre par le talent du dessinateur
militaire, Louis Bombled, l'une des pages héroïques de l'histoire
du général Dumas : la Défense du pont de Clausen.
VARIÉTÉ
Les premier des Dumas
L'ancêtre glorifié après ses descendants. - Général en chef à trente et un ans. - Le Diable Noir. - Dumas au pont de Clausen.- La. révolte du Caire. - Une statue bien méritée.
On va lui élever un monument près
de ceux de son fils et de son petits-fils. La gloire de l'ancêtre
est servie après celle de ses descendants. C'est qu'il vécut
en un temps où l'héroïsme militaire courait les champs
de bataille. Les traits de vaillance accomplis alors par les soldats
de France étaient si nombreux que les annalistes avaient à
peine le temps d'en fixer le souvenir.
Et puis, un seul homme alors prenait pour lui toute la gloire. Les autres,
quelle que fait leur vaillance, restaient dans la pénombre. De
tous les compagnons d'armes de Bonaparte, combien eussent été
illustres en d'autres temps, et qui demeurèrent ignorés,
rejetés dans l'oubli par l'éclatante renommée de
« l'homme prédestiné ».
Combien de ces héros de l'épopée moururent pauvres,
n'ayant eu d'autre récompense que la satisfaction du devoir patriotique
accompli !... Quand il succomba à quarante et un ans, ayant commandé
en chef, trois armées, ayant risqué vingt fois sa vie
pour son pays, et semé sa carrière des faits d'armes les
plus héroïques, le général Dumas n'avait que
4.000 francs de pension , il ne possédait même pas ce ruban
de chevalier de la Légion d'honneur qu'on prodigue aujourd'hui
aux acteurs, aux petites dames de lettres et aux couturiers.
Si son fils et son petit-fils n'avaient pas illustré par leurs
écrits le nom plébéien qu'il avait choisi et qu'il
leur légua ; si le géant des lettres n'avait pas, dans
ses Mémoires; célébré les hauts
faits du géant de l'Epopée auquel il devait le jour ;
le général Dumas reposerait aujourd'hui complément
oublié dans le petit cimetière de Villers-Cotterêts
; et nul ne songerait à réveiller son souvenir.
Il méritait pourtant de survivre ; il le méritait par
sa propre valeur, par son héroïsme, par les services rendus
au pays, et par la noblesse et la grandeur des sentiments qu'il montra
dans la disgrâce.
Né à Saint-Domingue, de l'union du colonel marquis Davy
de la Pailleterie avec une négresse, Marie-Cessette Dumas, il
vint en France avec son père en 1780. Il avait alors dix-huit
ans. Quelques années, il vécut la vie joyeuse des jeunes
nobles d'alors; puis en 1786, son père s'étant marié
avec sa femme de charge, le jeune homme se brouilla avec lui et résolut
de s'engager.
Mais le vieux marquis, qui avait été colonel et commissaire
général de l'artillerie, s'opposa à ce que son
fils traînât son nom dans les derniers rangs de l'armée.
- Engagez-vous si vous voulez, lui dit-il, mais prenez un nom de guerre.
- Soit, répondit le jeune homme, je m'engagerai sous le nom de
ma mère.
Et c'est ainsi que le fils du marquis Davy de la Pailleterie fut enrôlé,
vers la fin de juin 1786, sous le nom de Thomas-Alexandre Dumas, dans
le régiment des dragons de la Reine, qui tenait alors garnison
à Laon.
« Mon père, dit Alexandre Dumas dans ses Mémoires,
avait alors vingt-quatre ans. C'était un des plus beaux jeunes
hommes qu'on put voir. Il avait ce teint bruni, ces yeux marrons et
veloutés, ce nez droit qui n'appartiennent qu'au mélange
des races indiennes et caucasiques. Il avait les dents blanches, les
lèvres sympathiques, le cou bien attaché sur de puissantes
épaules, et malgré sa taille de cinq pieds neuf pouces,
une main et un pied de femme...
« La liberté dans laquelle il avait vécu aux colonies,
avait développé son adresse et sa force d'une manière
remarquable ; c'était un véritable cavalier américain,
un gaucho. Le fusil ou le pistolet à la main, il accomplissait
des merveilles dont Saint-Georges et Junot étaient jaloux. Quant
à sa force musculaire, elle était devenue proverbiale
dans l'armée... »
Et le fils, enthousiaste, rapporte quelques traits de la vigueur paternelle.
A l'en croire, le futur général s'amusait parfois, au
manège, quand il passait à cheval sous une poutre, à
prendre cette poutre entre ses bras et à enlever son cheval entre
ses jambes. A l'armée des Alpes, où il commandait en chef,
il vit, un soir, au bivouac, un soldat qui le doigt passé dans
le canon d'un fusil de munition, tenait ce fusil à bras tendu..
- C'est bien, dit le général, mais apportez-moi donc trois
autres fusils.
Et, passant ses quatre doigts dans les canons il leva les quatre fusils
avec autant de facilité que le soldat en avait levé un
seul.
Cette force musculaire était mise au service, d'un sang-froid,
d'une audace extraordinaires. En 1792, aux environs du camp de Maulde,
Dumas, brigadier, à la tête de quatre dragons, poursuivit
et fit prisonnier un parti de treize chasseurs tyroliens.
Le général Beurnonville, à la suite de ce fait
d'armes, l'invita à dîner et le porta à l'ordre
du jour de l'armée.
Ce fut son premier succès militaire. Il devait être suivi
de beaucoup d'autres.
On montait vite en grade en ce temps-là. Le 1er septembre 1792,
Dumas était sous-lieutenant ; quelques jours plus tard, on le
nommait lieutenant. Moins de quatre mois après, il passait d'emblée
lieutenant-colonel dans la légion franche de cavalerie des Américains
du Midi.
Le 30 juillet 1793, il recevait son brevet de général
de brigade à l'armée du Nord ; le 3 septembre de la même
année, il était nommé général de
division à la même armée. Enfin, cinq jours après,
il se voyait donner le commandement en chef de l'armée des Pyrénées
occidentales.
Il lui avait fallu vingt mois en partant des derniers rangs, puisqu'il
n'était que simple soldat, pour atteindre une des plus hautes
positions de l'armée.
***
Des Pyrénées, il passa en Vendée, puis à
l'armée des Alpes comme général en chef. C'est
là qu'il commença de donner la mesure de ses talents militaires.
Le Mont-Cenis était réputé imprenable. Dumas s'en
empara. Une nuit, ses soldats se trouvaient arrêtés devant
des retranchements bordés de hautes palissades. Comment pénétrer
dans le fort ennemi ? Le géant, parvient à se hisser sur
l'escarpe, et saisissant d'une main ses hommes, un à un, il les
passe par dessus la palissade et pénètre ainsi en force
dans la place.
Il s'empara ainsi de toutes les positions fortifiées du Mont-Cenis
et du Saint-Bernard, en chassa les Austro-Piémontais et opéra
la jonction de l'armée des Alpes avec l'armée d'Italie.
Mais, à quelques temps de là, ayant témoigné
avec courage de son horreur pour les exécutions jacobines, il
faillit partager le sort de tant d'autres généraux coupables
de n'avoir point approuvé les violences de la Terreur.
En arrivant au village de Saint-Maurice, il avisa sur la place une guillotine
toute rouge qui semblait attendre ses victimes. On devait, en effet,
le lendemain, exécuter quelques pauvres gens accusés de
tiédeur pour le régime de sang qui terrorisait la France.
Dermoncourt, dit le général à son aide de camp,
il fait grand froid et nous manquons de bois. Va démolir cette
vilaine machine. Elle servira à nous chauffer.
L'officier obéit. La guillotine fut débitée en
huches. Mais l'histoire fut rapportée à Paris. Collot-d'Herbois,
au nom du comité de Salut public, somma le général
de venir s'expliquer. Aux accusations, Dumas répondit par le
seul exposé des services qu'il avait rendus à la Nation
; et grâce à ses victoires, on lui pardonna son attentat
contre le « rasoir national ».
Peu de temps après, il passait à l'armée de Sambre-et-Meuse,
puis, à celle des côtes de Brest. Enfin, Bonaparte le réclamait
à l'armée d'Italie. A la seconde attaque de Mantoue, il
supporta tout le poids de l'armée de Wurmser, la battit, lui
prit six drapeaux. On le retrouva, le lendemain, avec huit cents hommes
seulement, et entouré de morts ; il avait eu un cheval tué
sous lui, un second avait été enterré par un boulet,
et lui-même n'avait dû qu'à une chance extraordinaire
de ne point être tué.
D'Italie, il fut envoyé dans le Tyrol avec mission de commander
la cavalerie de l'armée de Joubert.
Là encore, il sema sa route d'actions d'éclat. Les Autrichiens,
terrorisés par son audace et par sa force, qu'ils avaient éprouvées
en maintes circonstances, ne l'appelaient pas autrement que Schwartz
Teufel (Diable noir). Des légendes couraient sur lui aux
bivouacs des ennemis. Son apparition mettait la déroute dans
leurs rangs.
C'est au cours de cette campagne qu'il accomplit l'un des plus glorieux
faits d'armes de sa carrière, la défense du pont de Clausen.
Laissons la parole à son aide de camp Dermoncourt, qui a raconté
l'épisode :
« Le 5 Germinal, le général Dumas, à la tête
du 5e dragons, trouva toute la cavalerie autrichienne occupant une position
inexpugnable à Clausen.
» Le général partit avec une cinquantaine de dragons
pour examiner les localités : je le suivis. Nous trouvâmes
le pont barricadé avec des voitures, et de l'infanterie et de
la cavalerie derrière. Nous crûmes que, la position examinée,
le général allait attendre du renfort ; mais il n'y songeait
guère.
» - Allons, allons, dit-il, vingt-cinq hommes à pied et
qu'on me dégage ce pont-là !...
Vingt-cinq dragons jetèrent la bride de leurs chevaux aux mains
de leurs camarades et, au milieu du feu, de l'infanterie autrichienne,
s'élancèrent sur le pont. La besogne n'était pas
commode : d'abord, les charrettes étaient lourdes à remuer,
ensuite, les balles tombaient comme grêle.
» - Allons, fainéant ! me dit le général,
est-ce que tu ne vas pas donner un coup de main à ces braves
gens-là ?
» Je descendis et j'allai m'atteler aux voitures, mais comme le
général le trouvait pas que le pont de déblayât
assez vite, il sauta à son tour à bas de cheval et vînt
nous aider. En un instant, avec sa force herculéenne, il en eut
plus fait à lui seul que nous à vingt-cinq.
» A peine le passage fut-il libre, que le général
sauta sur son cheval et, sans regarder s'il était suivi ou non
, s'élança dans la rue du village, qui s'ouvre sur le
pont; : « Mais, général, nous ne sommes que nous
» deux !... » Il n'entendait pas, ou plutôt, ne voulait
pas entendre.
» Tout à coup, nous nous trouvâmes en face d'un peloton
de cavalerie, sur lequel le général tomba, et, comme les
hommes étaient en ligue, d'un seul coup de sabre donné
de revers, il tua le maréchal des logis, balafra effroyablement
le soldat qui se trouvait près de lui, et, à la pointe
de son sabre, en blessa encore un troisième. Les Autrichiens
ne pouvant croire que deux hommes avaient l'audace de les charger ainsi,
voulurent faire demi-tour, mais les chevaux fourchèrent, et,
chevaux et cavaliers tombèrent pêle-mêle, En ce moment,
nos dragons arrivèrent avec des fantassins en croupe, et tout
le peloton autrichien fait pris, soit une centaine de prisonniers. Mais,
de l'autre côté du village, nous apercevions un corps considérable
de cavalerie. A peine le général eut-il vu ce corps qu'il
le montra à ses dragons, laissa les prisonniers à l'infanterie
et courut sur les Autrichiens. Le commandant, qui parlait français,
lui cria :
» - Ah ! c'est toi, diable noir ! à nous deux !
» - Fais cent pas, jean-f..., dit le général, et
j'en ferai deux cents.
» - Général, ce que nous faisons là n'est
pas raisonnable, attendons que nous soyons ralliés, lui dis-je.
» Le général s'était arrêté
à la tête du pont et tenait seul contre tout l'escadron,
et comme le pont n'était pas large, les hommes ne pouvaient arriver
à lui que sur deux ou trois de front, il en sabrait autant qu'il
s'en présentait... »
Quand les dragons de Dumas revinrent, ils le trouvèrent entouré
de morts et de blessés et sabrant, sabrant toujours, seul contre
tout un escadron.
Son sabre était tellement ébréché et forcé
qu'il ne put le remettre au fourreau.
C'est à la suite de ce fait d'armes héroïque que
Bonaparte proclama Dumas l'Horatius Coclés du Tyrol.
***
En 1798, départ pour l'Egypte. Là encore, Dumas devait
faire admirer son courage, son esprit de décision, et sa probité
par surcroit. Au Caire, dans la maison qu'il occupait, il trouva un
trésor d'une valeur de deux millions que le propriétaire
du logis n'avait pas eu le temps d'emporter. Immédiatement, il
l'envoya à Bonaparte avec cette lettre :
Citoyen général,
» Le léopard ne change pas de peau, l'honnête homme
ne change pas de conscience.
Je vous envoie un trésor que je viens de trouver, et que l'on
estime à près de deux millions.
» Si je suis tué ici ou si je meurs de tristesse, souvenez-vous
que je suis pauvre, et que je laisse en France une femme et un enfant.
»
Napoléon. n'eût jamais dû oublier cette lettre si
digne et ce beau trait d'honnêteté ; il les oublia cependant,
comme il oublia tous les services rendus par son héroïque
compagnon d'armes.
La révolte du Caire, qui éclata peu de temps après,
donna au général Dumas l'occasion de faire preuve une
fois encore d'un prodigieux courage. Quand on vînt lui dire que
la ville était en pleine insurrection, il était au lit,
malade, grelottant de fièvre. Il se leva, sauta demi-nu sur un
cheval sans selle, rallia quelques officiers, et parcourut la ville,
repoussant les insurgés qui, impressionnés par sa haute
stature, fuyaient devant les moulinets de son sabre sanglant comme devant
l'épée de l'ange exterminateur. Les chefs de l'insurrection
s'étaient réfugiés dans la grande mosquée;
il en fit enfoncer les portes à coups de canon et y pénétra
le premier à cheval. Quand Bonaparte, qui. se trouvait dans l'île
de Roudah, accourut, la révolte était vaincue.
Mais le spleen avait mis sa griffe sur l'âme du géant.
Dumas s'ennuyait loin des siens. D'autre part, Bonaparte, dont il commençait
à percer à jour les visées ambitieuses, ne témoignait
que méfiance pour ce soldat demeuré loyalement républicain.
Dumas obtint la permission de rentrer en France. Mais le mauvais bateau
sur lequel il s'était embarqué dut relâcher en Calabre.
Fait prisonnier par les Napolitains, le général passa
deux années dans la plus affreuse captivité. Par deux
fois, on essaya de l'empoisonner. Sa vigoureuse constitution résista
au poison.
Enfin, il put regagner Villers-Cotterêts, et il y vécut
près de cinq ans, en disgrâce, dans une gêne voisine
de la misère.
Après sa mort, sa femme vint à Paris implorer le secours
du maître du monde. Le maître du monde refusa de la recevoir.
Telle fut la vie, toute de dignité, d'héroïsme et
de dévouement à la patrie, de ce grand général
républicain. Auprès de son fils, le plus grand conteur
de tous les temps et de tous les pays ; auprès de son petit-fils,
l'un des plus puissants génies du théâtre moderne,
on va le glorifier à son tour. Et cette statue qui vengera, sa
mémoire de l'injustice et de l'ingratitude, ne l'a-t-il pas cent
fois méritée ?
Ernest LAUT.
Le Petit Journal illustré du 26 Mai 1912