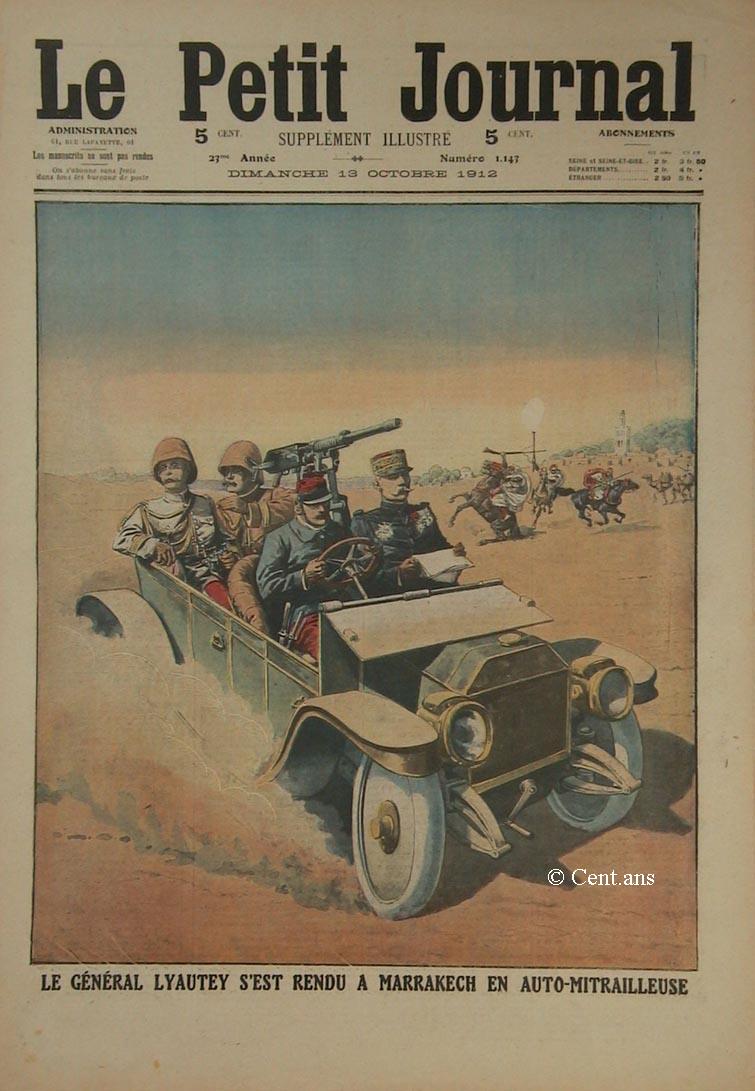LE GÉNÉRAL LYAUTEY
S'EST RENDU A MARRAKECH
EN AUTO-MITRAILLEUSE
La déroute du prétendant El Hibba
à définitivement assuré le prestige de nos armes
à Marrakech.
La vieille cité marocaine est maintenant conquise à l'influence
française. Le sultan Moulay Youssef y a été proclamé
et y viendra prochainement.
Quant au général Lyautey, il est parti de Rabat le 28
Septembre pour s'y rendre. Et c'est en auto-mitrailleuse qu'il a fait
tout le voyage sous les yeux étonnés des cavaliers du
désert.
Il est arrivé à Marrakech le 2 octobre.
La garnison, la population indigène et les grands caïds
lui ont fait le plus chaleureux accueil.
La grande ville du Sud est absolument calme et les routes qui y mènent
sont sûres. Les convois de ravitaillement y arrivent sans encombre.
Cet heureux résultat est dû à l'énergie des
décisions prises par le résidant général
et à la façon foudroyante dont elles furent exécutées
par le colonel Mangin et ses soldats.
VARIÉTÉ
La Femme qui fit la retraite de Russie
Les souvenirs de Louise Fusil. - Le siège de Lille. - Une actrice voyageuse. - Les principes de Rostopchine. - Le théâtre sur des ruines. - « Elle a passé la Berésina ! »
Le centenaire des tragiques événements
de 1812 fait revivre la figure héroïque d'une femme, d'une
Française qui partagea tous les dangers et toutes les souffrances
de nos troupes en Russie, connut toutes les horreurs de la retraite,
le froid, la faim, et ne montra pas moins de courage dans ces terribles
épreuves que les plus énergiques soldats de la Grande
Armée.
Cette femme s'appelait Louise Fusil, nom prédestiné qui
semblait par avance la vouer aux vicissitudes des combats. Et, de fait,
à lire son histoire, on croirait qu'une fatalité singulière
a pris plaisir à la mêler aux faits historiques les plus
considérables et les plus sanglants de son époque.
Nièce de Mme de Saint-Huberty, l'une des plus célèbres
cantatrices du dix-huitième siècle, Louise Fusil était
entrée jeune encore au théâtre. Le fameux compositeur
Piccini, le rival de Glück, avait pris soin de son éducation
musicales. Elle chantait à ravir. A dix-huit ans on la trouve
engagée au Théâtre des Élèves
de l'Opéra, où elle joue l'opéra-bouffe. Puis,
abandonnant quelque temps le chant, elle passe à la Comédie-Française,
où elle joue des petites rôles.
Mais le désir d'occuper un emploi plus important au théâtre
la fait partir en province. Elle trouve un engagement à Lille
pour des concerts. Or, à peine est-elle arrivée dans la
métropole flamande que la guerre précipite sur la frontière
une armée autrichienne qui vient mettre le siège devant
la ville. « Mon génie malfaisant, constate-t-elle, me conduisait
toujours là où il y avait des dangers à courir.
»
Elle passe a Lille toute la durée du siège, puis la ville
délivrée, se rend à Boulogne-sur-Mer chez des Anglais
de ses amis. Et voilà qu'un beau jour arrive dans cette ville
Joseph Lebon, le farouche proconsul d'Arras qui ordonne l'arrestation
de tous les étrangers. Louise Fusil est jetée en prison
avec la dame anglaise chez laquelle elle se trouve.
On reconnaît plus tard la méprise et Lebon la fait remettre
en liberté, mais à la condition qu'elle viendra le soir-même
assister à un bal qu'il donne aux sans-culottes ses amis.
Force fut à l'actrice d'y paraître et de danser avec le
tyran de l'Artois. Ce ne fut pas de toutes ses épreuves, la moins
pénible. « Plus d'une dame, écrit-elle, m'envia
l'honneur de danser avec le représentant et, cependant, je leur
aurais cédé volontiers cette faveur. »
Après de telles vicissitudes, la jeune chanteuse eût pu
espérer que la suite de sa carrière serait moins périlleuse
et moins agitée.
Ce n'était rien, cependant, auprès de ce que lui réservait
l'avenir.
***
Je passe sur les vingt années qui séparent le règne
de la Terreur de la campagne tragique où devait périr
la Grande Armée.
Dans l'intervalle, Louise Fusil a poursuivi avec des fortunes diverses
sa carrière d'actrice. Tour à tour la province et l'étranger
l'ont applaudie.
Ruinée par la Révolution, et n'ayant pu réussir
à refaire sa fortune, elle prend, en 1806, le parti de se rendre
dans les pays du Nord où les artistes français trouvent
des engagements plus avantageux que sur les scènes de la province.
Elle chante avec succès à Mayence, à Francfort,
à Hambourg. De là, elle se rend en Russie. En 1807, elle
est, à Moscou, la chanteuse à la mode. On se la dispute
dans les salons de la plus haute société.
C'est ainsi qu'elle connut, dès 1808, le comte Rostopchine, l'homme
de l'incendie de Moscou.
« Je voyais beaucoup cet homme célèbre dans les
maisons que je fréquentais le plus habituellement, dit-elle dans
ses Souvenirs, et je ne sais pourquoi j'éprouvais pour
lui un sentiment de répulsion que je ne pouvais définir...
»
Et elle raconte à son sujet une anecdote singulièrement
typique.
Rostopchine causait un jour en sa présence avec un noble moscovite,
le comte Rasomosky, et celui-ci se plaignait de ne pouvoir se débarrasser
d'une indiscrète famille à laquelle il avait permis d'habiter
provisoirement un pavillon dans son château de Petrosky et qui
refusait de s'en aller.
- Je m'y suis pris de toutes les façons, disait Rasornosky à
Rostopchine, pour leur faire entendre que ce pavillon m'est nécessaire,
mais je n'ai pu trouver un moyen honnête pour les engager à
déguerpir.
- Eh bien, répondit Rostopchine, vous n'avez qu'un parti à
prendre.
- Lequel ?.
- Parbleu ! mettre le feu à votre château.
« Il paraît, ajoute Louise Fusil, que ce moyen était
dans ses principes. »
***
Septembre 1812. Moscou est en émoi. On vient d'apprendre la prise
de Smolensk.
Toute la noblesse russe s'enfuit. On enlève le Trésor
du Kremlin. A mesure que l'armée française s'avance, la
ville moscovite se vide.
Louise Fusil fait une peinture saisissante de cet exode de la population
:
« Tout à coup, dit-elle, j'entendis un chant triste dans
l'éloignement, puis, peu d'instants après, le spectacle
le plus extraordinaire et le plus touchant s'offrit à mes yeux.
Une foule immense, précédée de prêtres en
habits sacerdotaux, portait des images : hommes, femmes, enfants, tous
pleuraient et chantaient des hymnes saints. Ce tableau d'une population
abandonnant sa ville et emportant ses pénates était déchirant.
Je me prosternai et me mis à pleurer et à prier comme
eux. »
Du haut de sa maison, l'actrice française surveillait l'horizon
avec une longue-vue. Un soir, elle aperçut au loin le feu des
bivouacs.
Le lendemain la police alla frapper à toutes les portes pour
engager les habitants à partir au plus vite. On va brûler
la ville, disait-elle.
On la brûla, en effet. A peine les troupes françaises étaient-elles
entrées dans la ville que, sur plusieurs points en même
temps, l'incendie éclatait.
« Nous fûmes quatre nuits sans avoir besoin de lumière,
écrit Louise Fusil, car il faisait plus clair qu'en plein jour.»
La malheureuse femme erra plusieurs jours de quartier en quartier, de
maison en maison, cherchant un asile, un logis qui n'eût point
été la proie des flammes.
Et voici qu'un jour lui arriva, de la part de l'empereur, l'ordre le
plus étrange, le plus imprévu, le plus invraisemblable,
dans l'épouvantable désarroi où l'on se trouvait.
Napoléon avait fait rechercher tous les artistes qui étaient
restés à Moscou après la fuite de la population
russe et il exigeait qu'une troupe fût formée et qu'on
lui jouât la comédie.
Le théâtre était brûlé ; les acteurs
n'avaient plus rien, ni habits, ni robes. On trouva dans l'hôtel
d'un grand seigneur russe une petite salle de spectacle que le feu avait
épargnée. La troupe improvisée s'y installa, fabriqua
des costumes avec des défroques ramassées un peu partout
dans les logis abandonnés, et joua jusqu'à la veille du
départ de l'armée. Elle joua des vaudevilles, des pièces
gaies, des opéras-comiques de Favart...
Quel contraste que ces joyeux fions-fions dans cette ville en ruines,
devant ces soldats que guettait la plus affreuse destinée !
Le 19 octobre 1812, l'armée française quittait Moscou,
trente-cinq jours après y être entrée.
Louise Fusil la suivait dans une voiture confortable. Tout alla bien
les premiers jours mais, aux environs de Smolensk, les épreuves
commencèrent. Déjà les grands froids de l'hiver
moscovite se faisaient sentir et le désordre allait bientôt
changer la retraite en déroute.
Les chemins étaient encombrés de traînards ; le
passage des ponts s'effectuait au prix de mille difficultés.
Louise Fusil a dépeint l'aspect bizarre que présentait
cette malheureuse armée.
« Chaque soldat avait emporté ce qu'il avait pu du pillage
: les uns couverts d'un cafetan de moujick ou de la robe courte et doublée
de fourrure d'une grosse cuisinière ; les autres, de l'habit
d'une riche marchande, et, presque tous, de manteaux de satin doublés
de fourrure...»
Elle fait remarquer qu'en ce temps-là, en Russie, les dames ne
se servant de manteaux que pour se garantir du froid, les portaient
noirs, mais que les femmes de chambre, les marchandes, toutes les classes
du peuple se faisaient de leurs manteaux une affaire de luxe et les
portaient roses, bleus, lilas ou blancs. C'étaient de ces manteaux
de femmes du peuple que les soldats avaient emportés et dont
ils se revêtaient contre le froid.
« Rien, dit-elle, n'eût été plus plaisant
(si la circonstance n'avait pas été aussi triste) que
de voir un vieux grenadier, avec ses moustaches et son bonnet, couvert
d'une pelisse de satin rose. Les malheureux se garantissaient du froid
comme ils le pouvaient mais ils riaient souvent eux-mêmes de cette
bizarre mascarade. »
Après Smolensk apparurent des légions de cosaques qui
harcelaient sans cesse l'armée en déroute. Le froid n'était
plus le seul ennemi contre lequel il fallait se défendre. Plusieurs
fois l'actrice faillit tomber entre leurs mains. Près de Krasnoé,
force lui fut d'abandonner sa voiture ; les chevaux, épuisés,
ne pouvaient plus aller. Elle gagna la ville à pied, espérant
y joindre le quartier général de l'empereur. Mais le quartier
général était parti et la ville commençait
à brûler. Elle la traversa en courant ; et, se voyant seule,
abandonnée, au milieu de cette déroute, épuisée,
perdant toute l'énergie qui l'avait soutenue jusque là,
elle se laissa tomber dans la neige, résolue à mourir.
« Je sentais, dit-elle, que le froid m'engourdissait le sang.
On prétend que cette asphyxie est une mort très douce,
et je le crois. J'entendais bourdonner à mon oreille «
Ne restez pas là !... Levez-vous !... » On me secouait
le bras ; ce dérangement m'était désagréable.
J'éprouvais ce doux abandon d'une personne qui s'endort d'un
sommeil paisible. Je finis par ne rien entendre et je perdis tout sentiment...»
Lorsqu'elle sortit de cet engourdissement, elle se trouvait dans une
maison de paysan. Un homme était auprès d'elle, lui prodiguait
des soins. C'était Desgenettes, le célèbre chirurgien.
Autour d'elle, tout un état-major chamarré. Un officier
général s'avança et lui dit avec un fort accent
alsacien : « Eh bien ça va-t-il ? Vous revenez de loin.
» C'était le vieux maréchal Lefebvre qui passant
près de l'endroit où elle était étendue,
l'avait fait transporter dans cette maison de paysan et lui avait sauvé
la vie.
Elle devait, quelques jours plus tard, lui payer sa dette de reconnaissance
en soignant avec le plus pur dévouement son fils le général
Lefebvre qui, miné par la maladie, devait rendre l'âme
entre ses bras.
***
Quand elle eut repris ses sens, le maréchal Lefebvre l'emmena
dans sa voiture. Le soir, ils s'arrêtèrent dans un village
au bord d'une rivière gelée : c'était la Bérésina.
Le lendemain matin, dans la calèche du maréchal elle franchit
la rivière fatale sur le pont que les soldats d'Eblé avaient
hâtivement construit pendant la nuit.
« L'empereur, raconte-t-elle, était debout à l'entrée
du pont pour faire presser la marche. Je pus l'examiner avec attention,
car nous allions doucement. Il me parut aussi calme qu'à une
revue des Tuileries. Le pont était si étroit que notre
voiture touchait presque l'empereur.
- N'ayez pas peur, dit Napoléon ; allez, allez, n'ayez pas peur.
»
Murat traversa la rivière au même instant.
« Le roi de Naples tenait son cheval par la bride, et sa main
était appuyée sur la portière de ma calèche.
Il dit un mot obligeant en me regardant. Son costume me parut des plus
bizarres, pour un semblable moment et par un froid de 20 degrés.
Son col ouvert, son manteau de velours jeté négligemment
sur une épaule, ses cheveux bouclés, sa toque de velours
noir ornée d'une plume blanche lui donnaient l'air d'un héros
de mélodrame... Lorsqu'il fut un peu en arrière de la
voiture, je me retournai pour le voir de face. Il s'en aperçut
et me fit un salut de la main. Il était très coquet, et
il aimait à ce que les femmes prissent garde à lui...
»
Quels hommes que ces héros de l'épopée, qui, dans
de telles circonstances, pensaient. encore à saluer les femmes
d'un geste de galanterie !
A peine Louise Fusil avait-elle atteint l'autre bord, que, sous la poussée
furieuse des soldats qui fuyaient devant le canon des Russes, le pont
se rompit. La glace n'était pas assez forte : elle céda
sous le poids, et les hommes, les chevaux, les voitures, tout fut englouti.
Pendant ce temps, tous ceux qui étaient demeurés sur l'autre
rive, tombaient, fauchés par la mitraille.
On sait quel écho douloureux eut en Francs là nouvelle
de ce désastre. « A mon retour, dit Louise Fusil, lorsqu'on
voulait me présenter ou me recommander à quelque puissant
du jour, on employait cette formule : « Elle a passé la
Bérésina ! »
Enfin, l'actrice arriva à Vilna. Il y faisait un froid terrible.
La plupart des Français de Moscou qui avaient échappé
au désastre de la Bérésina, périrent là
de froid et de faim.
Louise Fusil n'avait pas quitté le maréchal Lefebvre et
son fils, le général. Ce dernier, blessé et malade,
ne pouvait poursuivre sa route. Le vieux maréchal, forcé
de l'abandonner, le confia à l'actrice.
- Je resterai près de votre fils, lui dit-elle, et j'en aurai
les soins d'une mère.
Elle le soigna, en effet, avec un admirable dévouement et ce
n'est qu'après sa mort, après l'avoir fait inhumer d'une
façon décente qu'elle reprit sa route. Mais avant de partir,
elle sauva encore une pauvre fillette dont les parents étaient
morts pendant la retraite.
On lui avait apporté l'enfant presque mourante de faim et de
froid ; elle la rappela à la vie.
- Pourquoi ne la garderiez-vous pas ! lui dit un officier.
Elle la garda et l'adopta. La petite avait reçu le nom de «
Nadèje », ce qui en russe signifie « Destinée
».
Louise Fusil lui enseigna son art et, en fit une comédienne de
talent. A quinze ans, Nadèje débutait à la Comédie-Française.
Mais cinq ans plus tard, un mal impitoyable l'enlevait à la tendresse
de sa mère adoptive.
Ce fut une catastrophe pour la pauvre femme qui, vieillie, sans ressources,
traîna dès lors une existence misérable jusqu'en
1848, époque où elle mourut, âgée de soixante-quatorze
ans.
« Jusqu'à son dernier jour, dit l'éditeur de ses
Souvenirs, son unique distraction fut d'aller passer ses soirées
au foyer de la Comédie-Française, où on la tolérait
par pitié... »
Là, revivait pour elle et le souvenir de ses débuts au
théâtre et l'image de l'enfant adoptive qu'elle chérissait
et dans laquelle elle avait mis tous ses espoirs. Et les artistes et
les habitués du foyer écoutaient avec patience les récits
cent fois répétés de la vieille comédienne
qui avait passé la Bérésina.
Ernest LAUT.
Le Petit Journal illustré du 13 octobre 1912