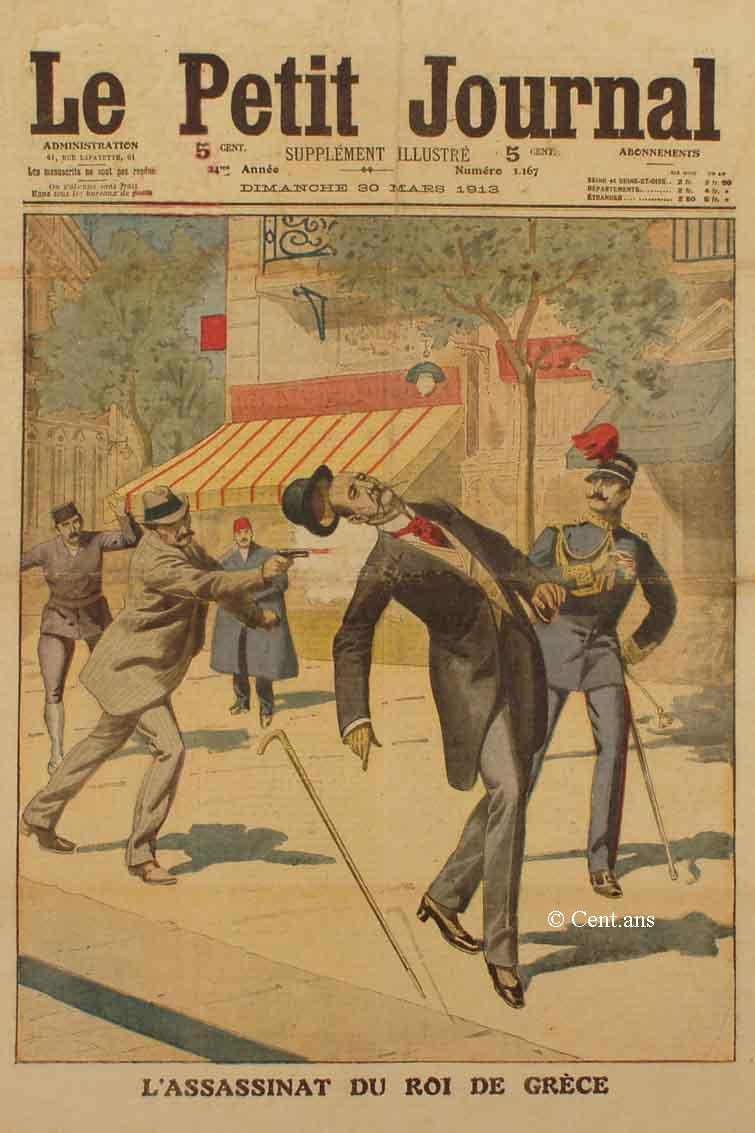ASSASSINAT DU ROI DE GREC
C'est à Salonique la ville nouvellement
conquise, qu'un misérable, déséquilibré
et fanatisé par la propagande révolutionnaire, a assassiné
le roi Georges de Grèce.
Le souverain, dont tout le monde en France connaissait la simplicité
toute démocratique, faisait une promenade en compagnie d'un seul
aide-de-camp, lorsque l'assassin lui tira un coup de revolver à
bout portant. La balle traversa le coeur ; et le roi mourut presque
aussitôt.
Depuis le début du XXe siècle, c'est le huitième
souverain ou chef d'État qui succombe à l'action anarchiste
et révolutionnaire. L'auteur de ce nouvel attentat est, comme
la plupart de ses devanciers, un déséquilibré ;
mais n'est-ce pas justement sur ces déséquilibrés
qu'agit le plus sûrement la propagande des soi-disant réformateurs
sociaux qui prétendent rénover l'humanité en la
noyant dans des flots de sang.
La responsabilité de tous ces crimes n'est pas seulement à
ces misérables qui les commettent, mais encore, mais surtout
à ceux qui les inspirent.
Quand donc, par une entente internationale, la vigilance des gouvernements
se décidera-t-elle à sévir contre ces propagandistes
anarchistes et révolutionnaires qui sont les vrais coupables
de ces odieux attentats
***
Le roi Georges de Grèce qui vient de tomber sous les coups d'un
assassin était né à Copenhague le 24 décembre
1845.
Il avait été élu à l'unanimité roi
des Hellènes par l'assemblée nationale grecque le 30 mars
1863, et reconnu par les puissances. Il meurt donc au moment où
s'achevait la cinquantième année de son règne.
Pendant toute la durée de ce règne, le roi Georges Ier
a poursuivi sans relâche. une politique d'agrandissement par le
retour à la nationalité grecque des territoires jadis
conquis par les Turcs.
En 1881, il avait réalisé en partie cette politique par
l'annexion de la Thessalie et d'une partie de l'Épire.
Mais en 1897, une guerre malheureuse contre la Turquie arrêta
quelque temps ses efforts. Depuis quelques mois, les Grecs avaient pris
une éclatante revanche des désastres passés. Après
une vigoureuse campagne menée par le prince héritier,
ils prirent Salonique, forcèrent une armée turque de 25.000
hommes à capituler. Ces jours derniers, Janina leur ouvrait ses
portes. Le roi Georges tombe en pleine gloire, ayant réalisé
son rêve d'agrandissement territorial et de relèvement
national.
VARIÉTÉ
Les Sourciers
La baguette divinatoire. - Aymar le maçon du Dauphiné. - Les expériences de l'abbé Paramel. - Le récit véridique d'un rabdomancien. -La science va parler.
Ne lisez pas « les, Sorciers ».
Si étranges que puissent paraître les faits dont nous allons
parler, il est bien évident que la sorcellerie n'y est pour rien.
La rabdomancie ou divination par la baguette, appliquée
à la recherche des sources donne des résultats contrôlés,
affirmés par des personnes absolument dignes de foi.
Des sceptiques ont pu les nier autrefois ; mais dans un siècle
qui a vu déjà se produire tant de phénomènes
de radio-activité, dans un siècle où se manifestent
chaque jour tant de forces jusqu'alors inconnues et dont les lois nous
demeureront peut-être longtemps encore ignorées, nous n'avons
pas le droit de rejeter sans les examiner des phénomènes
indéniables, et simplement parce que nous n'en comprenons pas
la cause.
C'est là le raisonnement que se sont fait les savants de l'Académie
des Sciences, qui viennent de nommer une commission pour examiner le
problème de la recherche de sources par la baguette.
Nos savants officiels montrent par là qu'ils sont un peu plus
ouverts que ne l'étaient certains de leurs devanciers à
l'étude des manifestations naturelles ou scientifiques dont ils
ignorent encore l'origine. Ils ne nient plus de parti-pris ce que leur
science ne connaît pas. C'est la preuve chez eux, d'un esprit
de libéralisme et de progrès dont on ne saurait trop les
féliciter.
Lorsqu'il y a un tiers de siècle environ les représentants
d'Edison présentèrent à l'Académie des Sciences
son phonographe, il en fut tout autrement. Plusieurs membres crurent
à une supercherie ; l'un d'eux même, un médecin
nommé Bouillaud, se précipita sur l'opérateur,
et le secouant d'importance :
- Charlatan ! lui cria-t-il, charlatan ! vous vous moquez. de l'Académie.
Avouez que vous êtes ventriloque !...
Ce savant, évidemment, manquait un peu d esprit scientifique.
Il est vrai qu'il ait de bien d'autres choses, notamment de sensibilité
et de coeur. C'était, en effet, le plus abominable vivisecteur
qu'on pût imaginer. C'est lui, qui, pour se distraire, trépanait
les chiens qui servaient à ses expériences et leur enfonçait
des fers rouges dans le cerveau.
L'inconscience de cet homme était monstrueuse. Parlant d'un chien
auquel il faisait subir ces effroyables tortures et qui, naturellement,
hurlait sans discontinuer, il disait :
- Nous avions beau le battre, il criait tout même : il est incorrigible.
On conçoit qu'un pareil, individu n'ait rien compris au génie
d'un inventeur qui, lui, était un véritable savant.
L'Académie n'a plus de Bouillaud, espérons-le... C'est
un honneur pour la science française ; c'en serait un bien plus
grand encore si nous pouvions dire qu'elle n'a plus un seul vivisecteur.
***
Mais revenons à nos sourciers.
La croyance aux vertus de la baguette divinatoire est vieille comme
le monde. De tout temps on a cru qu'à l'aide d'un rameau d'aune,
de hêtre, de pommier, et surtout de coudrier, certains hommes
étaient capables de découvrir les sources, les mines,
les trésors cachés, et même les voleurs et les meurtriers
fugitifs.
La « rabdomancie » était un art très répandu
dans l'antique Orient. Les mages de Pharaon se servaient pour leurs
miracles, de verges qui furent, comme chacun sait, changées en
serpents par Moïse.
Moïse lui-même était rabdomancien. Ne faisait-il pas,
avec sa baguette, jaillir l'eau des rochers ? Son frère aîné
Aaron possédait la même faculté.
Chez nous, dès le Moyen-Age, on croyait aux propriétés
magiques de la baguette. Un magicien sans baguette ne pouvait être
un vrai magicien.
Et, pour que la baguette eût le pouvoir voulu, on disait dans
quelles conditions il fallait se la procurer. Elle devait être
de la pousse de l'année ; et on était tenu de la couper
le premier mercredi de la lune, entre onze heures et minuit, en prononçant
certaines paroles cabalistiques.
Le plus célèbre rabdomancien qu'on ait vu en France était
un paysan du Dauphiné, nommé Jacques Aymar-Vernay. Il
était né à Saint-Véran (Isère), en
1622.
Simple ouvrier maçon, il se déclara un beau jour, doué
de la faculté de découvrir les sources et tous les objets
cachés, au moyen de la baguette divinatoire. De fait, à
maintes reprises, il indiqua de façon précise, dans les
villages environnants, les endroits où l'on pouvait creuser des
puits, et chaque fois l'eau jaillit en abondance.
D'autres expériences heureuses sur des objets perdus répandirent
peu à peu sa réputation. En 1692, un marchand de vins
de Lyon et sa femme furent trouvés assassinés dans leur
cave à coups. de serpe. Les recherches de la justice étant
infructueuses, on appela Aymar. En peu de jours, il retrouva, la serpe
instrument du crime et fit pincer un complice qui avoua, mais il ne
put jamais trouver la trace des assassins, qui s'étaient enfuis.
Aymar guida bien la justice jusqu'à la frontière : mais
là, chose curieuse, il semblait que sa baguette eût perdu
tout son pouvoir.
Malgré cet échec, sa réputation était allée
jusqu'à Paris. On l'y appela et on le soumit à des expériences
pour la recherche d'objets cachés. Or, il paraît que la
capitale n'était pas plus favorable à Aymar que la frontière
de Suisse. Le malheureux rabdomancien pataugea sa baguette tourna à
tort et à travers ; il ne réussit pas à retrouver
les objets cachés, et sa gloire naissante sombra dans le ridicule.
L'air de Paris ne convenait pas au fluide d'Aymar, apparemment.
Depuis lors, la recherche des trésors aussi bien que là
recherche des assassins par le moyen de la baguette divinatoire n'a
guère été pratiquée. Mais il n'en est pas
de même de la recherche des sources.
Il y eut, au XVIII° siècle, un certain abbé Paramel,
qui écrivit sur ce procédé un livre fort probant
et fort documenté l'Art de deviner les sources.
L'abbé Paramel était lui-même un maître en
rabdomancie. Partout où l'on manquait d'eau, il arrivait avec
sa baguette de coudrier, et se promenait par la campagne, en en tenant
les deux bouts fixés contre ses deux index. Soudain, la baguette
se mettait à tourner ; et, à la façon dont elle
tournait, au temps de son évolution, l'abbé savait à
quelle profondeur se trouvait la source.
- Creusez ici tant de mètres, disait-il, et vous rencontrerez
l'eau.
Jamais, dit-on, sa science ne fut mise en défaut.
C'était là, vous l'avouerez, un merveilleux personnage.
Or, savez-vous ce que disaient les sceptiques ? - Il y en avait beaucoup
en ce temps-là. - Ils disaient que l'abbé Paramel était
surtout un géologue très savant et un homme très
ingénieux. A la nature des terrains, il reconnaissait l'endroit
où devaient passer des cours d'eau souterrains ; alors, il s'arrêtait
; d'une pression imperceptible, il imprimait à sa baguette un
mouvement de rotation, et le tour était joué.
Mais, direz-vous, pourquoi ce charlatanisme, alors qu'il eût suffi
de quelques considérations scientifiques pour convaincre les
spectateurs.
Pourquoi, répondent les sceptiques, parce que le peuple des campagnes,
en ce temps-là, était tout pétri de préjugés
et tout farci d'ignorance, et que, si l'abbé Paramel n'avait
parlé qu'au nom de la science, on ne l'eût pas écouté,
et maints villages où, faute d'eau, d'hygiène faisait
complètement défaut, en fûssent demeurés
privés.
Or, l'abbé était philanthrope et psychologue autant que
savant. Il s'était donc résigné à cacher
sa science et à la dissimuler sous un peu de surnaturel pour
mieux la faire triompher.
Voilà ce que disaient des sceptiques. Mais il n'en est pas moins
vrai que la recherche des sources par le moyen de la baguette de coudrier
donnait souvent des résultats dans lesquels le charlatanisme
n'avait aucune part.
La preuve en est que ce n'est pas d'aujourd'hui que la science officielle
se préoccupe de ces phénomènes singuliers. Au mois
de mars 1853. un certain Riondet avait été appelé
devant une commission de l'Académie des Sciences, dont faisaient
partie notamment Boussingault et Babinet, pour faire des expériences
sur la recherche des eaux souterraines par la baguette divinatoire.
Il avait, en effet, trouvé des sources ; et la commission avait
rédigé un rapport dans lequel elle admettait l'hypothèse
que la baguette pouvait obéir à un fluide impondérable.
Cependant le célèbre Chevreul n'avait pas été
convaincu ; il prétendit que la docte compagnie, avait été
le jouet d'un imposteur qui connaissait d'avance les sources découvertes.
Et son intervention empêcha la reconnaissance officielle des vertus
de la baguette divinatoire.
***
Le problème, néanmoins, demeurait pendant. En dépit
de l'incrédulité de Chevreul, les découvertes de
sources par ce procédé se multipliaient, et des hommes
parfaitement dignes de foi en étaient acteurs ou témoins.
C'est ainsi qu'il y a quelques années, comme nous avions ici
même traité incidemment de la baguette divinatoire, un
de nos Lecteurs, dont l'honorabilité et la véracité
sont au-dessus de tout soupçon, nous signalait les résultats
qu'il en avait personnellement obtenus.
« J'habite, nous disait-il, à P.., une jolie petite station
balnéaire sur le bord de l'Océan, non loin de Nantes.
Il y a une trentaine d'années, j'y ai fait construire une maison,
et, dans le jardin, on creusa un puits, sans indication autre que celle
de la commodité. On trouva bien l'eau, mais elle était
insuffisante aux besoins du jardin. D'ailleurs, ce puits tarissait tous
les étés, et l'hiver il n'avait qu'une médiocre
profondeur d'eau.
» Or, quelque temps après, me trouvant avec des amis, je
vins à parler de mon ennui de n'avoir pas d'eau dans la saison
où on en a le plus besoin.
» - Pourquoi, me dit d'un d'eux ne cherchez-vous pas une autre
source à l'aide de la baguette divinatoire ?
» - La baguette divinatoire ?...
» - Mais oui, cela existe. J'ai même un bouquin là-dessus.
» Le lendemain, mon ami m'apportait une brochure rarissime dont
voici le titre: « Abbé C. Chevalier. La Baguette divinatoire
expliquée scientifiquement, Tours, Lecesne, 1848, in-8°.
»
» J'avoue que je n'avais qu'une médiocre confiance dans
ce procédé qui me semblait extranaturel.. Cependant, je
me mis à lire consciencieusement ce petit livre, et à
mettre en oeuvre, d'après ses indications, la baguette de coudrier,
coupée de façon à faire un angle aigu dont chaque
branche est repliée a l'extrémité pour pouvoir
tenir dans les deux mains et préconisée pour la recherche
d'une source. Après bien des tâtonnements inhérents
à toute oeuvre nouvelle ; j'acquis la certitude, puisque ma baguette
ne tournait pas devant mon puits, qu'il ne contenait qu'une quantité
d'eau insignifiante ; mais, comme je voulais faire une expérience
consciencieuse, je me mis à parcourir toute l'étendue
de mon jardin. Enfin, je parvins, à une dizaine de mètres
environ du puits, à voir tourner sur elle-même la baguette
et avec une extrême rapidité. Confiant dans cette expérience,
je fis creuser un nouveau puits : l'eau y afflua d'une manière
abondante et malgré les années de sécheresse, ce
puits n'a jamais tari - il a 6 mètres de profondeur. »
Tel est le récit de mon correspondant ; il ajoute que maintes
autres expériences tentées par lui en d'autres endroits
lui donnèrent les mêmes résultats.
« Il est bien certain, dit-il, qu'un aimable farceur pourra faire
tourner la baguette quand il le voudra, j'ai vu maintes fois faire cette
expérience. Mais le chercheur de bonne foi qui attend patiemment
le résultat ne saurait lui être comparé. Il parcourt,
lentement un espace de terrain, et lorsqu'il arrive à un conduit
d'eau souterrain non seulement la baguette tourne malgré lui,
mais il ressent dans les muscles des bras une sorte de rétraction,
de torpeur, qui laisse pour ainsi dire, le champ libre à l'instrument.
Particularité à noter : on coupe une branche de coudrier
ou d'ormeau : pour avoir l'angle dichotomique, il faut tailler et rogner
les petites branches secondaires. Eh bien ; si on n'a pas le soin de
rogner exactement, si on laisse des aspérités, ces dernières
entament quelque peu la paume des mains... »
Quant aux facultés qu'il faut posséder pour faire agir
la baguette, notre correspondant ajoute qu'elles ne sont point communes
à tout venant. Sur un certain nombre de ses voisins et amis qu'il
a soumis à l'expérience, il en a trouvé environ
50 % qui y étaient réfractaires et n'avaient pas le fluide
nécessaire.
Voilà ce que dit un expérimentateur loyal et véridique
; bien d'autres hommes de bonne foi ont pu faire les mêmes remarques
et les mêmes expériences. Mais la science jusqu'à
présent n'avait pas encore dit son mot sur la question. Elle
s'apprête à parler. Écoutons-la.
Ernest LAUT.
Le Petit Journal illustré du 30 Mars 1913