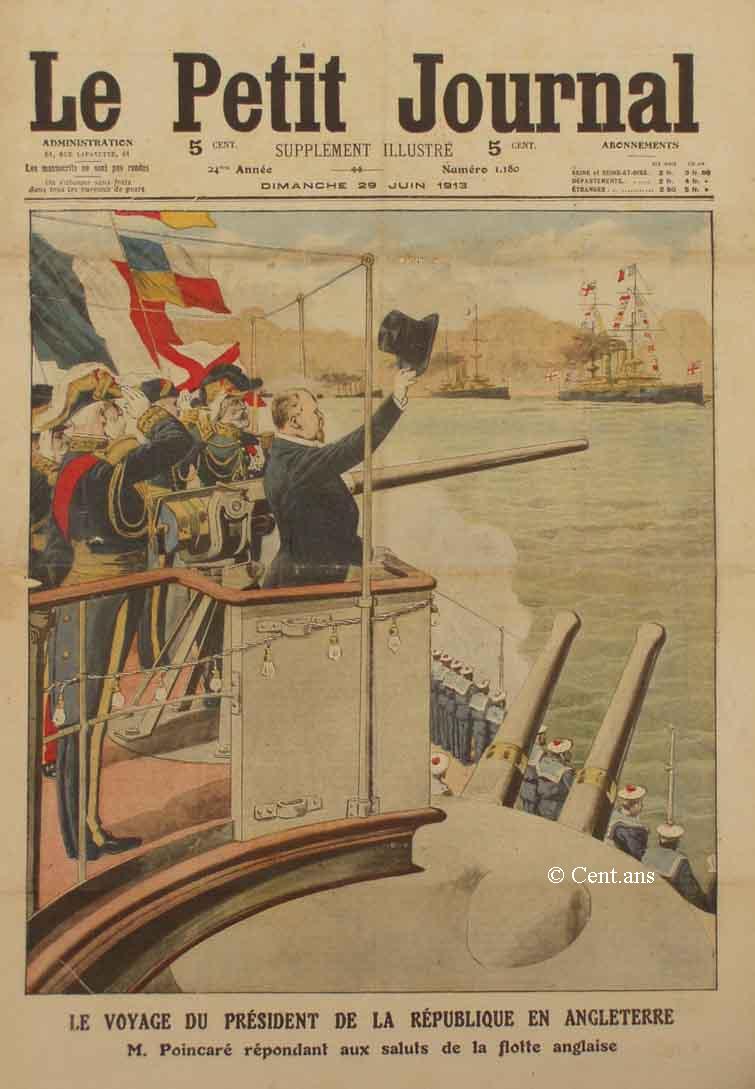LE VOYAGE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE EN ANGLETERRE
MM. Poincaré répondant aux
saluts de la flotte anglaise.
Comme nos lecteurs le verront dans le résumé
succinct que nous avons tracé ci-dessous de l'histoire de l'entente
cordiale, c'est Louis-Philippe qui fut le premier chef d'État
, français reçu amicalement de l'autre côté
du détroit.
Mais si les rois de France allèrent peu en Angleterre, les Présidents
de la République ne se font pas faute de s'y rendre. Et nous
constatons avec plaisir qu'après MM. Loubet et Falllières,
notre Président actuel trouve en ce moment chez nos voisins un
accueil de nature à réjouir la France entière.
VARIÉTE
L'entente cordiale
Le voyage du Président de la République. - L'entente cordiale au XVIe siècle. - Louis-Philippe et la reine Victoria. - Portsmouth. - Un mot de Joseph de Maistre.
Le Président de la République
est parti pour l'Angleterre, et Londres lui prépare une réception
qui marquera dans les annales de l' « entente cordiale »
entre les deux pays.
Cette entente n'est point, comme on se l'imagine généralement
en France, de date toute récente. La longue rivalité de
Napoléon et de l'Angleterre a fait oublier, aux générations
qui nous ont précédés, les bons rapports qui, au
cours de plusieurs périodes de d'histoire, existèrent
entre l'Angleterre et la France.
Jusqu'après la Révolution de 1830, l'Anglais fut, pour
la majorité des Français, l'ennemi héréditaire.
Le fameux hymne de Charles VI, l'opéra d'Halévy
:
Jamais, jamais en France
Jamais l'Anglais ne régnera
était devenu chez nous une manière
de chant national ; et malgré les rapports cordiaux des souverains
des deux peuples sous la monarchie de juillet et sous le second empire,
l'hostilité contre « la perfide Albion » n'avait
pas encore disparu de l'âme du peuple.
Joseph de Maistre a comparé l'Angleterre et la France à
deux aimants qui s'attirent avec force et se touchent un instant pour
se fuir ensuite avec une égale énergie. La comparaison
n'est pas sans justesse. Les deux pays, au cours de l'histoire, se sont
maintes fois rapprochés de façon si complète qu'on
put croire à une union durable; mais presque toujours cette union
fut assez courte.
Cependant, dans les trois quarts du siècle qui vient de s'écouler,
l'entente a été, sauf quelques éclipses, s'affermissant
presque constamment.
C'est d'ailleurs ce qui fait croire à beaucoup que les premières
tentatives de rapprochement franco-anglais ne datent que du règne
de Louis-Philippe. Rien n'est plus inexact, d'ailleurs elles datent
de l'époque de la Renaissance.
En ce temps-là, l'ennemi commun de la France et de l'Angleterre,
c'était l'Espagne qui, depuis le règne de Charles-Quint,
aspirait à la domination européenne.
Dans une curieuse lettre adressée le 19 février 1582 aux
maire et échevins de la ville de Chartres, par François,
duc d'Anjou, et frère de Henri III, le prince, sur le point de
partir à la conquête des Pays-Bas, et de tenter également
une autre conquête, celle de la reine d'Angleterre dont il briguait
la main, explique aux magistrats chartrains l'intérêt d'une
alliance avec les Anglais.
« Considérons, dit-il, le danger qui nous menace : si nous
souffrons que la puissance, d'un prince voisin ( le roi d'Espagne ),
quand bien il seroit amy, croisse si démesurément qu'il
puisse donner la loy à qui bon luy semblera, estant très
certain que la seureté des grands estats ne gist qu'en un contrepoids
égal de puissance, ne servant d'accroissement et grandeur de
l'un que d'affaiblissement et ruyne à l'autre ; mais, j'espère
que Dieu me fera la grâce de devancer ses pernicieux desseins,
dont je me rendray tant plus certain par l'accomplissement de mon mariage
avec la reine d'Angleterre, par moy si instamment poursuivy que j'en
espère une bonne issue, y joignant d'amitié par un ferme
lien les deux grands royaumes, ils seront non seulement suffisanz pour
eux conserver et maintenir, mais de donner la loyaux plus grands rois
de la terre quand bon leur semblera... »
C'est cette même pensée que Ronsard traduisit alors en
vers.
S'adressant à la France et à l'Angleterre, il leur disait
:
Quand vous serez ensemble bien unies,
L'Amour, la Foi, deux belles compagnies,
Viendront ça bas le coeur nous échauffer ;
Puis, sans harnois, sans armes et sans fer,
Et sans le dos d'un corselet vous ceindre,
Ferez vos noms par toute Europe craindre,
Et l'âge d'or verra de toutes parts
Fleurir les Lys entre les Léopards.
D'ailleurs, la reine Elisabeth souhaitait vivement
cette alliance. On sait qu'au moment où Philippe II d'Espagne
menaçait la France d'une invasion, elle envoya le comte d'Essex
faire une diversion sur les côtes espagnoles pour défendre
le territoire français.
Et c'est à cette occasion que la grande souveraine prononça
ces paroles historiques
- Sachez que la France ne peut souffrir d'éclipse qui ne soit
funeste à l'Angleterre et que son dernier jour serait un présage
de notre prochaine nuit.
Vous voyez qu'il y e quelque trois cent vingt ans, on fondait déjà,
en France et en Angleterre, de belles espérances sur l'entente
cordiale.
***
Des siècles, cependant, devaient passer avant que cette entente
commençât à se réaliser.
C'est seulement sous Louis-Philippe que reprirent les bons rapports
entre les deux pays. Et c'est alors que pour la première fois,
les souverains d'Angleterre et de France échangèrent des
visites d'amitié.
La reine Victoria vint la première. Elle était alors dans
tout l'éclat de sa jeunesse et de sa beauté, car elle
fut belle, vraiment belle, cette vieille dame que les caricatures de
Léandre nous représentaient naguère avec ses bajoues
tombantes et ses yeux en boules de loto. Elle fut belle : pour s'en
rendre compte, il suffit de passer en revue dans le Musée spécial
des portraits qui se trouve à la National Gallery à Londres,
les innombrables tableaux qui la représentent dans la fraîcheur
de sa jeunesse.
C'était en septembre 1843. La petite reine débarqua au
Tréport, en compagnie du prince consort. Louis-Philippe et toute
la cour étaient venus au devant d'elle en berlines attelées
de quatre chevaux, car il n'y avait pas encore de chemin de fer.
Le roi, en compagnie de M. Guizot, se rendit à bord du yacht
royal pour souhaiter la bienvenue à la reine, et tous deux, dans
un canot pavoisé et emporté dans le rythme vertigineux
de douze paires de rames, firent leur entrée dans le port.
Dans des carrosses découverts, tous les invités gagnèrent
le château d'Eu.
Plusieurs jours se passèrent en promenades, en réceptions,
en galas de toutes sortes ; et puis, la souveraine et le prince ,consort
remontèrent sur leur yacht et regagnèrent l'Angleterre.
Ils n'étaient même pas venus jusqu'à Paris.
Il paraît que l'esprit frondeur et révolutionnaire du peuple
de Paris ne disait rien qui vaille aux ministres d'Angleterre ; et c'est
pourquoi ils avaient très respectueusement, mais très
fermement, engagé, la jeune reine à ne pas aller plus
loin que le château d'Eu
L'année suivante, Louis-Philippe rendit sa visite à la
reine.
Le roi bourgeois n'avait pas plus de yacht que n'en ont nos Présidents
de la République. Il s'embarqua au Tréport sur une frégate
de guerre, et, escorté, de toute une flotte, il partit pour Portsmouth.
La France, l'année précédente, n'avait pas eu l'idée
de faire débarquer la jeune reine dans un de ses ports de guerre,
à Cherbourg, par exemple ; l'Angleterre, au contraire, voulut
que le roi de France la contemplât, dès son arrivée,
dans tout l'appareil de sa puissance maritime.
C'est pourquoi elle le fit débarquer à Portsmouth.
Portsmouth est le port imposant, le port où la force de l'Angleterre
apparaît dans toute son ampleur. C'est à Portsmouth que
M. Loubet, que M. Fallières touchèrent le sol anglais
lors de leur visite. C'est à Portsmouth que débarque M.
Poincaré.
Portsmouth est le premier port de guerre de l'Angleterre depuis le règne
de Henri VIII ; mais dès le XIIIe siècle, c'était
déjà dans ses chantiers que l'on construisait les galères
royales.
Depuis le commencement du XVIe siècle, on n'a cessé de
fortifier la côte à cet endroit et de développer
l'organisation militaire et maritime. Si bien que Portsmouth est devenu
la véritable capitale militaire du Royaume-Uni, la cité
des canons et des cuirassés, la ville des marins et des soldats.
Tous les Français qui ont visité l'arsenal de Portsmouth
sont sortis émerveillés par l'impression de silence, d'ordre
et de discipline qu'ils y ont trouvée.
Une autre impression, encore, qu'ils en retirent, c'est celle de l'admirable
ferveur patriotique entretenue dans l'esprit et dans le coeur des marins
et des soldats qui passent là quelques années de leur
vie.« Partout, dit notre confrère M. Jacques Bardoux, les
monuments échelonnés, ancres et canons, places et obélisques,.
rappellent à Jack Tar (c'est le surnom donné
au marin anglais) les services que ses prédécesseurs ont
rendus au roi et à la nation. Pas une guerre n'est oubliée.
Chacune est rappelée, par une manifestation durable et tangible,
à la mémoire des générations qui viennent.
Et les enfants, qui chevauchent sur les canons ou escaladent les grilles,
apprennent à épeler en lisant les glorieuses annales de
la marine anglaise. Ils n'ont d'ailleurs qu'à se hausser légèrement
sur leurs petites jambes, pour apercevoir la silhouette de la Victory,
du navire de Nelson, toujours à l'ancre, en face de l'arsenal.
» Quand j'abordai au pied du vaisseau à trois ponts, ajoute
notre confrère, j'eus la même désillusion que donnent
souvent les cathédrales et les églises d'outre-Manche.
Le vieux bâtiment était par trop flambant neuf. Les cordages,
fraîchement goudronnés, brillaient au soleil. La coque,
soigneusement débarrassée de toute algue, paraissait dater
d'hier. Mais, lorsque, dans l'entrepont, le marsouin qui sert de guide
montre les voiles trouées, qui servirent, les haches qui frappèrent,
les tambours qui battirent, les canons qui tonnèrent à
Trafalgar; quand, à fond de cale, éclairé par de
vieilles lanternes, on frôle la table sur laquelle furent opérés
les blessés, on visite les cages à lapins qui servaient
de cabines aux officiers, on touche la poutre qui soutint de corps de
Nelson expirant, le visiteur revit la bataille. Le caporal, mon compagnon,
avec une conscience toute britannique, ne me fit grâce d'aucun
détail. Et pour m'édifier, après m'avoir instruit,
il me lut, en homme habitué à réciter les Ecritures,
la prière, qu'écrivit Nelson avant de tirer le canon :
» Puisse ce Dieu tout-puissant, en qui je crois, accorder à
mon pays - et pour le bien de l'Europe toute entière - une grande
et glorieuse victoire ! Puisse personne ne la ternir par une faute !
Puisse l'humanité, après la victoire, caractériser
la conduite de la flotte britannique ! Quant à moi, je mets ma
vie entre les mains de celui qui m'a créé. Puisse sa bénédiction
éclairer les efforts que je fais pour servir mon pays loyalement
! C'est à Lui que je me confie ainsi que la cause juste que je
suis chargé de défendre. Amen. »
» Et, sous la coupole vitrée, je revois la tunique noire
et le jeune visage, j'entends la voix grave du caporal. déclamant
les versets sacrés. C'est au milieu de ces tradictions et de
ces souvenirs que sont élevés les marins anglais dans
ce cadre grandiose de Portsmouth. »
***
Mais revenons à l'histoire de d' « Entente Cordiale »,
et notons en passant que cette expression remise en honneur depuis quelques
années pour caractériser les bons rapports entre la France
et l'Angleterre, est due à Louis-Philippe.
En effet, le 24 décembre 1843, à la suite du voyage de
la reine d'Angleterre, Louis-Philippe, dans son discours d'ouverture
de la session parlementaire, exprimait sa confiance dans la paix, et
disait :
« La sincère amitié qui m'unit à la reine
de la Grande-Bretagne et la cordiale entente qui existe entre mon gouvernement
et le sien, me confirment dans cette confiance. »
Donc, le roi citoyen avait débarqué à Portsmouth
le 8 octobre 1844. Il y fut reçu avec les marques de la plus
chaleureuse sympathie et prit, de là, la. route de Windsor, où
l'attendait la reine Victoria.
La réception a une touchante saveur d'émotion bourgeoise
:
« Le roi m'a embrassée très tendrement, écrit
là reine dans ses « mémoires » ; et il m'a
dit : « Combien j'ai de plaisir de vous embrasser. » Il
paraissait tout à fait touché et m'a accompagnée
en haut de l'escalier. Que d'émotions et que de pensées
doivent remplir son coeur en venant ici ! C'est le premier roi de France
qui rend visite au monarque de ce pays. C'est un événement
bien remarquable et qui doit sûrement porter de bons fruits.
» ... Le roi fut partout très cordialement acclamé...
ajoute-telle plus loin. Ici (à Windsor) il y avait une grande
foule et en rentrant, près de la grille, le roi, qui a une manière
très amicale de saluer très bas, en avançant les
mains, s'écria : « Je n'ai jamais eu une réception
pareille. Combien tout cela me touche. »
***
Ainsi se nouèrent, sous l'égide de cette simplicité,
les bonnes relations franco-anglaises.
Onze ans plus tard, Napoléon III, reçu triomphalement
en Angleterre, tandis que les troupes françaises et anglaises
combattaient côte-à-côte en Crimée, exprimait
à son tour ce qu'il pensait de l'entente cordiale.
« Il est de fait, disait-il au lord-maire qui le saluait au nom
de la grande cité, il est de fait que la Grande-Bretagne et la
France sont naturellement solidaires dans toutes les grandes questions
politiques et dans le progrès humain qui agite le monde... »
C'est là, semble-t-il, une opinion que nos hommes d'État
actuels professent et que partagent les hommes d'État anglais.
Les rapports plus suivis de peuple à peuple, les visites plus
fréquentes des souverains anglais en France et des Présidents
de la République en Angleterre l'ont confirmée. Et j'imagine
que si Joseph de Maistre était encore de ce monde, il modifierait
les termes de sa comparaison et ne verrait plus dans l'Angleterre et
la France que deux aimants qui, s'étant attirés avec force,
n'ont plus envie de se séparer.
Ernest LAUT
Le Petit Journal illustré du 29 juin 1913