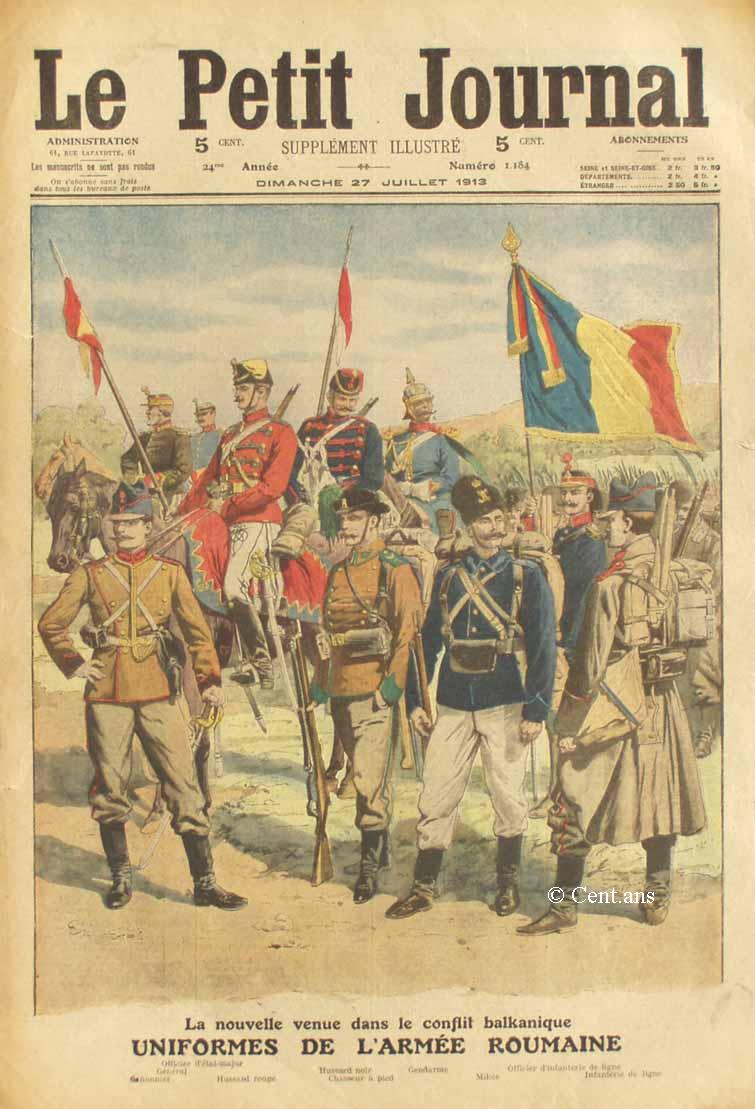LA NOUVELLE VENUE DANS LECONFLIT
BALKANIQUE
UNIFORMES DE L'ARMÉE ROUMAINE
A l'heure où la mobilisation et l'entrée
des Roumains en territoire bulgare vient ouvrir un chapitre nouveau
dans l'histoire du conflit des Balkans, il nous a paru intéressant
de donner à nos lecteurs la reproduction des principaux uniformes
de l'armée roumaine.
Le territoire de la Roumanie est partagé en cinq régions
de corps d'armée Craïova, Bucarest, Galatz, Jassi et Constantza.
L'infanterie compte : 9 bataillons de chasseurs et 40 régiments
à 3 bataillons de l'armée active. 40 bataillons de réserve,
et 96 bataillons de milice.
Cavalerie : 10 régiments de roshiori ( hussards rouges
) groupés en 5 brigades destinées à former 2 divisions
indépendantes, 10 régiments de calarashi ( hussards
noirs ), formant une brigade par corps d'armée.
Artillerie : 20 régiments de campagne à 6 batteries, groupés
en 10 brigades, une par division d'infanterie. Il faut y ajouter 7 batteries
d'obusiers, 1 groupe à cheval de 4 batteries et 2 régiments
d'artillerie de forteresse.
Les troupes techniques comportent 1 bataillon de pionniers par division,
1 bataillon de pontonniers, 1 de chemins de fer, et des compagnies d'aérostiers
et d'automobilistes.
L'armée de campagne mobilisée se compose de 5 corps d'armée
à 2 divisions, de 2 divisions de cavalerie et de 8 divisions
de milice.
L'infanterie est armée du fusil Mannlicher, l'artillerie du canon
à tir rapide Krupp.
VARIÉTÉ
Hôpitaux d'autrefois
De vieilles bâtisses qui disparaissent. - Ladreries et
léproseries. - L'Hôtel-Dieu de Paris. - Dix malades dans
un lit. -
Pourquoi nos ancêtres avaient peur de l'hôpital.
Nos vieux hôpitaux disparaissent un à
un. C'était dernièrement la Pitié dont on abattait
les murs lépreux ; c'est aujourd'hui Cochin et Ricord qui tombent
sous la pioche. Toutes ces bâtisses anciennes et antihygiéniques,
sont remplacées par des hôpitaux du modèle le plus
nouveau où les malades trouveront toutes les ressources de l'hygiène
moderne, tout ce qui manquait, en un mot, aux hôpitaux d'autrefois.
Les questions de prophylaxie sont, en effet, de celles dont nos aïeux
ne semblent guère s'être vivement préoccupés.
L'invasion des maladies contagieuses les trouvait généralement
désarmés ; ils n'avaient en matière de désinfection
que des connaissances très vagues, et leurs procédés,
pour empêcher la contamination étaient tout à faits
primitifs.
C'est assez dire que les lois de l'hygiène étaient fort
négligées dans leurs hôpitaux.
Mais, d'abord, en quoi consistaient les hôpitaux d'autrefois ?
L'Antiquité semble n'avoir pas connu ces institutions publiques
en faveur des malades. Chez la plupart des peuples de l'Orient on se
contentait, s'il faut en croire Hérodote, de transporter les
malades sur la place publique et de les étendre sur le sol. Les
gens qui passaient s'approchaient d'eux les interrogeaient, et ceux
qui avaient souffert des mêmes maux les conseillaient et leur
disaient comment il fallait s'y prendre pour guérir. Il n'était
pas permis, dit l'historien, de passer, auprès d'un malade, sans
s'enquérir de son mal. Vous pensez bien que cette médecine
mutuelle ne devait pas donner de merveilleux résultats.
Pas plus que la Grèce, Rome n'eut d'établissement publics
pour les malades. On trouvait seulement, chez les patriciens des valétudinaria
où l'on soignait les esclaves attachés au logis.
C'étaient là des infirmeries particulières où
n' étaient reçus que les serviteurs de la famille.
Ce n'est qu'au IVe siècle après J.-C. qu'on trouve à
Byzance les premiers hôpitaux dignes de ce nom. Julien l'Apostat
avait chargé son médecin Oribase de les construire et
de les aménager.
Ses successeurs continuèrent son oeuvre bienfaisante. Justinien
avait fait élever, sur le chemin du temple de Jérusalem
un hospice pour les pèlerins et un hôpital, dédié
à saint Jean. On vit là, pour la première fois,
une association d'hommes charitables se consacrer au service des malades.
Du Cange, dans son Histoire Byzantine, assure qu'au moment
où les Turcs s'emparèrent de Constantinople, la ville
ne comptait pas moins de trente-cinq hospices et hôpitaux.
Les sultans perpétuèrent cette tradition charitable. Mahomet
II, Bajazet fondèrent de vastes hôpitaux. Lovicerus, dans
son Histoire des Turcs, rapporte qu'ils en créèrent
même pour les animaux. En quoi ces Turcs d'autrefois étaient
plus humains que les Jeunes-Turcs d'aujourd'hui qui firent périr
de faim et de soif les chiens de Constantinople et les malheureux chevaux
qui les servirent pendant la guerre contre les Bulgares.
***
Le plus ancien hôpital élevé sur la terre de France
fut celui de Lyon. Il fut créé en 542, sous le règne
de Childebert. Une trentaine d'années plus tard fut élevé
à Paris, l'hôpital de Saint-Julien-le-Pauvre, voisin de
la vieille église qui existe encore, et où l'on recevait
indifféremment les voyageurs bien portants et les malades.
L'Hôtel-Dieu ne date que du siècle suivant. Il fut installé
en l'an 650 par saint Landri, évêque de Paris. Douze bourgeois
de Paris l'administraient sous la direction de l'évêque,
et le quart des revenus ecclésiastiques était affecté
à son entretien.
Mais jusqu'alors, sauf en quelques grandes villes, les maisons de secours
pour les malades sont rares. L'invasion des fléaux rapportés
des croisades, la lèpre, la peste, va multiplier ces asiles.
De toutes parts, au bord des grandes routes, dans les faubourgs des
villes, s'élèvent ces établissements connus sous
les noms de ladreries, maladreries, léproseries, lazarets. On
y reçoit pêle-mêle voyageurs en bonne santé
et malades. Aussi la contagion y fait-elle d'épouvantables ravages.
Au XIIe siècle, le nombre des léproseries s'élevait
en France à plus de 800. Gabriel Pouchet, dans son Histoire
des Sciences donne, pour le siècle suivant, le chiffre de
2.000. Au temps de la Renaissance, dit Renouard, dans son Histoire
de la Médecine, on ne comptait pas moins de 19.000 de ces
maisons d'isolement disséminées par toute la chrétientè.
A cette même époque, l'Hôtel-Dieu de Paris, bien
qu'agrandi à plusieurs reprises, par Louis XI et par François
1er, ne présente, au point de vue de l'hygiène, qu'une
organisation des plus défectueuses.
Jugez-en par ce passage extrait de lettres patentes à la date
du 14 mars 1515 :
« En l'infirmerie qui est de six toises de largeur seulement.
il y a six rangées de licts, chacun lict de troys pieds de largueur
ou environ, en chacun desquels il y a troys ou quatre malades qui nuisent
fort les uns aux autres, et en ladite infirmerie il y a sept ou huit
licts où se couchent vingt-cinq ou trente enffans, lesquels enffans
sont tendres et délicats à cause du gros ayr qui est en
ladite infirmerie et meurent la plupart tellement que de vingt n'en
reschappe pas ung. »
A lire cette description et à la comparer à celle que
les historiens font des hôpitaux au temps de saint Louis, il semble
qu'en ce qui concerne leur organisation, on ait fait entre l'époque
du Moyen Age et celle de la Renaissance des progrès à
rebours. C'est d'ailleurs, un phénomène qu'on constate
dans toutes les pratiques de l'hygiène : les Français
du Moyen Age furent infiniment plus propres, plus soucieux de leur santé
et de celle d'autrui que les Français de la Renaissance.
M. Louis Boutié, dans son livre sur saint Louis, décrit
le magnifique hôpital, fondé à Tonnerre, par Marguerite
de Bourgogne, belle-soeur du roi, hôpital dont la grande salle,
une des plus belles oeuvres de l'architecture du temps, existe encore.
« On y avait trouvé le moyen, dit-il, de séparer
les malades tout en les réunissant. De hautes cloisons divisaient
la grande salle en petits compartiments où chaque malade avait
sa cellule. Le vaisseau était fort élevé, l'air
circulait librement partout, et les cellules étaient dans les
meilleures conditions d'aération et de salubrité. Tout
autour de la salle, au-dessus des cellules régnait une galerie,
d'où les infirmiers pouvaient voir les malades... »
Dans son Manuel d'archéologie, M. Enlart confirme ce
souci d'hygiène qui distingue les constructeurs des maisons d'assistance
à cette époque.
« Les hôpitaux, dit-il, étaient aménagés
avec une entente si parfaite des conditions de salubrité, que
les progrès les plus récents en cette matière consistent
à restituer les dispositions universellement adoptées
du XIIIe au XVe siècle. »
Des fenêtres spacieuses s'ouvraient au-dessus des lits. L'air
était abondamment renouvelé. De grandes cheminées
chauffaient le local. Des chariots de fer, remplis de braise, étaient
promenés à travers la salle.
Les murs étaient peints à la chaux. Au XIIIe siècle,
ceux de l'Hôtel-Dieu de Paris étaient grattés une
fois par an et repeints à neuf.
***
Trois cents ans plus tard, il semble qu'on ait perdu l'habitude de ces
précautions et de ces soins. Les hôpitaux construits du
XVIe à la fin du XVIIIe siècle, le furent, en général,
sans le moindre souci d'hygiène.
Ils laissaient à désirer aussi bien au point de vue de
l'administration qu'à celui de la salubrité.
Et c'est de cette époque que date ce sentiment de répulsion
pour l'hôpital, passé depuis à l'état de
préjugé, et qui n'a pas encore disparu de l'esprit populaire.
Les hôpitaux parisiens de ce temps-là apparaissent aux
pauvres gens comme des lieux d'infection où l'on était
plus assuré de trouver la mort que la guérison. Aussi
les malades se refusaient-ils à s'y laisser transporter, et préféraient-ils
souffrir chez eux, privés de soins, plutôt que d'aller
chercher la mort dans ces caravansérails de toutes les contagions.
A l'Hôtel-Dieu, il y avait, au-dessus de l'entrée une inscription
ainsi conçue : « C'est ici la maison de Dieu et la porte
du ciel ». Les Parisiens facétieux en faisaient une interprétation
dont le sens était celui du lasciate ogni speranza de l'Enfer
du Dante ; et il faut bien dire que les innombrables décès
qui survenaient parmi les malheureux malades de cet hôpital justifiaient
amplement cette interprétation.
La réputation d'insalubrité de l'Hôte-Dieu était
telle que, lorsqu'en 1772, un incendie le dévora en partie, ce
fut dans la population une explosion de joie... « Tant mieux,
disait-on, tant mieux ! Que l'hôpital brûle. »
Marmontel, dans un mémoire publié cette même année
1772, démontrait que la mauvaise installation de l'Hôtel-Dieu
avait, depuis 1737, coûté la vie à plus de 80.000
personnes.
Quatre ans auparavant, Voltaire, dans sa lettre à M. Paulet sur
la petite vérole, avait écrit : « Vous avez dans
Paris, un Hôtel Dieu où règne une contagion éternelle,
où des malades entassés les uns sur les autres se donnent
réciproquement la peste et la mort ».
On résolut donc de profiter de l'incendie pour raser les bâtiments
de l'hôpital et pour le reconstruire hors de la ville, dans la
plaine de Grenelle. Une souscription publique fut ouverte qui, en peu
de temps, produisit deux millions de livres. Mais le ministre, Loménie
de Brienne, employa la somme à combler les trous de son budget,
et l'Hôtel-Dieu demeura debout avec toutes ses tares et toutes
ses contagions.
Quelques années plus tard, le célèbre philanthrope
anglais John Howard, poursuivant une enquête sur les oeuvres hospitalières
vint en France visiter nos hôpitaux. Il les trouva généralement
de beaucoup inférieurs à ceux de son pays. « L'Hôtel-Dieu
et l'hôpital Saint-Louis, écrivit-il, sont les deux plus
mauvais hôpitaux que j'aie jamais visités. Ils sont une
honte pour la ville de Paris ».
A la même époque, une commission de membres de l'Académie
des Sciences dans laquelle se trouvaient Tenon, Daubenton, Lavoisier,
confirmait ces critiques sévères.
Tenon dans un rapport rédigé au nom de cette commission
écrivait : « Il est évident qu' il n'est point d'hôpital
aussi mal situé, aussi resserré, aussi déraisonnablement
surchargé, aussi dangereux, qui réunisse autant de causes
d'insalubrité et de mort que l'Hôtel-Dieu. Qu'on se représente
une longue enfilade de salles contiguës où l'on rassemble
des malades de toute espèce, et où l'on entasse souvent
trois, quatre et même cinq malades dans un même lit, les
vivants à côté des moribonds et des mourants. Quelquefois
les lits sont à deux étages, et sur l'impériale
on établit une seconde couche de malades. L'air infecté
des exhalaisons de cette multitude de corps malsains portant les uns
aux autres les germes pestilentiels de leurs infirmités et le
spectacle de la douleur et de l'agonie de tous côtés offert
et reçu : voilà l'Hôtel-Dieu.
Ce même mémoire donne, par quelques chiffres, une idée
de l'effroyable encombrement qui régnait dans ce lieu d'horreur.
Une seule salle, la salle Saint-Charles-Saint-Antoine contenait quelquefois
plus de 800 malades. La population totale était illimitée.
En 1709, année de grand froid et de grande misère, elle
s'éleva jusqu'à 9.000 personnes. Les femmes en couches
étaient dans quatre salles au-dessus des blessés et des
fiévreux ; elles couchaient trois ou quatre dans chaque lit,
et, dit Tenon, lorsqu'on entrouvait les rideaux, il s'en dégageait
une buée chaude infecte qui donnait à l'atmosphère
une telle consistance qu'en la traversant on la voyait se fendre et
reculer de l'un et l'autre côté. »
Résultat : alors qu'à l'hôpital de Lyon, que l'on
considérait comme le mieux installé de France, la mortalité
était de 2 sur 24, elle était de 2 sur 9 à l'Hôtel-Dieu.
***
Ce n'était point cependant que les médecins, les hygiénistes,
les philanthropes et tous les hommes de bon sens n'eûssent de
tout temps protesté contre cet entassement des malades, et cette
promiscuité à laquelle on les condamnait en les mettant
plusieurs dans le même lit.
Déjà en 1515, François Ier à la suite d'une
visite à l'Hôtel-Dieu écrivait : « On veoit
ordinairement huit, dix et douze pauvres en ung lict, si très
pressés que c'est grand pitié de les veoir. »
Un siècle et demi plus tard, Sauval dans son Histoire des
Antiquités de la Ville de Paris, exprimait la même
critique : « On voudroit bien que les malades ne fûssent
pas tant ensemble dans un même lit à cause de l'incommodité,
n'y ayant rien de si importun que de se voir couché avec une
personne à l'agonie et qui se meurt. » Avouiez que le bon
Sauval n'était guère excessif en ses expressions, et que
le met « importun », dans l'occurrence, apparat plutôt
faible.
Au XVIIIe siècle, un philanthrope auquel on doit maints progrès
humanitaires et sociaux et dont le nom est fort injustement oublié,
Piarron de Chamousset, qui inventa la petite poste et fut le véritable
père de la mutualité, mena une vigoureuse campagne contre
ces déplorables pratiques. Il fit dans un mémoire intitulé
Exposition d'un plan proposé pour les malades de l'Hôtel-Dieu,
une peinture effroyable de ces asiles « si redoutés, disait-il
que les indigents pour lesquels ils ont été fondés
regardent comme le comble du malheur d'être obligés d'y
avoir recours. » Et pour illustrer son mémoire d'un exemple
probant, il créa dans sa maison même un hôpital où
les malades avaient chacun leur lit et un cube d'air suffisant pour
leur permettre de respirer.
Mais ni les bons exemples, ni les justes critiques ne pouvaient triompher
si vite de la routine. En 1786, on mettait encore dans un même
lit, au minimum quatre, et au maximum neuf malades ; on laissait pourrir
la paille et la laine dans les matelas ; on trouvait partout, disaient
les rapporteurs de l'Académie des Sciences, « une odeur
infecte, une humidité putride, une pullulation incroyable de
parasites de toute espèce, et jusqu'à des nichées
de rats qui élisaient domicile dans les paillasses.
Ce n'est qu'en 1799 qu'on commença d'adopter l'usage des lits
en fer, et seulement dans les premières années du XIXe
siècle qu'on renonça à la funeste habitude de coucher
plusieurs malades dans le même lit.
Mais avec quelle lenteur s'accomplirent, les autres progrès de
l'hygiène nosocomiale !...
Pour s'en faire une idée, il suffit d'avoir visité il
y a quelques années seulement certains de ces foyers de contagion
qu'étaient nos vieux hôpitaux parisiens. A la vue de ces
murs sombres, de ces salles froides et obscures, on se transportait
tout naturellement par l'imagination aux temps douloureux où
les malades étaient entassés là, sans souci de
la contagion, les mourants à côté des convalescents,
les vivants à côté des morts, et, certes, on la
comprenait, cette sainte horreur de l'hôpital qu'avaient nos ancêtres.
Ernest LAUT.
Le Petit Journal illustré du 27 juillet 1913