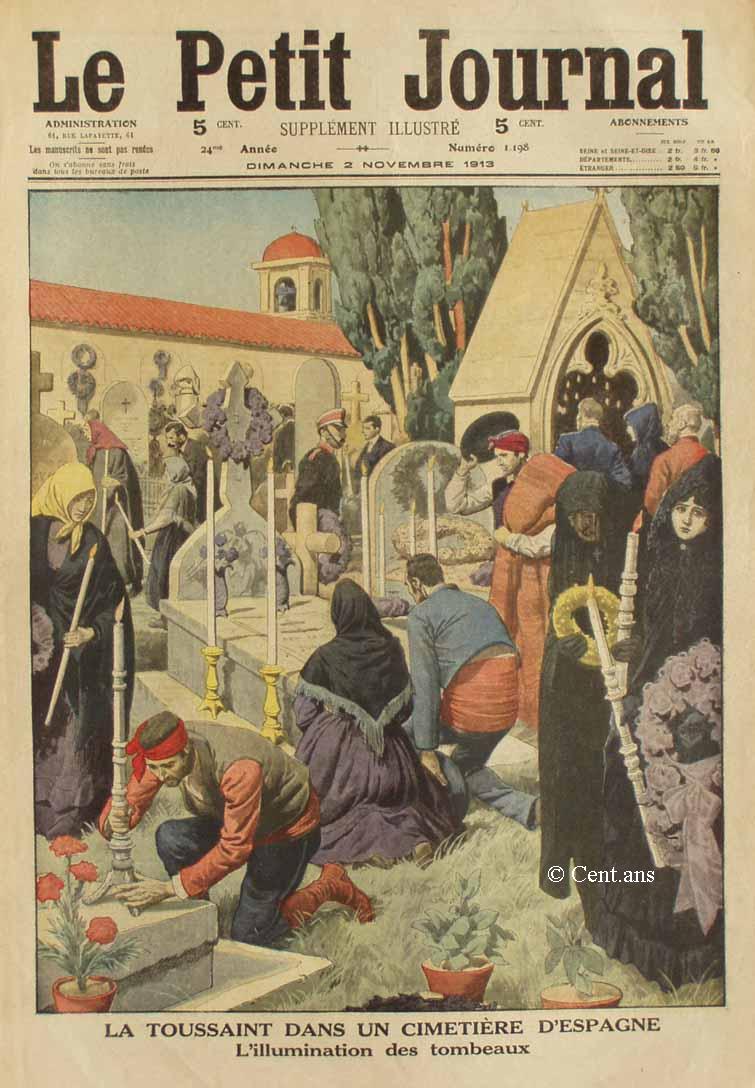LA TOUSSAINT DANS UN CIMETIÈRE D'ESPAGNE
Illumination des tombeaux
Nous signalons, dons notre « Variété
», cette curieuse coutume qui subsiste dans les pays du Midi latin,
en Alsace et même dans certaines villes françaises du Nord,
d'allumer des flambeaux sur les tombes le soir de 1a Toussaint.
C'est en Espagne surtout que cette tradition se manifeste avec le plus
de pittoresque. Les cierges sont ornementés, sculptés,
damasquinés, ornés de fleurs en cires multicolores : bleues,
rouges, vertes, jaunes. Sur les tombes, on dépose des couronnes
faite en plumes également multicolores. Et la foule, peu recueillie,
les femmes coiffées de la mantille ou d'un élégant
voile de tulle, circule à travers les cimetières, tandis
qu'à tous les clochers les cloches se répondent joyeusement.
L'hommage aux morts, en ce pays, ne s'accompagne nullement d'un appareil
lugubre.
VARIÉTÉ
La fête des Morts dans tous les pays
Les traditions de la Toussaint. - Le respect des morts autrefois et aujourd'hui. - Cérémonies pittoresques. - Les cimetières en fête.
Voici la Toussaint.
Durant ces premiers jours de novembre, la foule se presse vers les champs
de repos. Et, par une pieuse tradition, les dernières fleurs
de l'année, les roses tardives, les chrysanthèmes vont
s'effeuiller sur les tombeaux.
Le respect, la vénération des morts furent de tous les
temps. Les anciens avaient maintes façons de célébrer
le souvenir des parents et des amis disparus.
Ils plantaient sur les tombeaux l'if, arbre de deuil en raison de son
feuillage noir, et aussi le pin et le cyprès, qui ne repoussent
plus une fois coupés et qui, pour cette raison, symbolisaient
la mort.
Sur la tombe de ceux qui avaient laissé après eux une
réputation de bonté, on plantait le frêne, parce
qu'une croyance assurait que le serpent ne pouvait vivres sous l'ombrage
de cet arbre.
Le houx, symbolisant le courage, était réservé
aux tombeaux des guerriers ; le bouleau, avec l'écorce duquel
on faisait des livres, croissait sur ceux des savants.
Le rosier, enfin, était planté à profusion sur
toutes les sépultures. C'était le parfum sur l'urne funéraire,
le symbole de la vie rendant hommage à la mort
***
Les traditions se perpétuent de peuple à peuple et d'âge
en âge. Le respect des défunts, en dépit de notre
moderne scepticisme, reste intangible ; et il n'est si humble cimetière
de France qui ne reçoive les pieuses visites de ceux qui se souviennent.
A Paris même, ces visites sont si nombreuses qu'elles ne vont
pas sans causer quelque cohue dans les cimetières. On a parfois
protesté contre ces bruyants défilés qui font ressembler
les champs de repos à des boulevards un jour de réjouissances
.
Je ne sais plus plus qui a appelé la fête de la Toussaint
« la Courtille de la douleur ».
De fait, la foule n'est pas toujours très recueillie et son attitude
témoigne souvent d'autres sentiments que ceux du souvenir et
du regret
« Il y a, disait un chroniqueur parisien, comme une sorte de satisfaction
chez les visiteurs annuels des disparus. Regardez bien: les visages
sont loin d'avoir l'expression ravagée des pietas des
Primitifs. Ils expriment la satisfaction du devoir accompli, d'un devoir
souriant, comme si le deuil, cette vois, était en fête.Fête
des fantômes. Il y a bien, entre les pierres grises, quelque femme
en deuil, courbée sous ses voiles noirs, ou quelque vieillard,
cassé, portant d'un pas alourdi, une couronne à quelque
disparu. Mais la plupart des visiteurs semblent se hâter, presser
le pas, pour revenir à la vie qui attend, qui les appelle.»
L'observation est fort exacte. Beaucoup de gens vont dans les cimetières
ce jour-là par pure habitude, et n'y vont pas avec toute la piété
qu'il faudrait. Ils remplissent ce devoir comme toutes les autres obligations
accoutumées de l'existence, un peu par habitude, un peu par snobisme,
et leur attitude s'en ressent.
Cela est si vrai que beaucoup de ceux qui vont là avec la seule
pensée d'honorer leurs morts, ont pris le parti de faire leur
visite au cimetière avant le 1er novembre, pour éviter
la cohue de la Toussaint
Cependant, si les cimetières parisiens ne reçoivent pas
ce jour-là que des visites discrètes et réellement
pieuses, il faut reconnaître que le culte des morts est pourtant,
aujourd'hui, empreint de plus de dignité et de respect qu'au
temps jadis.
Nos aïeux avaient une sainte peur de la mort. Ils la représentaient
partout sur les murs des églises et des cloîtres et lui
donnaient l'aspect le plus terrifiant. Les danses macabres, l'illustration
constamment répétée du « dict des trois morts
et des trois vifs » apparaissaient sans cesse aux yeux de humains
pour leur rappeler qu'ils n'étaient que poussière.
Et les poètes se faisaient constamment, dans leurs vers, l'écho
des menaces de la mort.
La mort fiert à dextre à senestre
N'épargne lai ne clerc ne prestre
Quand elle a filé son fil retors.
( La mort frappe à droite à gauche, n'épargne ni laïc, ni clerc, ni prêtre, quand elle a filé son fil retors...)
La mort, en champs, en bois, en prés,
En tous lieux est à chacun près....
Ainsi, nos ancêtres vivaient dans la crainte
perpétuelle de la mort. Ils la redoutaient, mais ils ne la respectaient
pas.
Ce respect de la mort est un sentiment relativement moderne et qui s'est
développé avec l'éducation. A la fin du XVIII siècle,
Sébastien Mercier, le pamphlétaire, s'indignait, dans
son Tableau de Paris, contre le peu de déférence
que les Parisiens d'alors témoignaient, . aux enterrements qu'ils
croisaient dans les rues.
Aujourd'hui, qui donc ne se découvrirait pas sur le passage d'un
cortège funèbre ?
Il faut croire qu'il n'en allait guère mieux au commencement
du XIXe siècle qu'à la fin du précédent.
M. Jules Claretie, en effet, a exhumé des vers d'une poétesse
du temps, qui n'est autre que la femme du général Dupont
- le trop célèbre capitulard de Baylen - parmi lesquels
se trouve une pièce intitulée Les Tombeaux, où
se trouvent fustigés les visiteurs irrespectueux des cimetières:
Un peuples curieux, des groupes sans pudeur
Entourant ces tombeaux touchés par la douleur
Arrachent leur verdure et la fleur inodore
Qui, dans leur abandon, les consolait encore !
Et la générale commentait ses vers par quelques réflexions
en prose :
« A l'époque où j'ai écrit cette pièce,
disait-elle, le cimetière de l'Est offrait souvent, et particulièrement
le jour de la Toussaint, le spectacle le plus scandaleux et le plus
repoussant. La fête populaire, avec son rire bruyant, ses quolibets,
ses chansons grossières, ses orgies, s'y débattait dans
tous les sens, y hurlait sur tous les tons. L'ouvrier endimanché
venait faire là son dîner sur l'herbe. Les pierres tumulaires,
les urnes encombrées de provisions, inondées de vin, protestaient
silencieusement contre cette profanation impie. Les marchands forains
se heurtaient dans les étroits sentiers qui séparent à
peine les demeures de la mort. Les fleurs sacrées étaient
cueillies, brisées, écrasées ; les couronnes jetées
au vent. Malheur à l'infortuné qui tentai cette veille
de la fête des Morts, de porter son hommage à une cendre
vénérée ! Accueilli par la dérision de la
foule, et plus seul au milieu d'elle, plus séparé cent
fois de l'objet de ses regrets que dans la solitude accoutumée
du cimetière, il s'éloignait, à la fois indigné
et navré de se voir privé du triste et dernier bonheur
de porter à l'urne chérie son tribut de fleurs et de larmes...
C'était, vous le voyez, une vraie foire parmi les tombeaux. Les
moeurs, depuis lors, ont heureusement changé. Pour une fois,
nous pouvons louanger notre époque est ne point regretter le
temps passé.
***
Rares sont les peuples qui n'ont point, parmi leurs cérémonies
traditionnelles, un jour consacré au culte des morts. Les peuples
indo-chinois peut-être sont les seuls. Mais n'allez pas en déduire
qu'ils négligent la mémoire de leurs parents disparus.
Au contraire s'ils n'ont point de jour spécial pour la célébrer;
c'est qu'en réalité il la célèbrent tous
les jours. Le culte des ancêtres est permanent chez ces peuples,
et, dans chaque maison se trouve l'autel qui leur est dédié,
autel sur lequel trône un Bouddha devant lequel, chaque jour,
sont effeuillées des fleurs et brûlent des baguettes parfumées.
Les peuples de race arabe non plus n'ont pas de jour spécial
pour fêter leurs morts ; mais eux aussi les fêtent constamment,
car ils vont beaucoup au cimetière. Il est vrai que les cimetières
musulmanes ont un aspect riant que n'ont pas chez nous les champs de
repos.
« Le cimetière, dit le capitaine Paris, devient, pour la
plupart des hommes et des femmes arabes, un lieu de réunion où
l'on cause, où l'on rit, où l'on mange. En sortant du
bain maure, les femmes s'y donnent rendez-vous pour le vendredi suivant,
afin d'y terminer un commérage. Le vendredi, dimanche musulman,
est, en effet, généralement réservé aux
femmes, qui s'y rendent en foule. C'est pour elles une sortie heureuse,
une fuite du harem où la vie domestique est pénible, une
possibilité d'intrigue. Ce jour-là, un Européen
ne peut pénétrer dans ces nécropoles où
les vieilles sépultures, abandonnées à l'herbe
qui poussa et aux morsures du temps, ne sont plus que des endroits pleins
d'ombre et de fraîcheur, où le gazouillement des oiseaux
se mêle au babillage aigu des femmes... »
Ici, le souvenir des morts n'est accompagné d'aucune tristesse
; rien de macabre, de tragique ou de fantastique ne vient s'y mêler.
Il n'en est pas de même chez les peuples du Nord qui, en général,
célèbrent la mémoire des disparus avec une ferveur
empreinte d'un sombre mysticisme.
Jugez-en plutôt par cette coutume ancienne que le peuple lithuanien
observe encore le jour de la Dziady ou fête des trépassés.
Cette cérémonie, semi-catholique , semi-païenne,
fut naguère défendue, sévèrement par le
clergé. Dès lors, les paysans la célébrèrent
la nuit dans les caves ou dans les ruines abandonnées des châteaux.
Ils y apportent avec eux le miel l'eau-de-vie, les gâteaux et
autre offrandes prescrites par le rite. L'objet de la fête des
Morts est de soulager les âmes souffrantes dans l'autre monde
; elle a lieu le second jour de la Toussaint et est présidée
par un Huslar, joueur de luth, descendant dégénéré
des anciens bardes de la Lithuanie.
C'est le Huslar qui évoque les âmes des morts et ordonna
aux parents qui assistent à la cérémonie de leur
offrir le miel et les gâteaux, ou bien de leur promettre les prières
et les messes qui peuvent les soulager selon fleur position plus ou
moins douloureuse dans le purgatoire et dans les régions vagues
et incertaines entre la terre et le ciel.
Les paroles dont le Huslar se sert pour évoquer les âmes,
les signes symboliques qui accompagnent ses paroles sont, parfois, d'une,
poésie singulière. L'âme d'un enfant mort à
l'âge de l'innocence, mais sans baptême, est évoquée
par la flamme bleuâtre et légère des tresses de
lin ; la flamme de certaines fleurs desséchées, provenant
de plantes qui ne donnent pas de fruits, a la vertu de faire accourir
les âmes des jeunes fille qui sont mortes sans avoir aimé.
L'âme d'un avare est naturellement évoquée par le
son de l'argent. La fumée noire et épaisse du goudron
fait venir les âmes damnées des seigneurs qui opprimèrent
les paysans.
Cette cérémonie est toujours entourée de mystère
et il est assez dangereux, pour un étranger de vouloir en être
témoin. Un savant allemand qui, pour étudier les moeurs
des paysans lithuaniens, parvint à se glisser dans une de ces
assemblées mystérieuses, faillit payer de la vie sa curiosité.
On ne lui fit grâce qu'à la condition qu'il jurerait de
ne jamais révéler ce qu'il avait vu et entendu.
Le grand poète polonais Adam Mickiewicz a tiré parti de
cette cérémonie poétique, et l'a prise pour sujet
d'un de ses plus beaux poèmes.
***
D'étranges croyances sur le jour de la Toussaint subsistent également
dans des contrées maritimes où l'existence s'écroule
dans un perpétuel danger.
C'est ainsi qu'en Bretagne il n'était pas, jadis, un vieux pêcheur
qui consentit à prendre la mer ce jour-là, à cause
du « coup de vent des morts ». Si unie que fût la
surface de l'Océan, les vieux matelots ne s'y trompaient pas.
Ils savaient que ce calme était fallacieux et que dans les profondeurs
des flots s'agitait la légion innombrable des trépassés
engloutis par l'Océan.
Une croyance, que l'on retrouve d'ailleurs en Danemark et jusqu'en Islande,
assurait qu'il était au fond de la mer des cimetières
gardés par les « évêques de la mer ».
Le jour de la Toussaint, ces évêques officiaient dans d'immenses
cathédrales sous-marines, où se pressaient les trépassés.
Et les cloches de ces églises sonnaient, et les vieux déclaraient
que souvent, en se penchant sur les flots, ils avaient entendu l'écho
faible et lointain de leurs carillons.
Ils disaient aussi que, la nuit de la Toussaint, les âmes des
noyés, éveillées par ces cloches qui tintaient
de toutes parts au fond de l'Océan, montaient à la surface
et s'en venaient errer sur la crête des vagues.
Et c'est pour cela que, de peur de heurter l'âme de quelqu'un
de leurs ancêtres, ils préféraient, demeurer au
logis devant une bolées de cidre et conter aux femmes et aux
enfants frissonnants toutes ces belles et sinistres histoires du temps
passé, toutes ces légendes dont le souvenir s'estompe
et s'affaiblit, d'année en année, devant l'invasion de
la science et du progrès.
***
En certains pays, enfin, la fête des morts s'accompagne de manifestations
qui sont comme un lointain écho des rites du paganisme antique.
Dans maints villages d'Italie et d'Espagne, on peut assister ce jour-là
à des solennités des plus pittoresques.
Du matin au soir, les cloches des églises et des chapelles sonnent
à toute volée et le peuple accompagne leur carillon d'une
mélopée mélancolique et monotone qui est une sorte
d'invocation naïve aux morts. Les campagnards, dans leurs plus
beaux costumes, viennent en foule vers l'église, poussant devant
eux leurs ânes ou leurs mulets chargés de sacs de blé,
d'orge et de maïs. Sur les dalles, on vide tous ces sacs et l'église
ressemble bientôt à une halle. Puis, dans la journée,
ces dons volontaires sont vendus à la criée, et le produit
est employé à payer des messes pour le repos de l'âme
des défunts.
Le soir, suivant une tradition qui remonte aux temps les plus reculés,
les cimetières s'illuminent et l'on croirait voir une multitude
de feux follets sur les tombeaux.
Détail curieux : cette coutume n'est pas absolument particulière
aux pays du Midi latin ; on la retrouve en Alsace et dans un certain
nombre de villes de notre Flandre française, où elle survit
comme un dernier vestige des amours apportées jadis par les Espagnols,
qui occupèrent cette contrée au seizième siècle.
Au surplus l'usage d'allumer des feux sur les tombes le soir de la fête
des morts se retrouve jusqu'en Extrême-Orient.
Parmi les innombrables fêtes qui se célèbrent annuellement
au Japon, celle en mémoire des morts est la plus typique peut-être
et l'une des plus gaies à coup sûr.
Ce soir-là, on allume, d'un bout à l'autre des cimetières,
des lanternes multicolores ; et, devant les tombeaux des parents, les
familles apportent des provisions et viennent banqueter et se réjouir.
Nous qui, le jour de la Toussaint, parcourons nos champs de repos dans
le silence et le recueillement, nous serions tentés de nous scandaliser
de ces moeurs bachiques et bruyantes. N'en faisons rien : soyons éclectiques
et tolérants. Chaque peuple à sa façon de célébrer
le souvenir de ses morts, et les Japonais estiment assurément
que la meilleure manière de satisfaire les mânes de leurs
ancêtres c'est de leur montrer que ceux qui restent sont heureux.
Ernest LAUT.
Le Petit Journal illustré du 2 novembre 1913