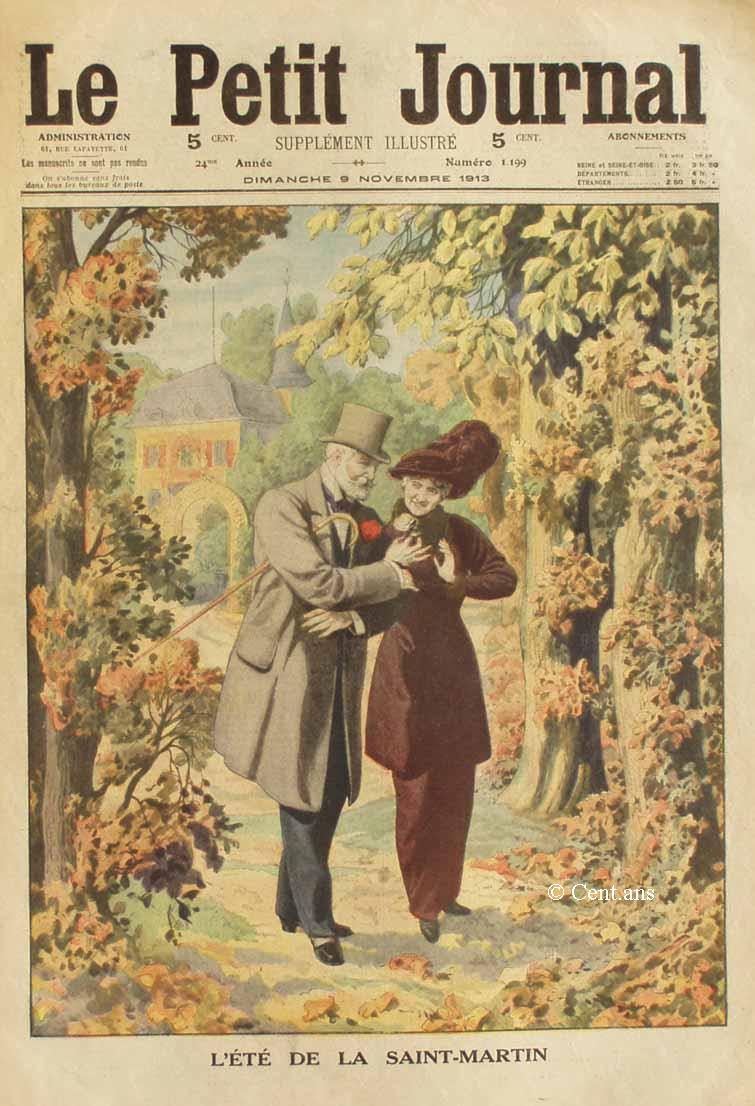L'ÉTÉ DE LA SAINT-MARTIN
Tout le monde sait ce que signifie, au figuré,
cette expression : l'Été de la Saint-Martin. C'est un
renouveau de jeunesse, un regain d'ardeur chez ceux qui ont passé
l'âge des passions.
De même que la nature nous rend chaque année à la
fin de l'automne les tiédeurs du printemps, de même il
arrive parfois à ceux qui sont aux portes de la vieillesse de
s'en évader quelques instants et de retrouver d'ardeur de leurs
jeunes ans.
Mais, dans la nature comme dans l'humanité, ce n'est que feu
de paille, flamme passagère qui s'éteint rapidement.
Voilà l'été de la Saint-Martin.
A présent, vous plaît il d'en connaître la légende.
Elle est curieuse et se rattache à celle du manteau de saint
Martin, que l'imagerie religieuse a popularisée.
Il faut que vous sachiez qu'avant d'être un des plus vénérés
parmi les prélats de la Gaule, saint Martin avait été
soldat. Or, vers l'an 330, le soldat Martin était en garnison
à Amiens ; et, déjà, sa bienfaisance était
légendaire, car il ne retenait de sa solde que la somme strictement
nécessaire à son entretien et il distribuait aux pauvres
le surplus.
Un jour, donc, un jour d'hiver sombre et froid, comme il rentrait à
Amiens après une chevauchée aux environs, Martin avisa,
au portes de la ville, un mendiant à peine couvert de vêtements
en lambeaux et qui grelottait sous les âpres morsures du vent.
L'homme se lamentait et demandait l'aumône. Martin arrêta
son cheval et fouilla dans sa bourse... Mais sa bourse était
vide... Il avait tout donné.
- Je n'ai, dit-il alors au mendiant, ni or ni argent, mais ce que j'ai,
je te le donne au nom de Notre-Seigneur.
Et, ce disant, le jeune cavalier tira son épée et s'en
servit pour couper en deux son manteau dont il donna la moitié
au miséreux.
Or, à peine Martin avait-il parlé, que la Nature, dit
la légende, tressaillit, et à travers les nuées
qui, brusquement, s'étaient entr'ouvertes, resplendit le plus
magnifique soleil.
En même temps se fit entendre du Ciel une voix qui disait :
- Martin, puisque tu t'es montré miséricordieux pour le
dernier des miens, j'ai voulu, te donner un avant-goût des joies
du paradis. Il y aura dans l'autre vie un printemps perpétuel
pour ceux qui auront pris soin, de mes pauvres ici-bas.
Depuis lors, en souvenir de la libéralité de Martin, il
en en est de même à époque fixe chaque année
; et c'est là l'origine de ces quelques journées clémentes
à l'orée de l'hiver, qu'on appelle l'Été
de la Saint-Martin.
L'été de la Saint-Martin est de tous les pays ; mais,
en chaque pays il porte un nom différent : Sur le Rhin, on l'appelle
l'été de tous les saints. En Lombardie, où c'est
en général une des époques les plus agréables
de l'année, on l'appelle l'été de Sainte-Thérèse.
Dans l'Amérique méridionale, où cet été
tombe à la mi-décembre, on l'appelle l'été
indien. Les Suédois le nomment l'été de Sainte-Brigitte,
les Tchèques l'été de Saint-Wenceslas, les Flamands
l'été de Saint-Michel, les Anglais l'été
du petit Saint-Luc, les Polonais l'été de la bonne femme.
Dans les pays du Nord, le 1er novembre est généralement
beau et on le qualifie de repos de tous les saints. Les Westphaliens
disent que l'été de la Toussaint dure trois heures, trois
jours ou trois semaines
VARIÉTÉ.
Les légendes du poison
A propos d'une communication à l'Académie de médecine. - Pascal est-il mort empoisonné ? Et Marie-Louise ? - Et, l'Aiglon ? - La confession fantastique du dentiste. - Comment la médecine réfute les légendes de l'histoire.
L'Académie de Médecine s'est occupée,
ces jours derniers, du cas d'un illustre malade, qu'il ne s'agissait,
d'ailleurs pas de guérir, car il est mort depuis plus de deux
cent cinquante ans.
Ce cas n'en était pas moins intéressant, étant
données la qualité du sujet et les légendes qui,
jusqu'à nos jours, ont couru sur les causes de sa mort.
Il s'agit de Blaise Pascal, mathématicien, physicien et philosophe
fameux, dont les Pensées demeureront, à travers
les âges, l'un des trésors du génie français.
Or, depuis deux siècles et demi, il avait couru des bruits fâcheux
- fâcheux surtout pour la science d'Esculape .- sur les causes
de la mort de Pascal. On prétendait que le philosophe avait été
bel et bien tué par les médecins qui le soignèrent.
Bast ! diront les contempteurs de la médecine, bast ! les médecins,
depuis ce temps-là, en ont tué bien d'autres !
Il se peut ; mais en tout cas, il paraît scientifiquement établi
qu'ils n'ont pas tué Pascal. Et c'est du moins un crime qu'il
faut rayer de leur acte d'accusation.
C'est le docteur Cabanès qui démontra, l'autre jour, devant
l'Académie, la fausseté de la légende.
On sait que le savant historiographe de la médecine s'est fait,
de l'étude des cas célèbres d'autrefois, une sorte
de spécialité.
C'est lui qui a créé la Société médico-historique,
dont le but est d'étudier l'histoire, la littérature et
l'art dans leurs rapports avec la médecines. Ses travaux n'ont
d'autre objet que de réformer les erreurs que la légende
populaire a peu à peu glissées dans l'histoire. Les morts
mystérieuses suscitent les recherches de sa sagacité.
Celle de Pascal ne pouvait le laisser indifférent.
Or, il a constaté que Pascal, quoiqu'on en ait dit, n'a point
été victime d'un empoisonnement, causé par une
application excessive du traitement antimonial, et que si les médecins
qui le soignaient ne surent pas découvrir le véritable
siège de son mal, du moins ne l'empoisonnèrent-ils-pas,
comme on l'a prétendu faussement. Ils le traitèrent pour
un mal d'intestins, alors que la maladie était dans la tête.
Pascal est mort d'une méningite. Quoi d'étonnant qu'un
tel homme ait succombé à une affection du cerveau ?...
N'était-ce pas, de tous ses organes, celui qu'il avait le plus
surmené ?
***
On n'imagine pas combien fréquentes et tenaces ont été,
au temps jadis, les légendes d'empoisonnement.
Dès qu'un personnage célèbre mourait sans qu'on
pût exactement déterminer les causes du mal qui l'avait
emporté, tout de suite la légende du poison se formait.
Or, la science du diagnostic était alors dans l'enfance. Les
médecins, non seulement n'étaient pas souvent capables
de démêler l'origine de la maladie ; mais le malade ayant
succombé, il leur arrivait parfois de n'y voir pas plus clair,
même après l'autopsie.
On conçoit, dans ces conditions, que la légende avait
beau jeu.
Aussi que de croyances absurdes s'échafaudèrent sur des
morts qui, en fin de compte, avaient été, la plupart du
temps, fort naturelles.
Et ce n'est pas seulement à l'époque de là Renaissance
et au dix-septième siècle que la mort plus ou moins expliquée
de certains personnages historiques a fait naître ces légendes
de l'empoisonnement. Dans sa dernière oeuvre : « Légendes
et curiosités de l'Histoire », le docteur Cabanès,
rappelle, entre autres sujets curieux, que les mêmes rumeurs d'empoisonnement
se répandirent à la mort de personnages historiques plus
proches de notre temps.
C'est ainsi qu'une double légende affirma longtemps que Marin-Louise
avait succombé au poison de même que le duc de Reichstadt.
On sait qu'après la mort du comte de Neipperg, son second mari,
Marie-Louise, duchesse de Parme, en avait pris un troisième,
le comte Charles-René de Bombelles. L'ex-impéaratrice
des Français était une femme de tempérament.
Or, tandis que Neipperg s'était contenté modestement de
son rôle de prince consort, Bombelles, personnage ambitieux et
autoritaire, s'avisa de vouloir, pour de bon, jouer au duc souverain.
Ses allures despotiques firent naître autour de lui un cercle
d'inimitiés. Un complot politique s'organisa contre lui et sa
mort fut décidée.
En Italie, terre classique du poison, quel autre moyen pouvait-on employer
pour se débarrasser du tyran ? Il fut donc résolu entre
les conjurés qu'on empoisonnerait Bombelles. Mais il advint que,
par suite d'une méprise, ce fut le châpelain-aumônier
de la grande duchesse qui avala le breuvage destiné à
Bombelles, et qui mourut à sa place.
Les conspirateurs, cependant ne se découragèrent pas :
dix jours plus tard, ils recommencèrent l'expérience.
Mais ce Bombelles, décidément, avait une chance invraisemblable
: chaque fois qu'on essayait de le tuer, il se trouvait là fort
à propos quelqu'un pour boire le poison qu'on lui avait préparé.
Cette fois, ce fut Marie-Louise en personne qui avala la drogue. Et
voilà comment la grande-duchesse aurait succombe à la
place de son troisième époux.
Telle est la légende.
Vous allez voir comment le docteur Cabanès en fait justice.
Il suit jour par jour les progrès de la maladie de Marie-Louise,
depuis le 9 décembre 1847, jour où elle en éprouva
les premiers symptômes, jusqu'au 18, jour où elle rendit
l'âme.
Neuf jours de maladie : il faut avouer que voilà un poison dont
les effets eussent été singulièrement lents à
se produire.
La grande duchesse ressentit d'abord une douleur au côté
droit de la poitrine, puis vinrent des frissons. La fièvre se
déclara ensuite et ne la quitta plus. Ajoutons qu'elle était
rhumatisante et que les douleurs qu'elle ressentait continuellement
dans les bras lui faisaient répéter souvent à son
entourage : « La première maladie sérieuse que je
ferai m'emportera. »
L'ex-impératrice ne se trompait pas. Avec la fièvre, elle
eut des accès de toux, de l'oppression. Les médecins,
d'ailleurs, ne s'abusèrent pas sur son mal : ils
diagnostiquèrent une pleurésie. Et c'est, en effet, d'une
affection aiguë de voies respiratoires qu'elle mourut, «
selon toute apparence dit le docteur Cabanès d'une pleuro-pneumonie
».
Cependant l'imagination populaire a un tel besoin de mettre du mystère
et de la tragédie dans tout ce qui concerne les grands de ce
monde que longtemps à Parme et dans toute l'Italie une foule
de gens demeurèrent persuadés que la veuve de Napoléon
était morte empoisonnée.
***
Mais la légende du poison fut bien autrement tenace en ce qui
concerne la mort du fils de Marie-Louise, de celui que la France appelait
le roi de Rome, d'Autriche le duc de Reichstadt, et auquel un vers fameux
de Victor Hugo a fait donner ce nom désormais consacré
par l'histoire : l'Aiglon.
Le fils de Napoléon vivait encore et souffrait du mal qui devait
l'emporter et déjà on chuchotait que c'était au
poison qu'il était en train de succomber. Ce bruit même
avait pris tant de consistance qu'au lendemain de la mort du jeune prince
le roi de Bavière demandait à l'ambassadeur autrichien
accrédité auprès de la Confédération
germanique :
- Dites-moi, le duc de Reichstadt est-il mort de mort naturelle ?
Et comme l'ambassadeur marquait quelque surprise d'une telle question
il ajoutait :
- Comprenez-moi bien : comme il y a en France deux partis qui ont intérêt
à sa mort, je me demande si rien n'a été tenté
de ce côté contre le fils de Napoléon.
On accusa le médecin Malfatti qui avait soigné le prince
d'avoir accepté de le tuer lentement.
L'auteur anonyme d'un mémoire intitulé Révélations
sur la mort du duc de Reichstadt, écrivait en 1833 :
« Selon l'opinion vulgaire la plus accréditée parmi
la populace, on a dit que pendant toute la maladie du duc, Malfatti
avait toujours marché le poison à la main, que sciemment,
pour arriver à un but arrêté, prescrit et consenti,
il avait soumis son malade à un traitement dont il calculait
froidement l'influence homicide. Selon les prôneurs de cette hypothèse,
ce calcul régicide a duré deux ans. Pendant deux ans,
Malfatti aurait divisé les jours de son malade par l'action d'un
poison ; et toutes les vingt-quatre. heures, il aurait fait la soustraction
de un pour cent de son existence... »
Et l'auteur de ces lignes ajoutait :
« Ce serait par trop atroce et c'est d'une trop grossière
absurdité pour supporter le raisonnement ; une telle accusation
est au-dessous de toute réfutation... »
Il y eut cependant sur le prétendu empoisonnement du duc de Reichstadt
une histoire d'une absurdité plus grossière encore que
celle-là :
Cette histoire fut recueillie dans les Mémoires d'une actrice
du Théâtre Français, Mme Judith, Mémoires
publiés il y a quelques années.
Mme Judith déclarait tenir cette tragique confidence du prince
Jérôme Napoléon en personne, lequel la tenait lui-même
de la duchesse Stéphanie de Bade, cousine de Napoléon
Ier.
Or, ladite duchesse Stéphanie avait une femme de chambre qui
avait épousé un dentiste renommé en Autriche à
l'époque de la maladie et de 1a mort de l'Aiglon.
Comme la duchesse avait gardé une grande affection pour cette
femme, elle n'hésita pas à se rendre à son appel
un jour où celle-ci, vieille et gravement malade la fit supplier
de venir à son chevet pour recevoir communication d'un secret
des plus graves.
Et quand son ancienne maîtresse fut auprès d'elle, cette
femme lui dit
« Vous aurez sans doute interêt à savoir la vérité
sur la mort du duc de Reichstadt, puisqu'il était de votre famille.
La voici : C'est mon mari qui a tué le fils de l'impératrice
Marie-Louise. Il m'en a fait l'aveu.
» Il soignait les dents du jeune duc. Un jour, le prince de Metternich
l'appela et lui parla sans témoins. Il lui demanda s'il ne pouvait
pas, par plusieurs piqûres empoisonnées faites aux gencives
et espacées sur le cours d'une année au moins, tuer lentement
le fils de Napoléon 1er. La mort paraîtrait ainsi l'effet
d'une maladie de langueur. Il lui promettait, de l'enrichir pour le
récompenser. Mon mari accepta ce marché abominable et
l'exécuta. Telle est la confession que j'avais à vous
faire. Au moment de quitter la vie, j'ai voulu décharger ma conscience
d'un secret qu'elle avait horreur de révéler... »
L'étrangeté et l'invraisemblance d'une pareille histoire
échappent à toute discussion. C'est un chapitre de roman
ou une scène de mélo. Cela n'a pas besoin d'être
réfuté. Mais de tels racontars témoignent une fois
de plus combien les événements les plus naturels, quand
il s'agit des personnages de l'histoire, affolent la cervelle de certaines
gens.
Bien d'autres bruits coururent sur la mort de l'Aiglon ; bien d'autres
hypothèses furent mises en avant pour expliquer cette mort par
un acte criminel. Tout cela ne tient pas devant l'étude de la
maladies et les observations du médecin.
« On a pu suivre l'évolution du mal qui emporta le duc
de Reichstadt, dit le docteur Cabanès, à travers les bulletins
de santé si précis, si explicites de son précepteur
; on en voit la signature nette, irrécusable dans le procès
verbal de son autopsie...
Et il conclut :
« Si le duc de Reichstadt a succombé au poison, c'est au
poison tuberculeux.. »
Mais allez donc empêcher l'imagination populaire de mettre du
mystérieux et du tragique dans l'histoire !
Ernest LAUT
Le Petit Journal illustré du 9 novembre 1913