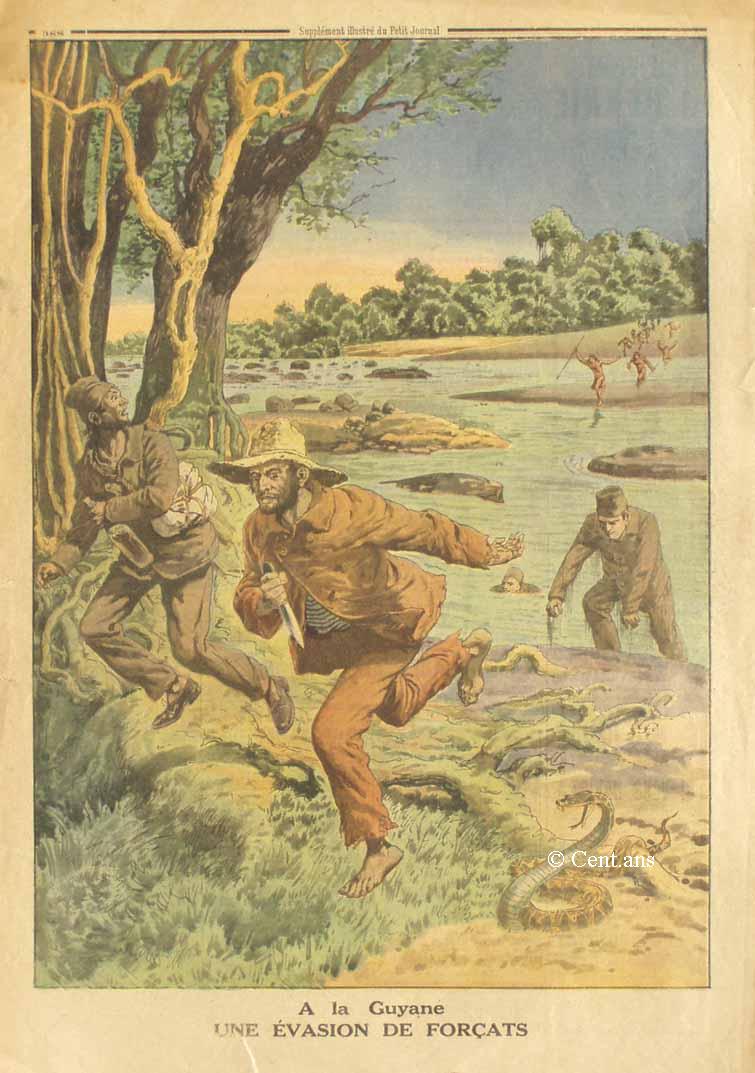A LA GUYANE
UNE ÉVASION DE FORÇATS
Nos lecteurs trouveront dans notre « variété
» des détails curieux et tragiques et des statistiques
édifiantes sur les évasions qui se succèdent constamment
dans nos colonies pénitentiaires de la Guyane.
C'est le tableau d'une de ces évasions que notre dessinateur
a représenté ici.
Quatre forçats, détenus au bagne de Saint-Laurent du Maroni,
avaient décidé de s'enfuir. La liberté n'était-elle
pas là, tout près, dans cette Guyane hollandaise dont
les forêts profondes semblent, par delà le fleuve Maroni,
leur offrir un asile certain ? Mais il y avait le fleuve à traverser,
un fleuve aux eaux rapides que les caïmans surveillent mieux que
des gardes-chiourme.
Ils risquèrent l'aventure pourtant, et parvinrent sur l'autre
rive. Mais des Indiens Galibis, dont l'unique métier consiste
à traquer les évadés pour toucher la forte prime,
les avaient aperçus ; et alors la chasse commença. Pour
échapper, ils s'enfoncèrent dans la forêt vierge
infestée de bêtes féroces et de serpents, et ce
fut une fuite effroyable, hallucinante, à travers un enchevêtrement
de lianes dont ils désespéraient de jamais sortir.
Fuite vaine, d'ailleurs. Après quelques jours de poursuite, les
Indiens les rejoignirent ; ils étaient épuisés
et se laissèrent ligoter et ramener au bagne sans résistance
VARIÉTÉ
Les évasions du bagne
Trop de « chevaux de retour ». - Comment on s'évade
du bagne. - Par la forêt ou par la mer. -Une scène de cannibalisme.
- Le bagne aux Kerguelen.
Récemment, en réponse à
une question de M. Grodet, député de la Guyane, le ministre
des Colonies publia une statistique dont les chiffres en disent long
sur la façon dont sont surveillés les forçats dans
cette colonie pénitentiaire.
De cette statistique, il résulte que dans les trois dernières
années 1910-1912, quatre mille huit cent soixante forçats
et relégués se sont évadés de la Guyane.
Un grand nombre, il est vrai, furent repris, soit en Guyane française,
soit en Guyane anglaise ou hollandaise. Mais cependant 438 forçats
et 236 relégués parvinrent à échapper à
toutes les recherches.
Or, les statistiques enseignent que cinquante pour cent des forçats
qui ont réussi à s'enfuir restent, soit au Brésil,
soit en Argentine, soit au Vénézuéla, où
ils sont sûrs de ne pas être extradés. Les autres
parviennent à rentrer en France où ils reprennent le cours
interrompu de leurs exploits.
C'est donc, en trois ans, trois-cent-trente-sept criminels dangereux
qui se trouvent, par la réussite de leur évasion, remis
en circulation, pour le plus grand dommage des honnêtes gens.
Étonnez-vous donc, après cela, que la police, ayant mis
la main sur des bandes de malfaiteurs y découvre presque toujours
des forçats en rupture de ban.
Dernièrement, des agents aperçoivent un malandrin qui,
à l'aide d'une baguette enduite de glu, dévalisait les
boîtes postales. Ils l'arrêtent, le mènent au commissariat.
Là, l'homme refuse de dire son nom. On le conduit alors au service
anthropométrique où l'on s'aperçoit que le voleur
n'est autre qu'un évadé de la Guyane.
Plus récemment encore, des inspecteurs de la police judiciaire
arrêtaient un autre « cheval de retour », condamné
en 1901 à six ans de travaux forcés et évadé
de la Guyane depuis 1904.
Il ne se passe plus guère de semaine sans qu'un incident du même
genre appelle l'attention sur ces évasions trop nombreuses et
les dangers qui en résultent.
Ne se décidera-t-on pas à aviser pour remédier
à un état de choses si funeste à la sécurité
publique ?
C'est donc chaque année, en moyenne, le sixième, et même
le cinquième de l'effectif du bagne qui prend la poudre d'escampette.
Cette proportion d'évadés est énorme. Elle démontre
combien la surveillance est insuffisante. Et que serait-ce, si les conditions
naturelles du pays n'opposaient pas aux bagnards qui se sauvent des
difficultés presque insurmontables ?... A coup sûr, il
ne resterait plus au bagne que les surveillants et quelques forçats,
criminels illustres dont le procès a fait sensation et qui, en
raison de leur célébrité, échappent au traitement
commun et se voient traiter par l'administration avec tous les égards
dus à leur notoriété. Ceux-là sont heureux
au bagne ; on leur donne d'agréables sinécures ; ils y
jouissent d'une bonne existence de farniente. Vous pensez bien qu'ils
se garderaient de risquer tous les périls d'une évasion,
pour mener, en somme, même dans le cas d'une réussite problématique,
une vie infiniment moins agréable que celle qu'on leur a faite
à la Guyane.
Il résulte, de ce fait, que les bagnards qui s'évadent
sont toujours les criminels obscurs. Ceux-ci subissent toutes les rigueurs
des règlements pénitentiaires. Aussi n'hésitent-ils
pas à s'enfuir quand l'occasion se présente. Et les difficultés
de l'entreprise ne les arrêtent pas.
Il y a pour fuir du bagne deux routes : la route de terre, qui conduit
à la Guyane hollandaise, et la route de mer.
Par la première, on risque d'être poursuivi et arrêté
par les Indiens Galibis qui font bonne garde afin de toucher la prime
de 50 francs accordée à quiconque ramène un forçat
évadé ; on risque encore, dans la forêt vierge,
d'être mangé par les fauves, les serpents ou les fourmis
rouges.
Par la seconde on ne court qu'un risque, mais il est d'importance. Un
gouverneur disait que le bagne était mieux surveillé par
les requins que par tous les gardes-chiourme du monde. Les côtes
de la Guyane sont infestées, en effet, de ces immenses squales
à la quintuple mâchoire qu'on appelle les « grands
pèlerins ».
Malheur au bagnard qui s'évade sur un trop frêle esquif
! Immédiatement, ces hôtes terribles de la mer lui font
cortège. Qu'une vague un peu forte retourne le bateau, c'est
la ruée sur la chair fraîche : en un instant le bagnard,
déchiqueté, a disparu dans les estomacs de ces monstres.
Vous voyez que, de quelque côté qu'on s'évade du
bagne, les périls sont à considérer, Cela n'empêche
pas que, tous les mois, en moyenne, cinquante à soixante forçats
tentent la périlleuse aventure.
Que de récits effroyables ont été faits par ces
hommes, des souffrances qu'ils ont subies !... Que de péripéties
extraordinaires qu'aucun romancier n'eût osé inventer.
Il y a quelques mois, une barque portant trois forçats évadés
venait s'échouer à l'embouchure du Maroni. Les trois hommes
furent ramenés au bagne, et là ils contèrent leur
épouvantable odyssée.
Le 6 janvier 1913, quatre forçats : Bachereau, Mouillard, Fossey
et Macheval s'étaient enfuis du pénitencier et avaient
gagné la forêt vierge. Ils avaient, pour toutes armes,
quelques sabres d'abatis, pour toutes provisions, quelques boîtes
de conserves. Fossey, qui les dirigeait, avait affirmé que le
voyage ne serait pas long, qu'en quelques jours on gagnerait la rivière
Mana. Là, on serait sauvé.
Mais, après six jours de marche, Fossey avoua qu'il s'était
trompé de route et qu'il ne savait plus où on était.
Les quatre hommes étaient perdus dans l'océan des lianes.
Ils marchèrent encore trois jours, au hasard, Les vivres étaient
épuisés ; ils mouraient de faim, étaient réduits
à mâcher des racines.
Harassés, ils résolurent de faire halte. Avec des branchages
ils construisirent une hutte. L'un d'eux, Macheval, malade, à
bout de forces, s'évanouit. Pendant ce temps, les trois autres
tenaient conseil. ... Et quel conseil !... La faim est une terrible
conseillère. Il s'agissait de manger, sinon, tous quatre étaient
menacés de laisser leurs os dans la forêt inextricable.
Or, cet homme évanoui, malade, allait mourir infailliblement.
Pourquoi ne le sacrifierait-on pas pour le salut commun ?...
Fossey empoigna un sabre d'abatis et frappa Macheval. Mouillard frappa
également. L'homme, éveillé par la douleur, comprit.
Il eut la force de se dresser, de s'enfuir. Les autres se mirent à
la poursuite du gibier qui s'échappait, le rejoignirent, l'achevèrent.
Le soir, repus, ils s'endormaient dans leur cabane ; et le lendemain,
après avoir, suivant l'expression de l'un d'eux, « choisi
les meilleurs morceaux » sur le corps de leur camarade, ils se
remirent en route.
Deux jours encore ils cheminèrent, vivant de chair humaine. Enfin,
ils arrivèrent à la rivière Mana, s'embarquèrent
dans une pirogue et allèrent échouer à l'embouchure
du Maroni, où on les reprit.
***
Voilà le pitoyable sort qui attend la plupart des évadés
: ils périssent dans l'aventure ou ils se font reprendre, soit
en Guyane, soit en Europe s'ils ont réussi à passer la
mer.
Et pourtant l'exemple de ceux qui ont échoué n'empêche
pas les autres de risquer l'évasion ; et l'horreur des tortures
subies par les évadés d'hier ne retient pas ceux qui ont
l'intention de s'évader demain.
C'est que le désir de la liberté, la nostalgie du pays
et aussi de la famille les poussent irrésistiblement à
tenter l'épreuve. On en vit qui, ayant réussi, revenus
en France, se trouvaient tellement désemparés qu'ils s'en
allaient se constituer prisonniers.
Il y a deux ans, un forçat du nom de Rechane, condamné
en 1904 par la cour criminelle de Constantine, parvint ainsi à
s'évader du bagne, au prix des plus terribles dangers, et à
regagner la France. Grâce à quelque argent qu'il avait
économisé en s'engageant comme mousse à bord d'un
bateau anglais, il put payer son passage de Marseille à Constantine.
Arrivé là, il courut embrasser sa vieille mère,
qui habitait toujours la ville, après quoi il s'en fut chez le
commissaire de police et se livra.
Interrogé sur les motifs qui le déterminaient à
se constituer prisonnier après avoir fait tant d'efforts et traversé
tant d'épreuves pour reconquérir la liberté, voici
ce qu'il répondit :
« Je ne me suis pas évadé avec l'intention de me
soustraire à la peine que je reconnais avoir méritée
; mais il y a cinq ans que j'ai quitté ma pauvre mère,
il y a cinq ans que je ne l'ai vue ni embrassée. Savez-vous ce
que c'est qu'être privé de ce bonheur pendant cinq ans
? Embrasser ma mère était ma hantise; voilà pourquoi
j'aurais tout bravé. Aucune autre raison ne me pousse plus à
ne pas continuer ma peine, et c'est pourquoi je viens me constituer
prisonnier.
Cette histoire est celle de bien d'autres « chevaux de retour
».
En 1911, cinq relégués s'échappaient du bagne de
Saint-Laurent-du-Maroni. Ils avaient réussi, sans éveiller
l'attention des gardiens, à construire un radeau sur lequel ils
prirent de large. Ayant abordé sur l'autre rive du fleuve, ils
pénétrèrent dans la forêt vierge. L'un d'eux
mourut ; deux autres se perdirent. Les deux qui restaient parvinrent
à s'embarquer sur un navire qui les amena en Espagne. Que n'y
demeurèrent-ils !... L'un d'eux nommé Champeaux, ne pensait
qu'à revoir ses parents qui habitaient un village des Hautes-Pyrénées.
Il y vint ; et les ayant embrassés, il se fit prendre et fut
renvoyé au baigne.
Un autre, encore nommé Barthélémy se livra pour
les mêmes raisons.
Il avait réussi à fuir du bagne et à gagner le
Vénézuéla. Là, il se réfugia à
bord d'un vapeur portugais et se cacha à fond de cale. C'est
en pleine mer seulement qu'il se montra. Débarqué à
Lisbonne, il partit pour Bordeaux. Dès ce moment, il ne pensa
plus qu'à revoir sa vieille mère et ses soeurs qu'il avait
laissées, quelques années auparavant, dans un modeste
logement du quai de Valmy. Il se mit en route et, mendiant et travaillant
dans les fermes, il arriva, d'étapes en étapes, à
Paris et courut quai de Valmy. Sa famille avait disparu. sans laisser
d'adresse.
Alors, désemparé, ne sachant que faire, il entra dans
le premier commissariat qu'il rencontra sur sa route et dit:
- Arrêtez moi, je suis un forçat en rupture de ban.!
***
Comment remédier, à ces évasions si fréquentes
et dont les résultats sont si dangereux pour la sécurité
publique ?
L'avis des spécialistes en matière pénitentiaire
est à peu près unanime : Il faut supprimer les bagnes
de la Guyane et les transporter en d'autres possessions lointaines où
les bagnards ne trouveront plus les mêmes chances d'évasion
et perdront, par conséquent, toute tentation de risquer l'aventure.
On a, depuis longtemps, proposé le choix es îles Kerguelen,
qui appartiennent à la France, et dont la France ne tire aucun
parti.
Les îles Kerguelen sont, dans de Sud de l'Océan Pacifique,
un groupe d'îles isolées de toutes parts et à égale
distance de la pointe du continent sud-africain et de l'Australie. Toute
tentative d'évasion serait rendue impossible par cet isolement
même ; et rien ne serait plus facile que d'y garder les forçats.
La principale des Kerguelen a été nommée, par Cook,
île de la Désolation. Elle a une superficie de 3.500 kilomètres
carrés et 1.000 kilomètres de côtes avec de bonnes
baies abritées en eau profonde. Le sol renferme des gisements
de minerai et. de houille qui seraient très exploitables. Le
climat, froid, y est sain et concourrait certainement au relèvement
moral des forçats qui, en Guyane, sont plutôt poussés
à la paresse par la température humide et chaude du pays.
Le projet d'un bagne à Kerguelen n'est, d'ailleurs, pas nouveau.
Depuis la découverte de ces îles en 1779 l'idée
d'en faire un lieu de relégation fut maintes fois émise.
Mais on sait avec quelle pitoyable lenteur s'accomplissent chez nous
les réformes les plus utiles, dès qu'elles dépendent
de la volonté administrative.
Et sans doute des années, des siècles peut-être
passeront-ils, et des milliers de forçats s'évaderont-ils
encore, avant qu'on se décide à transporter le bagne aux
Kerguelen et à garantir définitivement la métropole
contre la remise en circulation possible de tous ces « chevaux
de retour ».
ERNEST LAUT.
Le Petit Journal illustré du 30 novembre 1913