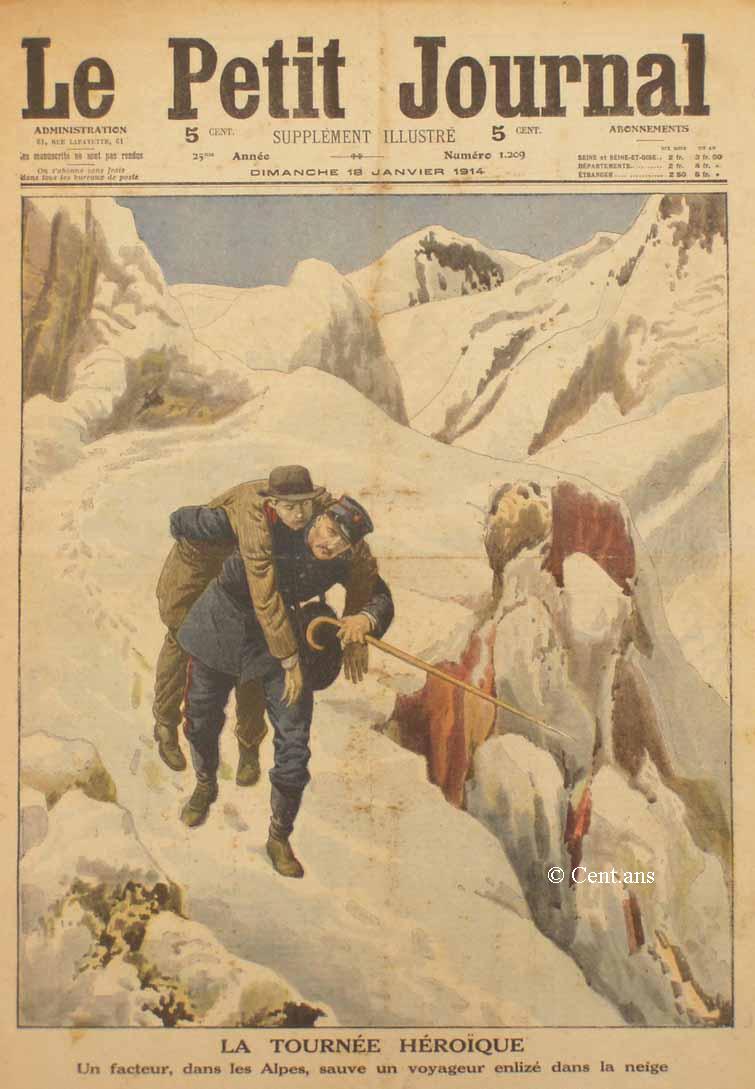LA TOURNÉE HÉROÏQUE
Un facteur, dans les Alpes, sauve un voyageur
enlizé dans la neige.
La tournée héroïque, c'est celle qu'accomplissent
courageusement, à cette époque si fertile en accidents
et en dangers, les facteurs des postes en nos régions montagneuses.
Ces jours derniers, l'un d'eux, au Petit Saint-Bernard eut l'occasion
de sauver un homme au cours de sa tournée.
Un voyageur, venant de Héricourt ( Haute-Saône). et se
rendant en Italie par le Petit-Saint-Bernard, s'était enlizé
dans la neige où il serait inévitablement mort si le facteur
qui fait le service de l'hospice n'avait aperçu sa tête
qui émergeait encore. Le malheureux voyageur était évanoui.
Le facteur le retira du trou de neige où il était tombé
et le transporta sur son dos à quelque distance de là,
en un endroit plus sûr. Il le frotta énergiquement avec
de la neige et parvint à le ranimer. Puis ! alla chercher du
secours et bientôt le voyageur put être, transporté
à l'hôpital de Bourg-Saint-Maurice.
VARIÉTÉ
LE RUBAN ROUGE
Le mois des décorations. - Pourquoi Bonaparte créa la Légion d'honneur. - Grands chanceliers.- Les villes décorées. -- Une contrefaçon. - Pour ceux qui veulent faire croire qu'ils l'ont.
Janvier est, pour quelques-uns, le mois des
espérances satisfaites, mais, pour combien d'autres le mois des
cruelles désillusions ! Car janvier est le mois des décorations.
Chaque année, à cette époque, la manne des rubans
de diverses couleurs se répand sur les citoyens qui ont bien
mérité de la République. Mais, bien que, d'année
en année, le nombre des élus aille sans cesse croissant,
celui des solliciteurs augmente, lui aussi, et dans des proportions
telles qu'en dépit des largesses que nos gouvernements font du
ruban, il est à peine possible de satisfaire un sixième
des postulants.
Ne dit-on pas qu'il y a cette année plus de 30.000 demandes de
palmes ?... Admettez qu'on distribue six mille rubans et rosettes l'Académie.
Voilà, 24.000 Français et Françaises qui porteront
au coeur le deuil de leurs ambitions déçues.
Chose curieuse, cette fièvre de distinctions honorifiques est
en France d'origine toute moderne. Sous l'ancien régime, la noblesse
seule recherchait les titres Et les rubans ; la bourgeoisie et plus
encore le peuple restaient insensibles à ces satisfactions de
la vanité.
Mais cet orgueil dormait au fond de l'âme française ; et
Bonaparte, avec sa connaissance profonde des hommes et le sens merveilleux
qu'il avait des moyens de les gouverner, l'y avait clairement discerné.
Aussi n'hésita t-il pas, dès qu'il sentit sa puissance
fortement établie, à exploiter ce généreux
orgueil en instaurant un nouvel ordre de chevalerie, qu'il appela la
Légion l'honneur.
***
Sous la Révolution, le Directoire et le Consulat, les «
guerriers qui avaient rendu des services éclatants en combattant
pour la République » recevaient en récompense des
armes d'honneur. On leur distribuait fusils, sabres, mousquetons, carabines,
grenades, haches d'abordage, haches de sapeurs, trompettes et baguettes
de tambours.
Mais du jour où ces militaires rentraient dans l'élément
civil, aucune marque apparente ne leur permettait de rappeler l'honneur
qu'ils avaient reçu dans le service, car ses distinctions n'allaient
pas sans l'uniforme, et le soldat retiré dans ses foyers en perdait
du même coup le bénéfice extérieur.
Bonaparte exposait à ce propos un argument personnel.
« Le Français, disait-il, aime la gloire, mais veut être
remarqué. »
Et il contait : « A Rivoli, je fus en péril a par suite
de l'effroi d'un cheval qui s'était jeté dans les rangs.
Un cavalier, qui me rendit là grand .service, fut sérieusement
blessé. Je lui demandai ce qu'il souhaitait :
» - Tu ne vas pas m'offrir de l'argent, répondit-il, j'ai
déjà un sabre d'honneur. Alors tu n'as rien à me
donner. Demain, on m'aura oublié. »
» En effet, ajouta Napoléon, je ne pus rien faire. Il faut
qu'on puisse récompenser ceux qui le méritent, mais il
faut que ,cette récompense soit visible et connue de tous,
à tout instant et partout. Un insigne n'est-il pas plus
facile à montrer que toutes A les armes d'honneur ? »
En outre, les artistes, les savants, les hommes qui, dans l'industrie,
le commerce ou l'administration, avaient rendu des services au pays,
se plaignaient justement de ne pas avoir leur part dans ces manifestations
de la reconnaissance nationale.
C'est pour remédier à ce double inconvénient qu'en
1802, Bonaparte, alors premier consul de la République, conçut
l'idée de créer un ordre destiné à récompenser
également le courage militaire et le mérite civil.
Le 4 mai 1802 il vint en personne défendre son projet au Conseil
d'État.
Mathieu Dumas, tout en approuvant l'institution, voulait qu'elle fût
réservée exclusivement aux militaires. Bonaparte lui répondit
:
« Nous sommes trente millions d'hommes réunis par les lumières,
la propriété, le commerce ; trois ou quatre cent mille
militaires ne sont rien auprès de cette masse. Les soldats eux-mêmes
ne sont que les enfants des citoyens. L'Armée, c'est la Nation.
Si l'on distinguait les hommes en militaires et en civils, on établirait
deux ordres, tandis qu'il n'y a qu'une nation... »
D'autres, comme Berlier, estimaient que les croix et les rubans n'étaient
que des hochets bons pour la monarchie.
Le premier consul leur répliqua avec vivacité :
.«.. Je défie qu'on me montre une République ancienne
ou moderne dans laquelle il n'y a pas eu de distinctions. On appelle
cela des hochets ; eh bien ! c'est avec des hochets qu'on mène
les hommes !... »
Cette déclaration, dénuée d'artifice, triompha
des oppositions. Finalement, le projet de loi, adopté par le
Conseil d'État, fut voté par le Tribunat par 50 voix contre
38 et par le Corps législatif à la faible majorité
de 166 voix contre 110.
L'ordre était organisé en seize. cohortes, comprenant
chacune sept grands officiers, vingt commandants, trente officiers et
trois cent cinquante légionnaires, ce qui faisait un total de
6.512 membres
A ces quatre classes, un décret de janvier 1805 en ajouta une
cinquième. Ce fut le plus haut degré dans la hiérarchie
de la Légion d'honneur, celui de grand-aigle, qui, depuis,
a pris le nom de grand cordon ou grand'croix.
La forme choisie pour la décoration fut celle d'une étoile
à cinq branches, avec, au centre, sur l'avers, l'effigie de Napoléon
ler entourée d'une couronne de chêne et de laurier ; et
au revers un aigle tenant la foudre et la légende : Honneur
et Patrie.
C'est dans la chapelle de d'Hôtel des Invalides, ou plutôt,
comme on l'appelait alors, dans le « Temple de Mars », qu'eut
lieu, le 15 juillet 1804, la première distribution solennelle
des croix de la Légion d'honneur. Napoléon voulut que
cette cérémonie fut entourée du plus grand éclat.
Après un éloquent discours du grand-chancelier le comte
de Lacépède, on fit l'appel des grands dignitaires, qui
s'approchèrent successivement du trône de Napoléon
pour prêter le serment individuel prescrit par les statuts. Puis,
l'empereur se couvrit et, s'adressant aux commandants, officiers et
légionnaires, prononça, d'une voix forte la formule du
serment.
Tous les membres de la Légion, debout, la main levée,
répondirent : « Je le jure ».
Après la messe, les décorations furent déposées
au pied du trône dans des bassins d'or, et l'empereur les remit
à leurs titulaires.
Cette phase de la solennité inspira au peintre Debret le célèbre
tableau qui figure aujourd'hui au musée de Versailles.
Une tradition veut que le premier décoré ait été
un vétéran du nom de Coignet ; une autre assure, au contraire,
qu'au début de la fête l'empereur aurait appelé
à lui le vénérable cardinal Caprara, représentant
du Pape à Paris, et que, détachant de son cou le cordon
rouge, il l'aurait tendu eau prélat, qui fut, de ce fait, le
premier membre de la Légion d'honneur.
Quelques vieux officiers républicains, ceux que Bonaparte appelait
les mauvaises têtes, ne répondirent pas à l'appel
de leur nom. Mais l'immense majorité de l'armée et de
la nation accueillit avec joie la création de la Légion
d'honneur.
Un mois plus tard, le 16 août, cette fête devait se renouveler
au camp d'Ambleteuse, près de Boulogne-sur-Mer, où se
trouvait réunie une armée de 70.000 hommes, destinée
à la descente en Angleterre.
Du haut de son trône, qui était, dit-on, le fauteuil de
Dagobert et qui dominait un vaste hémicycle occupé par
ses troupes, l'empereur découvrait toute l'armée, les
batteries de côte, l'entrée du port et une partie de la
rade.
Les militaires, désignés vinrent successivement recevoir
des mains de Napoléon les croix qui leur étaient destinées.
L'empereur prenait ces décorations non plus dans les bassins
d'or comme le mois précédent, aux Invalides, mais dans
les casques et les cuirasses de Bayard et de Duguesclin.
Pendant la cérémonie, des vaisseaux ennemis s'étant
imprudemment approchés de la côte, furent canonnés
par les bâtiments de la flottille française.
Et devant une foule de plus de cent-mille personnes accourue de tous
les points de la région septentrionale, la cérémonie
se déroula, imposante et solennelle, au milieu des clameurs d'enthousiasme
que ponctuait la grande voix du canon.
***
Du début à la fin de l'Empire, il fut fait 48.000 nominations
dans la Légion d'honneur, dont 1.400 seulement dans l'élément
civil.
La Restauration maintint la Légion d'honneur, mais elle remplaça
l'effigie de son fondateur par celle de Henri IV. Elle fit même
de cette distinction un usage immodéré et, dans ses deux
premières années, ne distribua pas moins de 10.000 croix.
Sous Louis-Philippe on commença à se plaindre de la facilité
avec laquelle on décorait les gens, particulièrement les
fonctionnaires. On critiquait vivement les titres acquis « en
se chauffant dans un bureau » ; et le baron Mounier résumait
ainsi l'opinion générale
« La valeur de la décoration s'est affaiblie ; ceux qui
la distribuent comme ceux qui l'obtiennent ont cessé d'y attacher
le même prix et, si elle a continué d'être sollicitée
avec ardeur, elle a été donnée avec légèreté
et reçue avec tiédeur. »
A cette époque, l'effectif constaté était de 96
grands-croix, 216 grands officiers, 825 commandeurs, 4.061 officiers...
et un nombre considérable de chevaliers.
Comme remède, la Chambre des députés vota en 1840
la limitation, en décidant que dorénavant il ne serait
plus permis de s'écarter des chiffres fixés que pour faits
de guerre.
Le second empire rétablit sur la décoration l'effigie
de Napoléon 1er.
Enfin, le 20 octobre 1870, le gouvernement de la Défense Nationale
décréta que la couronne impériale qui surmontait
la décoration serait remplacée par une couronne de chêne
et de laurier et que l'effigie de la République, avec l'exergue
: République Française, 1870, serait substituée
à celle de Napoléon Ier ; et au revers, à la place
de l'aigle, deux drapeaux tricolores en sautoir avec la devise : Honneur
et Patrie.
Voici, depuis la création de l'Ordre, les noms des grands chanceliers
de la Légion d'honneur :
Comte de Lacépède (21 août 1803) ; baron de Pradi,
archevêque de Malines, nommé commissaire pour remplir les
fonctions de grand chancelier (6 avril 1814) ; lieutenant général
comte de Bruges (13 février 1815) ; comte de Lacépède,
rétabli dans ses fonctions (1er avril 1815) ; maréchal
Macdonald, duc de Tarente (9 juillet 1815) ; maréchal Mortier,
duc de Trévise (11 septembre 1831) , maréchal comte Gérard
(4 février 1836) maréchal Oudinot, duc de Reggio (17 mai
1839) ; à nouveau maréchal comte Gérard (21 octobre
1842) ; général Subervie (19 mars 1848) ; maréchal
Molitor (23 décembre 1848) ; général Exelmans (15
août 1849) général comte d'Ornano (13 août
1852) général Lebrun, duc de Plaisance (26 mars 1853)
; maréchal Pélissier, duc de Malakoff (25 juillet 1859)
; amiral Hamelin (24 novembre 1860) ; général comice de
Flahault (27 janvier 1864) ; général Vinoy (6 avril 1871)
; général Faidherbe (28 février 1880) ; général
Février (10 octobre 1889) ; général Davoust, duc
d'Auerstaedt (5 décembre 1895) ; général Florentin
(23 septembre 1901).
***
L'organisation créée en 1804 par le Premier consul ne
visait que les individus. Bonaparte ne prévoyait pas alors la
possibilité de décorer également les cités
de France pour quelque action d'éclat ou pour quelque service
rendu au pays.
Ce sont les glorieuses résistances de certaines d'entre elles
au cours de la douloureuse campagne de France, en 1814, qui lui en donnèrent
l'idée.
Les premières villes décorées furent Chalon-sur-Saône,
Saint-Jean-de-Losne et Tournus. L'empereur avait manifesté l'intention
de donner aussi l'étoile des Braves à Roanne, mais les
événements de 1815 ne lui en laissèrent pas le
temps ; et c'est Napoléon III qui signa le décret quarante
ans plus tard.
A la suite des événements de 1870, des décrets
signés du maréchal de Mac-Mahon, des présidents
Grévy, Carnot et Félix Faure, accordèrent la Légion
d'honneur aux villes de Châteaudun, Belfort, Rambervillers, Saint-Quentin
et Dijon.
En octobre 1900, des décrets du président Loubet décorèrent
également Paris et Bazeilles, en récompense de leur conduite
au cours de l'année terrible.
En outre, le ministre de la Guerre proposa de donner la croix de la
Légion d'honneur à trois villes honorées jadis
d'un décret de la Convention, déclarant qu'elles avaient
bien mérité de la Patrie : Lille, Valenciennes et Landrecies
; et ces trois cités septentrionales reçurent l'étoile
des braves pour leurs glorieuses résistances de 1792 et 1793,
c'est-à-dire- particularité curieuse- pour des faits qui
s'étaient passés avant la création de la Légion
d'honneur.
Enfin, plus récemment, Saint-Dizier, Saint-Cloud et Péronne
reçurent la même distinction.
La France compte donc aujourd'hui dix sept villes autorisées
à faire figurer dans leurs armes l'étoile de la Légion
d'honneur.
***
Entre autres détails anecdotiques sur l'histoire de la Légion
d'honneur, en voici un qui, je crois, est peu connu. Il s'agit d'une
contrefaçon de la Légion d'honneur - - une contrefaçon
exotique.
En 1849, à Haïti, le président Soulouque, à
l'occasion de sa proclamation comme empereur sous le nom de Faustin
1er, créa un ordre de la Légion d'honneur absolument calqué
sur le nôtre.
Inutile d'ajouter que cette pâle copie de la grande institution
de Bonaparte n'eut qu'une existence éphémère. Elle
vécut ce que vivent en ce pays lointain les généraux
et les présidents de république.
***
Nous avons aujourd'hui soixante et quelques mille membres de la Légion
d'honneur, et malgré ce nombre considérable qui scandaliserait
l'ombre de Bonaparte, combien de citoyens français souhaitent
ce ruban rouge qu'ils n'auront peut-être jamais.
Le désir de tout Français est d'avoir la Légion
d'honneur et, s'il ne l'a pas, de faire croire qu'il l'a.
Passons donc en revue les ordres étrangers qui peuvent, à
défaut de notre ordre national donner cette satisfaction aux
amateurs de ruban.
Il y a la Toison d'Or, qui est rouge, entièrement rouge, mais
c'est un ordre réservé aux grands personnages et beaucoup
plus difficile à obtenir que la Légion d'honneur. Non
moins rares, des cordons de Saint-Alexandre-Newski et de l'ordre du
Bain d'Angleterre, lequel est rouge giroflée.
Restent la croix du Mérite d'Autriche, rouge foncé, et
celle de Léopold de Belgique, rouge ponceau, la croix de François-Joseph,
le Faucon Blanc de Saxe, Alexandre de Bulgarie.
Enfin, il y avait le Christ de Portugal, la providence des amateurs
de ruban rouge. Mais le Christ n'est plus : la République portugaise
a supprimé les décorations.
Les jeunes républiques suppriment toujours les décorations.
Mais les amateurs de ruban rouge n'ont que patience à prendre
le Christ ressuscitera quelque jour. Les Républiques, en vieillissant,
rétablissent toujours les hochets de la vanité.
Ernest LAUT.
Le Petit Journal illustré du 18 janvier 1914