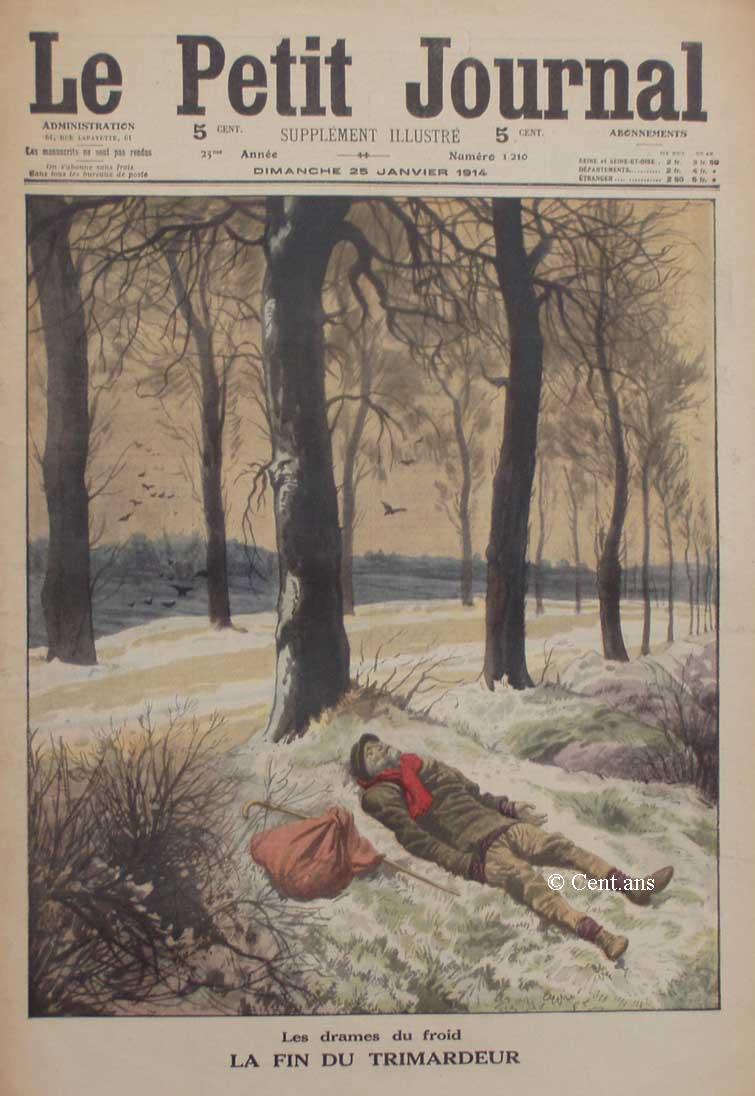LES DRAMES DU FROID
LA FIN DU TRIMARDEUR
" L'hiver tueur de pauvres gens " n'est pas une figure; Cet hiver-ci aura tué beaucoup de miséreux.
Du moins, dans les villes, l'homme frappé de congestion est-il secouru. Mais le pauvre diable qui court les routes par tous les temps, a bien des chances pour succomber seul, sans qu 'une main secourable l'aide à ses derniers moments.
On a découvert à plusieurs reprises, ces temps derniers, des corps rigides de chemineaux tombés ainsi, au bord des routes, foudroyés par le froid. Certes, beaucoup de ces gueux constituent un véritable danger pour nos campagnes ; mais il en est pourtant qui ne sont que de pauvres gens férus d'indépendance et qui se contentent seulement de solliciter la modeste aumône qu'on leur donne de bon cœur.
Ceux-là ont l' horreur des villes, et pour eux l'hiver est terrible. Ils vont, ils vont sans cesse, par toutes les saisons, par tous les temps. Ce chemineau la est pareil ; à ce « vieux lapin » qu'a chanté Richepin :
Il semble, sans bâte ni
trêve,
Poursuivre un impossible rêve,
Toujours, toujours tant qu' il en crève.
Et il en crève, en effet, un jour impitoyable de neige et de
gel.
Alors, sur le bord du chemin
Meurt sans qu' on lui presse la main
Cet affamé de lendemain.
VARIÉTÉ
CACHETS D'ARTISTES
Ce que gagnait Fragson. --- Comment les Romains payaient leurs acteurs. - Une diatribe de La Bruyère. -- Tournée de comédiens et de chanteurs. - La généreuse Amérique. - A quoi tient la vogue ?
La mort tragique de Fragson a attiré
l'attention publique sur les étoiles de music-hall. La fortune,
relativement considérable, laissée par le chanteur à
la mode
n'a pas été sans surprendre tous ceux lui ignorent nos
moeurs byzantines et ne savent pas ce que coûtent leurs plaisirs
aux habitants des grandes villes.
En apprenant que, pour cinq ou six chansons, le chanteur anglo-français
touchait régulièrement des cachets de mille à douze
cents francs, que de gens ont dû s'indigner et vitupérer
une fois de plus contre les moeurs de bas-empire qui sont les nôtres.
Certes, de tels cachets pour un diseur de chansonnettes apparaissent
excessifs et scandaleux, quand on songe que tant de savants, tant de
travailleurs de tout ordre, dont les oeuvres sont profitables à
la civilisation et à l'humanité, ne gagnent pas en un
mois ce que ce chanteur gagnait en un soir. Mais faut-il en incriminer
uniquement les moeurs de notre temps ?
Il en fut à peu près de même à toutes époques.
Les amuseurs du peuple furent toujours mieux traités que ceux
qui s'employaient à son instruction ou à son bien-être.
Les Romains ne furent pas plus sages que nous sur ce point. Macrobe,
l'auteur des Saturnales, parle de la prodigieuse fortune du comédien
AEsopus, qui laissa cinq millions de patrimoine à son fils.
Dyonisia, actrice tragique du théâtre Latin - la Sarah
Bernhardt du temps - recevait 200.000 sesterces, soit 50.000 francs
pour une saison.
Phoebe Vocondia, artiste du théâtre comique, touchait pour
une saison également,- 170.000 sesterces.
Le danseur Jason ayant exécuté un jour un pas inédit
devant le triumvir Crassus. reçut une somme de 6.000 francs pour
ce cavalier seul.
Les riches praticiens payaient jusqu'à 30.000 francs un esclave
habile dans l'art de jouer de la lyre.
Je crois même que nous n'allons pas aussi loin que les Romains
au temps de Cicéron. Nous subventionnons les théâtres,
mais nous n'en sommes pas encore arrivés à subventionner
personnellement les comédiens. Or, l'acteur Roscius, l'ami du
grand orateur, indépendamment d'une somme considérable
qu'on lui payait pour chaque représentation, avait sur le trésor
public, un traitement qu'on évaluait à plus de neuf cents
francs par jour.
Il est vrai que si nous ne faisons pas de pensions aux comédiens
illustres, nous payons assez cher d'autres baladins : ceux de la politique.
Et ces baladins-là nous coûtent plus que ne coûtait
Roscius aux Romains, bien qu'ils aient infiniment moins de talent.
***
Déjà, au siècle de Louis XIV, les acteurs à
la mode exigeaient d'être payés comme des princes. Alors
que les auteurs des tragédies et des comédies ne touchaient
qu'un prix infime de leurs oeuvres, les interprètes célèbres
se taillaient la large part dans les profits des représentations.
Si bien qu'on trouve à chaque instant dans les écrivains
du temps, des protestations contre leurs exigences scandaleuses.
Parlant de leur art et de leur personne. La Bruyère écrit
dans ses Caractères :
« Il n'y a point d'art si mécanique ni de si vile condition
où les avantages ne soient plus sûrs, plus prompts et plus
solides. Le comédien, couché dans son carrosse, jette
de la boue au visage de Corneille qui passe à pied. »
Mais c'est pis encore au siècle suivant. Les tragédiennes
célèbres, comme Mlle Clairon au Théâtre Français,
élèvent leurs exigences au fur et à mesure que
grandit leur renommée.
Quant aux chanteuses de l'Opéra leurs prétentions apparaissent
scandaleuses ; et tous les folliculaires protestent contre les cachets
qu'on leur donne.
Il est vrai qu'il n'en va pas mieux à l'étranger. En 1770,
la Gabrielli se trouvant à Moscou, est sollicitée par
l'impératrice Catherine II de chanter à la Cour. Elle
demande 5.000 ducats d'honoraires.
- Mais, se récrie l'impératrice, je ne paie sur ce pied-là
aucun de mes feld-maréchaux.
- Eh bien : réplique irrévérencieusement la chanteuse,
que Votre Majesté fasse chanter ses feld-maréchaux !
A Londres, Lucrecia Bastardina. dont la voix et le talent émerveillaient
Mozart. touche deux mille francs par soirée pour chanter deux
morceaux.
En Espagne, la Mingotti, une artiste polyglotte qui chantait indifféremment
en français, en espagnol ou en italien, toucha un jour un cachet
de dix mille livres pour un air qu'elle chanta chez un prince andalou.
M. Caruso eut, à cette époque, un précurseur en
fait de gros cachets : c'était le ténor à la mode
Cafarelli.
Cafarelli, fils d'un simple paysan napolitain, touchait 45.000
francs pour chanter trois fois par semaine pendant trois mois.
Un de ses biographes assure qu'il aurait pu ouvrir un magasin d'orfèvrerie
avec les bijoux et toutes les pièces de vaisselle d'or et d'argent
que lui envoyèrent ses admirateurs lors de ses représentations
à Naples en 1730.
Louis XV l'appela à Versailles, le logea au palais et lui donna
un carrosse avec six laquais à ses ordres.
Jélvotte, autre ténor en vogue dont tout Paris, et dont
toutes les Parisiennes surtout, raffolèrent, fit une grande fortune
en peu de temps.
Carat, un ténor encore, touchait, en 1799, quinze mille francs
pour avoir chanté dans trois concerts à l'Opéra.
La Saint-Huberti, l'interprète favorite de Gluck, devint millionnaire
; et elle eut non seulement la fortune, mais les honneurs. Louis XV
lui conféra le collier de Saint-Michel.
Rosalie Levasseur, elle aussi, ne se contenta pas d'être bien
payée : elle devint, en 1771, baronne du Saint-Empire.
Ces dames avaient en général l'esprit pratique, même
l'esprit d'à-propos. Un jour, la Desmatins, une artiste douée
du plus admirable talent, ayant chanté chez un financier reçut,
sous enveloppe, un billet de mille francs avec ces mots :
« Ci inclut, mille francs et dix mille compliments. »
Elle répondit :
« Merci. J'aurais préféré mille compliments
et dix mille francs. »
A cette époque, pourtant, les prétentions des danseuses
apparaissent plus raisonnables que celles des comédiennes et
des chanteuses. En 1762, la Guimard, premier sujet de la danse à
l'Opéra, ne touche que 600 livres par an et s'en contente.
***
Le XIX, siècle vit encore s'accroître les cachets des artistes
des théâtres. Dès cette époque, commence
le régime des tournées des grands comédiens et
des chanteurs célèbres. On va en province et à
l'étranger et l'on tire de ces voyages d'importants profits.
Tous les ans, Talma exige de la Comédie un congé de plusieurs
mois qu'il occupe en voyages d'un bout à l'autre de la France
et même à l'étranger. A Bruxelles, à Lyon,
il obtient jusqu'à mille francs par soirée. La somme est
considérable pour l'époque.
Une lettre de Mlle Mars, publiée il y a quelques années,
nous fait connaître dans quelles conditions la grande comédienne
consentait à aller jouer à l'étranger.
Cette lettre est adressée au directeur d'un théâtre
de Bruxelles. L'actrice demande mille francs par représentation,
plus un jeton de quarante francs par jour à dater de son arrivée,
et, au bout d'un certain nombre de représentations, une soirée
à son bénéfice pour les frais du voyage
Et elle ajoute :
« J'ai toujours eu le bonheur d'attirer le public, mon dernier
voyage date de six ans, j'ai plusieurs pièces nouvelles à
offrir. Ainsi, je crois que cet arrangement qui me tranquillise ( il
y a de quoi ! ) ne peut être onéreux pour l'administration.
»
On ne nous dit pas si l'administration fut de cet avis.
Quelques années plus tard, Rachel se montrait non moins gourmande
que son illustre devancière. En 1840, au théâtre
Français, elle obtenait 27.000 francs de fixe, 18.000 francs
de feux, et, une représentation à bénéfice
estimée 15.000 francs. En tout 60.000 francs. Mais ses prétentions
ne s'arrêtaient pas là, et de nombreuses tournées
venaient, chaque année, augmenter le profits qu'elle tenait du
théâtre.
On sait qu'en l'espace de moins de vingt ans que dura sa carrière,
la grande tragédienne gagna plus de douze millions.
La fin de cette carrière, cependant, fut attristée par
une cruelle déception. Lorsqu'en 1855, elle consentit à
faire une tournée en Amérique, on lui avait garanti pour
sa part absolument personnelle plus de douze cent-mille francs. On s'attendait
à des recettes énormes telles qu'en avait réalisées
peu de temps auparavant la fameuse chanteuse Jenny Lind, laquelle avait
gagné près de deux millions en quelques mois.
Mais il paraît que le chant avait plus d'attraits que la tragédie
pour les Yankees d'alors. La tournée dramatique de Rachel ne
donna pas 700.000 francs de recettes. Et l'artiste rentra de ce voyage,
fatiguée, malade et non moins atteinte dans sa santé que
blessée dans son amour-propre.
Depuis cette époque, elle ne cessa de languir, et lorsque, deux
ans plus tard, elle mourut, on put dire avec raison que c'était
dans sa tournée d'Amérique qu'elle avait pris le germe
de son mal.
Depuis lors, les Américains ont fait des progrès dans
le goût de l'art dramatique français et dans l'admiration
de ses interprètes. Mme Sarah Bernhardt a fait là-bas
plusieurs tournées triomphales et de véritables râfles
de dollars.
Sa première tournée dura quatre mois et lui rapporta 600.000
francs nets. Son impresario lui donnait 5.000 francs par soirée
et payait tous ses frais, jusqu'à son train spécial.
A l'Opéra, c'est sous la direction du docteur Veron que commença
réellement l'ère des gros cachets.
La Taglioni gagnait 36.000 francs ; Fanny Essler, 46.000 ; Carlotta
Grisi, 42.000 ; la Cervito, 45.000 ; la Rosati vint à gagner
60.000. Si, en restant parmi les étoiles du corps de ballet,
nous cherchons un peu plus près de nous, nous voyons que Mme
Rosita. Mauri recevait, naguère, 40.000 francs d'appointements.
En passant, maintenant, aux chanteurs et aux chanteuses, nous constatons
que Duprez recevait 70.000 francs, Baroilhet, 60.000 ; Levasseur, 45.000
; Mario, 30.000 ; Massol, 30.000 ; Mlle Falcon, 50.000 ; Mme Dorus-Gras,
45.000 ; Mme Rosine Stoz, 72.000 ; Mme Sophie Cruveli, 100.000 francs
!
Une statistique faite vingt ans plus tard, c'est-à-dire aux dernières
années de l'Empire, nous donne le tableau suivant pour les principaux
sujets de l'Académie nationale de musique : Naudin, 110.000 francs;
Faure, 90.000 , Gueymard, 72.000 ; Villaret, 45.000 ; Mme Gueymard,
60.000 ; Mme Marie Sasse, 60.000..
Il y a une vingtaine d'années, le baryton Lassalle touchait 11.000
francs par mois à l'Opéra ; Jean de Reszké, 6.000
; son frère Edouard, 5.000 ; Mme Richard, 5.000. Le ténor
Escalaïs avait 45.000 francs par an, Melchissédec 48.000,
Mme Rose Caron avait, lorsqu'elle a quitté l'Académie
nationale de musique, 85.000 francs par an.
De toutes les artistes lyriques, celle qui connut à coup sûr
les plus gros cachets, ce fut la Patti. En Amérique on lui donna
jusqu'à 25.000 francs par représentation. De 1861 à
1881, elle a tiré annuellement de son art de 750.000 à
875.000 francs. En 1889, une tournée qu'elle fit dans l'Argentine
lui rapporta 1.250.000 francs. Elle a amassé plus de dix-huit
millions durant sa carrière.
Après elle, on peut citer le célèbre ténor
Jean de Reszké. La première fois qu'il alla en Amérique,
il reçut 5.000 francs par représentation. Son succès
fut si grand qu'on lui offrit ensuite 6.000 et que dans sa dernière
saison de New-York il obtint 12.000 et un intérêt sur la
recette.
Caruso lui aussi commença par chanter à New-York pour
5.000 francs par soirée. On sait qu'il n'en resta pas là.
A Ostende, il chanta à raison de 8.000 francs par représentation.
A Vienne, il obtint 15.000 couronnes, soit 18.000 francs par soirée.
Il y a quelques années, il disait à un de nos confrères
:
« J'ai signé des engagements pour quatre ans. Les conditions
ne sont pas mauvaises. Pour 80 représentations par année,
je touche 800.000 francs ; de plus la Société des gramophones
me donne environ 200.000 francs ; sans, compter les soirées où
je chante à New-York, chez les Gould, les Vauderbilt et autres,
qui me rapportent encore 200.000 francs. Total au bout de l'année,
1.200.000 francs. Le Metropolitain Opéra House de New-York me
paye mes voyages et tous mes frais de séjour là-bas. »
Et il ajoutait :
« Je ne me considère pas comme le premier ténor
du monde, mais je suis le plus payé. »
***
L'Amérique au surplus n'est pas généreuse seulement
pour les ténors. Nous avons vu que Mme Sarah-Bernhardt y draîna
force dollars. Mme Eleonora Duse, la célèbre tragédienne
italienne, fit, il y a quelques années, une tourné dans
l'Amérique du Sud : cinquante représentations à
raison 12.500 francs par soirée, soit, pour la tournée,
la somme coquette de 625.000 francs.
Et les instrumentistes ? C'est Paderewski le pianiste, qui détient
le record des gros cachets. Il a fait de nombreuses tournées
aux Etats-Unis et, chaque fois, il a rapporté plus de 750.000
francs. Une fois, même, il a atteint le million.
Kubelick, le violoniste, lui aussi, ne joue jamais à moins de
2.500 francs par soirée.
Mais nous ne saurions oublier que c'est à propos des cachets
de Fragson que nous nous sommes lancé dans cette revue bénéfices
réalisés par les chanteurs et comédiens à
travers les siècles. Revenons donc à nos moutons, c'est-à-dire
à nos acteurs de music-hall.
Savez-vous que Thérésa, la grande Thérésa
ne gagna jamais plus de cent francs par soirée. Les artistes
qui lui succédèrent dans la faveur du public firent augmenter
les prix. Yvette Guilbert touchait jusqu'à 800 francs à
la Scala. A Berlin et à Londre, elle recevait de 1.700 à
1.800 francs.
Paulus, en Amérique, eut 25.000 francs par mois.
Il n'est pas rare, aujourd'hui, au café-concert, de trouver des
artistes aimés du public qui, à Paris, touchent de trois
à quatre cents francs par soirée et se font payer en province
et à l'étranger de 15 à 20.000 francs par mois.
Fragson, à Londres, recevait en moyenne 21.000 francs. Tous ces
chiffres nous paraissent énormes : ils le sont, en effet, mais
il y a une chose qui les justifie et que nous ne devons pas perdre de
vue quand nous les considérons : un artiste peut perdre sa voix
du jour au lendemain, et peut perdre la vogue.
A quoi tient la faveur du public ? Et le pauvre Fragson le savait bien
quand il disait à un de ses anis :
- Je me surmène, j'entasse, je mets l'argent de côté.
J'ai le succès, j'en profite : l'aurai-je encore demain ?
Ernest Laut
Le Petit Journal illustré du 25 janvier 1914