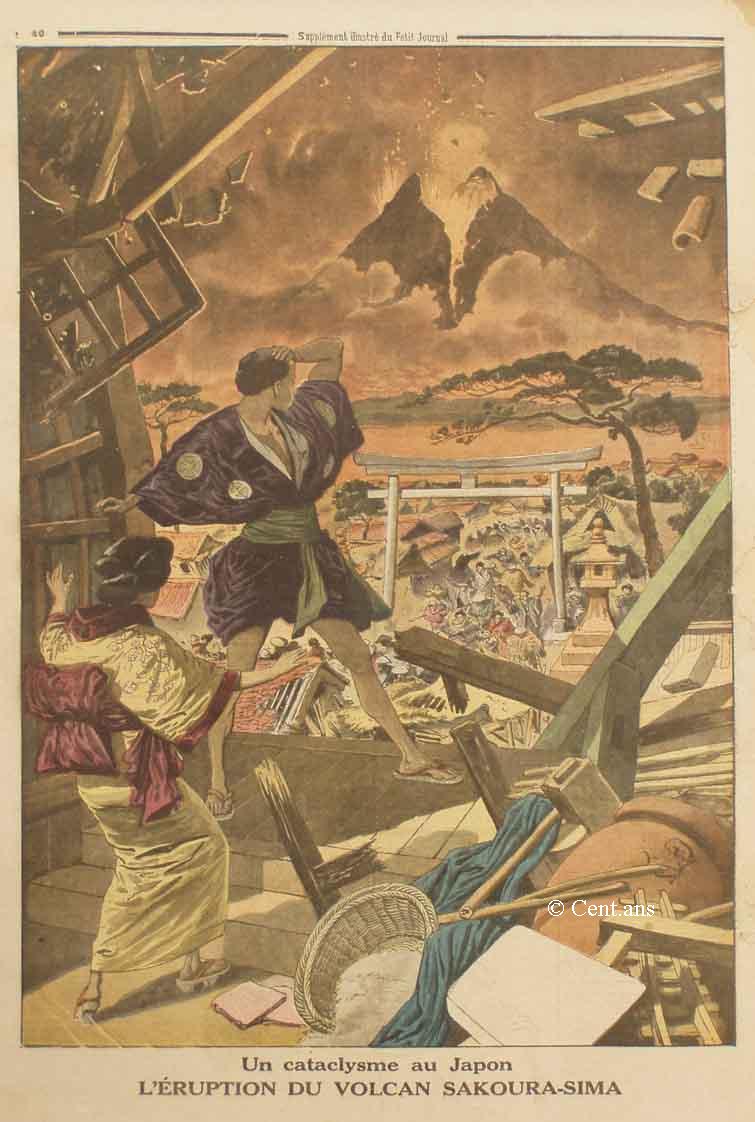UN CATACLYSME AU JAPON
L ÉRUPTION DU VOLCAN SAHOURA-SIMA
Une fois de plus, l'ardeur volcanique de la terre
japonaises vient de s'éveiller et de semer la ruine et le deuil
sur toute une région.
Le volcan Sakoura-Sima, dont l'éruption a causé des désastres
sans nombre, est situé dans la baie de Kagoshima. La ville du
même nom, qui se trouve à quelque distance du volcan, a
été bouleversée de fond en comble par le cataclysme.
L'éruption passée, la ville, dit une dépêche,
ressemblait à un champ de bataille. Ses habitants avaient fui,
affolés, vers la côte. Presque toutes les maisons avaient
été détruites par la chute des rochers et. par
le tremblement de terre.
Toute la côte occidentale de l'île « a sauté
». Un raz de marée a passé sur la ville, pendant
que des secousses sismiques ébranlaient la terre : maisons, routes,
voies ferrées, tout est détruit sur une distance de plusieurs
kilomètres. Treize mille immeubles sont anéantis, soixante-dix
mille habitants ont disparu.
Le volcan de Sakoura-Sima n'avait pas eu d'éruption depuis 1779.
VARIÉTÉ
LE PAYS DES VOLCANS
C'est le Japon. - Cataclysmes volcaniques.-
Le Fouji-Yama. - Villes d'eaux japonaises. - L'île qui paraît
et disparaît.
- Le tempérament frénétique des Japonais.
Certains ethnologues ont attribué à
la nature volcanique des îles japonaises le tempérament
belliqueux de leurs habitants.
De fait, le Japon est le véritable domaine de Vulcain, et si
la légende des Cyclopes avait existé en Extrême-Orient,
il n'est pas douteux qu'on eût donné pour asile à
ces forgerons farouches les flancs du Fouji-Yama.
De Fornose jusqu'à la pointe du Kamtchatka, l'archipel japonais
compte plus de trois mille huit cents îles et îlots. C'est
un immense cordon volcanique dont plus d'un cratère est aujourd'hui
encore en activité.
Le feu et l'eau sont en rivalité constante, dans les profondeurs
de ces régions ; et si les volcans ne jouaient le rôle
de soupapes de sûreté, le pays serait continuellement exposé
aux plus épouvantables cataclysmes.
Le Japon, d'ailleurs, ne compte plus le nombre des éruptions
et des tremblements de terre.
L'une des plus épouvantables révolutions telluriques que
les annales japonaises aient enregistrées est celle qui, dans
l'espace de quelques heures, aux environs de Yédo, creusa le
lac Mitu-Umi et fit sortir de terre la célèbre montagne
du Fouji-Yama, dont la hauteur atteint près de 4.000 mères.
Le fait remonte, s'il faut en croire la légende, à la
fin du troisième siècle avant notre ère.
Ce Fouji-Yama devint dès lors, pour les Japonais, l'objet d'une
vénération étrange - vénération mêlée
de crainte, sans doute, car, à plusieurs reprises, le volcan
sema ses ravages sur les terres d'alentour.
Le Ni-hon-go-ki, l'un des plus anciens livres des traditions japonaises,
conte ainsi la première grande éruption du Fouji :
« sous le règne de l'empereur Kwanmou, la 19e année
de l'ère Yen-reki, une éruption du Fouji-Yama dura plus
d'un mois. Pendant le jour, l'atmosphère était obscurcie
par la fumée du cratère ; pendant la nuit, l'éclat
de l'incendie illuminait le ciel. On entendait deux détonations
semblables au tonnerre. Les cendres que lançait le volcan tombaient
comme de la pluie. Au bas de la montagne, les rivières étaient
couleur de feu... »
Périodiquement, le Fouji continua son oeuvre dévastatrice.
Contentons-nous de noter les dates de ses deux éruptions les
plus importantes. En 864, i1 fut en feu pendant dix jours et son cratère
lança jusque dans l'océan d'énormes quartiers de
roches. Des centaines de familles de paysans, habitant des villages
au pied de la montagne, furent ensevelies sous la lave.
Enfin, le 23e jour du 11e mois le l'année 1707, une épouvantable
éruption du Fouji-Yama accompagnée de plusieurs tremblements
de terre, désola de nouveau la contrée et fit un grand
nombre de victimes.
Cependant, tous ces méfaits de la montagne légendaire
n'empêchent pas les Japonais de lui témoigner une admiration
exaltée. Ils l'appellent de divers noms qui signifient «
l'Immortelle » et « l'Inépuisable » et disent
d'elle qu' « elle n'a pas sa pareille au monde ». Leur mythologie
assure que c'est dans les flancs du Fouji que se trouve le séjour
des bienheureux.
On sait, d'autre part, combien l'art de la peinture et de l'estampe
au Japon a vulgarisé la physionomie de cette montagne célèbre.
Il n'est pas un peintre japonais qui n'ait mêlé la silhouette
du Fouji à ses compositions. On la retrouve à chaque page
dans les oeuvres d'Hiro-Shigé, le grand paysagiste, et dans celles
d'Hokousaï, l'artiste le plus fécond et le plus illustre
du Nippon.
Il faut dire que sa silhouette est de la plus majestueuse beauté.
« Selon les heures du jour, dit un voyageur français qui
en fit l'ascension, sa cime couverte de neige pendant près de
dix mois dans l'année, ses pentes verdoyantes ou dénudées,
formées de débris de scories, s'éclairent de lueurs
merveilleuses. Le Fouji-Yama, que chacun vient visiter, même de
:provinces assez lointaines, prend alors des aspects fantastiques qui
exaltent l'imagination des poètes. Ils chantent chaque jour,
encore ses beautés. C'est au Japon, la montagne populaire partout
représentée et dont la vue ne se lasse jamais. Elle est
figurée sur les laques et les porcelaines précieuses,
aussi bien que sur les moindres éventails et sur les images que
les artistes japonais savent si bien peindre. »
L'ascension de la montagne sacrée exige, chez les Japonais, certains
rites particuliers. Les pèlerins, habillés de toile blanche,
ont la tête couverte d'un grand chapeau en forme de champignon
destiné à les garantir contre les ardeurs du soleil.
Ce costume d'ascension ne doit jamais être nettoyé. On
voit au Fouji des gens revêtus de vêtements usés,
couverts de poussière, et d'une coupe très ancienne. Ces
vêtements sont ceux avec lesquels leur père pour grand-père
firent. l'ascension de la montagne. Ils les ont conservés tels,
sans les brosser, et ils les portent avec fierté.
Les pélerins ainsi vêtus sont les plus respecté
car l'état de leurs habits prouve qu'ils firent plusieurs fois
la visite du Fouji ou que leurs ancêtres y allèrent souvent
rendre hommage à Bouddha.
Malgré sa hauteur, le Fouji est facile d'accès, et l'on
peut parvenir à la cime sans trop de fatigues.
Chose curieuse, au bord même de ce cratère, coule une source
fraîche et d'une merveilleuse pureté. C'est la «
source d'argent », dont les bonzes qui gardent le sanctuaire bouddhique
installé sur une plate-forme au sommet de la montagne, offrent
une coupe aux pèlerins.
***
Le Fouji-Yama, s'il est le volcan le plus haut de l'archipel japonais,
n'en est pas le plus actif.
Il existe, dans la province de Hizen, un autre volcan, le Wun-Zendaki,
ou « montagne des sources chaudes », qui, s'il n'a qu'un
peu plus du quart de la hauteur du Fouji, ne lui céda en rien,
naguère, pour la fréquence et la violence de ses éruptions.
La dernière grande manifestation volcanique, au Japon, avant
l'éruption récente, est celle du Bantaï-San, qui
se produisit en 1881. Ce volcan, éteint depuis onze siècles,
et couvert de végétation, se ralluma soudainement.
L'éruption, précédée d'un violent tremblement
de terre, fut épouvantable. Douze villages disparurent à
jamais sous des flots de cendre et de lave.
Comme conséquence de l'agitation volcanique de son sous-sol,
le Japon possède de nombreuses sources d'eau chaude qui entraînèrent
la création de stations balnéaires très fréquentées.
L'une des plus célèbres est celle de Kusatsu, où
l'on soigne la goutte, le rhumatisme et maintes autres maladies. L'eau
qui y jaillit à une température de 51 degrés, contient
un grand nombre de sels minéraux et est conduite dans une série
de piscines primitives où sa température s'abaisse de
deux ou trois degrés. Mais il faut encore avoir un certain courage
pour aller se plonger dans un bain de 48 degrés ; aussi la balnéation
se fait-elle suivant un véritable cérémonial que
voici :
Quand vient l'heure du bain, la station retentit de sons de corne appelant
les baigneurs. Ceux-ci se rendent alors à l'établissement
et, par groupes de quinze ou vingt, ils sont introduits dans la piscine.
Pour éviter les congestions et les syncopes, ils commencent par
s'asperger la tête, avec de l'eau chaude et descendent ensuite
dans la piscine. sous la direction d'un maître baigneur. Une lois
que tout le monde se trouve dans l'eau, celui-ci entonne une chanson
dont les malades reprennent en choeur le refrain, ce qui semble donner
du courage aux hésitants. Tout en chantant, le maître baigneur
n'oublie pas d'annoncer toutes les minutes combien de temps on a encore
à rester dans l'eau. A un moment donné il crie : c'est
fini, et tout le monde sort précipitamment de la chaudière.
A Kaunawamura, station célèbre par ses bains de vapeur,
les choses se passent d'une autre façon.
La chambre où l'on prend les bains de vapeur se compose d'une
petite pièce circulaire entière entièrement en
pierre, même le plafond, dans laquelle on pénètre
par une porte basse se fermant au moyen d'une natte en paille de riz.
Le sol est constitué par un treillis de joncs sur lequel passe
un courant d'eau chaude naturelle dont les vapeurs enveloppent les baigneurs.
En sortant de cette étuve, les malades traversent la rue et vont
se jeter dans une piscine d'eau fraîche. L'eau naturelle . qui
s'évapore, dans le bain de vapeur possède une température
qu'aucun Européen ne saurait supporter. On raconte notamment
que pour se suicider, les Japonais se jettent souvent dans les sources
d'où jaillit cette eau et qu'ils y sont rapidement ébouillantés.
A côté de ces villes d'eaux où les baigneurs subissent
stoïquement les tortures de l'eau chaude, il en est d'autres où
ils sont traités d'une façon plus humaine. Ainsi à
Beppu, qui est situé au bord de la mer, la température
du bain et graduée suivant la maladie que l'on traite. Les piscines
y sont même arrangées de telle façon qu'à
la marée haute elles sont envahies par la mer qui, de cette façon,
abaisse la température du bain.
Une station également curieuse est celle de Yumoto, dont l'eau
ferrugineuse laisse déposer une boue jaunâtre. Les Japonais
en profitent pour placer dans les sources de larges pièces de
coton qu'ils laissent s'imbiber de sels minéraux. Une fois que
les pièces ont pris une coloration jaune, elles sont retirées
et séchées, puis vendues pour faire des ceintures aux
enfants ou des robes, des kimonos, pour les grandes personnes.
Les vêtements confectionnés avec cette toile passent pour
posséder des vertus curatives extraordinaires, puisque, d'après
les croyances populaires, il suffit de les porter seulement pendant
douze heures pour éviter une saison complète à
la station.
***
Les îles méridionales et centrales du Japon sont éminemment
volcaniques, mais que dire de l'île septentrionale, cette île
de Yéso, si brumeuse et si froide, et dont chaque montagne est
un volcan qui sommeille ?
Enfin, il n'est pas superflu de noter que l'archipel des Kouriles, qui
continrent les îles japonaises jusqu'à la pointe du Kamtchatka,
compte lui-même une bonne douzaine de volcans dont quelques-uns
retrouvent de temps à autre toute leur activité.
Il arrive même que des éruptions volcaniques, se produisant
au fond de la mer, fassent naître des îles qui ne tardent
pas à disparaître comme elles sont venues.
Ce fait curieux se produisit il y a moins d'une dizaine d'années
dans l'archipel des Liou-Kiou, au sud du Japon.
Le 14 novembre 1904, les habitants de l'île Ivo-Shima, près
de l'île Borain-Shima, entendirent au loin un bruit effroyable.
Le bruit recommença quinze jours plus tard. Cette fois, on remarqua
de gros nuages d'une fumée noire et blanche qui semblaient sortir
de la mer.
Le 5 décembre, la fumée s'éclaircit et il fut possible
de distinguer une petite île. Trois jours plus tard on apercevait
trois îles dont les contours étaient très nets.
Le 12 décembre, une des îles parut s'agrandir considérablement.
Elle avait l'apparence, d'une colline escarpée du côté
de d'est, mais qui s'abaissait doucement du côté de l'ouest.
Le 2 janvier, la partie de l'île qui était en pente subit
un changement complet et s'éleva progressivement jusqu'à
atteindre le niveau de la partie la plus haute.
Les habitants d'Ivo tinrent une réunion et dix hommes s'offrirent
pour tenter un petit voyage de découverte.
Ils atteignirent, dans un petit canot, le 1er février, l'île
nouvellement formée.
Ils constatèrent qu'elle mesurait près de cinq kilomètres
de circonférence et 160 mètres d'élévation
moyenne au-dessus de la surface de la mer. Au nord, il y avait un lac
d'eau, bouillante. La côte sud était formée d'une
masse de rochers couverts d'une couche épaisse de terre.
Sur le point le plus élevé de l'île, les voyageurs
plantèrent une perche avec le drapeau japonais et tracèrent
sur une pierre l'inscription suivante : « Terre nouvelle. Appartient
au Japon. Nombreux banzaïs (hourras) ».
La nouvelle de cette découverte fut transmise au gouverneur de
l'île Bonin-Shima qui donna à la nouvelle île le
nom de Nou-Shima.
Le gouvernement du Mikado fut informé qu'une terre nouvelle était
née au soleil de l'empire. Immédiatement, un personnage
officiel fut désigné avec mission d'inspecter cette île
et d'y organiser l'administration japonaise.
Il partit sur un vaisseau de l'Etat. Mais en, arrivant, au début
de juin, en vue de l'île Nou-Shima, il s'aperçut que l'île
s'enfonçait dans la mer presque à vue d'oeil.
On n'en voyait plus que le point le plus élevée, qui était
redescendu à six pieds seulement au-dessus du niveau de la mer.
Trois jours plus tard, l'île volcanique avait totalement disparu,
entraînant avec elle sous les flots le drapeau japonais et l'inscription
qui la faisait sujette du mikado.
Ainsi, toute la chaîne immense et presque ininterrompue des îles
japonaises est constamment soumise aux fantaisies ses volcans. Cette
chaîne volcanique se continue même jusque dans l'archipel
de la Sonde, où les soulèvements telluriques causèrent
sauvent d'épouvantables catastrophes.
Il nous suffira de rappeler la plus effroyable de toutes, l'éruption
du Krakatoa, qui se produisit le 25 août 1883.
Plus de 40.000 personnes périrent, asphyxiées par la cendre,
brûlées par la lave ou englouties par les vagues que la
mer avait jetées sur le rivage.
Ce fut plus qu'une éruption : le volcan éclata, s'ouvrit
entièrement sous la poussée d'une formidable, colonne
de feu ; la terre ne fit pas que trembler : elle s'enfonça, De
grands vaisseaux qui se trouvaient sur la côte furent projetés
à plusieurs kilomètres dans des terres ; un grand nombre
d'îles disparurent dans les profondeurs de l'Océan.
Ce fut, peut-être, de tous les cataclysmes de ce genre le plus
considérable, celui, à coup sûr, qui fit le plus
grand nombre de victimes.
Mais la nature volcanique de ces régions ne cause pas que des
catastrophes. Il est au moins une de ses manifestations que les habitants
apprécient comme un bienfait c'est le courant d'eau chaude, le
Kouro-Sivo, le courant noir, comme l'appellent les Japonais,
qui, venant du sud de Formose, longe les côtes orientales du Japon
et répand sur elles la bienfaisante influence de sa température.
***
On voit, par tous ces détails, que le Japon mérite bien
le nom de « pays des volcans ». Et certains ethnologues
expliquent par cette nature du sol ce qu'on a appelé chez les
Japonais le « tempérament frénétique ».
Quoi d'étonnant, après tout, que, par un phénomène
de transmission fort vraisemblable, l'ardeur éruptive de la terre
passe quelquefois dans 'l'âme des habitants !
Ernest LAUT.
Le Petit Journal illustré du 1 février 1914