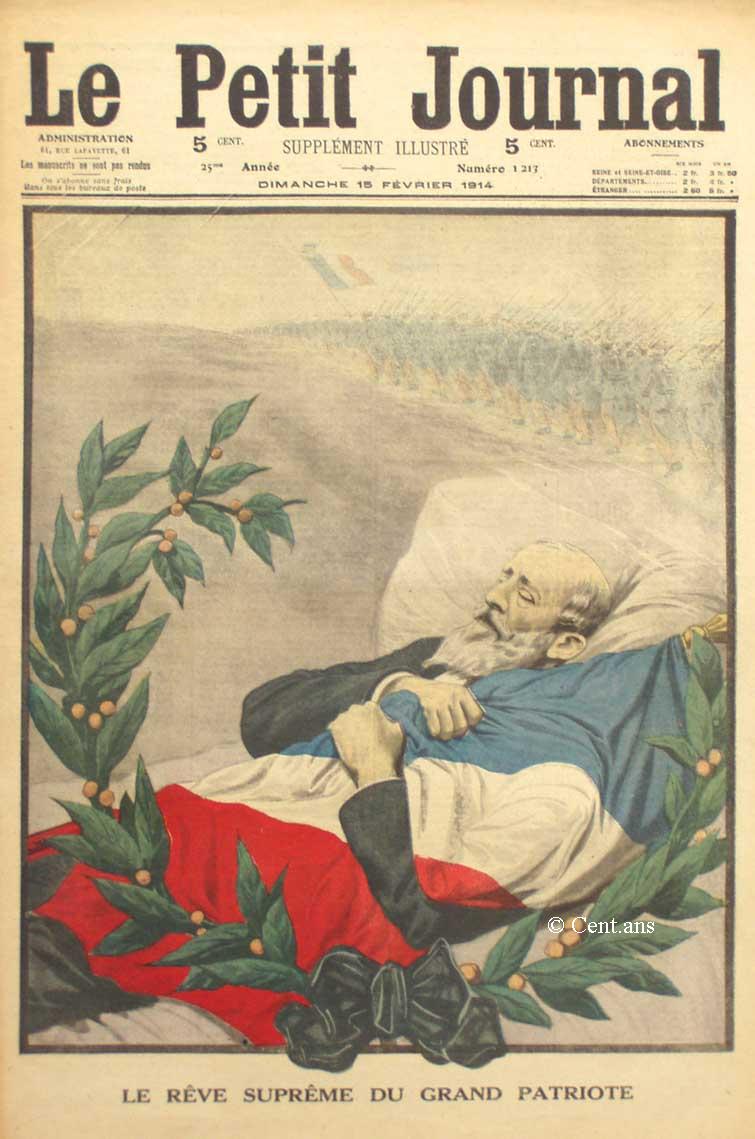LE RÊVE SUPRÊME DU GRAND PATRIOTE
Le rêve suprême de Déroulède,
le rêve de toute sa vie, son rêve unique, ce fut le retour
des provinces perdues à la France.
Dès la guerre finie, il n'eut plus qu'un désir : voir
la France reprendre aux Allemands par la fonce ce que par la force ils
nous avaient enlevé.
Et il écrivait :
Je n'ai jamais formé qu'un seul voeu
: leur déroute.
Les voir chassés du sol qu'ils nous ont arraché.
Si j'ai changé parfois et de guide et de route,
C'est vers Metz et Strasbourg que j'ai toujours marché.
Oui, c'est vers Metz et Strasbourg qu'il marchait
lorsqu'il allait par la province, prêchant la religion de la Patrie.
Jean Lecoq, dans le Petit Journal, rappelait à ce propos
une belle réponse de l'apôtre national.
« C'est ainsi, dit-il , qu'un soir il vint dans ma petite ville.
Le théâtre, où il parlait, débordait d'une
foule attentive et silencieuse. Nous étions là nous, des
jeunes, nous tous qui gardions le souvenir d'une enfance douloureuse
attristée, par l'invasion, et nous écoutions avidement
cet homme qui personnifiait nos indignations et nos espérances.
Soudain, d'un coin de la salle, un de ces niais qui ne peuvent s'imaginer
qu'en réunion publique on parle d'autre chose que de politique,
lui lança je ne sais plus quelle interruption absurde, le sommant,
si je .me souviens bien, de donner son avis sur une question qui divisait
alors les partis, et teignant de le considérer comme un homme
qui venait mendier chez nous quelque candidature.
» Ah ! la réponse ne se fit pas attendre.
»-Je viens ici vous parler de patriotisme, et non de politique,
s'écria Déroulède. Mais si vous croyez que je cherche
un mandat, eh bien, soit ! Je demande à être député
de Strasbourg.
» Je vous laisse à penser, ajoute Jean Lecoq, si de tels
mots, à une telle époque, déchaînaient l'enthousiasme...
» .
Ah ! ce rêve de retrouver françaises les provinces perdues,
avec quelle ferveur il l'a poursuivi toute sa vie ! Un jour, il disait
à Falateuf, l'avocat qui venait de plaider pour lui :
- L'Alsace-Lorraine ! Mais si on me disait que, pour qu'elle nous soit
rendue, il fallait me laisser enduire de pétrole et brûler
vif... mais je le ferais tout de suite avec joie !
Ce rêve, il est mort sans le voir accompli, mais, dans une pièce
admirable qui est comme sa profession de foi, et que nous reproduisons
dans nos « Pièces à dire », il a écrit
ce vers :
Dieu veuille un jour qu'un grand Français
l'achève :
Et tel doit être le voeu de tous les bons Français.
VARIÉTÉ
LE POÈTE-SOLDAT
Paul Déroulède. - L'internationalisme à la fin de l'Empire. - Deux jeunes héros. Sur la barricade. - Les chants du soldat. - Idéal et générosité.
L'homme qui vient de mourir fut comme l'incarnation
du patriotisme agissant. Il n'est point un Français, homme de
coeur, de quelque parti qu'il soit, qui ne s'incline devant sa dépouille.
Rien n'est plus beau qu'une vie toute entière consacrée
à une passion unique, quand cette passion, la plus haute, la
plus noble, la plus désintéressée des passions,
s'appelle l'amour du pays.
Cet amour, Déroulède l'éprouva jusqu'au paroxysme
; il lui sacrifia tout : sa jeunesse, sa fortune ; il lui consacra son
coeur, son intelligence, son talent ; il n'eut point dans son existence
une pensée qui n'en fût inspirée ; il n'a pas écrit
une seule page, un seul vers qui n'aient eu pour but de l'exalter
Nos abstracteurs de quintessence, nos poètes alambiqués
peuvent dédaigner la forme simple et rude de ses petits poèmes,
cette forme est celle qui convient aux chants d'un poète-soldat
; certaines pièces sont vibrantes comme des sonneries de clairon
; c'est de la belle poésie populaire : cela coule de source,
et ça vous prend au coeur.
On vous dira : ce n'est pas de l'art. La belle affaire ! C'est de l'émotion
vraie, c'est de la force, c'est de la vie, c'est de la sincérité.
Et cela vivra tant qu'il y aura des Français qui aimeront la
France.
***
Sait-on que ce grand patriote faillit, en sa jeunesse, se laisser prendre
aux folles utopies de d'internationalisme.
Ce n'est pas d'aujourd'hui que les criminelles théories du pacifisme
et de l'humanitarisme ont commencé de troubler les âmes
et les cervelles
Des intelligences non moins hautes que celle de Déroulède
s'étaient déjà laissé tenter par elles.
Lamartine n'écrivit-il pas cette Marseillaise de la Paix,
si peu en rapport avec ses sentiments patriotiques, et que, depuis lors,
les socialistes révolutionnaires exploitèrent tant de
fois au profit de leurs. idées ?
A la fin de l'Empire, la jeunesse des écoles était volontiers
internationaliste Et antimilitariste par haine du régime impérial.
Déroulède, comme la plupart de ses camarades, avait des
sentiments républicains à la manière des gens de
1848 ; et, comme les bons rêveurs d'alors, toute cette jeunesse
assagie chantait volontiers :
Les peuples sont pour nous des frères
Et les tyrans des ennemis.
Pourtant, le jeune homme n'avait certes pas
été élevé dans l'indifférence patriotique.
Enfant de bonne bourgeoisie ( il était fils d'un avoué
à la cour d'appel, et sa mère, Amélie Augier, était
la sueur du célèbre auteur dramatique Emile Augier ) il
avait reçu une éducation profondément française.
Sa mère lui avait appris à lire dans l'Histoire de
France de Walter Scott ; et le premier livre qu'elle lui avait
donné, le jour de sa première communion, c'était
un Corneille. L'auteur du Cid fut son premier maître.
C'est dans son oeuvre qu'il apprit l'héroïsme, l'abnégation,
l'amour de la patrie, sans compter l'art de bien frapper un vers et
de développer clairement une pensée.
A l'époque où il était encore collégien,
Déroulède assista à deux spectacles qui demeurèrent
profondément gravés dans sa mémoire : le retour
triomphal de l'armée d'Italie et les obsèques d'un de
ses oncles, le lieutenant-colonel Déroulède, tué
en combattant en Cochinchine. Cette apothéose des soldats victorieux,
ces honneurs funèbres rendus à l'officier mort au champ
d'honneur firent sur lui la plus vive impression. Et ce fut le désir
unique de toute sa vie : ou de revenir en France comme les premiers,
ou de mourir comme le second.
Cependant, Étudiant au Quartier Latin, puis jeune journaliste
et jeune avocat, embrigadé dans l'opposition bonapartiste, il
ne me poussait point les sophismes qui semblaient alors inséparables
de l'idée républicaine.
Déroulède, dans ses Feuilles de route, a eu le
noble courage de s'accuser de cette faiblesse et d'en faire amende honorable.
Vers 1863, dit-il, il était de tradition au Quartier Latin de
honnir le régime impérial ; et il y était de mode,
ce qui est plus grave, de rabaisser les vertus militaires pour glorifier
les vertus civiques et d'exalter la liberté individuelle en faisant
fi de l'indépendance nationale. L'Humanité primait la
Patrie.
» L'avenir nous semblait proche où le genre humain réconcilié,
rejetant tout ensemble ses armes et ses chaînes, confondrait tous
les peuples et toutes des races dans une embrassade mondiale...
» Tel était, à peu d'exceptions près, ajoute-t-il,
et avec plus ou moins de violence selon les milieux, l'état d'esprit
des républicains de l'époque... Sincère ou non,
généreuse ou intéressée, la frénésie
bonapartiste allait vraiment jusqu'au vertige. On en était arrivé
à ne voir dans les drapeaux que les aigles qu'on en voulait arracher
; dans les soldats, que les soutiens ou, comme on disait, que les suppôts
du tyran. Tout levier semblait bon qui ferait écrouler l'Empire.
L'internationale fut un de ces leviers ; l'antimilitarisme en fut un
autre ; et, comme l'amour de l'Armée n'est que le complément
de l'amour de la Patrie, après avoir bafoué l'une on renia
l'autre...»
Le poète avoue humblement qu'il faillit sombrer dans cette folie.
« En vérité, dit-il; si les néologismes inventés
de nos jours pour nos néo-Français ,avaient eu cours à
cette époque, j'aurais eu plus d'un titre à être
classé intellectuel, pacifiste, antimilitariste, humanitariste,
voire « internationaliste conscient. »
***
Le coup de tonnerre de Wissembourg balaya toute cette idéologie.
Déroulède, nommé sous-lieutenant de la garde mobile,
ne se contenta pas d'un emploi qui le tien au loin du danger. Il s'engagea
dans les zouaves. Son frère, André Déroulède
vint l'y rejoindre : il quittait le collège pour aller au combat.
C'était un enfant, dix-sept ans à
peine,
De beaux cheveux blonds et de grands yeux bleus.
Mme Déroulède elle-même avait encouragé ses deux fils à courir au secours du pays. Et le poète a célébré en beaux vers cet héroïsme maternel :
Oui, cette femme au cœur français,
à l'âme fière,
Qui mène vaillamment ses deux fils aux combats,
Oui, cette femme-là, cette femme est ma mère,
Et c'est mon frère et moi qu'elle a créés soldats.
On sait quel fut le sort des deux jeunes héros.
André, blessé grièvement au plateau d'llly, transporté
dans une ambulance allemande ; Paul, prisonnier, emmené en Silésie.
Ce furent pour lui de terribles jours que ces jours de captivité.
De la forteresse où on le tenait captif, il écrivait à
sa soeur des lettres débordantes d'espoir dans le relèvement
du pays. Mais ces lettres passaient sous les yeux du commandant de la
forteresse, un général prussien du nom de Von den Linden,
qui se faisait une joie cruelle de blesser l'âme du jeune patriote.
Et c'était entre Déroulède, et lui un combat incessant,
où la verve et l'à-propos du Français triomphaient
aisément des lourdes injures de l'Allemand.
« Un jour, raconte Jules Clairetie, dans un article sur Déroulède,
un jour le prisonnier avait parlé dans sa lettre des «
troupes que le gouvernement de la Défense nationale pouvait mettre
encore en ligne ».
» - Il y a un mot inexact, dit insolemment le général.
Quand on est battu, on n'est pas une troupe, on est un troupeau.
» - Monsieur, fit Paul Déroulède, vous êtes
ici pour me condamner à subir votre prison, mais non pas vos
leçons de français. »
De fait, il fut mis au cachot. Mais il n'en continua pas moins à
braver avec sa verve juvénile le commandant prussien qui le retenait
prisonnier. Il mit même le comble à sa bravade, lorsque
en s'évadant pour aller rejoindre l'armée de la Loire,
il adressa au général une de ses cartes avec ces trois
lettres goguenardes : P. P. C pour prendre congé.
A Tours, où il arriva tout d'une traite, Gambetta voulut le face
capitaine. « Je ne suis qu'un soldat de trois semaines »,
dit Déroulède, donnez-moi les gallons de Sous-lieutenant,
cela me suffit.
C'est en cette qualité qu'il fit, dans un régiment de
turcos, la campagne de l'Est. On sait que sa conduite à Montbéliard
lui valut une citation à l'ordre du jour et la croix, cette croix
dont il portait pieusement le large ruban à la façon des
demi-solde.
La guerre contre l'étranger finie, il fut appelé à
Paris pour combattre la Commune. Et l'on cite plus d'un trait de son
héroïsme et de sa générosité à
l'égard des communards.
C'est ainsi qu'un jour, au pied d'une barricade, il se trouva aux prises
avec une amazone de la Commune, qui, tout en lui adressant des injures
variées, le visa, tira, le manqua.
Elle rechargeait son arme et faisait feu, en continuant à invectiver
l'adversaire qui lui servait de cible et ne lui répondait que
par des éclats de rire. Elle était exaspérée.
- Mon lieutenant, dit un caporal, je vais lui montrer comment on descend
quelqu'un.
Paul Déroulède releva, le canon du fusil et après
avoir salué ironiquement sa peu cavalière adversaire.
- Madame, quand on est à ce point maladroite, on ne se mêle
pas de faire le soldat.
Et il redescendit dans la tranchée.
Ce soldat héroïque que la guerre contre l'étranger
avait épargné, devait être blessé par une
balle française.
C'était à la barricade de Belleville. Il y avait deux
heures qu'on tiraillait sans parvenir à déloger les insurgés.
Déroulède vint trouver son chef :
- Voulez-vous me laisser faire, mon capitaine ?
- Allez.
Et Déroulède, toujours vêtu de son uniforme de turco,
prit avec lui quelques chasseurs à pied, enfila les rues sous
les balles, grimpa sur la barricade et saisissant le drapeau rouge planté
sur les pavés, se mit en devoir de l'arracher.
C'est à ce moment qu'à bout portant, un jeune homme en
bras de chemise, presque un enfant, dont la physionomie est restée
toujours gravée dans la mémoire de Déroulède,
lui envoya son coup de fusil. L'officier lâcha le drapeau rouge
qui s'abattit sur les pavés, et son bras cassé tomba le
long de son corps.
Mais que lui importait ! Les chasseurs l'avaient suivi, mettant en fuite
les insurgés. La barricade était prise.
***
Sa blessure fut longue à guérir. Et c'est pendant l'inaction
forcée qu'il dut subir de ce fait, qu'il composa ses premiers
Chants du Soldat, ce livre fougueux qui eut le succès
populaire le plus éclatant, ce livre dont Banville disait : «
Il sent la bataille et la poudre, et, dès qu'on l'a ouvert, il
nous enivre par un parfum de bravoure, d'insouciance, de jeunesse et
de mâle vertu. »
Avec les Chants du Soldat, c'était une poésie
nouvelle qui naissait, une poésie en harmonie avec l'âme
des Français d'alors, tout vibrants encore de l'héroïsme
dépensé, tout émus encore des deuils subis.
A propos de ces petits poèmes «, qui versaient à
la France, dans son casque brisé, la boisson des forts »,
Paul de Saint-Victor écrivait ces lignes :
« Le tallent est grand, mais l'inspiration est plus haute encore.
Le poète se soucie moins de ciseler ses vers que de les tremper.
Leur éclat est celui des armes , leur cadence semble réglée
sur celle d'une marche guerrière. il n'entre que du fer dans
les cordes de cette lyre martiale. C'est de l'héroïsme chanté.
»
D'autres chants suivirent : Chants du Soldat, encore, Chants
du Paysan, Marche et Sonneries. Et toujours sur
la lyre du poète éclatait la même note d'héroïsme
et de regret.
Car ce fut là la source unique de son inspiration. Il exalta
le courage des vaincus pour aviver les espérances ; et tout l'espoir
de sa vie fut dans la pensée qu'il verrait un jour revenir au
pays par la victoire les provinces que la défaite nous avait
enlevées.
La mort, hélas ! l'a pris avant que son espoir se soit réalisé.
Ce culte unique et fervent, cette sorte d'obsession héroïque,
cette constance patriotique poussée, jusqu'à l'idolâtrie,
tout cela joint à son allure de capitan,lui avait valu quelquefois
les railleries des méchants et des sots. Leur commune moquerie
était de le comparer à Don Quichotte.
Don Quichotte, ?... Eh bien quoi ? N'a-t-on pas dit de nous tous, Français,
que nous étions une nation de Don Quichottes?... Oui certes,
on l'a dit maintes fois ; et appréciation au demeurant, ne saurait
nous froisser. Il n'appartient pas à toutes les nations d'être
des nations de Don Quichottes.
Cela veut dire qu'en France on n'hésite jamais à aller,
même inconsidérément, au secours des faibles et
des opprimés.
Qui osera nous le reprocher ? A chacun sa folie. Nous avons celle de
la générosité et de l'idéal. Tâchons
de n'en point guérir de sitôt, et souhaitons que notre
France ait dans l'avenir beaucoup de Don Quichottes comme de grand Français
qui vient de mourir !
Ernest LAUT.
Le Petit Journal illustré du 15 février 1914