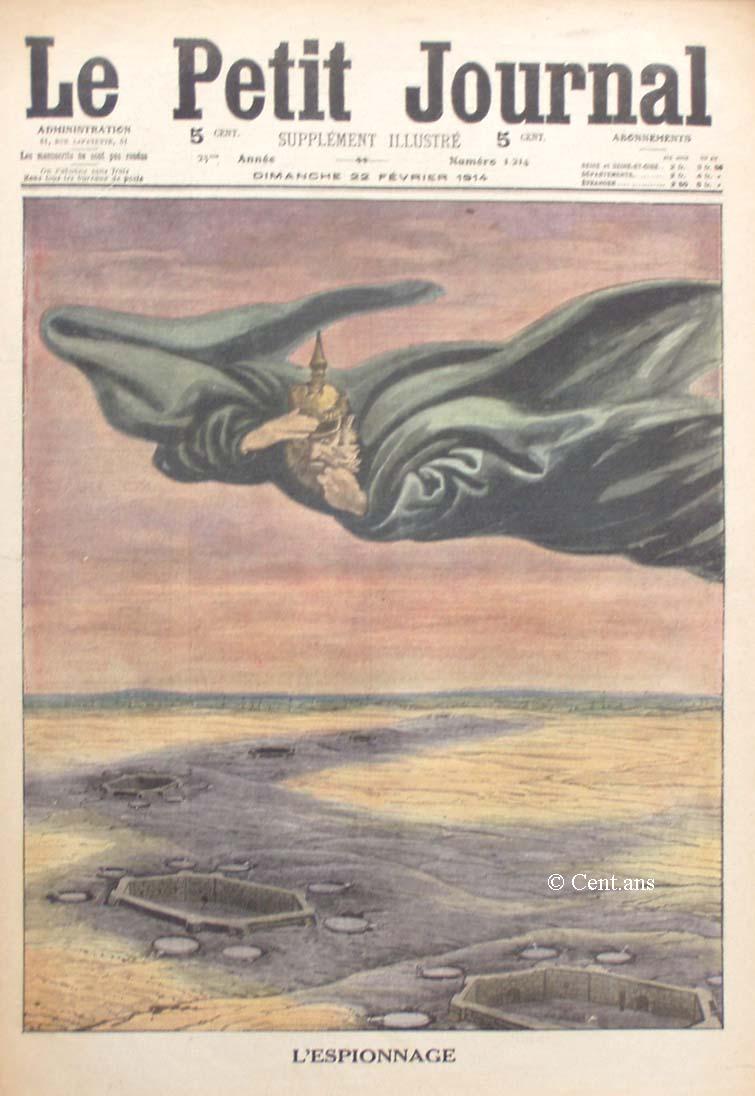L'ESPIONNAGE
Cette composition allégorique caractérise
de façon hélas ! trop réelle ce qui se passe chez
nous depuis quelques années surtout. Oui, l'espionnage est comme
un monstre formidable qui plane sur notre pays tout enter ; son ombre
immense s'étend sans cesse sur nos villes, sur nos forts, partout.
On sait comment Bismarck prépara la guerre de 1870. Il fit précéder
l'invasion de la France par les armées prussiennes, d'une autre
invasion, clandestine celle-ci, l'invasion de ses espions et lorsque
les Allemands passèrent notre frontière, ils avaient de
notre défense, de nos forts, de nos villes, de nos routes et
de nos moindres sentiers, des plans les plus complets. Pas un pouce
de notre territoire ne leur était inconnu.
Sommes-nous donc revenus à ces temps douloureux ? C'est à
le croire. Aujourd'hui comme avant 1870, les espions semblent pousser
sur notre sol comme les champignons après la pluie. Ils sont
partout au Nord, à l'Ouest, au Midi, à l'Est... à
l'Est surtout.
On vient d'en arrêter un aux abords d'un fort, près de
Toul. C'est un ancien instituteur allemand, naturalisé Français
: il y a plus de quinze ans qu'il espionne chez nous pour le compte
de l'Allemagne.
Cet homme se dit cultivateur. En effet, il occupe une ferme, mais il
ne cultive pas les terres qui en dépendent ; il n'a même
pas de chevaux ni de boeufs pour les labourer.
Il y a plus, d'un an et demi que le Petit Journal, a signalé,
sur la frontière de l'Est, l'existence d'une foule de faux fermiers
du genre de celui-ci. Chaque fois qu'une ferme proche de quelque hauteur
ou de quelque point stratégique est à vendre ou à
louer, on voit arriver un acquéreur étranger au Pays,
qui paie, sans discussion, le prix demandé par le propriétaire.
Et les autorités ne savent rien ou feignent de ne rien savoir.
L'administration française, d'ailleurs, est optimiste. Lorsqu'il
y a quelques années le conseil général des Côtes
du Nord attira son attention sur les achats de terrain de l'île
de Bréhat par les Allemands, l'administration lui répondit
que ses craintes patriotiques étaient chimériques.
A la faveur de cet optimisme, les Allemands se répandent chez
nous en toute liberté. Ils sont plus de six cent mille en France.
Combien sur ce nombre espionnent pour leur pays ?... Ce qui est certain,
c'est que les espions pullulent ; ils se gîtent aux bons endroits,
près des places fortes, à proximité des ponts,
des tunnels, des ouvrages d'arts qu'ils ont, sans nul doute, mission
de saboter quand ils en recevront l'ordre pour empêcher notre
mobilisation.
On les connaît, on les montre au doigt, on les arrête même
quelquefois, mais on ne les surveille pas, mais on les traque pas.
Ah ! c'est une dangereuse chose que l'optimisme de l'administration
!
VARIÉTÉ
LE CAFÉ
Va-t-on le supprimer de l'alimentation de nos soldats ? -- Un mot de Voltaire. - Le café dans la légende et dans l'histoire. Ses amis et ses adversaires. - Ce qu'on en consomme en France.
Le Petit Journal annonçait,
ces jours derniers, que parmi les mesures d'hygiène préconisées
par le ministre de la Guerre, pour maintenir en de bonnes conditions
l'état sanitaire de l'armée, il était question
d'opérer une véritable révolution dans l'alimentation
du soldat. Le café, « le jus », comme disent pittoresquement
les troupiers, serait remplacé par une soupe chaude, constituant
pour le soldat un déjeuner plus substantiel.
Cette réforme, à coup sûr, ne pourra qu'être
favorablement accueillie dans l'armée, puisqu'elle a pour but
d'assurer une meilleure nourriture aux hommes ; mais, cependant, ils
ne verront pas disparaître sans quelque regret ce « jus
» traditionnel qui constitue depuis cinquante-sept ans le repas
matinal de nos soldats.
***
« Je ne sais pas ce qu'était l'ambroisie, disait Voltaire,
mais j'aime à croire que ce devait être le café.
»
Or, Voltaire, entraîné par son amour du café, se
trompait évidemment. L'ambroisie des Dieux du paganisme ne devait
pas être le café, attendu que, le café semble avoir
été inconnu de l'antiquité grecque et romaine.
Nous ne trouvons dans les auteurs anciens nulle allusion à une
boisson qui puisse être identifiée avec le café.
Les Orientaux eux-mêmes devaient ignorer en ce temps-là
les vertus du fruit du caféier. Car il est évident que
s'ils les avaient connues, les Grecs leur eussent emprunté l'usage
de boire du café, et les Romains l'eussent emprunté aux
Grecs. Et il est bien certain que ni les Grecs ni les Romains n'ont
connu cette boisson, dont tant de gens d'aujourd'hui ne peuvent pas
se passer.
La raison de cette ignorance réside probablement dans ce fait
que les contrées où le caféier poussait à
l'état sauvage étaient inconnues des Anciens. S'il faut
en croire le docteur Roth, le café serait originaire d'Abyssinie,
et plus particulièrement d'une province de ce pays, la province
de Kaffa dont il tire son nom. On le trouve encore a l'état sauvage
dans le Soudan et l'Afrique équatoriale.
Or, ni l'Abyssinie, ni l'Afrique équatoriale ne furent explorées
par les Anciens.
Les Abyssins furent apparemment le premier peuple du monde qui but du
café. De chez eux, le café passa en Perse où, dès
le XV siècle, on connaissait l'art de le brûler et de le
broyer pour en faire des infusions.
Un muphti d'Aden rapporta cette pratique en Asie Mineure, et, dès
lors la culture du café se fit dans ce pays. Elle passa de là
en Arabie et réussit particulièrement dans le Yémen.
Jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, tout ce qui se consommait de
café en Europe venait de ce pays. Moka en était le centre
d'exportation.
Un auteur arabe raconte sur la découverte du. café cette
jolie légende :
Un berger, chargé de garder les chèvres d'un monastère,
constatait que ses bêtes ne dormaient pas et cabriolaient toute
la nuit. Il fit part de sa remarque au prieur du couvent, qui observa
les chèvres à l'endroit où elles paissaient. Et,
il remarqua qu'elles mangeaient volontiers les fruits de certains arbustes
sauvages. Il cueillit de ces fruits, les fit bouillir, et ayant bu de
cette décoction, il constata que lui-même n'avait plus
la moindre envie de dormir. Or, comme ces moines avaient la fâcheuses
habitude de sommeiller pendant les offices de nuit, il leur en fit boire
également.
C'est ainsi que les propriétés anti-somnifères
du café furent découvertes pour la première fois.
D'Orient, le café passa en Europe, au XVIIe siècle. Trévoux
affirme, dans son Dictionnaire, que, sous Louis XIII, on vendait dans
une boutique proche du Petit Châtelet, une boisson nommée
« cahouet », qui n'était autre chose que de la décoction
de café.
Ce qui est certain, c'est que, dès l'an 1644, quelqu'un apporta
à la Cour du café de Moka et en fit goûter à
Louis XIV, qui trouva la boisson savoureuse.
Mais ce ne fut qu'une vingtaine d'années plus tard que l'usage
du café se vulgarisa a Paris. La mode en fut répandue
surtout par Soliman Aga, ambassadeur de Turquie, et par le voyageur
Thévenot, qui avait conservé de ses voyages en Orient
l'habitude de cette boisson.
Un Arménien ouvrit, à la foire Saint Germain, un débit
de café qui attira la foule. Un Sicilien, nommé Procopio
Cultelli, en ouvrit un autre rue des Fossés-Saint-Germain (actuellement
rue de l'Ancienne-Comédie), en face du Théâtre-Français
; et ce fut l'origine du Procope, le fameux café littéraire,
qui ne disparut qu'en ces dernières années.
***
Bientôt, le café fit fureur. En un temps où un mot
spirituel suffisait pour illustrer son auteur, comment cette boisson,
qui passait pour stimuler l'esprit, n'eût-elle pas eu grand succès
?
Mais ce n'était point là la seule vertu que nos aïeux
reconnaissaient au café ; ils lui attribuaient encore la propriété
de dissiper les fumées de l'ivresse causée par le vin.
Nous en trouvons le témoignage dans ces vers qu'un poète
du temps adressait à l'un de ses confrères, bien connu
pour aimer la dive bouteille.
Ami, si le sommeil vient au milieu des pots
Répandre ses pavots,
Et qu'un vin trop fumeux te brouille la cervelle,
Prends du café : ce jus divin
Pour chasser le sommeil et le vapeurs du vin,
Saura te redonner une vigueur nouvelle.
Et Berchoux exprimait la même idée dans son poème la Gastronomie.
Le café vous présente une heureuse
liqueur
Qui, d'un vin trop fumeux, chassera la vapeur.
Cependant, le café n'eut pas que des
partisans. Quelques détracteurs s'élevèrent contre
la boisson nouvelle. C'étaient, en général, des
médecins qui s'effrayaient de la consommation abusive qu'on en
faisait.
Perdant tout le XVIII siècle, de nombreux médecins en
combattirent l'usage et le défendirent à leur clientèle.
L'un d'eux, ayant traité le café de poison devant Fontenelle
le vieil écrivain lui répondit :
- Il faut avouer que si le café est un poison, c'est un poison
lent, car j'en bois plusieurs tasses par jour depuis quatre-vingts ans
et ma santé n'en est pas sensiblement altérés.
Pourtant, tous les gens de lettres ne partageaient pas, sur les vertus
du café, l'enthousiasme de Fontanelle.
Montesquieu, notamment, raillait les gens qui prenaient du café
pour avoir de l'esprit :
Dans les Lettres Persanes, Usbeck écrit à Rhédi
: « Le café est très en usage à Paris ; il
y a un grand nombre de maisons où on le distribue. Il y en a
une où on apprête le café de telle manière
qu'il donne de l'esprit à ceux qui en prennent : au moins, de
tous ceux qui en sortent, il n'y a personne qui ne croie qu'il en a
quatre fois plus que lorsqu'il y est entré.»
D'ailleurs, ce n'était pas seulement en France que les armateurs
et les détracteurs du café disputaient sur les vertus
ou les méfaits de ce breuvage. Il en était de même
en Allemagne. On y répandait à foison des couplets et
des pamphlets sur le café. Et ne vit-on pas le grand Sébastien
Bach mettre en musique une cantate sur la boisson nouvelle.
Cette cantate, bien simplette comme livret, mais dont la musique est
pleine d'esprit et de grâce enjouée, met en scène
un vieux bourgeois, maître Schlendrian, qui, ennemi juré
du café, défend à sa fille d'en boire, et lui déclare
que si elle désobéit à ses ordres, il ne la mariera
pas. La jeune Liesschen promet tout ce qu'exige son papa, mais, en secret,
elle annonce qu'elle ne donnera sa main qu'au soupirant qui lui garantira
le café par contrat.
Cette bluette, en dépit de sa naïveté, était
une sorte de symbole de l'action du café dans les familles. De
véritables Passions se manifestaient pour ou contre la boisson
nouvelle. Maris et femmes se querellaient sur ses vertus ou ses défauts.
Les enfants n'obéissaient plus à leurs parents. Un breuvage
de discorde s'était insinué dans les ménages
A. la vérité, pendant un siècle et demi, le café
demeura boisson d'intellectuels. Tous les poètes l'avaient chanté.
Tous les gens d'esprit crurent devoir l'apprécier. Même-ceux
qui ne l'aimaient pas en prirent par respect de la mode.
Mme de Sévigné, qui, d'ailleurs, n'a jamais prononcé
ni écrit la phrase fameuse « Racine passera comme le café
» - c'est Voltaire et La Harpe qui lui attribuèrent gratuitement
le propos - Mme de Sévigné n'était pas folle du
café. Elle disait - et ceci elle le disait vraiment - : «
Le café m'abêtit. » Mais elle en prenait tout de
même. Il est vrai que Mme de Sévigné fut la femme
« snob » par excellence. Il n'est pas un remède à
la mode, pas une station thermale en vogue dont elle n'ait voulu tâter.
Comment n'eût-elle pas pris du café alors qu'il était
de bon goût d'en prendre chez les gens de bon ton ?
Mais le peuple et surtout le peuple des campagnes ignora longtemps les
vertus du café. Jusqu'au XIXe siècle, le café ne
jouit auprès des masses que d'une assez médiocre réputation.
Beaucoup de médecins le présentaient comme une boisson
dangereuse, non point en elle-même, mais parce qu'insensiblement,
lorsqu'on en avait goûté on était entraîné
à en abuser. De sorte que beaucoup de gens prudents préféraient
ne pas se laisser tenter.
Cette thèse singulière avait trouvé un écho
chez Brillat-Savarin. Le grand gastronome exagère à plaisir
les dangers du café. Il raconte entre autres anecdotes qu'il
a vu à Londres, sur la place de Leicester, « un homme que
l'usage immodéré du café avait réduit en
boule ». Et il recommande aux pères et mères d'interdire
sévèrement le café à leurs enfants, «
s'ils ne veulent pas avoir de petites machines sèches, rabougries
et vieilles à vingt ans ».
Certes, le café n'est pas très salutaire aux enfants,
à cause de l'excitation nerveuse qu'il produit, mais, tout de
même, Brillait-Savarin exagérait un peu.
Napoléon fut un grand partisan du café, qui, cependant
ne lui réussissait guère. Un jour que le docteur Arnott
lui conseillait de n'en plus prendre, l'empereur lui répondît
« Le café fort et beaucoup me ressuscite ; il me cause
une cuisson, un rongement singulier, une douleur qui n'est pas sans
plaisir. J'aime mieux souffrir que de ne pas sentir. »
Il y a cent ans, on n'en donnait pas encore à nos soldats. En
1818, un médecin de la marine ayant signalé le café
comme un puissant antiscorbutique, on commença à en prescrire
l'emploi dans la nourriture des marins.
Quant aux troupes de terre, elles n'en reçurent que dans certaines
campagnes lointaines. Le baron Larrey, le grand chirurgien des armées
impériales, avait constaté dans les campagnes d'Égypte
et de syrie, l'excellente action du café sur les soldats atteints
de fièvre paludéenne. Son fils, le baron Hippolyte Larrey,
rappela le fait, alors des premières campagnes d'Algérie,
et si le café fut employé comme moyen prophylactique des
fièvres intermittentes dont les cas étaient assez nombreux
dans armée d'expédition. :
Ce n'est qu'en 1857 que le café entra régulièrement
dans l'alimentation du soldat Deux ans plus tard, nos troupes faisaient
la guerre en Italie, pendant une période extrêmement humide,
sous la pluie, dans la boue. Cependant, l'état sanitaire demeurait
excellent ; et beaucoup de médecins attribuaient à l'usage
du café cette heureuse influence sur la santé des soldats.
Ceci, à ce qu'il semble, devrait militer en faveur du maintien
du café dans la nourriture de nos troupiers. Peut-être
pourrait-on, du moins, le leur donner meilleur à faire en sorte
qu'il ne justifie plus le nom de « jus de chapeau », dont
ils l'ont gratifiè.
***
Aujourd'hui, le café n'a plus guère d'ennemis. Le dernier
adversaire, et le plus terrible peut-être qui se dressa contre
lui, fut Hahnemann, le créateur fameux de l'homéopathie.
Hahnemann allait jusqu'à lui dénier toute influence favorable
sur l'esprit.
C'était aller à l'encontre de l'opinion de Voltaire. Or
Voltaire, en l'espèce, était certainement beaucoup plus
compétent qu'Hahnemann.
Au surplus, on ne saurait prétendre que nous abusons du café.
Si j'en crois une statistique récente, en France on ne boit guère
qu'un peu plus de trois livres de café par an et par tête
d'habitant. Qu'est-ce au près du Brésil, où l'on
en boit annuellement quatorze livres par habitant ?
Ah ! si nous m'abusions pas plus de l'alcool !
Ernest LAUT
Le Petit Journal illustré du 22 février 1914