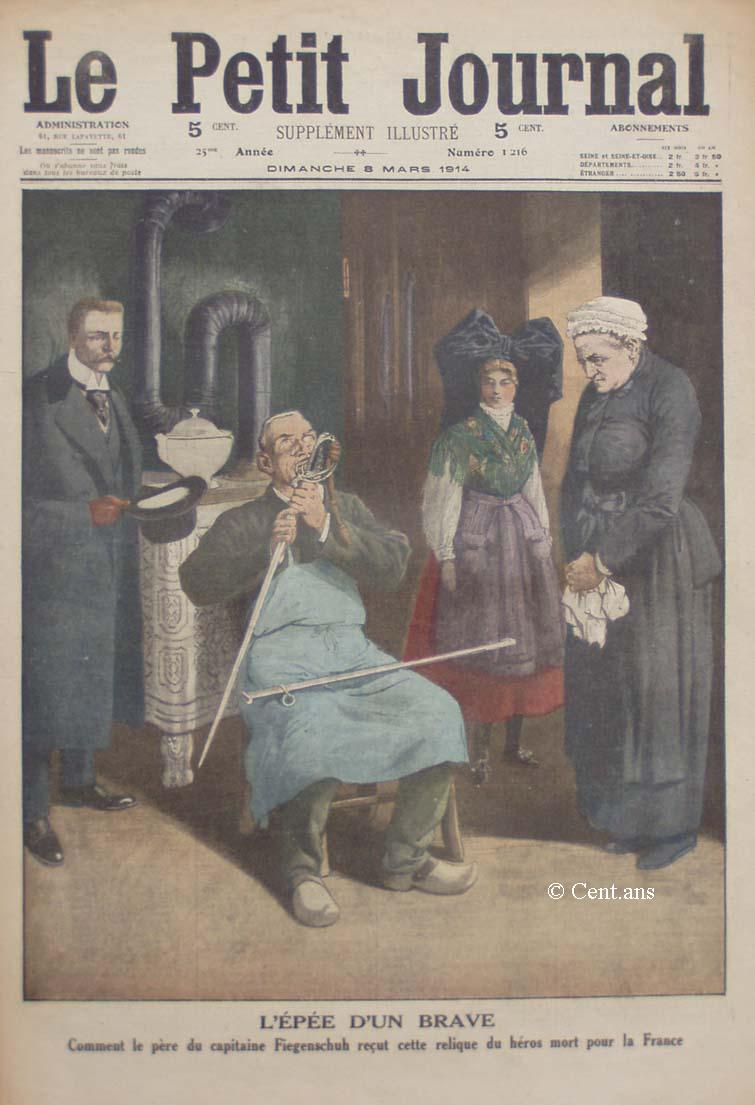L'ÉPÉE D'UN BRAVE
Comment le père du capitaine Fiegenschuh reçut cette relique du héros mort pour la France.
Le musée de l'Armée s'enrichira
prochainement d'une pièce remarquable qui lui viendra d'Alsace.
Il s'agit de l'épée du capitaine Fiegenschuh le héros
d'Abéché tué 1e 10 janvier 1910 au Massalit.
On se rappelle l'émotion intense qui étreignit tout le
pays lorsqu'on apprit la mort héroïque du vaillant soldat.
Quand on vint alors annoncer aux parents de l'officier, la triste nouvelle,
le père Fiegenschuh qui est aveugle depuis 1895, s'écria
: « Il est mort en brave, pour son pays ! » Quant, à
la mère, elle dit : « Hélas ! nous n'avons pas un
seul souvenir de lui !
Ce souvenir les braves gens l'ont aujourd'hui, et le plus glorieux des
souvenirs.
Après de longues recherches, on était parvenu à
retrouver l'épée du vaillant officier alsacien, mort pour
la France. Pendant un certain temps, cette relique resta déposée
au ministère de la Guerre, dans le cabinet même du ministre.
Depuis quelques jours, elle se trouve aux mains de la famille Fiegenschuh,
qui habite La Robertsau, aux portes de Strasbourg. En recevant l'épée
de son fils, le vieux père Fiegenschuh éclata en sanglots,
embrassa longuement la garde...
La famille Fiegenschuh gardera l'épée par devers elle
pendant un certain temps, puis en fera remise au Musée de l'Armée.
VARIÉTÉ
Les petits prodiges
L'enfant chef d'orchestre. - Les petits
virtuoses fameux. - Pic de la Mirandole et ses émules.
Le savant qui tette sa nourrice. - Pauvres petits prodiges !
On mène très grand bruit en ce
moment autour d'un jeune garçon de sept ans qui serait, parait-il,
un chef d'orchestre extraordinaire.
Ce « kapellmeister » à la bavette est Italien. Ses
parents lui servent d impresario et le baladent à travers l'Europe
pour l'exhiber aux dilettantes ébahis. Il revient de Russie,
où le tsar, non content de l'applaudir, l'a embrassé.
Excusez du peu !... Bientôt il ira à Londres ; après
quoi, j'imagine qu'il viendra à Paris... Vous pensez bien qu'on
ne saurait manquer de présenter ce phénomène au
peuple le plus badaud de la terre.
L'étonnant de l'histoire, c'est qu'il paraît que ce prodigieux
enfant, qui dirige à volonté toutes les oeuvres des musiciens
classiques ou modernes, ne sait pas lire une partition. Il lui suffit
d'entendre une fois à l'orchestre et une fois au piano l'oeuvre
qu'il doit diriger, et la voilà sténographiée dans
sa mémoire, avec toutes les nuances, tous les rythmes, toutes
les reprises des instruments divers. Si vous ne trouvez pas ça
miraculeux, c'est que vous êtes bien difficile.
La raison qu'on donne de cette organisation surprenante, c'est que tous
les parents de cet enfant sont musiciens. Il a été élevé,
si l'on peut dire, dans une atmosphère d'harmonie. De là,
ces dons exceptionnels, favorisés par une mémoire extraordinaire,
et, peut-être aussi, par un travail préparatoire, accompli
sans doute à huis clos sous la direction paternelle.
Je dis « peut-être », parce qu'il serait imprudent
de rien affirmer en pareille matière : la nature a parfois des
fantaisies surnaturelles. Mais, à quiconque a tant soit peu de
connaissances musicales, il paraîtra pour le moins singulier qu'un
marmot de sept ans qui, de l'aveu même de sa famille, ne sait
pas lire une partition, puisse diriger à l'orchestre les oeuvres
des maîtres.
S'il se contentait d'être virtuose, nous ne nous étonnerions
pas. Le fait n'est pas excessivement rare d'un enfant de cet âge
jouant merveilleusement de quelque instrument. Les concours du Conservatoire
nous en offrent même assez souvent des exemples. Mais,de virtuose
à chef d'orchestre il v a une nuances. Pour diriger l'orchestre
les oeuvres des maîtres, il ne suffit pas d'avoir le goût
et le sens de la musique avec beaucoup de mémoire, il ne suffit
même pas d'être musicien et de connaître à
fond ce qui n'est même pas le cas tous les secrets de l'harmonie
; il faut encore de nombreuses études, une connaissance approfondie
de la technique de tous les compositeurs classiques, toutes choses qui
ne se peuvent acquérir que par de longues années de pratique
et de travail.
Aussi peut-on rester sceptique quand on vient vous raconter qu'un jeune
garçon de sept ans, qui ne sait pas l'harmonie, vous dirige quatre-vingts
ou cent musiciens jouant. indifféremment du Beethoven ou du Bach,
du Berlioz ou du Wagner.
L'hypothèse la plus probable, c'est que ce petit prodige, bien
stylé par l'impresario paternel, « fait les gestes »,
et qu'il les fait à propos. C'est déjà quelque
chose, évidemment ; mais souffler n'est pas jouer, battre la
mesure n'est pas diriger.
Et voilà pourtant de quoi épater les populations !...
***
On a comparé cet enfant à Mozart. Mais Mozart, lorsqu'il
vint à Paris, en 1763, - il avait alors sept ans, lui aussi -
ne fut présenté que comme un virtuose. Il jouait à
ravir du clavecin et du violon, mais il n'avait pas la prétention
de diriger des orchestres.
Déjà, il avait fait fureur à la cour d'Autriche
; il fit fureur à la cour de France. Et cet enfant n'était
pas que virtuose : il était musicien ; il savait lire une partition,
toutes les partitions qu'on voulait bien lui désigner. Il prestesse
sans une faute, et avec une prestesse incomparable, les morceaux les
plus ardus. Même, il composait. On prétend qu'à
cinq ans il avait fait déjà un concerto pour le piano.
Au point de vue musical, Mozart est à coup sûr le plus
étonnant des enfants prodiges ; mais il n'est pas le seul. Chacun
sait que Lully, petit marmiton au service de Mlle de Montpensier, jouait
si joliment du violon que la princesse le remarqua et le fit entendre
par le roi.- Ce fut le point de départ de sa carrière
de grand musicien.
Haendel, à douze ans, était déjà célèbre
comme virtuose. Schubert, Rameau, tout enfants, jouaient fort bien du
clavecin et s'essayaient à la composition.
A peine âgé de quatre ans, le Jeune Meyerbeer montrait
déjà les dispositions les plus rares et un goût
d'une remarquable précocité pour la musique. Son biographe,
Arthur Pougin, raconte que, saisissant au vol les mélodies des
orgues qui venaient s'arrêter devant la maison paternelle, il
les transportait aussitôt sur le piano, cherchant et souvent réussissant
à les accompagner convenablement de la main gauche. En 1800,-
il avait alors neuf ans - il se fit entendre à Berlin dans un
concert public, et tout le monde s'accorda à voir en lui un musicien
appelé à devenir illustre.
Je pourrais citer bien d'autres musiciens d'autrefois qui furent, en
leur enfance, des prodiges ; mais à quoi bon chercher des exemples
dans le passé, alors que nous avons, dans le présent,
le plus extraordinaire, le plus merveilleux de tous ?
Je veux parler de M. Camille Saint-Saëns, la plus haute gloire
de la musique française de ce temps. L'enfance de M. Saint-Saëns
est comparable à celle de Mozart. Tout petit, il montrait un
tel goût pour la musique, qu'à trente mois on lui donnait
son premier piano, un piano minuscule. On lui apprit le nom des notes
et on lui mit sous les yeux la méthode de Carpentier. En un mois,
il l'avait parcourue entièrement. Il ne voulait plus d'autres
jouets et poussait des cris dès qu'on fermait l'instrument.
A cinq ans, il jouait des sonates d'Haydn et de Mozart. A dix ans, il
donna son premier concert à la salle Pleyel et joua des concertos
de Beethoven et de Mozart avec accompagnement d'orchestre. Quelqu'un
qui se trouvait là s'étonnait qu'on fit jouer du Beethoven
à cet enfant :
- Quelle musique jouera-t-il quand il aura vingt
ans ?
- Il jouera la sienne ! répondit sa mère avec un juste
orgueil.
***
Tous ces jeunes prodiges que je viens de citer
sont de ceux qui tinrent les promesses de leur enfance. Mais combien
d'autres ne furent que des étoiles vite éteintes ! Combien
d'autres succombèrent jeunes sous de poids de leur génie
naissant !
Ce n'est point en musique seulement que se manifeste la précocité
prodigieuse de certains enfants. On en trouve des exemples dans la plupart
des autres arts ; on en trouve également dans la littérature
et même dans la pratique des sciences les plus ardues.
Vous n'êtes point sans avoir ouï parler de ce fameux Pic
de la Mirandole, dont le nom est resté comme le synonyme du savoir
universel.
Dès son enfance, il se voua avec un entraînement extraordinaire
à l'étude de toutes les sciences. La philosophie, les
langues, la poésie, les mathématiques, la jurisprudence,
la théologie, les recherches d'érudition, les sciences
occultes même, furent les premiers jeux de cet enfant extraordinaire,
qui semblait devoir reculer les bornes du savoir humain. A dix ans,
on le considérait, en Italie, comme le premier orateur et le
première poète de son temps.
De tous les savants dont la jeunesse se manifesta prodigieuse par l'étude,
il est un de ceux qui vécurent le plus longtemps. Pic de la Mirandole
mourut en 1491 à l'âge de trente et un ans.
Bien d'autres furent moins favorisés du ciel : tel, par exemple,
cet autre prodige, Jean-Philippe Baratier, qui naquit le 19 janvier
1721, à Schwabach, près de Nuremberg.
A l'âge de trois ans, Jean Baratier savait écrire. A quatre
ans, il parlant le latin avec son père, le français avec
sa mère et allemand avec sa servante. A sept ans, il savait de
plus le grec et l'hébreu. A neuf ans, il composa un dictionnaire
grec des mots les plus difficiles de l'Ancien et du Nouveau Testament,
soit deux volumes de trois à quatre cents pages in-4°. En
1732 ( il avait alors onze ans ), il composa une traduction française
d'un manuscrit hébreu du XIIe siècle, l'Itinéraire
de Benjamin de Tudèle, avec des notes et des dissertations
qui remplissent un volume et étonnent encore aujourd'hui les
commentateurs par l'abondance des lectures et la force de logique qu'elles
supposent dans leur jeune auteur.
Tout à coup, il s'éprit d'une grande passion pour les
mathématiques ; et trouva des méthodes de calcul nouvelles.
Puis il se livra aux études astronomiques et composa des mémoires
qui lui valurent d'être nommé membre de l'Académie
de Prusse.
En 1738, il proposait à d'Académie des Sciences de Paris
une boussole qu'il avait inventée avec trois mémoires
des plus savante sur des questions astronomiques.
Son étonnante intelligence s'exerçait sur toutes les sciences.
Il étudia les langues et les littératures de tous les
temps et de tous les pays, traduisit les inscriptions des médailles
des antiquités égyptiennes, chinoises, indiennes, grecques
et romaines. Il commençait à s'occuper de l'explication
des hiéroglyphes, lorsqu'il mourut, à l'âge de dix-neuf
ans, le 5 septembre 1740.
Quand ils sont trop savants, les enfants vivent peu.
Nous en trouvons une nouvelle preuve dans l'histoire de Henri de Heinecken,
qui naquit à Lubeck, le 6 février 1721.
A l'âge de dix mois ce phénomène parlait et posait
des questions. A douze mois, il récitait couramment une traduction
en vers du Pentateuque ; à treize, tout l'Ancien Testament ;
à quatorze, le Nouveau. A dix-huit mois, il apprenait l'Histoire
universelle, la géographie; le latin, l'anatomie, et, entre deux
tétées que lui donnait sa nourrice, il conversait avec
elle en patois bas-allemand. Ces débuts promettaient à
l'Allemagne un Pic de la Mirandole plus moderne que l'autre et par suite
plus instruit, quand les parents du jeune prodige, conseillés
par son maître, eurent la vaniteuse et funeste ambition de le
présenter au roi Frédéric IV de Danemark. L'enfant,
alors âgé de trois ans, obtint les honneurs d'une audience
solennelle où le monarque, assisté des hommes les plus
savants du royaume, voulut s'assurer lui-même de son érudition.
L'enfant, très faible, pouvant marcher à peine, était
porté dans les bras de sa nourrice et, comme Antée touchant
la terre maternelle, entre deux discours, il reprenait des forces au
contact de sa porteuse, car, si avancé qu'il fut à tant
d'égards, à trois ans il tétait encore. Et c'était
un spectacle peu banal que celui de ce savant, mêlant à
des dissertations d'économie politique et de théologie
ces intermèdes puérils. Le voyage à Copenhague
le fatigua beaucoup. Revenu en Allemagne, il ne fit plus que languir,
sans rien perdre toutefois de sa force intellectuelle. Il vit venir
la mort avec courage, demanda un squelette pour vérifier un détail
d'anatomie, discuta la question de l'immortalité et mourut en
disant : « Seigneur Jésus, recevez mon âme. »
Il avait quatre ans.
La littérature fournit aussi des petits prodiges ; mais ceux-là,
on les appelle plus communément des « enfants sublimes
». N'empêche qu'il :serait préférable, parfois,
de laisser dans l'ombre les oeuvres de leur enfance. On nous a exhumé
ces temps derniers des vers écrits par Victor Hugo à douze
ans de la prose de Flaubert, à quinze ans qui, très certainement
n'ajouteront rien à la gloire de ces deux écrivains.
La vérité, c'est que l'homme seul est capable de créer.
Enfant, on peut être un virtuose, un interprète habile,
on peut donner, par des ressources extraordinaires de mémoire,
l'illusion de la science, mais le génie créateur on ne
saurait l'avoir qu'après des années d'études et
quand on a pu enfin dégager sa personnalité de ces études
mêmes et de l'imitation d'autrui. Compositions de musiciens en
culotte courte, vers de poètes à la bavette ne peuvent
être que des balbutiements.
***
Mais revenons à notre chef d'orchestre de sept ans. Un de nos
confrères, qui est allé lui rendre visite, l'a trouvé
jouant avec des soldats de plomb.
Pauvre petit prodige !... Je gagerais qu'il a plus de plaisir à
faire manoeuvrer sous ses doigts ses petits bonshommes qu'à discipliner
sous sa baguette tous ces musiciens barbus qui doivent bien,.quelquefois,
le regarder avec un peu de pitié.
Car je ne sais si vous êtes comme moi, mais c'est là le
sentiment que m'inspirent généralement tous ces enfants
prodiges. Je les plains, parce qu'ils sont enfants sans avoir le joies
de l'enfance.
Est-il rien de plus pénible que de voir un enfant exprimer des
sentiments ou remplit une fonction qui ne sont pas de son âge?
Je me rappelle, il y a quelques années, une fillette de huit
à dix ans, qu'une mère inconsciente traînait dans
les soirées, où elle lui faisait réciter des poème
ou des fragments de tragédies. L'enfant a déjà
la physionomie, la voix et toutes les allures de l'emploi. Elle faisait
des mines et prenait des poses comme une cabotine accomplie. Elle disait,
de la façon la plus naturelle du monde, des choses qu'elle ne
pouvait comprendre, et qu'elle exprimait pour tant sur le ton le plus
juste, grâce, évidemment, à une faculté d'assimilation
extraordinaire et à la patience de ses maîtres.
Eh bien, le croiriez-vous, cette justesse de ton, qui m'eut ravi chez
une vraie tragédienne, me semblait horriblement péniblement
chez cette enfant. Je pensais, en écoutant la pauvre gamine déclamer
des tirades, des tragédies de Corneille ou des drames de Victor
Hugo, je pensais à tout ce qu'on avait dû lui imposer de
travail pour arriver à ce résultat, à toutes les
joies enfantines dont on l'avait privée ; je pensais aux poupées
délaissées, aux rondes oubliées.
Et j'aurais voulu pouvoir dire à la mère, à cette
mère coupable de sacrifier ainsi, pour sa vanité ou pour
son profit, l'innocence morale de sa fillette, tout ce que cette sorte
de proxénétisme avait d'abominable.
Oui, ce n'est pas toujours de l'admiration qu'on éprouve en face
d'un enfant précoce, c'est plus souvent de la pitié. Un
enfant précoce, c'est un petit malheureux qui n'aura pas connu
ce qu'il y a de meilleur dans la vie : l'insouciance et la naïveté
de l'enfant.
Ah ! n'encouragez pas trop chez l'enfant les passions précoces,
ces passions fûssent-elles les plus hautes et les plus nobles
; faites qu'il reste enfant le plus longtemps possible. « Un enfant
sans innocence est une fleur sans parfum », a dit Châteaubriand.
Si vous voulez que la fleur sente bon, laissez-la au jardin ; si vous
voulez que l'enfant reste pur, ne l'arrachez ni à son milieu
ni aux jeux de son âge, et gardez-vous de le livrer trop tôt
aux émotions de la vie, et à ses désillusions.
Ernest Laut
Le Petit Journal illustré du 8 Mars 1914