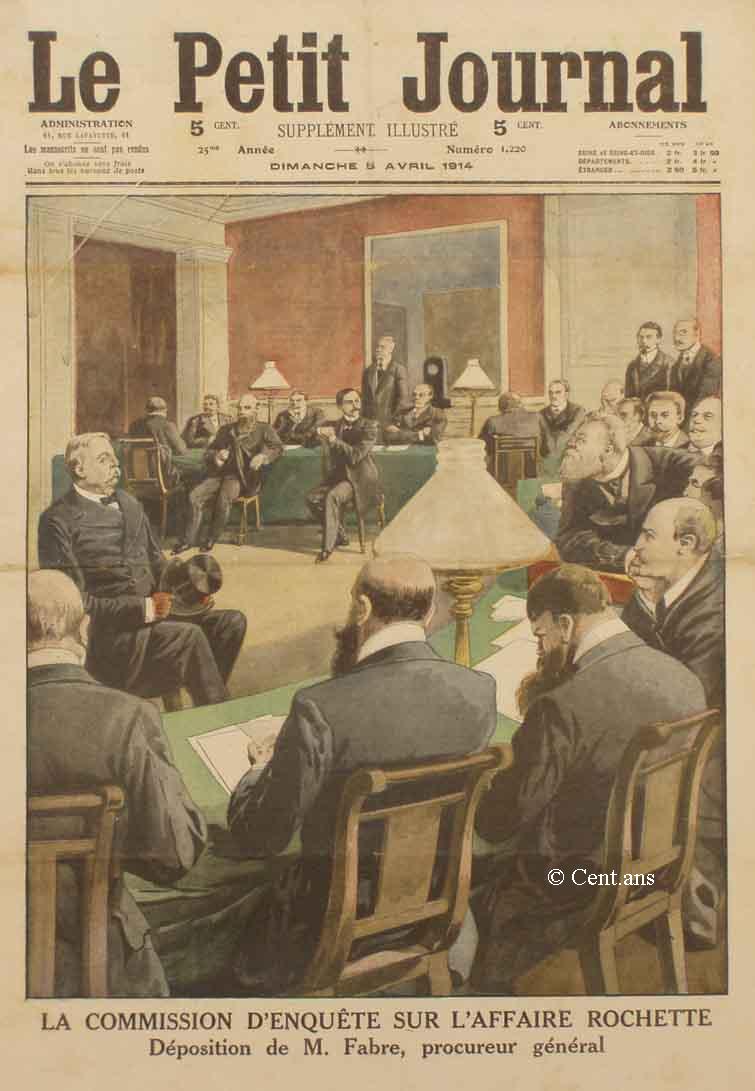LA COMMISSION D'ENQUÊTE
SUR L'AFFAIRE ROCHETTE
Déposition de M. Fabre, procureur général
A. la suite de l'assassinat de M. Calmette,
un document secret fut produit à la Chambre par M. Barthou, document
dans lequel M. Victor Fabre, procureur général, avait
consigné, en 1911, les pressions dont il déclarait avoir
été l'objet de la part de M. Monis, alors président
du Conseil, sur les instances de M. Caillaux, en faveur du financier
Rochette.
C'est la production de ce document qui a fait reprendre, l'enquête
sur cette affaire Rochette, dont les péripéties politico-financières
ont, depuis six ans, troublé tant de fois l'opinion publique.
Et, devant la commission parlementaire, nommée il y a quatre
ans déjà, sous la présidence de M. Jaurès,
la dite enquête a repris son cours, afin de rechercher quel fut
exactement le rôle des hautes personnalités du Parlement
visées dans le rapport du procureur général.
Un des membres de la commission, M. Maurice Barrès, nous donne
la physionomie une de ces séances.
« Nous siégeons, écrit-il, dans un des bureaux où
se réunissent les commissions ordinaires, une pièce assez
haute, assez grande, dont les deux larges fenêtres donnent sur
le jardin intérieur du Palais-Bourbon. Une table à tapis
vert, en forme de fer à cheval l'occupe entièrement. Nous
nous asseyons tout autour au hasard de notre arrivée et chacun
a devant soi du papier, de l'encre, des plumes...
» A chaque fois qu'un témoin est introduit, tout le monde
se lève. Le président lui adresse un mot de courtoisie
et, en face de lui, l'invite à s'asseoir entre les deux branches
que dessine notre table. Le témoin parle sans que personne l'interrompe.
Ceux des commissaires qu'une phrase met en éveil, d'un geste
se font inscrire. Quand le témoin a cessé de parler, le
président procède à l'Interrogatoire, puis selon
l'ordre d'inscription donne à chacun de ses collègues
la parole. Et pour finir, après un remerciement du président,
chacun s'étant de nouveau levé, le témoin se retire.
»
Telle, est la procédure de ces séances. Tout se passe
là froidement, dignement, parlementairement. Mais que d'agitations
se manifestent au fond des consciences, que d'émotions contenues
se lisent parfois sur les visages. Et quel drame profond se joue sous
cette apparence de solennité parlementaire.
VARIÉTÉ
Au temps des Chicards
Les bal masqués de l'Opéra, - Leur origine et
leur histoire. - Musard et son orchestre. - Chicards et Débardeurs.
- Les Clodoches. - Où sont les folies d'antan ?
On tente en ce moment de faire revivre les bals
masqués de l'Opéra. Y réussira-t-on ? C'est possible.
Paris a perdu depuis assez longtemps la tradition de ces redoutes bruyantes
et tumultueuses pour que le goût lui en puisse revenir.
Car il en est des modes de divertissement comme de toutes choses en
ce monde. Tout passe, tout lasse. Après le succès vient
la satiété. Que de plaisirs qui faisaient la joie de nos
aïeux et qui nous semblent aujourd'hui fastidieux ! Mais ces mêmes
divertissements du passé renaîtront quelque jour prochain
peut-être et amuseront nos fils.
Cependant, une raison semble rendre douteux le succès de la tentative
actuelle. Les danses à la mode en ce moment ne sont pas des danses
gaies. Avez-vous vu danser le tango? Il paraît que c'est voluptueux.
Je n'en sais rien ; ça me fait surtout l'effet d'être compliqué
et pas mal ennuyeux. Les gens qui dansent ça ont tous un pli
au front. Çà m'a tout l'air d'être pour eux un travail
bien plus qu'un plaisir. Ils paraissent avant tout préoccupés
de ne pas s'embrouilles dans leurs pas.
Eh bien, on ne fait pas un bal gai avec des danses tristes, avec des
danses lentes aux rythmes complexes et savants. Sébastien Mercier
raconte que, sous le Directoire, on dansait de telles danses, et que
des hommes avaient tous en dansant « un air froid, triste et morose
» ; et puis un beau jour, un certain M. de Trénis rapporta
d'Allemagne une danse voluptueuse et entraînante à la fois
: la valse. Et dès lors, les bals qui étaient, auparavant,
peu fréquentés et vides d'agrément, s'emplirent
d'une foule ardente et pleine d'entrain.
La foule ne va pas au bal uniquement pour regarder danser ; elle veut
entrer dans la danse ; sinon elle ne tarde pas à s'ennuyer. Or,
avec des danses compliquées et froides, on n'aura comme danseurs
que des professionnels ; et la foule, une fois sa curiosité satisfaite,
ne reviendra plus.
C'est pourquoi il me semble que si l'on veut faire revivre les joyeux
bals masqués du Second Empire, il importe avant tout de remettre
à la mode les danses faciles bien rythmées, des danses
à la portée de tout le monde, et les joyeux quadrilles
avec leur galop infernal.
***
Cet essai de renaissance des bals masqués de l'Opéra fait
évoquer bien des souvenirs du passé. C'est toute la joyeuse
vie parisienne d'autrefois qui revit dans ces souvenirs.
Savez-vous qu'il y a près de deux siècles que fut créée
cette tradition du Paris qui s'amuse. C'est en 1715 que le comte de
Bouillon proposa au Régent d'organiser trois fois la semaine
dans la salle de l'Opéra des bals masqués ou non masqués.
Il s'agissait de faire concurrence à tous les petits bals borgnes
qui s'étaient ouverts dans Paris et où se passaient constamment
des scènes et des aventures fâcheuses. Le Régent
trouva le projet de son goût et donna au comte de Bouillon six
mille livres pour qu'il le réalisât. « On fit, dit
Saint-Simon, une machine d'une admirable invention et d'une exécution
facile et momentanée, pour couvrir l'orchestre et mettre le théâtre
et le parterre au même plain-pied et en parfait niveau. »
On sait que l'Opéra était alors au Palais Royal : le Régent
venait au bal en voisin, à la suite de ses petits soupers. Mais
il ne voulait pas être reconnu ; et, non content de porter un
masque, il demandait à ses familiers d'éviter toute marque
de respect qui pût déceler sa vraie personnalité.
C'est à ce propos que Chamfort raconte l'anecdote que voici:
« Le Régent voulait aller au bal et n'y pas être
reconnu « J'en sais un moyen », dit l'abbé Dubois
; et, dans le bal, il lui donne des coups de pied dans le derrière.
Le Régent qui les trouva trop forts, lui dit :
« L'abbé, tu me déguises trop ».
Pendant tout le dix-huitième siècle, la tradition des
bals de l'Opéra se poursuivit avec des fortunes diverses. La
Révolution l'abolit comme elle abolit toutes les joies du passé.
La carmagnole avait remplacé les grâces du menuet ; et
la carmagnole se dansait surtout dans la rue.
La fin du Directoire vit renaître les fêtes chorégraphiques
de l'Opéra. Mais sous l'Empire les bals furent clairsemés.
Tous les jolis danseurs étaient à l'armée ; et
Napoléon les avait bien plus habitués à la musique
des canonnades qu'à celle des orchestres joyeux.
La pudibonde Restauration n'encouragea guère ces sortes de fêtes.
Mais voici Louis-Philippe ; et les bals de l'Opéra vont rentrer
en faveur. De 1830 jusqu'à la fin de Empire, c'est une période
presque ininterrompue de succès.
Il est vrai qu'il y a Musard, le grand Musard, le chef d'orchestre abracadabrant
qui invente les danses les plus effrénées, les galops
les plus extraordinaires, Musard qui imagine les moyens les plus extravagants
pour entraîner les danseurs et rendre contagieuse la folie du
plaisir.
En 1837, Mme de Girardin, dans ses Lettres Parisiennes, reproduisit
ces lignes que lui écrit une amie qui sort du bal de l'Opéra.
« C'était une fête dont rien ne peut donner l'idée.
Six mille personnes dans la salle, et deux mille à la porte qui
n'ont pu entrer. Toutes les loges prises ; celles du roi, de M. le duc
d'Orléans, envahies par des gens qui ne savaient où se
réfugier. Les costumes les plus pittoresques, les danses les
plus vives les plus passionnées. La police point taquine, et
pas le moindre désordre ; mais ce qu'il y a de plus remarquable,
l'événement de la nuit, c'est le triomphe de Musard porté
sur les épaules de six des plus beaux danseurs, et promené
dans toute la salle, aux acclamations, aux applaudissements de toute
la foule. La figure de Musard était rayonnante : c'était
le roi des Ribauds... »
Il est vrai que tout ne se passait pas toujours aussi bien. La même
Mme de Girardin reproduit, à propos d'un autre bal une lettre
encore qui donne une note toute différente:
C'était une cohue épouvantable : on ne comprend pas qu'on
puisse s'amuser à de pareils plaisirs. Il y a eu bien des batailles
où l'on courait moins de dangers. Un jeune homme est tombé
au milieu du galop, et tout le galop lui a passé sur le corps
; on l'a relevé dans un état affreux ; puis les danses
les plus scandaleuses, un désordre effroyable. J'ai eu pour ma
part un pan de mon habit emporté... »
A la vérité, je crois que ce second tableau devait être
plus exact que le premier et que les bals de ce temps-là devaient
tourner souvent en cohues et en saturnales. C'était là,
d'ailleurs, l'objectif de Musard qui s'ingéniait, de mille façons,
à surexciter les nerfs des danseurs.
Chose curieuse, ce grand amuseur, ce surprenant entraîneur de
foules, était un petit homme d'aspect triste et falot.
Théophile Gautier, dans un de ses feuilletons, nous le montre
« morne, livide et grêle ».
« Certes, dit-il, il est difficile pour un prêtre de la
bacchanale d'avoir une figure plus sombre et plus sinistre : cet homme
qui verse la joie et le délire à tant de folles têtes,
a l'air de méditer une suite aux Nuits, d'Young, ou
aux Tombeaux, d'Harvey... Après cela le plaisir qu'on
donne on ne l'a plus ! Et c'est sans doute ce qui rend les poètes
comiques si mornes... »
L'observation est d'une incontestable justesse. Il semble de plus souvent
qu'à amuser autrui on perde sa propre gaîté.
Cependant, un geste de Musard, ce petit homme piteux, suffisait à
déchaîner la folie.
Écoutons encore Théophile Gantier :
« Le moment venu, Musard se courba sur son pupitre, allongea le
bras et un ouragan de sonorité éclata soudainement dans
le brouillard de bruit qui planait au-dessus des têtes; des notes
fulgurantes sillonnaient le vacarme de leurs éclairs stridents,
et l'on aurait dit que les clairons du Jugement dernier s'étaient
engagés pour jouer des quadrilles et des valses. Les morts danseraient
à une pareille musique... »
C'était, en effet, un étonnant orchestre que cet orchestre
de Musard : il comptait une soixantaine de violons, des altos, des violoncelles
et des contrebasses en proportion; mais que de cuivres !... Quinze cornets
à piston, douze trombones... Jugez du vacarme quand tout cela
soufflait à pleins poumons.
L'imagination de Musant y ajoutait des effets inattendus. C'est ainsi
qu'au milieu d'une contredanse endiablée, on entendait tout à
coup le fracas de plusieurs chaises qu'on brisait en mesure sur la scène,
ou qu'une pétarade de coups de pistolet éclatait soudain
à l'attaque du galop final.
Musard amena même un jour un petit canon qui fit sa partie dans
l'orchestration de la bacchanale.
« Figurez-vous, raconte encore Théophile Gauntier, qu'il
a imaginé une contredanse intitulée le Chemin de fer
; elle commence par l'imitation de ces horribles coups de sifflet qui
annoncent le départ des convois. Le râle des machines le
choc des tampons, le remue-ménage des ferrailles y sont parfaitement
imités. Vient ensuite un de ces galops pressés haletants,
près desquels la ronde du sabbat est une danse tranquille...»
Et le poète, après-avoir décrit le tableau de la
foule qui braille, hurle,tourbillonne au son de cette infernale musique,
après avoir décrit les heurts, les chutes, les écrasements
impitoyables, conclut :
« Ce n'est donc qu'à ce prix qu'on s'amuse aujourd'hui.
Il faut, à force de gambades, de cabrioles, de dislocations extravagantes,
de hochements de tête à se casser le col, se procurer une
sorte de congestion cérébrale ; cette ivresse de mouvement
ou de délire gymnastique a quelque chose d'étrange et
de surnaturel;. On croirait voir des malades attaqués de la chorée...
»
***
Oui, c'est ainsi qu'on s'amusait au bal masqué sous le règne
du roi-citoyen.
Et le carnaval de cette époque n'a pas eu que sa musique ; il
a eu aussi ses costumes, déguisements pittoresques, originaux,
nés de la fantaisie d'un des plus grand artistes de ce temps
: Gavarni.
Chicards, flambards, débardeurs, tout cela est sorti du crayon
de Gavarni. « C'est au bal des Variétés, nous dit
Sainte-Beuve, que s'est produit d'abord. dans toute sa nouveauté
et sa fureur, le débardeur svelte, alerte, découplé,
déluré, en chemisette bouffante de satin blanc : tous
les beaux d'alors, la jeunesse à la mode en arboraient la livrée...
»
Simple, mais combien élégant le débardeur de Gavarni
: un large pantalon de velours laissant voir la cheville et découvrant
un soulier mignon, une chemisette de soie, une ceinture rouge flottante,
un petit bonnet de police incliné sur une perruque touffue :
voilà tout. Et ce charmant costume avait l'avantage de convenir
également à l'un et l'autre sexes.
C'est qu'en ce temps-là on ne se contentait pas d'aller au bal
masqué en habit avec un simple flot de rubans à la boutonnière.
Tout le monde, ou presque, était costumé ; tout le monde
jouait son rôle dans la pièce : tout le monde était
à la fois acteur et spectateur.
Et ce peuple de viveurs avait ses reines : Pomaré, Mogador, qui
devint comtesse et femme de lettres, Rigolboche dont Ludovic Halévy,
qui l'avait connue, disait :
« C'était une véritable artiste, une grande danseuse.
Elle était absolument le Débardeur de Gavarni. Sa danse
était la chose du monde la plus audacieuse et la plus fantaisiste.
C'était bien le cancan, mais, non le cancan brutal et violent
des bals de barrière... C'était d'ailleurs, ajoutait-il,
une personne très intelligente. »
***
Pendant la première partie du second Empire, les bals de l'Opéra
ne furent ni moins brillants ni moins pittoresques que sous le règne
de Louis-Philippe. Ce fut l'époque du fameux quadrille des Clodoches.
Ce quadrille apparut pour la première fois au bal de l'Opéra,
en 1856. Clodomir Ricart, dit Clodoche, le meneur de la bande, avait
un costume de gendarme d'une extravagante fantaisie : des bottes à
l'écuyère qui lui montaient jusqu'au ventre, des gants
à crispin qui lui allaient jusqu'aux coudes, un immense bicorne
en bataille. Il conduisait une plantureuse pêcheuse de moules
en grand bonnet cauchois, Quant à son partenaire, vêtu,
d'un extraordinaire costume de pompier, il donnait le bras à
une super nourrice normande.
L'orchestre attaqua un quadrille ; et le quatuor se mit à danser,
à bondir, à gesticuler avec un tel ensemble et une telle
fantaisie que la salle entière l'acclama. Dès lors, il
n'y eut plus de donne fête chorégraphique sans les Clodoches
, et les autre gaillards, qui n'étaient autres que de braves
lurons échappés d'un atelier du faubourg Saint-Antoine,
connurent, du jour au lendemain, toutes les joies de la grande notoriété
parisienne.
Mais ce furent là les derniers jours éclatants du bail
de l'Opéra. Bientôt, on commence à négliger
le déguisement, on va au bal en habit. Plus de costumes originaux
et fantaisistes ; le domino domine. En 1865, Théophile Gautier
le remarque avec regret :
Bientôt, il nous faudra pendre au clou
dans l'armoire
Ces costumes brillants de velours et de moire.
Le carnaval déjà prend pour déguisement
L'habit qui sert au bal comme à l'enterrement.
Il montre le Parisien,
Allant à l'opéra grave, en cravate blanche
C'est fini on ne va plus au bal pour s'amuser,
mais pour voir s'amuser les autres. Dès lors, le bal masqué
se meurt comme d'ailleurs se meurt le carnaval. Nos tristesses de 1870
lui donnèrent le dernier coup.
Et, depuis une quarantaine d'années, tous les efforts tentés
pour ranimer la tradition défunte ont échoué. Musard
n'est plus, ni Strauss, ni Pilodo ; toutes leurs folies orchestrales
sont oubliées. On ne sait Talus le quadrille ; et le cancan de
nos père apparaîtrait à la jeunesse d'aujourd'hui
comme un galop naïf et sans charmes.
On est allé chercher dans les pays exotiques des tas de danses
lentes, graves et compliquées comme des problèmes de mathématiques.
Les bals masqués sont morts d'une sorte de maladie de langueur
; et ce n'est point, à coin sûr, le peuple de neurasthéniques
que nous sommes qui leur rendra la vie.
Ernest LAUT.
Le Petit Journal illustré du 5 avril 1914