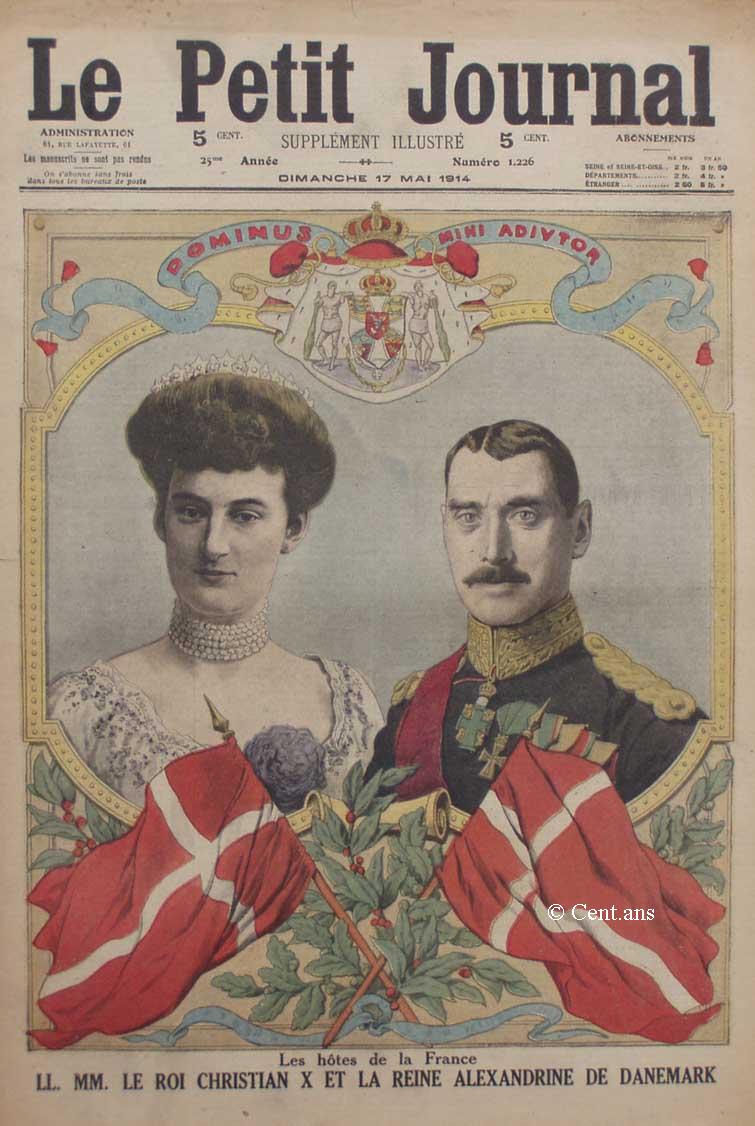LES HÔTES DE LA FRANCE
LL. MM. LE ROI CHRISTIAN X ET LA REINE ALEXANDRINE DE DANEMARK
Les visites royales se succèdent à
Paris. Hier c'étaient les souverains d'Angleterre que nous acclamions
; demain, le roi et la reine de Danemark seront les hôtes de notre
capitale.
Le roi Christian X a succédé, en 1912, à son père
Frédéric VIII, mort tragiquement, on s'en souvient, en
pleine rue à Hambourg. Il est le petit-fils de ce bon roi Christian
IX qu'on appelait le beau-père et le grand-père de l'Europe,
et qui mourut au mois de janvier 1906.
Christian X, né le 26 septembre 1870, a l'allure jeune et paraît
à peine ses quarante-quatre ans. Il a épousé, en
1898, sa cousine Alexandrine, duchesse de Mecklembourg.
Le Danemark est un des pays d'Europe où l'esprit français,
la civilisation française sont le plus estimés. Tout Danois
éduqué parle notre langue. Le peuple est instruit, sobre,
travailleur. « La civilisation du Danemark, disait un Français
qui venait de visiter ce pays, c'est son instruction, une instruction
générale qui luit même dans la demeure de chacun
des paysans ; c'est plus que cela encore : c'est l'instinct de son honneur
national, l'aspiration à la liberté, à la dignité,
à la bravoure sur terre et sur mer... »
Car le peuple danois est resté un peuple de vaillants soldats
et de hardis marins.
Il a gardé la tradition de ces glorieux aventuriers d'autrefois,
des Lodbrog, des Hastings, des Rollon, qui se lançaient sur leurs
frêles navires à la conquête de l'Europe, et chantaient
dans la tempête, se riant des vents et des flots. Mais ses aptitudes
militaires et maritimes n'ont pas étouffé en lui d'autres
aspirations. Le Danemark a des illustrations nombreuses dans la science
et dans l'art. Tous les voyageurs qui l'ont visité, même
au temps où le niveau intellectuel de Europe n'était pas
ce qu'il est aujourd'hui, ont constaté qu'il tenait une place
enviable au point de vue de la civilisation.
Paris rendra hommage aux vertus du peuple danois en acclamant les augustes
souverains qui viennent le représenter parmi nous.
VARIÉTÉ
LES PARIAS D'AUTREFOIS
C'étaient les lépreux. - Un fléau qui reparait. - L'origine de la lèpre. - Le code du lépreux. - Une singulière méthode de diagnostic.
Ces parias d'autrefois, c'étaient les
lépreux, ces malheureux, atteints d'une incurable maladie, et
qu'on obligeait, de ce fait, à vivre en dehors de la société.
Or, depuis le XVIIe siècle, la lèpre avait à peu
près disparu de l'Europe. Mais voilà qu'elle fait chez
nous un retour offensif. A la dernière séance de l'Académie
de médecine, ne fut-il pas question de rétablir, comme
au moyen âge, des léproseries ? C'est le cas où
jamais de dire que le monde est un éternel recommencement.
A la vérité - qui le croirait ? - il y eut toujours des
lépreux à Paris ; mais naguère, et il y a une vingtaine
d'années encore, on n'en comptait pas plus d'une cinquantaine
pour une population de trois millions d'habitants. On en compte aujourd'hui
plus de trois cents, et à peu près autant dans le reste
du pays, notamment dans les Alpes, en Bretagne et en Auvergne.
Six cents lépreux pour toute la population française :
il n'y a pas là de quoi nous alarmer. Mais tout de même,
c'est six cents de trop. Il est inouï qu'en notre siècle
d'hygiène nous puissions avoir encore quelque chose à
craindre de cette maladie qui rappelle les plus tristes jours du temps
passé.
***
La lèpre fut avec la peste un de ces « maux sataniques
», une de ces « verges de Dieu » qui terrorisèrent
nos pères.
Michelet, qui eut quelquefois la faiblesse de subordonner son génie
d'historien à l'esprit de parti, en attribue la diffusion à
la malpropreté entretenue au moyen âge par les lois ecclésiastiques
». Or, Michelet se trompe ou nous trompe. Tout le monde sait aujourd'hui
que le moyen âge fut une époque de propreté, et
que les lois de l'Église, loin d'interdire le bain, en imposaient
la pratique régulière dans les monastères.
La lèpre ne put donc naître de la saleté du moyen
âge. Et ,cette saleté eût-elle même existé
que la lèpre n'eût pu en résulter puisque l'origine
de cette maladie se perd dans le passé le plus lointain. La lèpre
exista de toute antiquité en Orient, et nul n'ignore que les
Hébreux la rapportèrent de leur captivité en Égypte.
Moïse, qui fut un grand hygiéniste, avait pris contre la
lèpre des précautions que les gens du moyen âge
ne firent que renouveler. On trouve dans des livres une description
très minutieuse de la maladie, de des symptômes et de ses
manifestations. Cette description avait pour but d'éclairer les
prêtres qui étaient chargés d'examiner les malades
soupçonnés d'avoir la lèpre, et de prononcer sur
leur expulsion et sur leur séquestration. L'individu atteint
du terrible éléphantiasis était déclaré
impur et chassé du camp tête nue, et la bouche couverte
d'un voile. Il devait rester séquestré jusqu'à
ce que le prêtre chargé de l'examiner l'eût reconnu
guéri. Alors, on. faisait sur lui des offrandes expiatoires.
Tant que la guérison n'était pas définitive, le
malade demeurait absolument isolé.
C'est en somme l'unique moyen de prophylaxie qu'employèrent plus
tard nos aïeux du moyen âge : l'isolement, système
renouvelé des Hébreux.
Mais, comme, bientôt, le nombre des lépreux alla croissant
dans des proportions considérables, il fallut créer, aux
environs de chaque agglomération, de véritables villages
d'isolement.
Ce fut l'origine des léproseries.
Car il ne faudrait pas s'imaginer que les léproseries furent,
à l'origine, des hôpitaux organisées non seulement
pour recueillir, mais encore pour soigner les malheureux atteints de
la terrible maladie pas du tout ! ce furent tout simplement des réunions
de huttes misérables dans chacune desquelles croupissait un de
ces maudits, et où les lépreux étaient tout vivants
mis au tombeau.
On choisissait aux alentours des villes un terrain assez vaste qu'on
entourait de murs ou de haies. On y élevait une chapelle, on
y ménageait un cimetière destiné ,uniquement aux
lépreux. Quelquefois la munificence d'un seigneur ou d'une municipalité
permettait d'y bâtir un logis de quelque importance, où
les malades de condition trouvaient asile ; quant aux malades pauvres,
ils étaient logés dans des cabanes, que, le plus souvent,
ils étaient obligés d'élever de leurs mains. Aux
abords de la maison principale, on creusait un puits que le prêtre
bénissait ; autour des maisonnettes on ménageait un petit
espace de terrain que le lépreux cultivait. Et c'est dans cet
enclos que les malheureux étaient condamnés à passer
le reste de leur existence.
Les lépreux, une fois relégués dans la léproserie,
devaient en sortir le moins possible. Le dimanche seulement, quelques
uns d'entre eux se tenaient dans une logette placée au bord de
la route, à l'entrée de la maladrerie. De là, ils
voyaient venir les promeneurs et, à l'aide d'une cliquette, ils
attiraient leur attention et sollicitaient leur charité.
C'étaient là tous leurs rapports avec l'extérieur.
Pour le reste, les léproseries devaient, dans la mesure du possible,
se suffire à elle-mêmes. On y élevait des bestiaux
pour la consommation exclusive des lépreux. Il était,
d'ailleurs, interdit aux bouchers de la ville d'acheter des bêtes
élevées dans les maladreries. Les lépreux faisaient
eux-mêmes leur pain, récoltaient leur froment, leurs légumes.
Quant aux rares objets qu'ils devaient se procurer hors de la léproserie,
le soin de les acheter et de les apporter dans l'enclos maudit était
commis à des religieux de l'ordre de Saint-Lazare, Soeurs et
Frères convers, qui, revêtus du même costume que
les lépreux, portaient sur la manche de leur robe un morceau
de drap rouge qui permettait aux passants de les reconnaître à
distance et de s'éloigner d'eux.
Cependant, comme il n'était pas possible, sauf dans certaines
léproseries considérables et dotées de revenus
importants, de séquestrer complètement et pour l'éternité,
les lépreux dans leurs maladreries, l'autorité leur permettait
de sortir à certains jours et à certaines heures, mais
exigeait d'eux maintes précautions que, nous trouvons. résumées
dans le cérémonial de la séquestration des lépreux.
Les détails de ce cérémonial, tels qu'ils figurent
dans les chroniques du moyen âge, ont été reproduits
en 1877 par M. Salètes, dans une thèse sur la lèpre.
Dès que la maladie était constaté, quelle que fût
la situation sociale du malade, l'official diocésain décidait
la séquestration et le curé de la paroisse l'annonçait
au prône.
Le dimanche suivant, le lépreux, vêtu de noir, se présentait
à la porte de l'église. Le prêtre, en pompe, précédé
de la croix et du bénitier, allait l'y chercher et commençait
par l'inonder littéralement d'eau bénite.
Cela fait, il l'amenait dans le sanctuaire, à une place réservée
et enclose de barrières, puis il célébrait une
messe du Saint-Esprit à. laquelle s'ajoutait une oraison spéciale
de circonstance : l'oraison pro infirmis.
La messe dite, le lépreux était conduit professionnellement
à la maladrerie et introduit dans la cabane qui lui était
réservée. Pour lui bien signifier qu'il devait se considérer
comme inhumé tout vif, on allait prendre, dans le cimetière,
de la terre qu'on jetait sur le toit de la cabane en criant au malheureux
qu'on allait abandonner des paroles latines qui signifiaient «
Sois mort pour le monde et n'aies plus d'espoir de revivre qu'en Dieu
». Après quoi, le prêtre ayant récité
les litanies, remettait successivement au malade divers objets dont
il ne devait plus se séparer une cliquette pour annoncer sa présence
; des gants pour éviter de répandre la contagion par le
toucher de ses mains ; enfin, une panetière pour recevoir les
aumônes.
Il lui résumait ensuite ce qu'on pourrait appeler le code du
lépreux, lui faisant défense expresse :
« D'entrer désormais ès églises, moulins,
fours ou marchés, ny de se trouver ès assemblées
du peuple ;
» De ne jamais se laver les mains ny chose aulcune qui soit à
son usage, ès fontaines, rivières ou ruisseaux qui servent
au public ;
» D'aller déchaussé hors de la maison ny sans habits
de lépreux (c'est-à-dire en robe noire et la bouche voilée),
et ses cliquettes afin d'estre recognu d'un chacun ;
» De toucher, quelque part qu'il se trouve, aucune chose qu'il
voudra achepter, sinon avec une verge où baston ;
» D'entrer, aux tavernes ny autres maisons, sous quelque prétexte
que ce soit ;
» De répondre sur les chemins à ceux qui l'interrogeraient,
s'il n'est hors et au-dessous du vent, de peur qu'il n'infecte les passants
;
» De passer par les chemins étroits, pour obvier aux rencontres
contagieuses ;
» S'il est contraint de passer l'eau, de toucher les pieux et
autres instruments qui servent à cet effet sans avoir premièrement
mis ses gants ;
De toucher aucunement les petits enfants ny leur donner aucune chose
ny à quelque autre personne que ce soit ;
» De boire ny manger en compagnie, sinon de lépreux comme
lui. »
A toutes ces recommandations formelles le prêtre ajoutait quelques
paroles d'encouragement :
« Vous ne vous fâcherez pas, disait-il au lépreux,
d'être séquestré des autres, d'autant que vous aurez
votre part à toutes les prières de notre mère la
Sainte Église, comme si personnellement étiez tous les
jours au service divin avec les autres... Seulement prenez garde et
ayez patience, Dieu demeure avec vous. »
Et le malheureux n'avait plus qu'à suivre ces sages conseils
et à se résigner à sa douloureuse solitude,
***
C'était là à peu près tout ce que nos pères
avaient trouvé pour combattre la diffusion de la lèpre.
Ils isolaient le malade, ils le séquestraient. Quant à
le soigner, c'était une autre affaire. Jamais le fatalisme de
nos aïeux ne se manifesta plus nettement qu'en ce qui concerne
la prophylaxie de la lèpre. La tradition attribuait, depuis l'antiquité,
une origine quasi-surnaturelle à cette maladie ; il en résultait
chez nos pères une sorte de conviction que seule, l'intervention
divine pouvait guérir ceux que la colère divine avait
frappés. On se gardait donc de chercher d'autres remèdes
que l'isolement et la prière.
Cependant, en certaines provinces, on se préoccupa quelquefois
d'enrayer la diffusion de la maladie non pas seulement en supprimant
les dangers de contagion, mais encore en supprimant les chances d'hérédité.
C'est ainsi que le Parlement de Compiègne en l'an 757 déclara
nul tout mariage entre deux personnes dont l'une était atteinte
de la lèpre et autorisa la partie saine à contracter une
nouvelle union. C'est ainsi également qu'en Normandie, les descendants
des lépreux ne pouvaient recueillir la succession de leur père
et n'en avaient que l'usufruit.
Dans le pays de Galles, les lois destinées à empêcher
la diffusion de la lèpre par hérédité étaient
bien plus sévères encore. Le fils engendré après
l'envoi du père dans une léproserie était absolument
privé de son patrimoine. Quant à la femme lépreuse
qui avait un enfant après sa séquestration on la condamnait
à mort et on la brûlait vive.
En dépit de toutes ces précautions, la lèpre, au
cours de plusieurs siècles, dut prendre une extension considérable
si nous nous en rapportons au nombre des léproseries qui furent
crées en France.
Dès la fin du VIe siècle, on compte quelques-uns de ces
établissements. Ils se multiplient au VIII siècle. Mais
aux IXe et Xe siècles, la lèpre se répand tellement
qu'il faut ouvrir partout des maladreries. Toute ville, toute bourgade
même, a son refuge de lépreux. Au XIIIe siècle,
on évalue à 19.000 le nombre des léproseries répandues
par toute la chrétienté. Sur ce nombre, la France en compte
deux mille.
Je vous laisse à penser quelle formidable population de malades
abritaient ces nombreux asiles.
Il est vrai que s'il faut en croire certains chroniqueurs, les bénéfices
accordés par les rois, les seigneurs, les communes aux léproseries
y attiraient force gens qui n'étaient point lépreux et
n'avaient d'autre maladie qu'une paresse invétérée
et le désir de vivre sans travailler.
Peut-être vous souvient-il de l'amusante histoire de ce solliciteur
qui priait son député de lui faire obtenir une bonne place
d'aliéné. Eh bien ! au moyen âge il dut y avoir
des citoyens de cette espèce qui se faisaient recommander pour
obtenir une bonne place de lépreux.
Les léproseries étaient généralement riches
, on donnait beaucoup pour les lépreux. Leur costume même
était une recommandation à la charité publique.
Si bien qu'en certaines villes on accordait à des gens parfaitement
sains, et sympathiques au magistrat, le droit de s'habiller en lépreux
pour émouvoir plus sûrement la pitié des passants.
D'autre part, il n'était pas très difficile de se faire
passer pour lépreux. Ceux qui étaient chargés d'examiner
des malades et de prononcer leur séquestration, étaient,
en général d'une ignorance absolue sur les caractéristiques
de la maladie. C'étaient des prêtres et non des médecins.
En Hollande, savez-vous sur quelle expérience ils basaient leur
diagnostic ? Dans l'urine de la personne soupçonnée d'avoir
la lèpre, ils jetaient de la poudre de plomb brûlé.
Si la poudre allait au fond, pas de doute : la personne était
lépreuse, et on l'enfermait incontinent.
Si la lèpre devait nous revenir, j'aime à croire qu'on
y regarderait de plus près avant de claquemurer les gens.
Ernest LAUT.
Le Petit Journal illustré du 17 mai 1914