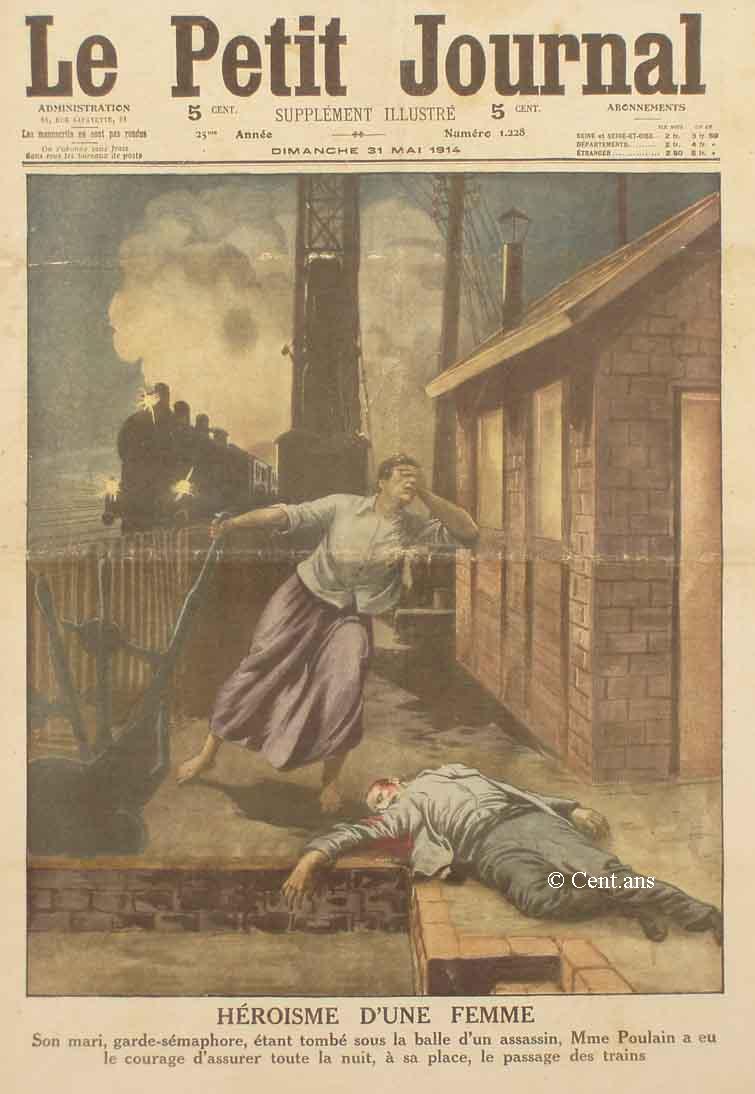HÉROÏSME D'UNE FEMME
Son mari, garde-sémaphore, étant
tombé sous la balle d'un assassin, Mme Poulain a eu le courage
d'assurer toute le nuit, à sa place, le passage des trains.
Nos lecteurs n'ont pas perdu le souvenir de Mme Matelot, cette femme
d'un gardien de phare, qui, son mari étant mort subitement, eut
la force de refouler sa douleur et de faire tourner, toute une nuit,
avec l'aide de ses enfants, la lanterne du phare.
C'est d'un héroïsme pareil qu'a témoigné Mme
Poulain, la femme du garde-sémaphore de la ligne du Nord qui
fut lâchement assassiné en pleine nuit, à son poste.
Tandis que son mari expirait à ses pieds, l'admirable femme songeait
que des trains allaient passer, remplis de voyageurs, et que, si le
geste nécessaire n'était pas fait pour leur donner la
voie, d'effroyables catastrophes pourraient en résulter.
Et, alors, elle aussi refoula sa douleur, et ne songeant qu'à
la sauvegarde des autres, elle saisit les leviers qu'elle voyait tous
les jours maniés par son mari, et elle donna le passage aux trains.
Au matin seulement un garde-sémaphore vint la relever de son
poste de dévouement. Toute la nuit, elle y était demeurée.
Il n'est point de récompense humain qui soit assez haute pour
payer de tels héroïsmes.
VARIÉTÉ
L'ABATTOIR
La reconstruction de la Villette. - Histoire des abattoirs. - La crainte du syndicalisme au XVlIe siècle. - Une réforme impériale. - Pitié pour les bêtes qu'on tue !
Le conseil municipal vient de s'occuper des
abattoirs de la Villette. Depuis huit ans déjà, il avait
décidé leur reconstruction, car ce n'est pas d'aujourd'hui
que ces abattoirs ne répondent plus aux besoins de l'alimentation
parisienne, et apparaissent, au double point de vue de l'hygiène
et du progrès, comme absolument indignes d'une capitale.
Mais, comme bien on pense, l'administration n'a tenu aucun compte des
voeux du conseil municipal, et la question des abattoirs reste toujours
pendante. C'est pourquoi nos édiles ont cru devoir, ces jours
derniers, lui rafraîchir la mémoire.
L'affaire en ira-t-elle plus vite ? Il est permis d'en douter. Songez
qu'il y a soixante ans que l'achèvement du boulevard Haussmann
a été décidé... et le boulevard Haussmann
n'est toujours pas achevé.
Au surplus, l'importante question d'hygiène publique qu'est la
question des abattoirs préoccupa moins encore nos aïeux
que les Français d'à présent. La grande cause de
leur indifférence en cette matière était leur parfaite
insensibilité en face de la souffrance des bêtes.
Ces Parisiens d'autrefois, qui prenaient plaisir à aller à
chaque fête de la Saint-Jean voir brûler vifs de malheureux
chats qu'on jetait dans le bûcher de la place de Grève,
ou qui, aux cabarets de la barrière du Combat, s'amusaient à
contempler le martyre d'un pauvre âne sur lequel on lançait
des molosses affamés, ces Parisiens-là s'inquiétaient
fort peu de voir les animaux destinés à leur alimentation
égorgés en pleine rue, devant la porte des bouchers.
Ceci vous explique qu'il n'y a pas même cent ans que Paris possède
des abattoirs.
***
Il est fort peu probable que de tels établissements aient existé
dans l'antiquité. Certains auteurs latins disent bien que les
bestiaux, à Rome, étaient abattus dans des locaux spéciaux
nommés lanienœ ; mais ces locaux n'étaient-ils
pas des tueries adjointes aux boutiques des bouchers plutôt que
des abattoirs ?
C'est ainsi qu'il en fut à Paris. jusqu'en 1818. Chaque boucher
avait sa tuerie et son échaudoir ; ceux qui n'avaient pas de
tuerie abattaient leurs bêtes sur la voie publique. Et l'on trouvait
cela tout naturel. Seul, à la fin du XVIIIe siècle, Sébastien
Mercier proteste contre ces pratiques abominables. « Le sang ruisselle
dans les rues, dit-il, il se caille sous vos pieds et vos souliers en
sont rougis. »
Je vous laisse à penser si cette multiplicité d'abattoirs
privés devait répandre l'infection par la ville.
Dès le Moyen-Age, les autorités communales essaient d'y
remédier. Elles demandent aux bouchers d'établir leurs
tueries hors des murs. Mais les bouchers sont organisés en une
corporation puissante. Ils refusent d'obéir. Pourtant, un certain
nombre d'entre eux consentent a s'établir sur la Seine et sur
la Bièvre. Ces deux rivières ne tardent pas à être
empoisonnées, par les déjections des boucheries ; et,
comme les riverains y puisent l'eau pour tous leurs besoins domestiques
et même pour la boisson, ils élèvent de telles protestations
qu'on se résout à laisser les bouchers tuer leurs bêtes
dans les cours de leurs maisons ou sur la voie publique. Résultat
: ce n'est plus le fleuve, c'est la rue qui est empoisonnée.
Les eaux sanguinolentes qui ont servi au nettoyage des issues coulent
au ruisseau, entraînent avec elles des débris de viande
qui pourrissent lentement au soleil. Le voisinage en est infecté.
Lisez les auteurs de mémoires du XVIIe et du XVIIIe siècles
tous s'accordent à répéter que Paris est inhabitable
l'été.
« Paris, dit la princesse Palatine, est un endroit horrible et
puant. Les rues ont si mauvaise odeur qu'on n'y peut demeurer. »
La pourriture du sang et des viandes jetés au ruisseau est une
des principales causes de cette puanteur. Il est non moins certain que
cet état de choses détermina la plupart des pestes et
des épidémies qui désolèrent Paris au temps
jadis.
Les autorités municipales s'en rendaient bien compte puisque
dans toutes les ordonnances prises par elles en temps de contagion se
retrouve cet article constamment répété : «
Défense de tuer bestiaux et pourchaux en la ville. »
En 1664, un hygiéniste - cet homme était évidemment
seul de son espèce en ce temps-là - se mit en tête
de débarrasser Paris de l'infection due aux résidus de
la boucherie. Il proposa d'élever, à ses frais, aux extrémités
des faubourgs Saint-Marcel, Saint-Germain, Saint-Honoré et Saint-Martin,
c'est-à-dire aux quatre points cardinaux de Paris, « de
gros bâtiments couverts pour y faire, par les bouchers, les tueries
de leurs bestiaux ». Il s'engageait, en outre, à ménager,
aux abords de ces bâtiments, de grands espaces libres, où
les bouchers pourraient acheter les bêtes qu'on leur amenait de
Bourg-la-Reine, de Poissy et du Bourget. C'était, en somme, le
procédé moderne : le marché aux bestiaux proche
du lieu d'abattage.
Dans sa pétition adressée au Parlement, ce novateur ne
réclamait, pour couvrir ses frais, qu'une légère
redevance sur le marché et sur l'abattage, à tant par
tête.
Une enquête fut faite, qui aboutit à des résultats
favorables ; des lettres-patentes furent accordées au pétitionnaire.
Mais la corporation des bouchers ne vit dans ce progrès qu'une
atteinte à ses privilèges. Et, comme elle était
forte et redoutée, elle s'opposa à sa mise en pratique.
Ce précurseur de nos modernes hygiénistes ne put réaliser
son généreux projet.
Sauvons du moins son nom de l'oubli il s'appelait Nicolas Rebuy.
***
Une trentaine d'années plus tard, l'idée fut reprise par
un traitant nommé Chandoré. Celui-ci proposait d'organiser
hors des murs, aux environs de la rivière, un abattoir au compte
du gouvernement. Il en eût été le fermier, et il
s'engageait à avancer au roi quatre cent mille livres en échange
de ce privilège.
Cette fois encore, les bouchers jetèrent feu et flamme pour empêcher
le projet d'aboutir. Et, chose inouïe, ils réussirent à
le faire rejeter après enquête.
Les raisons données de ce rejet étaient de la plus belle
extravagance.
On objectait d'abord que le transport des animaux à travers les
rues jusqu'à l'abattoir encombrerait trop la circulation.
Ensuite, on accueillait l'objection fournie par les bouchers eux-mêmes
: à savoir que l'adoption du projet leur porterait un grave préjudice
et les empêcherait d'exercer leur profession. Nous ne pourrons,
disaient-ils, être aux champs et à la ville, et surveiller
à la fois la vente dans notre boutique et les employés
chargés d'abattre les bestiaux hors des murs.
Enfin, et cette troisième raison était, vous l'allez voir,
d'un ordre bien différent : on faisait remarquer que chaque boucher
ayant quatre ou cinq garçons, généralement violents
et indisciplinés, il y aurait un grave danger pour la tranquillité
publique à leur permettre de se compter et de se réunir
au nombre de onze ou douze cents.
Les bouchers, à Paris, étaient, en effet, à cette
époque, bien près de trois cents. Et l'on voit par là
que si leur corporation se montrait singulièrement exigeante
et jalouse de ses prérogatives et de ses droits, elle redoutait,
par contre, de voir les garçons du métier s'unir, car
elle prévoyait, apparemment, que cette union commencerait par
exercer son action contre la puissance patronale.
Qui eût cru que, dès la fin du XVIIIe siècle, la
crainte du syndicalisme se fût manifestée à Paris
?
Bref, devant ce second échec, les projets d'un abattoir hors
murailles furent définitivement abandonnés. Et les tueries
particulières continuèrent d'ensanglanter et d'empoisonner
la ville.
Cependant, dès la fin du XVIIIe siècle, les plaintes commencèrent
à s'élever de toutes parts. L'été, au voisinage
des boucheries, régnait une puanteur effroyable. Des résidus
de viande corrompue qui pourrissaient dans les cours, s'échappèrent
des myriades de mouches vertes qui portaient l'infection dans le quartier.
On vit, à plusieurs reprises, dans les environs de certaines
boucheries, particulièrement malpropres, comme une sorte d'épidémie
de phlegmons et d'abcès causés par les piqûres de
ces mouches.
Les médecins de la ville, consultés sur l'origine de ces
maux, n'hésitèrent pas à les attribuer au mauvais
entretien des tueries privées.
Tant que les gens du bon ton n'étaient sortis qu'en chaise ou
en carrosse, les protestations contre la saleté des rues, ne
venant que du menu peuple, n'avaient guère ému la police.
Mais, après la révolution d'hygiène accomplie par
l'influence du médecin genevois Tronchin, les petites dames se
mirent à sortir le matin, en cotte courte et en souliers plats,
afin de « tronchiner », de marcher par la ville. Et il ne
leur fut guère agréable de patauger dans la boue des rues
toute rougie du sang des boucheries. Elles firent entendre force plaintes,
dont Mercier se fit l'écho dans son Tableau de Paris, comme nous
l'avons vu plus haut.
Cependant, rien n'y fit. Les bouchers étaient toujours les plus
forts. Il fallut arriver jusqu'aux premières années du
XIXe siècle pour que l'on songeât sérieusement à
reprendre les projets, abandonnés naguère, de Rebuy et
de Chandoré.
***
Dès le début du Consulat, Napoléon s'était
attaché à épurer Paris à tous les points
de vue. Les troubles révolutionnaires, la faiblesse du Directoire
avaient fait pulluler à Paris les malandrins de toute espèce.
En plein jour, on volait à main armée dans les rues. Bonaparte
mit ordre à cela. En moins de deux ans, la police débarrassa
la capitale de la horde de brigands qui la déshonorait.
Ayant rendu la sécurité à Paris, Napoléon
voulut lui assurer l'hygiène. Nombre de quartiers furent assainis
par l'élargissement des rues. Des industries malsaines furent
repoussées hors des murs. Mais la question des abattoirs restait
toujours pendante.
En 1808, le chroniqueur Nougaret le déplorait dans un article
des Aventures Parisiennes, article où, après avoir décrit
toutes les améliorations apportées au bien être
et à l'hygiène des Parisiens par la volonté de
l'empereur, il ajoutait :
« Mais il faut convenir qu'il reste encore, bien des choses à
faire pour l'embellissement et la salubrité de Paris. C'est avec
autant de dégoût que d'étonnement qu'on voit des
boucheries et des tueries dans plusieurs rues de cette capitale, infectée
par les miasmes qui s'en élèvent : les ruisseaux regorgent
de sang ainsi que les pavés, et l'on y pose le pied en frémissant
d'horreur. Ce n'est pas tout : souvent le boeuf qui va être frappé
du coup mortel brise ses liens et s'échappe avec fureur dans
les rues ; il court, brise, renverse tout ce qui se présente,
et foule souvent à ses pieds des femmes et des enfants. »
Napoléon se détermine à supprimer ces spectacles
scandaleux, malpropres, immoraux et dangereux. Mais, cette fois encore,
la corporation de la boucherie organisa la résistance. Il ne
fallut pas moins que trois décrets impériaux ( 9 février,
19 juillet 1810 et 24 février 1811) pour la réduire à
l'obéissance et imposer cette réforme si nécessaire
à l'hygiène et à la moralité de la capitale.
Ces décrets prescrivaient la construction immédiates de
cinq abattoirs à proximité des quartiers du Roule, de
Montmartre, de Popincourt, d'Ivry et de Vaugirard. Mais la boucherie
n'avait pas complètement désarmé ; et l'administration
semble avoir pris à tâche de desservir, à son profit,
les intérêts de la population. Les travaux marchèrent
avec une lenteur désespérante. L'empire était tombé
déjà depuis trois ans quand cette réforme impériale
fut enfin accomplie.
Les abattoirs ne furent ouverts qu'en 1818.
Détail digne d'être noté : ce progrès, comme
bien d'autres progrès, avait été réalisé
en province avant de l'être à Paris. De 1780 à 1812,
des abattoirs généraux avaient été établis
à Rochefort, à Blois, à Grenoble, à Orléans,
dans d'autres villes encore. La capitale, une lois de plus, n'avait
pas donné le bon exemple.
***
De ces premiers abattoirs parisiens, rien ne subsiste aujourd'hui. Ils
ont été remplacés, à partir de 1867, par
d'autres établissements plus considérables.
Ces établissements eux-mêmes ne sont certes pas à
l'abri des critiques. Tous ceux qui connaissent les abattoirs de la
Villette et ont visité également certains abattoirs de
l'étranger, notamment ceux d'Allemagne, vous diront que nous
sommes, ce qui concerne ces sortes d'établissements et surtout
sous le rapport de la propreté et des conditions d'hygiène,
dans un état de pitoyable infériorité vis-à-vis
de nos voisins.
Ils vous diront encore qu'à l'étranger on s'ingénie
surtout à éviter à l'animal, qui, doit être
sacrifié pour l'alimentation, les fatigues et les souffrances
inutiles. On sait que, selon l'expression de M. Jules Bluzet, l'auteur
d'un excellent ouvrage sur l'Enfer des Bêtes, on sait
que « le muscle qui travaille, la chair qui souffre et qui brûle,
la blessure ouverte, secrètent instantanément des poisons
violents (leucine, xanthine, créatinine, etc.). Or, ces poisons
restent dans la viande qui arrive sur nos tables. Nous les mangeons
en toute confiance, sans nous douter que nous avalons à la fois
des toxines redoutables et de masses de germes infectieux. Car, à
la faveur du surmenage, tous les microbes se mettent à pulluler
chez l'animal. »
Voilà pourquoi, en Allemagne on ne surmène pas l'animal
qui doit mourir ; on ne le frappe pas, on ne cesse pas de le nourrir
et de l'abreuver. On laisse même reposer les bêtes quelques
jours avant de les abattre. La qualité de la viande gagne.
Au contraire, allez donc voir dans nos abattoirs comment on traite les
bêtes destinées à l'alimentation. Vous serez édifié
et vous comprendrez pourquoi nous mangeons tant de mauvaise viande.
Nous avons, hélas ! supprimé maintes et maintes bonnes
traditions du passé. Pourquoi diable avons-nous si précieusement
conservé la plus mauvaise de toutes : l'insensibilité
de nos pères devant la souffrance des animaux
Ernest LAUT.
Le Petit Journal illustré du 31 mai 1914