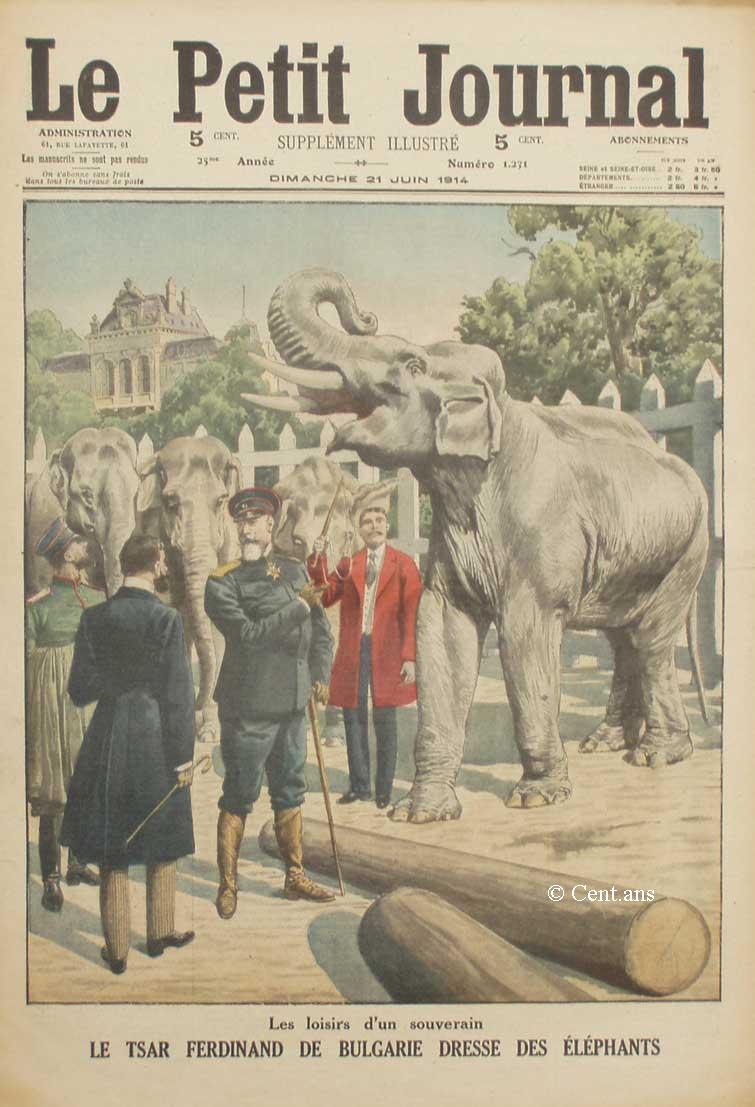LES LOISIRS D'UN SOUVERAIN
LE TSAR FERDINAND DE BULGARIE DRESSE DES ÉLÉPHANTS
Tous les souverains ont leur « violon
d'Ingres ». Le roi d'Angleterre collectionne les timbres-poste
; le Tsar de Russie fait de la culture, tient volontiers de ses mains
le manche de la charrue ; le roi de Suède fait de la peinture
; le roi d'Italie est un numismate des plus savants ; quant à
Guillaume II, tout le monde sait qu'il a maintes cordes à son
« violon d'Ingres »,et qu'il est tout à la fois peintre,
historien, orateur, critique, auteur dramatique et musicien.
Le passe-temps favori du tsar Ferdinand de Bulgarie est le plus original
de tous. Il consiste dans le dressage des éléphants. Le
tsar possède aux environs de Sofia un petit parc où vivent
en liberté quatre jolis éléphants qui lui appartiennent.
Il aime s'y rendre tous les matins et s'y divertit en faisant travailler
ces gros quadrupèdes comme un véritable dompteur de profession.
De temps en temps, le roi se plaît à inviter dans son cirque
les personnalités étrangères et offre, en leur
honneur, une représentation de « gala ».
VARIÉTÉ
La crinoline
Reviendra-t-elle à la mode ? - Son histoire. - Ses inventeurs. - Le bourreau-fabricant de crinolines. - De l'utilité de la jupe à cerceaux dans les accidents de voiture. - Pourquoi la crinoline a vécu.
C'est Voltaire, je crois bien, qui appelait la mode
... une déesse inconstante, incommode,
Bizarre dans ses goûts, folle en ses ornements,
Qui parait, fuit, revient et naît dans tous les temps...
On ne saurait en moins de mots la dépeindre
plus exactement. La mode, en effet, « paraît, fuit, revient
» sans cesse. C'est surtout en parlant d'elle qu'on peut dire
qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La mode d'avant-hier redevient
celle d'aujourd'hui ; la mode d'hier sera celle de l'avenir.
Ce qui caractérise la mode, c'est une véritable frénésie
dans l'incohérence. Depuis quelques années, les femmes
prenaient plaisir à s'entraver. Elles portaient des robes étroites
à tel point qu'elles me pouvaient plus marcher. Plus on raillait
cette mode et plus elles s'y obstinaient. A présent qu'on s'est
accoutumé à leurs petits pas d'oiseaux, voilà qu'elles
s'avisent de l'incommodité de leurs jupes. Mais, comme, en matière
de modes, la réaction n'est jamais raisonnable, soyez sûrs
qu'elles vont aller d'un extrême à l'autre.
Et, de fait, ne nous annonce-t-on pas le renouveau de la crinoline ?
Pourtant, de toutes les modes ridicules, en est-il une qui ait, plus
que celle-ci déchaîné les railleries ? A coup sûr,
il n'est pas une femme de ce temps-si qui, regardant des gravures de
modes d'il y a soixante ans, ne se soit écriée «
Dire que nos grands'mères s'habillaient comme ça !...
»
Eh oui, belle madame, vos grands'mères s'habillaient comme ça.
Et si la mode exigeait que vous fissiez comme elles, vous vous inclineriez
devant les volontés de la mode, car il n'est point de d'exemple
dans l'histoire que les femmes y aient résisté..
***
La crinoline n'est pas, comme on le croit généralement,
une création du second Empire. Elle eut, dans l'histoire de la
mode, deux ancêtres qui firent quelque bruit.
Les premières crinolines datent du règne de François
1er. Il y avait alors, à la cour du roi-chevalier, quelques dames
qui avaient les hanches mal faites. Pour dissimuler cette imperfection,
elles inventèrent le « vertugadin », par lequel elles
prétendaient donner de l'élégance à la taille
en arrondissant les hanches.
Afin de ne point laisser deviner la vraie raison de cette mode, elles
en firent honneur à leur modestie en l'appelant « vertugardien
». On en a fait vertugadin par corruption.
Or, le vertugadin n'était autre chose qu'une crinoline seulement
plus évasée aux hanches que celle qu'on porta sous Napoléon
III.
Cette mode, abandonnée pendant deux siècles, reparut sous
Louis XV, et apparemment pour la même raison. On lui donna le
nom de « paniers ». C'était là le nom d'un
maître des requêtes fort répandu dans le monde. Fut-il
l'inventeur ou plutôt le restaurateur de cette mode absurde ?
On ne sait. Toujours est-il que son nom y gagna une célébrité
qu'il n'eût point conquise sans cela.
La vogue des paniers est un des exemple les plus probants de la toute
puissance de la mode. Tout le monde les trouvait ridicules, incommodes.
Les femmes ne pouvaient plus monter en chaise à porteurs ; dans
les carrosses, elles tenaient toute la place au détriment de
leurs maris. Dans les salons, elles se gênaient mutuellement avec
les développements excessif de leurs jupes ; et, comme disait
plaisamment un écrivain du temps, la duchesse couvrait la marquise,
la marquise couvrait. la comtesse, la comtesse couvrait la baronne.
Les plus grands appartements devenaient trop étroits pour le
développement de ces énormes falbalas.
La commodité, les bon sens condamnaient les paniers ; bien mieux,
la religion tonnait contre eux. Les prédicateurs censuraient
de tout le pouvoir de leur éloquence ces accoutrements scandaleux.
A Saint-Sulpice, le père Bridaine, de sa voix de stentor, adjurait
ses pénitentes d'y renoncer si elles ne voulaient être
condamnées à aller expier leurs excès somptuaires
dans les flammes de l'enfer.
Qu'arrivait-il ?... Les belles élégantes, pour aller l'écouter
à l'église, mettaient de modestes robes plates sur les
hanches, mais dès qu'elles étaient rentrées au
logis, c'était à qui d'entre elles s'ornerait des plus
formidables paniers.
Tant il est vrai que le supplice des pires incommodités dans
ce monde et la menace des pires tortures dans l'autre, ne peuvent rien
contre les femmes quand les tient le démon de la mode.
***
La crinoline ne fut qu'un succédané du vertugadin et des
paniers. Comme son nom l'indique, la crinoline fut d'abord une étoffe
de crin dont le but était de soutenir les jupons balonnés.
Mais cette étoffe était lourde et dure ; je vous laisse
à penser quel poids devait être supporté par la
taille de nos aïeules, quand, par dessus cette jupe de crin, elles
superposaient trois ou quatre autres jupons raidis, amidonnés,
baleinés, afin de les faire tenir aussi raides que possible.
Pour obvier à cet inconvénient, l'industrie vint en aide
à la mode. Et l'on imagina de garnir les robes de ces dames de
légers cerceaux d'acier souple, disposés comme les cercles
des tonneaux. Ce fut le second aspect, l'aspect définitif de
la crinoline.
Quel fut l'inventeur de cet ingénieux procédé ?...
Deux hommes s'en disputèrent la gloire. Tous deux Français,
bien entendu il n'y a que des Français pour avoir ces idées-là.
L'un s'appelait Person. Commis dans un magasin de nouveautés
à l'époque où les femmes commençaient à
porter des jupes ballonnées, il s'avisa de disposer des cerceaux
dans la jupe. Il se fit même breveter pour cette invention, et
vendit son brevet 4.000 francs. Ce n'était guère, il faut
l'avouer, si l'on considère combien le procédé
fut exploité.
Mais Person fut-il vraiment l'inventeur ou fut-il l'unique inventeur
de la crinoline ?
Il y a trois ou quatre ans, mourait à Haboken, sur le fleuve
Hudson, en face de New-York, un vieillard de quatre-vingt-trois ans,
Français d'origine, qui s'appelait Joseph Thomas et qui affirmait
avoir été, sous l'Empire, le créateur de la jupe
à cerceaux.
Mécanicien de son métier, Thomas prétendait avoir
trouvé le premier le moyen de rendre flexibles des rubans d'acier.
L'application immédiate de son invention avait été
la création de la crinoline ; et les profits qu'il en avait tirés
lui avaient permis d'aller s'établir aux Etas-Unis, pays rêvé
des inventeurs.
Mais le grand fournisseur de crinolines, ce ne fut ni Perron, ni Thomas.
Ce fut... savez-vous qui ?... Je vous le donne en mille... Ce fut le
bourreau...
Le bourreau, en ce temps-là, s'appelait Heinderick. Il était,
lui aussi, mécanicien de son état. Et, comme Napoléon
III, bon rêveur et digne précurseur de nos humanitaires
d'aujourd'hui lui faisait des loisirs en graciant à tour de bras
les condamnés à mort. mort, Heinderick en profitait pour
arrondir ses revenus en travaillant de son métier. La vogue de
la crinoline lui ouvrit un débouché ; il en fabriqua des
quantités et fit une petite fortune.
Combien de nos grands'mères portèrent des crinolines faites
de la main du bourreau !
***
La « cage à poulets », comme on appelait alors la
crinoline, est donc d'origine française. C'est une des rares
inventions que l'étranger ne nous dispute pas ; et c'est pourtant
une de celles dont nous lui céderions volontiers l'honneur.
Mais le goût de la crinoline d'où nous vient-il ? On assure
que c'est d'Angleterre. La reine Victoria, au début de son règne,
aimait, paraît-il, à porter des bottes qui lui montaient
à mi-jambe. Toutes les dames anglaises, par loyalisme, voulurent,
comme elle, porter des bottes et les montrer. Elles adoptèrent
dans ce but une toilette spéciale : de petits festons, à
l'aide de cordonnets, relevèrent la robe sur un jupon en flanelle
rouge. Mais ce jupon, qui battait les jambes, fut trouvé gênant.
On imagina de le soutenir au moyen d'un autre jupon qu'on garnit d'abord
de baleines et qui, plus tard, par l'invention de Person ou de Joseph
Thomas, devint la classique crinoline.
Il ne faudrait pas croire que cette mode ait été acceptée
sans protestations et sans railleries. Il n'en est guère, au
contraire, qui ait inspiré plus de satires et plus de brocards.
On en parlait tellement, de la crinoline, elle était l'objet
de tant de discussions, que tout Paris, excédé, chantait,
vers 1865 :
Asseyez-vous d'ssus
Et puis qu'ça finisse !
Asseyez-vous d' ssus
On n'en parl'ra plus !
On continua cependant à en parler, car
cette vogue absurde ne dura pas moins de sept ans.
Enfin, la crinoline disparut et les gens de goût ne la regrettèrent
pas.
Mais il faut croire qu'elle n'était pas partie sans espoir de
retour. Il y a environ une dizaine d'années, elle tenta un retour
offensif. En Amérique, un mouvement se dessinait en faveur de
sa résurrection.
Or, ce mouvement était parti de Pittsburg ; et Pittsburg est,
comme chacun sait, le grand centre industriel de l'acier. On y voyait,
dans le retour de la crinoline et de son indispensable accessoire, la
jupe à cerceaux, une source. de fortune pour l'industrie locale.
Deux dames des plus élégantes de la société
de Pittsburg se dévouèrent pour essayer de lancer la restauration
de la crinoline. Elles sortirent en voiture, amplement crinolinées
et entreprirent une tournée à travers les principaux magasins
de la ville.
Mais, dès leur descente de voiture, la déconvenue commença.
La porte du premier magasin où elles se présentèrent
se trouva trop étroite pour leur rotondité exagérée.
Après de vains efforts, elles durent passer, par la porte cochère.
Mais la foule s'était assemblée, riant, criant, applaudissant
ironiquement les malheureuses, voulant entrer pour voir de plus près.
Pour éviter l'envahissement de son magasin, le marchand dut prier
les deux dames de s'en aller et fut obligé d'aller chercher la
police pour leur ouvrir un passage !...
La première tentative pour faire rentrer en faveur la crinoline
avait piteusement échoué.
Pourtant, le mouvement ne s'arrêta pas là. Il semble avoir
tenté de s'étendre dans les Etats de l'Union puisqu'un
peu partout il souleva des protestations. On vit même- chose inouïe
- la politique s'en mêler. Un sénateur américain,
M. Franck Smith, déposait ce projet de loi à Albany :
« Attendu qu'il est rapporté par la presse que la mode
des jupes à cerceaux est sur le point d'être rétablie
dans ce pays, ce qui ne peut manquer de causer de graves embarras et
inconvénients au public en circulation ou en voyage, et plus
particulièrement dans les temples, les théâtres
et autres lieux de réunion, et dans le but d'économiser
l'espace à l'Exposition universelle de Chicago et d'éviter
ainsi au gouvernement fédéral et aux divers Etats d'être
obligés d'accorder des crédits supplémentaires,
il est décrété qu'il serait illégal pour
qui que ce soit de vendre, prêter, donner ou fournir à
n'importe quelle personne dans l'État de New-York des jupes à
cerceaux, appelées vulgairement crinolines, et pour toute personne
de porter lesdites crinolines. En outre, les peines établies
pour les délits ordinaires s'appliqueront aux contraventions
à la présente loi. »
Comment la crinoline n'eut-elle pas cédé devant la menace
de telles sévérités ?
Cependant, bannie d'Amérique, la mode absurde tenta de passer
l'Océan. Partout elle trouva le plus disgracieux accueil. L'Angleterre,
qui en avait été pourtant l'initiatrice au temps de la
reine Victoria, avait, depuis lors, singulièrement changé
d'avis, car l'annonce d'un renouveau de la crinoline y souleva les indignations
féminines.
Les dames londoniennes allèrent jusqu'à créer une
No Crinoline league dont les membres s'engagèrent solennellement
à ne jamais porter la crinoline, qu'elle que pût être
sa forme rénovée, et même si Paris, Berlin et Vienne
l'accueillaient.
Paris, Berlin et Vienne, d'ailleurs, ne l'accueillirent pas plus que
Londres. Toutes celles qui l'avait connue et portée au temps
de leur jeunesse n'en avaient gardé que mauvais souvenirs qu'elles
évoquèrent à l'envi. Et je ne trouve guère,
parmi tant de diatribes, qu'un témoignage en faveur de la crinoline
: c'est une plaisante histoire qu'un lecteur alsacien racontait à
notre confrère l'Intermédiaire des Checheurs et des
Curieux.
« J'ai connu, disait-il, au temps de ma jeunesse, une dame, Mme
W..., flemme d'un chimiste de Strasbourg, laquelle a été
redevable à la crinoline de n'avoir pas été estropiée
pour le reste de ses jours. C'était si je me rappelle bien, dans
l'automne de l'année 1862. Une cérémonie de famille
avait réuni un certain nombre d'Alsaciens et d'Alsaciennes à
Saar-Union. petite ville du département du Bas-Rhin, aujourd'hui
annexée à l'Allemagne.
» Au cours d'une promenade, la voiture qui portait quatre ou cinq
d'entre eux, versa dans un pré. on s'empressa autour de Mme W...,
à qui les roues de la voiture avaient passé sur les jambes
et qu'on croyait grièvement blessée. Elle n'était
heureusement qu'étourdie. La crinoline avait fait l'office d'un
ressort et empêché les jambes qu'elle recouvrait d'être
rompues. Mme W... put assister le soir même à l'un de ces
dîners copieux et interminables, comme on en donnait alors en
Alsace...»
Tel est l'unique argument qu'on pourrait invoquer aujourd'hui pour la
crinoline Il est vrai qu'en un temps où l'automobilisme a multiplié
les occasions d'accidents et où passants et passantes sont, dans
nos rues, écrasés comme des mouches, cet argument serait
de quelque poids. Mais pour un si mince avantage, que d'inconvénients
! Les dames crinolinées auraient peut-être la chance de
passer indemnes sous les voitures, mais elles auraient, par contre,
le désagrément de ne plus pouvoir s'asseoir dedans.
La crinoline était possible au temps des landaus spacieux. Au
temps de l'automobile, ce serait un anachronisme. Et, qui qu'on fasse
la crinoline a vécu.
Ernest LAUT
Le Petit Journal illustré du 21 juin 1914