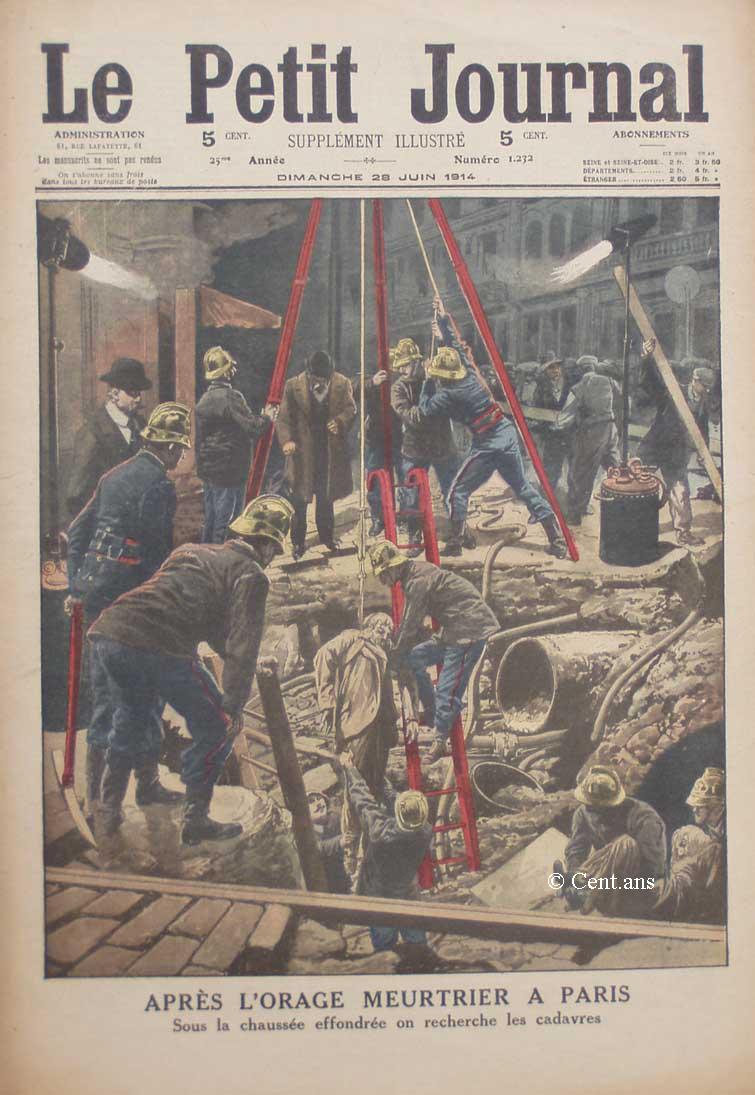APRÈS L'ORAGE MEURTRIER A PARIS
Sous la chaussée effondrée on recherche les cadavres.
Un orage effroyable que rien n'avait pu faire
prévoir s'étant abattu sur Paris a entraîné
une véritable catastrophe.
Sur trois points de la ville, la chaussée s'est ouverte sous
la poussée de l'eau échappée des égouts
dont les parois avaient éclaté.
Des passants furent engloutis dans ces trous ouverts sous leurs pas
; un taxi-auto disparut avec le chauffeur et la voyageuse qui s'y trouvait
; et tous ces malheureux furent noyés dans des flots de boue.
Les pompiers, avec le dévouement à toute épreuve
qui leur est coutumier, accoururent et tentèrent de procéder
au sauvetage. Mais les abîmes ne rendirent que des cadavres.
Pendant plusieurs jours, des quartiers, parmi les plus fréquentés
de Paris, auront été bouleversés comme par un véritable
cataclysme. Des îlots entiers interdits à la circulation
; le gaz, l'électricité coupés ; le commerce, dans
ces quartiers aura subi des préjudices considérables ;
les craintes, même, furent telles qu'on fit momentanément
évacuer des maisons qu'on croyait menacées d'effondrement.
Jugez combien déplorable est le retentissement de ces événements
à l'étranger et quelles conséquences désastreuses
ils peuvent entraîner pour les intérêts de Paris.
Il est effroyable de penser qu'il suffit d'une pluie plus abondante
que de coutume pour causer de pareils accidents. Le sous-sol parisien
est continuellement en travail ; mais le travail y est-il effectué
avec toute la méthode désirable ? On ne cesse de se plaindre,
depuis vingt ans, de la façon dont les services municipaux conduisent
ces travaux. Aucune entente n'existe entre eux. Au lieu de coordonner
leurs efforts, ils semblent s'ingénier à se rendre mutuellement
la besogne plus difficile, et ne prennent les uns et les autres, aucun
souci de l'oeuvre du voisin.
La catastrophe actuelle semble bien être le résultat de
ce manque d'entente et de solidarité. Pour l'accomplissement
des travaux du Métropolitain on a dû dégager les
conduites des égouts et l'on a négligé de remblayer
ensuite et de tasser autour de ces conduites la terre qui en maintient
les parois.
On ne pensait pas qu'un torrent viendrait qui crèverait ces parois
affaiblies. Mais le torrent est venu. Et maintenant des malheureux sont
morts. Comme d'habitude, personne ne sera responsable, personne autre
que le destin.
Si seulement nous pouvions espérer que la tragique leçon
ne sera pas oubliée!...
VARIÉTÉ
Égouts de Paris et d'ailleurs
A propos d'une catastrophe. - Les égouts dans les villes d'autrefois. - Rome et ses cloaques. - Les égouts de Paris. - Un réseau modèle, mais qu'il faut surveiller.
Les égouts de Paris ont fait tristement
parler d'eux, ces jours derniers. Ils ont eu, sous la poussée
d'un formidable orage, une crise de faiblesse qui s'est traduite par
des accidents effroyables, et d'une nature tout au moins imprévue,
on serait même tenté de dire invraisemblable, quand on
songe qu'il s'agit d'une capitale où les travaux édilitaires
devraient être accomplis de telle façon qu'ils puissent
résister à toutes les éventualités.
Or, les Parisiens qui paient de si lourds impôts municipaux, ont
de bonnes raisons de s'étonner et de s'indigner quand ils voient
que les égouts de la ville cèdent à l'effort d'une
simple pluie d'orage, et que de véritables catastrophes en peuvent
résulter.
Faut-il donc douter, une fois de plus, de ces bienfaits du progrès
que nous devons à la science et à l'industrie modernes
?
***
De toutes les branches de l'hygiène publique, celle qui concerne
les égouts semble avoir été la moins négligée
par l'édilité des grandes cités d'autrefois.
La plupart des capitales de l'antiquité avaient des réseaux
d'égouts, et ces réseaux de canaux souterrains étaient
admirablement organisés pour l'évacuation des eaux de
la ville. On peut même dire que, dans ce genre, nous n'avions
pas inventé grand'chose.
Lorsque, il y a quelque quinze ans, l'administration parisienne décréta
que tous les propriétaires devraient installer dans leurs maisons
le tout-à-l'égout, elle s'imagina peut-être réaliser
un progrès jusqu'alors inconnu.
Or, ne lui en déplaise, elle ne faisait là, que renouveler
une pratique qui existait, il n'y a guère plus de 2.500 ans,
à Babylone.
La grande cité assyrienne, en effet, avait non seulement des
égouts, mais encore le tout-à-l'égout. Sir Henri
Layard, le grand explorateur anglais qui, le premier, fouilla de fond
en comble les ruines de Babylone, a constaté le fait. Il a trouvé
la trace d'immenses égouts qui communiquaient avec les maisons
par des tuyaux particuliers.
Chaque maison avait son conduit spécial, qui permettait d'envoyer
directement à l'égout les déjections de ses habitants.
Comme quoi, vous le voyez, une fois de plus, il n'y a rien de nouveau
sous le soleil. Nous pouvons même constater, à propos de
cette mesure d'hygiène, que beaucoup de villes françaises
du XXe siècle sont infiniment moins avancées que ne l'était,
il y a vingt-cinq siècles, la cité de Nabuchodonosor.
Combien de nos villes du Midi n'ont pas le tout-à-l'égout,
et pour cause, n'ayant pas d'égouts du tout. Le tout-à-l'égout,
dans ces aimables cités, c'est le tout-au-ruisseau.
Nous savons encore bien peu de chose de la civilisation assyrienne :
les travaux des Layard, des Rawlinson, des Botta, des Oppert, n'ont
pas dépassé les cercles scientifiques ; et l'histoire
de l'antiquité, telle qu'on nous l'enseigna, était surtout
l'histoire du peuple juif.
Or, le peuple juif n'était qu'un ramassis de nomades inaptes
à la civilisation et aux progrès du bien être et
de l'hygiène. C'est dans les grandes villes de la Mésopotamie
et de l'Égypte, et peut-être aussi de l'Inde, qu'il faut
chercher les témoignages de la civilisation antique. Et le jour
où les recherches archéologiques auront fait la lumière
sur la vie de ces peuples dont nous ne savons jusqu'ici à peu
près rien, nous nous apercevrons peut-être que tant de
progrès dont nous nous enorgueillissons, ont été
mis en oeuvre par eux, il y a plus de deux mille ans, et que beaucoup
de nos pratiques modernes concernant l'hygiène des villes et
les commodités de la vie, ont été connues d'eux,
et ne sont, en fin de compte, que du vieux-neuf.
Il est notamment certain que les villes de l'Égypte ancienne,
comme celles de l'Assyrie, possédaient des égouts. Encore
une invention moderne qui n'est, évidemment, que renouvelée
de l'antiquité : c'est celle de l'épandage. Les Égyptiens,
dit Hermann Baas, étaient très avancés dans l'art
de créer des canaux et des écluses pour retenir les eaux
ou les évacuer, de manière à diriger sur leurs
champs l'eau fécondante du Nil et les immondices des villes emportées
avec elle. C'était l'épuration agricole par irrigation
que nos modernes ingénieurs s'imaginent peut-être avoir
inventée et qui existait il y a plus de deux mille ans. Il est
fort probable que des réseaux d'égouts amenaient les immondices
à ces canaux.
On. sait, en tous cas, de façon certaine que, près de
cinq cents ans avant Jésus-Christ, la ville de Syracuse avait
des égouts. Hérodote rapporte qu'ils avaient été
construits par des prisonniers carthaginois, sur l'ordre de Gélon,
tyran de Géla et de Syracuse. Ces égouts portaient le
nom dégoûts phéaques, du nom de l'architecte
Phéax, qui en dirigea les travaux.
Par contre, les Grecs ne semblent pas avoir attaché la moindre
importance à toutes les pratiques nécessaires à
l'hygiène des villes. Athènes n'était qu'un grand
village, dont les rues n'étaient même pas pavées,
et Strabon reproche aux villes grecques trois choses pour lesquelles
les Romains, au contraire, dépensaient sans compter : les rues,
les égouts et les conduites d'eau.
Rome, en effet, fut, dès la plus haute antiquité, une
cité modèle au point de vue de l'organisation de l'hygiène.
On y voit encore, aujourd'hui, le grand égout, la cloaca
maxima, construite par les Tarquins. Les citoyens riches tenaient
à honneur de construire à leurs frais les canalisations
amenant dans la ville les eaux des sources voisines, et les égouts
qui débarrassaient la cité des eaux impures et des immondices.
Fonssagrives, dans son travail sur 1'hygiène et l'assainissement
des villes, rappelle qu'Agrippa, gendre d'Auguste, étant
édile, fit construire à ses frais un égout gigantesque.
A Rome, chaque propriétaire était tenu de construire lui-même
le cloaque privé qui déversait les eaux de sa maison aux
égouts publics. Ces égouts formaient un réseau
méthodiquement conçu qui venait aboutir au Tibre, lequel
servait d'égout collecteur.
Et ce service d'hygiène publique avait son organisation particulière,
assurée par des fonctionnaires nommés curatores cloacarum,
nettoyeurs d'égouts, et son budget spécial garanti par
une taxe régulière, l'impôt cloacarium.
L'édilité ne regardait pas à la dépense
pour l'entretien de ses cloaques. Tite-Live rapporte qu'en l'an 184
avant J.-C., elle rendit un édit par lequel elle consacrait une
somme de 1.000 talents (environ 3 millions de francs) au nettoyage d'un
certain nombre d'égouts qui étaient bouchés et
ne laissaient plus passer d'eau
***
Les Romains apportèrent en Gaule leurs pratiques de propreté
urbaine.
Dans là plupart des grandes cités galloromaines, on a
trouvé la trace d'égouts anciens. L'empereur Julien en
fit construire plusieurs dans sa « chère Lutèce
».
Mais ces travaux d'édilité furent complètement
négligés pendant tout le moyen âge, et même
longtemps après.
Paris, pendant plusieurs siècles, n'eut d'autres égouts
que les rivières qui le traversaient. Les eaux de la rive gauche
s'en allaient, tout au long des ruisseaux, jusqu'à la Bièvre.
Puis, lorsque, vers le milieu du XIVe siècle, on eut construit
des remparts entre la porte de Bussy et la porte de Nesle, les eaux
de la rive gauche furent dirigées dans les fossés qui
bordaient ces fortifications.
Sur la rive droite, c'était le ruisseau de Ménilmontant
qui servait d'égout. Du quartier Montmartre descendait une rigole
découverte qui y amenait les eaux de ce quartier. Et il s'exhalait
de cette rigole une telle infection que Hugues Aubriot, qui était
prévôt des marchands sous Charles VI, la fit couvrir de
maçonnerie.
Ce fut là le premier égout voûté de Paris
et probablement de toutes les villes de France, depuis l'occupation
romaine.
Au fur et à mesure que la ville s'agrandissait, il fallut creuser
de nouveaux ruisseaux destinés à recevoir les eaux et
à les mener à la rivière ; mais on ne prenait pas
la peine de les garnir d'un revêtement de pierre non plus que
de les couvrir. Et comme la pente en était très faible,
on conçoit que les immondices s'y accumulaient et qu'il s'en
dégageait des odeurs effroyables.
Auprès du palais des Tournelles, qui occupait l'emplacement actuel
de la place des Vosges, passait un de ces égouts à ciel
ouvert : l'égout Sainte-Catherine. Tout le quartier en était
empoisonné ; et l'habitant qui en souffrait le plus n'était
rien moins que le roi de France.
Louis XII et François Ier, en effet, habitaient les Tournelles.
Tous deux, à maintes reprises, sollicitèrent le prévôt
des marchands de détourner le cours de cet égout, sans
pouvoir obtenir l'exécution de ce travail. Preuve manifeste de
l'indépendance de l'édilité parisienne vis-à-vis
des rois de France.
A la fin, François Ier, excédé de ne pouvoir mettre
le nez à la fenêtre de son palais sans respirer les odeurs
les plus nauséabondes, prit le parti d'abandonner les Tournelles.
Au commencement du XVIIe siècle, les égouts de Paris étaient
dans un tel état de saleté, tellement encombrés
d'immondices que Marie de Médicis, craignant une épidémie
de peste, les fit nettoyer aux frais du trésor royal.
L'hygiène publique n'en continua pas moins à être
négligée par l'édilité parisienne. En 1663,
il n'y avait encore à Paris que 1.200 toises d'égouts
couverts contre 4.120 toises d'égouts découverts.
Ce n'est qu'au commencement du XVIIIe siècle que le grand égout
formé par le ruisseau de Ménilmontant, celui qu'on appelait
le grand égout de ceinture, fut revêtu de murs. Et c'est
en 1740 seulement que Turgot, prévôt des marchands, le
fit couvrir d'une voûte.
Cet égout commençait au Marais, au bout de la rue du Calvaire
et se continuait en traversant les faubourgs du Temple, de Saint-Martin,
de Saint-Denis, de la Nouvelle-France, de Montmartre, des Porcherons,
de la Ville-l'Evêque. du Roule, les Champs-Élysées
et le bas de Chaillot, jusqu'à la Seine. Turgot, avant de le
faire couvrir, fit effectuer de grands travaux, en vue d'y assurer toujours
le libre cours des eaux et le nettoyage rapide.
C'est ainsi qu'à la tête de cet égout fut bâti
un réservoir, alimenté par les sources de Belleville,
où l'on tenait en réserve une masse d'eau que de puissantes
machines, imaginées par l'ingénieur Petitot, pouvaient
chasser violemment pour rincer l'égout.
Ce fut là le premier grand ouvrage exécuté à
Paris dans un but de salubrité urbaine. Turgot, qui l'ordonna
et le fit accomplir, peut être considéré, de ce
fait, comme le précurseur des grands hygiénistes d'aujourd'hui.
***
Cependant, au début du XIX siècle, l'administration parisienne
ne possédait même pas un plan des égouts de la ville
et ignorait totalement dans quel état ils se trouvaient.
Or, en 1805, un homme proposa de les visiter, d'établir ce plan
et de signaler les réparations nécessaires. C'était
une proposition singulièrement aventureuse. L'administration
ne voulut pas prendre la responsabilité de donner l'autorisation
demandée. Elle en référa au ministre de l'Intérieur,
lequel crut devoir en parler à l'Empereur.
Napoléon acquiesça.
Le hardi explorateur s'appelait Bruneseau. Il s'engagea avec courage
dans son excursion souterraine et courut les plus grands dangers. Il
faillit plusieurs fois être noyé, asphyxié ou enlizé
dans des amas de boue. Enfin, il en sortit sain et sauf, ayant parcouru
plusieurs égouts de la rive droite et notamment le grand collecteur
de Turgot, dont il trouva la maçonnerie en fort piteux état.
L'Empereur le félicita et le récompensa pour avoir su
accomplir heureusement, au péril de ces jours, une excursion
que tant de curieux font aujourd'hui sans le moindre danger.
On le chargea de faire les réparations qu'il avait jugées
nécessaires et d'accomplir maints autres travaux qu'il estimait
utiles.
Dès ce moment, l'organisation des égouts de Paris commença
de se perfectionner. Il n'y avait encore que 23.000 mètres d'égouts
couverts. Un demi siècle plus tard il y en avait près
de 200.000 mètres.
C'est sous Louis-Philippe que furent exécutés les travaux
les plus considérables : près de 90.000 mètres.
Aujourd'hui, Paris a un réseau d'égout de près
de douze cents mille mètres à l'intérieur des murs
desservi par près de 14.000 bouches et plus de 20.000 «
regards ». La longueur des galeries qu'on peut parcourir est de
plus de 43 kilomètres.
On y circule, en temps normal, sans crainte de noyade, d'asphyxie ou
d'enlizement dans les boues. Il est même certain que le sous-sol
est, bien souvent, plus propre que le sol, et qu'à certains jours
mieux vaudrait se promener dans les égouts que dans les rues.
Mais si grands que soient les progrès accomplis, d'autres progrès,
s'impose sans cesse. L'utilisation de jour en jour plus considérable
du sous-sol parisien exige que les égouts sans cesse ébranlés
par les travaux voisins ou trop souvent isolés de la masse de
terre qui soutient leurs parois, soient construits d'une façon
plus résistante et ne cèdent pas à une poussée
d'eau anormale.
Ce serait pour les Parisiens un effroi de tous les instants s'ils devaient
craindre de voir, à tout ébranlement du sol ou à
chaque pluie d'orage, des gouffres meurtrier s'ouvrir sous leurs pas.
Ernest Laut
Le Petit Journal illustré du 28 juin 1914