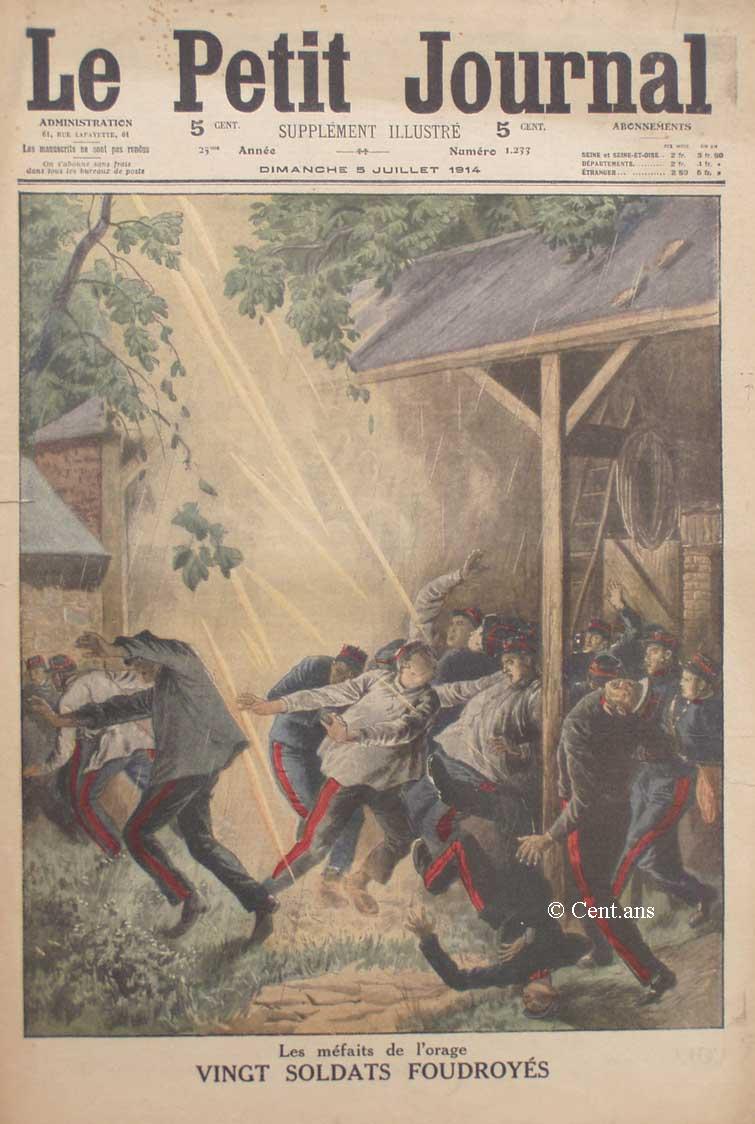LES MÉFAITS DE L'ORAGE
VINGT SOLDATS FOUDROYÉS
L'été orageux que nous subissons,
a causé, d'un bout à l'autre du pays, nombre d'accidents
graves. Celui dont le camp de Cercottes fut le théâtre,
pour n'avoir pas entraîné mort d'homme, n'en fut pas moins
déplorable par le nombre des blessés.
Un détachement d'artillerie du 45e régiment, était
occupé, dans le champ de tir, à la corvée de «
caffut », qui consiste à ramasser les débris de
balles et d'obus, lorsque l'orage éclata. L'adjudant chef, qui
commandait, ordonna à ses hommes de se réfugier sous l'un
des abris du camp.
Les soldats venaient à peine d'y pénétrer lorsqu'un
éclair sillonna la nue. La foudre, avec un fracas effroyable,
tomba à une centaine de mètres. Malheureusement, le fluide
rencontra un réseau téléphonique communiquant avec
l'abri militaire. La foudre suivit le chemin et, après avoir
traversé la toiture, vint se perdre au milieu du campement improvisé
des artilleurs.
Le choc fut terrible. Les militaires furent renversés, culbutés
violemment les uns sur les autres et brûlés, pour la plupart,
en diverses parties du corps. Deux d'entre eux furent transportés
à l'hôpital militaire dans un état assez grave.
Dix-huit autres, moins grièvement atteints, ont été
envoyés à l'infirmerie.
VARIÉTÉ
L'Homme et l'Insecte
J.-H. Fabre, l'« Hômère des insectes ». - Une ménagerie de bestioles. - Les vertus de la fourmi. - L'araignée est une artiste. - Le passé et l'avenir de la sériciculture,
La gloire qui, trop tardivement, est allée
trouver dans son mas de Sérignan, le vénérable
entomologiste J.-H. Fabre, le grand savant modeste que nul ne connaissait,
et que Victor Hugo, pourtant avait appelé l' « Homère
des Insectes » - cette gloire a eu pour résultat imprévu
d'attirer l'attention publique sur les êtres infimes, auxquels
Fabre a consacré ses études et sa vie.
Qui donc, auparavant, s'était préoccupé de l'existence
et des moeurs des insectes ? Qui donc se fût avisé que
ces bestioles que nous écrasons sous nos pas, pouvaient faire
montre d'intelligence ? Tout au plus avions-nous quelques vagues données
sur l'organisation sociale des abeilles, quelques idées non moins
vagues sur celles des fourmis. L'homme, dans son incurable vanité;
daigne à peine observer les animaux qui vivent, auprès
de lui et qui le servent, les animaux qu'il a appelés «
domestiques », parce qu'il n'a vu en eux que des serviteurs. Comment
se fût-il avisé que l'insecte pouvait lui fournir des notions
dignes d'intérêt et même lui offrir de précieuses
leçons ?
C'est aux travaux de J.-H. Fabre que nous devons cette révélation.
L' « Homère des Insectes » a suscité, en faveur
de ses héros, un intérêt qui, depuis quelques années,
n'a cessé de se manifester, et dont le plus récent témoignage
est le succès remporté par l'exposition d'insectes vivants
qui vient de se tenir au Jardin d'acclimatation.
Une ménagerie d'insectes. Qui donc eût songé à
cela, naguère ? L'entomologie était alors une science
morte, une science qu'on n'étudiait que sur des bêtes piquées
au mur avec une épingle au travers du corps. J.-H. Fabre en a
fait une science vivante ; et ses livres ont donné au grand public
le goût d'étudier, non plus seulement l'anatomie de l'insecte,
mais ses moeurs, sa vie, son intelligence. Une telle étude ne
saurait être qu'infiniment profitable à l'humanité.
Car, si l'homme savait, ou daignait observer, il verrait constamment
que la nature, jusque dans ses infiniment petits, a multiplié
pour lui les utiles enseignements.
***
Ces jours derniers, à la campagne, j'ai passé une heure
à suivre les efforts d'une fourmi qui traînait vers la
fourmilière, une mouche morte qu'elle avait trouvée sur
le chemin. C'était merveille de voir avec quelle énergie
la petite bête tirait cette masse dix fois plus grosse qu'elle.
Le sol, pavé de briques, était inégal. N'importe
! la fourmi grimpait les collines, descendait dans les vallées,
sans jamais lâcher sa proie qu'elle tenait solidement par une
patte.
Un obstacle se présentait-il, impossible à franchir, la
fourmi s'arrêtait, tournait deux ou trois fois rapidement autour
du corps de la mouche, reconnaissait le terrain, puis, ressaisissant
son fardeau, l'entraînait de nouveau dans un autre sens, jusqu'à
ce que le sol aplani lui permit de reprendre sa route.
Elle parcourut ainsi un espace de dix mètres au moins, sans s'être
laissé décourager par la longueur du chemin et las difficultés
de l'entreprise.
Quel enseignement un éducateur eût pu tirer d'un tel spectacle
pour ses élèves ! Énergie, volonté, continuité
dans l'effort, la petite bête avait donné un merveilleux
exemple de toutes ces vertus. Que d'hommes, mis en face d'une besogne
proportionnée à celle qu'elle avait accomplie, se fûssent
arrêtés en chemin !
Il y a quelques années, divers journaux allemands, racontèrent
que les belles dames de Paris, éprises d'un snobisme nouveau,
avaient toutes, dans leur salon, une boîte de verre renfermant
une fourmilière, devant laquelle elles passaient des heures à
contempler le travail des fourmis.
L'écho était mensonger, comme bien vous pensez. A vrai
dire, une jeune artiste de l'Opéra-Comique s'était avisée
de ce passe-temps, et possédait, en effet, chez elle, une fourmilière
installée de cette, façon.
Sans doute, un correspondant de journaux allemands avait vu chez elle
cette fourmilière, et il avait généralisé
à la façon de cet Anglais qui, débarquant à
Calais et voyant sur le quai une femme rousse, écrivit sur son
carnet : « En France, toutes les femmes sont rousses. »
Bref, il était faux que les Parisiennes eussent des fourmis dans
leur salon. Et les journaux allemands raillaient à tort un snobisme
qui n'existait que dans l'imagination de leur correspondant. Mais ce
snobisme eût-il été en faveur parmi nos mondaines
que, pour ma part, je me fasse bien gardé d'y trouver matière
à critique.
Cela eût prouvé tout simplement que les Parisiennes avaient
plus de goût pour l'observation scientifique ne le croyaient nos
voisins d'Outre-Rhin.
Il y aura toujours, à tout prendre, plus de profit pour l'intelligence
humaine dans l'étude de la nature que dans la pratique du bridge
ou du jeu de puzzle. S'il prenait fantaisie aux Parisiennes de s'amuser
à observer les fourmis, il faudrait les approuver : Elles ne
trouveraient dans cette observation que d'excellents exemples d'ordre,
de méthode, d'économie et de travail. Il faudrait même
leur conseiller ce passe-temps : Elles pourraient en avoir de plus mauvais.
***
On a cité bien des traits de l'esprit industrieux de la fourmi.
Il n'en est peut-être pas de plus curieux que celui qu'observa
dernièrement un naturaliste américain, M. Mac Look, chez
les fourmis-bergères.
Installé dans une région des Monts Alleghanys où
les fourmis de cette espèce sont nombreuses, le naturaliste raconte
qu'elles vont chercher sur les feuilles des rosiers, des oeufs d'aphis
(puceron de la rose), qu'elles font éclore en les protégeant
soigneusement contre les caprices de la température. Quand les
pucerons sont nés, elles les élèvent avec une sollicitude
qui serait maternelle si elle était plus désintéressée.
Elles les installent ensuite sur des arbustes dont ils seront chargés
d'extraire le suc pour l'entretien de la communauté. Les aphis
enfoncent leurs suçoirs dans l'écorce de la plante et,
lorsqu'ils sont suffisamment gorgés de sève, les fourmis
préposées au service des vivres viennent leur soutirer
le trop plein de leur nourriture pour le distribuer à celles
de leurs compagnes que retient à la fourmilière un travail
intérieur. C'est la traite des pucerons. Dans l'intervalle de
ces visites, les fourmis dressent, autour des plantes où sont
parqués les pucerons, des barrières, véritables
bercails destinés à empêcher leur fuite. Souvent
l'une d'elles fait fonction de bergère et veille d'un œil
jaloux sur le troupeau commun.
Ainsi, les fourmis ont leurs troupeaux qu'elles élèvent,
qu'elles gardent, qu'elles exploitent. Et voilà qui prouve une
fois de plus que l'homme n'est pas seul à savoir tirer profit
des ressources que la prévoyante nature a mises à la disposition
de tous les êtres.
***
Et l'araignée, la hideuse araignée ?... Mérite-t-elle
la réprobation qu'on lui a vouée ? C'est une artiste :
elle aime la musique. Demandez plutôt à M. Camille Saint-Saëns.
Le grand compositeur partage l'horreur instinctive que presque tout
le monde éprouve en face de l'araignée cependant, il lui
reconnaît de l'intelligence et un certain esprit de sociabilité.
« Malgré l'admiration dont, on ne peut se défendre
pour ses travaux, dit-il, l'araignée m'a toujours causé
une horreur insurmontable, et, dans l'espérance de vaincre cette
aversion gênante, j'ai parfois apprivoisé quelqu'une de
ces bestioles. Il faut pour cela une certaine patience. Aux premières
tentatives, l'araignée, effrayée, se laisse tomber au
bout d'un fil, ou s'enfuit rapidement dans une cachette. Il faut trois
ou quatre jours pour qu'elle commence à se rassurer il faut toute
une semaine pour qu'elle arrive, après des expériences
habilement graduées, à prendre une mouche dans les doigts
de l'observateur. Elle est alors complètement rassurée.
On a parlé du goût de l'araignée, pour la musique
; je l'ai observé plusieurs fois à la campagne, où
j'attirais bien malgré moi, en jouant du piano, de grosses araignées
dont le voisinage ne m'était nullement agréable.
« Le signe le plus curieux l'intelligence m'a été
donné par des araignées de Cochinchine. Dans ce pays,
des araignées d'une grandeur énorme, peu redoutables parce
qu'on ne les voit jamais que de loin, tendent d'un arbre à l'autre,
à des distances relativement considérables, des fils horizontaux
et parallèles ; sur cette chaîne, elles tissent de place
en place une trame sur laquelle elles se tiennent, la tête en
bas. Or, quand les Français occupant le pays, y eurent placé
des fils télégraphiques, ces bestioles, trouvant une «
chaîne » toute préparée, en ont profité
; elles se sont établies sur ces fils qui leur épargnaient
la plus grosse part de travail, se contentant de tisser la trame sur
laquelle elles se mettent à l'affût. Il est difficile de
ne pas voir dans ce fait le résultat d'une observation et d'une
réflexion ».
C'est là, en effet, la révélation d'un certain
sens pratique, et cela prouve que l'araignée sait tirer profit
des travaux de d'homme.
Il est vrai que l'homme, malgré son horreur de l'araignée,
a tenté, lui aussi, de tirer profit des travaux de l'insecte.
Il y a tout juste deux cents ans qu'un digne magistrat, président
de la cour des aides de Montpellier, nommé Bon, s'avisa de faire
tisser la toile d'araignée et d'en faire des vêtements.
Les premiers essais furent couronnés de succès et l'on
en fit grand bruit à la cour et à la ville.
Peu de mois avant sa mort, Louis XIV fut sollicité en faveur
de cette nouvelle industrie. Bon lui fit hommage d'un habit complet
et d'une paire de gants tricotés en toile d'araignée.
Il offrit en même temps à la duchesse de Bourgogne une
paire de bas et à l'impératrice d'Allemagne une paire
de mitaines de la même fabrication.
Mais, depuis lors, le tissage de la toile d'araignée fut abandonné
; il paraît que les araignées de nos contrées sont
de trop faibles productrices de fil. Réaumur, consulté
sur ce point par l'Académie des Sciences, déclarait qu'il
faudrait plus de cinquante mille araignées pour tisser une livre
de toile.
Mais, à défaut des araignées de la Métropole,
celles d'une de nos colonies ont servi à rénover cette
industrie abandonnée depuis le XVIIIe siècle.
Ce sont les araignées de Madagascar.
On sait qu'il se fabrique dans la grande île une dentelle spéciale
faite d'une soie d'un beau jaune d'or. Le fil qui sert à cette
dentelle est produit par une araignée, la Nephila de
Madagascar qui vit dans les manguiers.
Un de nos compatriote qui a longtemps vécu à Madagascar
décrit ainsi le procédé employé à
l'école professionnelle de Tananarive pour la récolte
de ce fil.
« On enferme, dit-il, les araignées ou halabi,
comme on les appelle en Imerina, dans de petites boîtes disposées
par séries de douze, tout juste assez grandes pour en contenir
chacune une, et percées sur leur face antérieure d'un
trou ; l'on y dispose les patientes de telle sorte que la filière
qui est placée au bout de leur abdomen, émerge du trou
; il suffit alors de saisir ou plus simplement de toucher successivement
avec le doigt les filières de ces animaux pour attirer les fils
qu'on réunit et enroule sur une bobine. Chacun d'eux donne de
3 à 400 mètres de fil à chaque opération
et en supporte quatre, ou cinq avant de mourir. Afin d'avoir toujours
sous la main un nombre suffisant d'halabi, on les achète aux
indigènes. Comme ces araignées sont d'humeur sédentaire,
on les conserve aisément dans un enclos spécial où
sont plantées de nombreuses tiges de bambous, au milieu desquelles
elles tissent leurs grandes toiles ; quelques plantes cultivées
et des baquets pleins d'eau y attirent les insectes dont elles se nourrissent...
»
La soie de l'halabi est à la fois fine et résistante ;
malheureusement, le prix de revient en est fort élevé,
et c'est pourquoi, sauf pour des objets de luxe comme la dentelle, il
est peu probable que cette industrie séricicole soit appelée
à un grand avenir.
***
Au surplus, et puisque nous parlons des insectes utiles et des profits
que l'homme néglige parfois d'en tirer, comment ne constaterions-nous
pas la décadence de l'industrie séricicole dont le producteur
est le vulgaire ver à soie.
Dans notre enfance, l'éducation du ver à soie était
en honneur jusque dans les cassette des collégiens ; aujourd'hui,
elle est complètement. abandonnée.
M. Mozziconacci, professeur régional de sériciculture
et directeur de la station expérimentale d'Alais, observe la
sériciculture française, qui produit, vers le milieu du
XIXe siècle, 26 millions de kilogrammes de cocons, n'en fournit,
plus aujourd'hui que huit millions.
« C'est, dit-il, à la dépopulation croissante de
nos campagnes, à la rareté et de la cherté de la
main d'oeuvre qu'il faut attribuer la cause de cette décadence
».
Une autre raison, encore, a empêché la sériciculture
de se développer en France : et c'est la croyance où l'on
est généralement que l'élevage du ver à
soie n'est praticable que dans le sud et le sud-est de France.
M. Mozziconacci fait justice de cette erreur. Il assure que la sériciculture
peut être pratiquée partout, aussi bien dans région
parisienne et dans le centre de France que dans le midi. Le mûrier
blanc, nécessaire à la nourriture des vers à soie
prospère très bien sous le climat de Paris.
En faut-il des preuves ? En voici une prise dans le passé. En
1601, olivier de Serres fit conduire à Paris vingt mille pieds
de mûriers ; ils furent plantés au Tuileries, au château
de Madrid, à Fontainebleau, et reprirent partout avec plus grande
facilité.
En voici une autre, prise dans le présent : C'est l'organisation,
à Joinville-le-Pont, par M. et Mme Rousseau, deux véritables
apôtres de la sériciculture, d'une école où
l'on instruit plus particulièrement dans l'élevage du
ver à soie, des jeunes gens venus de nos colonies asiatiques.
Ainsi, grâce aux sériciculteurs de Joinville, cette industrie
trop négligée dans la métropole, commence à
revivre dans possessions d'Extrême-Orient.
***
Que de joies, que d'enseignements, que de profits l'homme s'assurerait
à jamais par d'observation et l'exploitation de tout ce que la
nature lui offre jusque dans ses plus infimes créatures
Ernest Laut
Le Petit Journal illustré du 5 juillet 1914