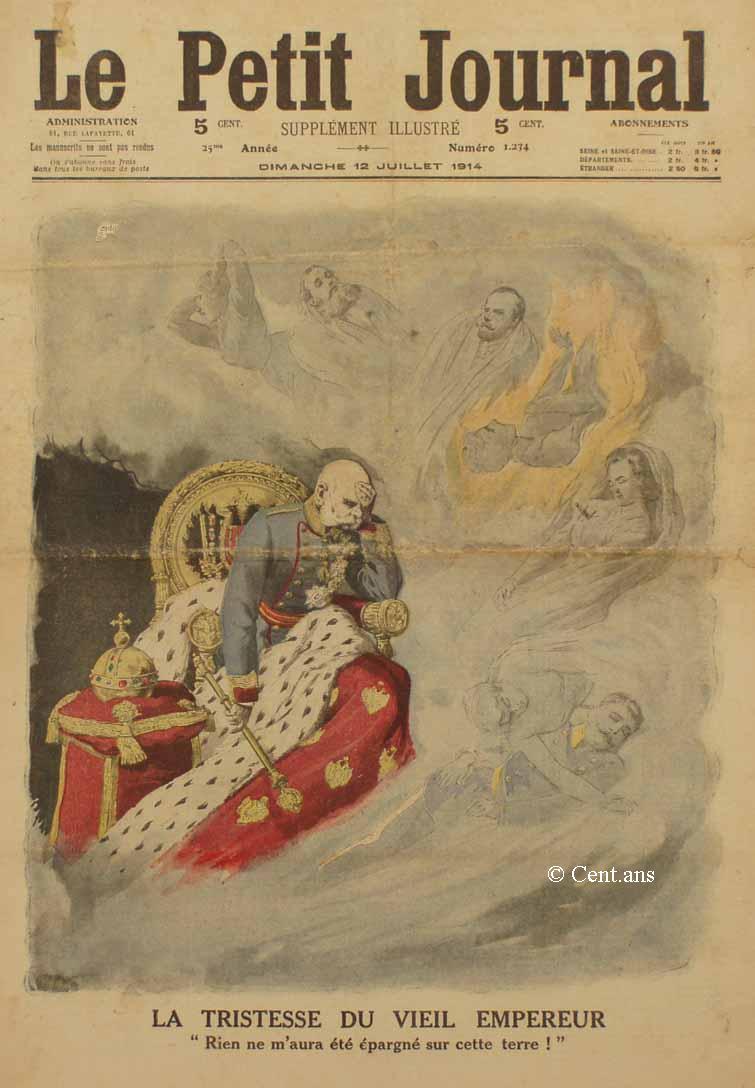LA TRISTESSE DU VIEIL EMPEREUR
« Rien ne m'aura été épargné
sur cette terre ! »
Tel fut le cri poignant de l'empereur Frainçois-Joseph
quand on lui apprit le drame de Sarajevo.
En effet, la vie du vénérable souverain a été
tissée de drames tragiques.
Depuis le 2 décembre 1848, jour où fut inauguré
son long règne, la mort, sans relâche, a frappé
autour de lui.
Le 19 juin 1867, son frère, l'archiduc Ferdinan, couronné
empereur du Mexique sous le nom de Maximilien Ier, condamné à
mort, tombe sous les halles des nationalistes mexicains dans les fossés
de Queretaro. La raison de sa femme, l'impératrice Charlotte,
ne résista pas à l'affreuse nouvelle de cette mort. Depuis
quarante-sept ans, la belle-soeur de François-Joseph, frappée
de démence, consume sa morne existence au château de Bouchout,
en Belgique.
Puis, le 30 janvier 1889, c'est le drame mystérieux de Meyerling.
Le fils unique de l'empereur, l'archiduc Rodolphe, est trouvé
un matin inanimé et sanglant. Près de lui, le cadavre
d'une femme, la baronne Vecsera. Crime ou suicide ? C'est un secret
que détiennent toujours les archives de la maison impériale.
Neuf ans plus tard, le 10 septembre 1898, l'impératrice Élisabeth,
qui, depuis la fatale journée, traînait à travers
l'Europe, son incurable tristesse, tombe à Genève sous
le poignard meurtrier d'un anarchiste. L'année précédente,
la soeur de l'infortunée souveraine, la duchesse d'Alençon,
avait trouvé dans l'incendie du bazar de la Charité une
effroyable mort.
Et voici maintenant le neveu de François-Joseph, héritier
de sa couronne, qui, avec sa femme, succombe sous la fureur sanguinaire
d'un fanatique. Dramatique destinée que celle du vieux souverain,
qui, dans son palais désert, voit ainsi la mort frapper sans
répit autour de lui !
VARIÉTÉ
Dentelle et Dentellières
A propos d'une exposition. - Les légendes de la Dentelle. - Son histoire. - Encourageons les dentellières de France
Une ravissante exposition, organisée
ces temps derniers par la « Vie féminine », sur l'initiative
de Mlle Valentine Thomson, a fait revivre à nos yeux les merveilles
d'un art français que nos aïeules portèrent au plus
haut point de perfection, mais qui, depuis un siècle avait subi
maintes vicissitudes.
Le succès de cette exposition démontre que la belle dentelle
à la main a toujours la faveur des élégantes. Espérons
qu'il se traduira par un renouveau de cet art charmant, et que nous
verrons Alençon et Argentan, Bayeux et Chantilly, Valenciennes
et Lille, Le Puy et Mirecourt et tant autres centres dentelliers reprendre
l'aiguille ou les fuseaux négligés, abandonnés,
pour créer de nouveau des merveilles.
***
Les historiographes de la dentelle ont copieusement discuté sur
la question de savoir si cet art était originaire d'Italie ou
les Flandres.
La question n'est pas encore définitivement fixée, bien
que le plus grand nombre penche pour l'Italie. Heureuse Italie, on lui
attribue toutes les créations artistiques ! Musset n'a-t-il pas
proclamé, dans des vers rameux, qu'elle nous avait donné
l'harmonie ? Et depuis lors, pourtant, les musicographes ont prouvé
péremptoirement que la musique était née, en réalité,
dans les Flandres... N'en serait-il pas de même pour la dentelle
?...
Quoi qu'il en soit, Venise a sur l'origine de la dentelle une antique
et délicieuse légende que je vais emprunter, pour vous
la dire, à M. Lefébure, l'historien de la dentelle.
« Un jeune pêcheur de l'Adriatique était fiancé
à la plus belle fille d'une des îles de la lagune. Aussi
laborieuse que belle, la jeune fille lui fit un filet neuf qu'il emporta
sur sa barque. La première fois qu'il s'en servit, il ramena
du fond de la mer une superbe algue pétrifiée qu'il s'en
pressa d'offrir à sa fiancée.
» Mais voilà que la guerre éclate et oblige tous
les matelots à partir sur la flotte vénitienne, vers les
rives d'Orient. La pauvre jeune fille pleure le départ de son
fiancé et reste des jours entiers à contempler la belle
algue qu'il lui a laissée comme gage de son amour. Tout en regardant
ces superbes nervures reliées de fibres si légères,
elle tresse les fils, terminés par un petit plomb, qui pendent
autour de son filet ; peu à peu, elle reproduit, de ses doigts
habiles, le modèle aimé sur lequel ses yeux se portaient
sans cesse. A la fin, elle réussit la dentelle à piombini
était inventée... »
Voilà pour l'Italie... Mais attendez, n'allez pas conclure de
là que la dentelle est une invention vénitienne. Bruges,
elle aussi, a sa légende sur la dentelle, une légende
non moins jolie que la précédente. Je vous l'offre telle
qu'une vieille dentellière brugeoise l'a contée récemment
à une de nos amies qui me l'a rapportée :
« Il y avait jadis, dans la ville de Bruges, une frêle et
blonde jeune fille qui se nommait Serena. Sa famille était pauvre
; sa mère veuve et infirme ; ses soeurs, encore enfants, ne vivaient
que de son travail ; pour subvenir aux besoins de la maison, il lui
fallait travailler sans relâche et filer, chaque semaine, dix
écheveaux de lin. Serena était aimée d'amour ;
son fiancé, Arnold, travaillait en apprentissage chez un sculpteur
; aussitôt passé maître, il devait l'épouser.
Mais, voyant chaque jour la détresse des siens, la jeune fille
fit un vœu héroïque : « Sainte Vierge, dit-elle
un matin, donnez-moi les moyens de secourir ma famille et je renonce
aux joies de la vie, j'abdique les espérances de mon coeur. »
» Le dimanche suivant, Serena se rendit à la campagne avec
ses soeurs. Comme elle était assise sur l'herbe et songeait tristement,
une multitude de ces fils légers qu'on nomme fils de la Vierge
et qu'on dit échappés de la quenouille de Marie, vinrent
se poser sur son blanc tablier et formèrent, par leurs entrelacs,
un dessin magnifique. Et Serena, les considérant, comprit qu'elle
était exaucée. Elle emporta chez elle le merveilleux réseau.
Avec un lin d'une extrême finesse qu'elle avait tissé et
blanchi elle-même, elle se mit en devoir de l'imiter.
» La tâche fut d'abord difficile. Comme les fils se mêlaient,
Arnold, qui la regardait faire, attacha au bout de chacun d'eux un petit
morceau de bois ; c'est ainsi que je fuseau fut trouvé. Puis,
pour maintenir son ouvrage, la jeune fille l'attacha avec des épingles
sur une pelote de laine, et, par ce moyen, inventa le carreau. Au bout
d'une semaine, la première dentelle fut achevée, et bientôt
toutes les dames de Bruges voulurent avoir des dentelles pour leurs
coiffes ; on ne manqua plus de pain dans la maison de Serena. Fidèle
à son voeu, lorsqu'Arnold, passé maître sculpteur,
vint demander sa main, la jeune fille refusa.
» Mais une si belle histoire ne saurait tristement finir. Après
avoir laissé pendant un an à la pieuse ouvrière
le mérite de sa peine, la Vierge lui apparut et la délia
de son serment. Arnold et Serena se marièrent ; ils furent heureux
; ils eurent beaucoup d'enfants. Tous ces enfants furent des filles,
et toutes ces filles des dentellières. »
***
Bref, qu'elle vînt des Flandres ou d'Italie, la dentelle, à
coup sûr, s'installa de bonne heure sur notre sol et ne tarda
pas à y prendre de solides racines.
Cependant, sous Henri IV et sous Louis XIII, l'Italie avait encore le
monopole de la belle dentelle ; les grands seigneurs français
ne portaient que du point de Venise.
Même ils en portaient tant et de si beau que plusieurs se ruinèrent
en achats de dentelles, et que les rois, afin d'empêcher l'exode
à l'étranger des fortunes françaises, firent des
édits somptuaires qui proscrivaient l'emploi des « passements
» d'Italie.
Mais, dès qu'il fut au pouvoir, Colbert, dont l'admirable génie
s'exerça sur toutes choses, comprit que combattre le luxe, c'était
commettre, au point de vue économique, la plus lourde et la plus
coupable hérésie. Loin de défendre le port des
dentelles, il songea à faire profiter l'industrie française
du goût immodéré que la noblesse leur témoignait.
Venise - protectionniste à outrance - punissait tout ouvrier
d'art qui quittait son territoire par des peines sévères
qu'elle faisait subir à sa famille. En dépit de ce despotisme,
Colbert parvint à amener en France un certain nombre des dentellières
vénitiennes les plus habiles. Il les installa dans divers centres
et créa, en 1665, les manufactures royales de dentelles.
Pendant plus d'un siècle, l'industrie dentellière
jouit d'une prospérité ininterrompue. Ce fut la Révolution
qui la tua. A la fin du dix-huitième siècle elle était
en pleine décadence presque partout ; à Valenciennes,
elle avait complètement disparu.
Le luxe du premier empire, celui du second tentèrent en vain
de la ranimer. Depuis lors, l'industrie de la dentelle à la main
n'a plus retrouvé sa prospérité d'autrefois.
En 1704, un mémoire, adressé à la Chambre de commerce
de Paris, estimait que la dentelle faisait subsister plus d'un quart
de la population française « de tous états, conditions
et âges. » Aujourd'hui, les dentellières n'étant
point organisées ni syndiquées à la manière
de tant d'autres corporations, on ne saurait les dénombrer exactement.,
mais d'après des statistiques plus ou moins précises,
on peut présumer qu'environ cent cinquante à deux cent
mille femmes pratiquent encore cet art chez-nous.
Je dis qu'elles le pratiquent, mais non pas qu'elles en vivent, car
le salaire qu'elles touchent est en général peu en rapport
avec le talent qu'elles déploient et la besogne qu'elles fournissent
et je sais des régions où une dentellière habile
gagne en tout et pour tout 1 fr. 50, après avoir travaillé
douze ou quatorze heures durant.
Quoi d'étonnant, dans ces conditions que, de jour en jour, le
nombre des dentellières diminue ?
Cependant, malgré les variations de la mode, le perfectionnement
inouï des machines, l'abaissement des salaires et surtout le déclin
du goût, l'industrie de la vraie dentelle s'est conservée
en France dans quelques contres.
Alençon produit toujours son fameux point à l'aiguille
et ce point n'a pas cessé de jouir de la plus grande faveur.
On compte que dix mille ouvrières environ travaillent encore
à ces merveilleuses dentelles qui figurent dans les plus riches
trousseaux.
Avant la Révolution, Alençon avait un redoutable concurrent
dans le point d'Argentan, qui ne lui cédait pas en élégance
et en délicatesse. Mais, depuis lors, Argentan a complètement
abandonné la dentelle pour la broderie, et Alençon reste
à présent la seule ville de France qui produise le point
à l'aiguille.
La dentelle aux fuseaux fut aussi de tous temps en honneur dans la Normandie.
Avant 1789, les dentellières y étaient nombreuses, mais
vint l'inévitable décadence, résultant des troubles
politiques, et à la fin du dix-huitième siècle,
on n'y trouvait plus guère que vingt mille ouvrières.
Cinquante ans plus tard, ce chiffre avait triplé d'importance.
On trouve des dentellières tout le long de la côte, depuis
Le Havre jusqu'à Cherbourg, à Honfleur, Bolbec, Fécamp,
Dieppe, à Bayeux, Pont-l'Evêque, Falaise et Lisieux.
A Honfleur et à Dieppe, on fabrique spécialement une sorte
de valenciennes épaisse, connu sous le nom de valenciennes
diepppoise. Une école existe à Dieppe, où
l'on fait l'apprentissage de ces dentelles.
Caen produit encore des « blondes » noires et aussi des
blondes d'or et d'argent, parfois mêlées de perles.
Mais le centre le plus actif est Bayeux, où se trouve une maison
fort ancienne, datant de plus de soixante-dix ans.
Bayeux fait tout spécialement la dentelle de Chantilly, dont
la « ville des Condé » a depuis cinquante ans abandonné
peu à peu la fabrication.
La Flandre, qui fut le berceau de la dentelle, a gardé peu de
centres dentelliers. Lille a renoncé à ses belles dentelles
d'autrefois pour ne plus produire en petite quantité d'ailleurs
que la dentelle commune. Arras fait également des dentelles à
bas prix.
Quant à Valenciennes, la ville célèbre entre toutes
dans l'art de la dentelle, il y a cent ans qu'on n'y entend plus le
cliquentis des fuseaux.
C'est dans la Flandre belge et plus particulièrement aux environs
de Bruges et d'Ypres que cette industrie s'est réfugiée.
Vingt mille ouvrières y conservent et y perpétuent les
traditions de la belle valenciennes.
Dans la Flandre française, à Bergues, Cassel, Hazebrouck,
à Bailleul surtout, et dans une vingtaine d'autres communes,
on compte encore quelques milliers de dentellières qui font également
de la fausse valenciennes.
Mais depuis cinquante ans, on a pu constater que le nombre des dentellières
avait toujours été en décroissant dans le Nord
et le Pas-de-Calais. Cela tient à ce que dans ces régions
de grande activité industrielle, les femmes trouvent à
gagner leur vie plus largement et plus facilement dans d'autres métiers
et n'hésitent pas à abandonner un art qui exige tant de
soins et de talent pour un si maigre salaire. Vingt à vingt-cinq
mille ouvrières dentellières travaillent encore dans les
Vosges.
La dentelle de Mirecourt possède une juste renommée. C'est
de la dentelle blanche dans le genre de celle qu'on fabriquait naguère
à Arras et à Lille. On fait aussi à Mirecourt,
depuis une cinquantaine d'années, de très belles imitations
de point de Bruxelles:
Mais le centre le plus important de France pour la fabrication de la
dentelle aux fuseaux c'est la ville du Puy.
On compte en Auvergne - Cantal, Haute-Loire, Loire, Puy-de-Dôme
- cent vingt à cent trente mille ouvrières. La Haute-Loire
à elle seule en a plus de soixante mille.
L'Auvergne produit toutes espèces de dentelles : blanche et de
couleurs, en laine, en fil ou en soie. On y fait tout, depuis les bordures
étroites à 0 fr. 20 le mètre, jusqu'aux dentelles
d'or et d'argent.
C'est d'Auvergne que nous viennent ces modestes ouvrières en
plein vent qui travaillent sous quelque porte cochère aux alentours
de nos grands magasins parisiens et devant lesquelles s'arrêtent
volontiers les badauds. La dentelle étroite et commune qu'elles
font, sur un petit coussin chargé de deux douzaines de fuseaux
et piqué d'épingles aux têtes multicolores, décèle
leur origine auvergnate.
***
On peut voir, par cet exposé rapide des centres de production
de la dentelle en France, que le sort d'une telle industrie d'art est
de tous points digne d'intérêt.
Au dix-huitième siècle, la France tenait le premier rang
dans l'art de la dentelle.
Pourquoi ne serait-il pas possible de lui rendre aujourd'hui cette suprématie
?
En Belgique, en Italie, en Angleterre, la dentelle est l'objet de tous
les encouragements.
Souhaitons que l'initiative privée et les pouvoirs publics s'unissent
chez nous dans le même but. Ce serait faire oeuvre doublement
généreuse que d'assurer par un salaire convenable l'existence
et le bien-être de tant d'intéressantes ouvrières
et de relever en même temps cet art de la dentelle qui est l'art
de la femme par excellence.
Le Petit Journal illustré du 12 juillet 1914