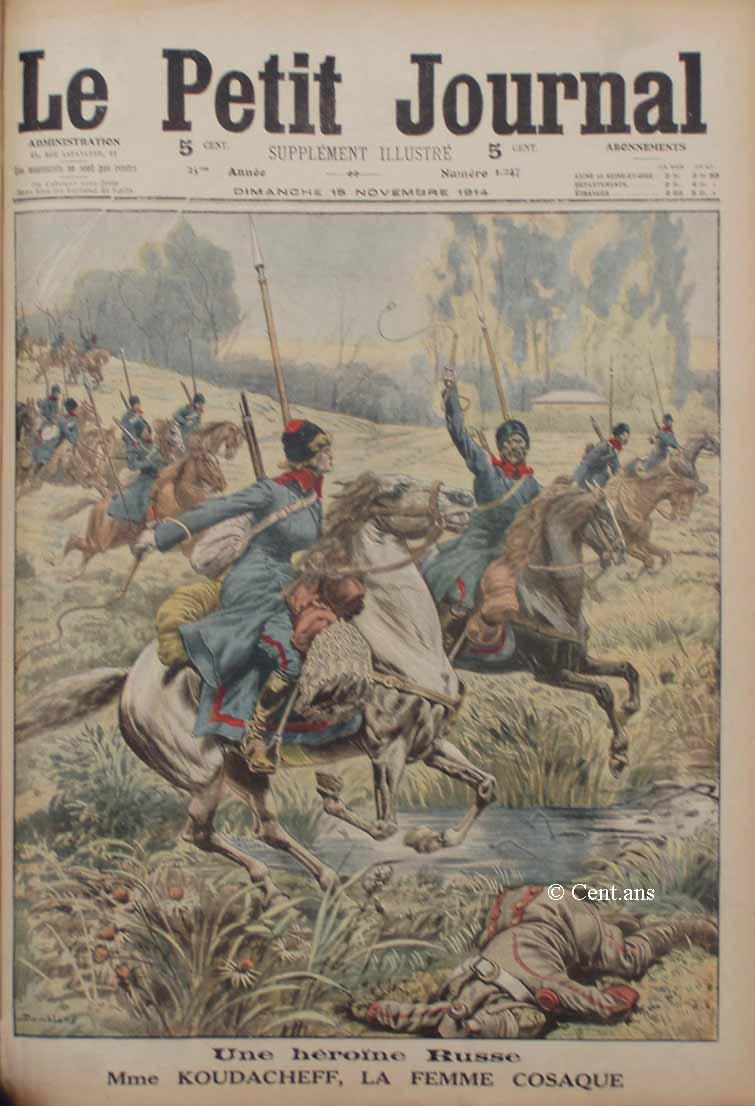Une héroïne russe
LA FEMME COSAQUE
La femme slave prend volontiers sa part des périls
de la guerre. On sait que dans l'armée serbe, pendant
la guerre contre la Turquie maintes femmes se firent remarquer par leur
courage.
Dans l'armée russe, en ce moment, on compte plusieurs femmes.
Dernièrement, à l'hôpital de Kiew, arrive un petit
cosaque blessé.
Lors d'une récente bataille, ce petit cosaque avait recueilli
un grand diable de fantassin qu'un éclat d'obus avait couché.
Il l'avait emporté sur sort cheval rapide, et, comme il galopait
vers une ambulance, une balle l'avait atteint lui-même.
Il fallut alors évacuer sur Kiew avec les autres blessés
le grand fantassin et le petit cosaque.
Et à l'hôpital on reconnut que ce petit cosaque était
une toute jeune femme. Son mari est officier. Lui parti, elle s'ennuyait
à la maison ; et, pour se distraire, elle s'était engagée
comme volontaire à la suite d'une « sotnia ».
Mais la femme cosaque la plus célèbre est Mme Koudacheff,
l'exploratrice bien connue.
Elle a été versée dans l'armée du général
Rennenkampf, où elle est attachée au service des reconnaissances.
VARIÉTÉ
LES FEMMES ET LA GUERRE
Les combattantes - Les ambulancières.
-L'énergie d'une femme : Mme Macherez à Soissons. - Les
femmes à la caserne.
Le sentiment du devoir et l'amour du pays.
Lamartine, parlant des femmes en temps de guerre,
disait : « Par la pitié, elles se dévouent, par
l'enthousiasme, elles s'exaltent. Exaltation et dévouement, n'est-ce
pas là tout l'héroïsme ? »
Toutes les nations ont dans leurs annales quelques traits de cet enthousiasme
féminin, qui poussa les héroïnes aux armées
et fit parfois d'une femme la libératrice de sa patrie. Mais
aucune n'en a autant que notre pays. Si la miraculeuse figure de Jeanne
d'Arc domine de cent coudées et rejette dans l'ombre toutes celles
des autres guerrières françaises, celles-ci n'en sont
pas moins innombrables. Leur seule énumération emplirait
nos colonnes. Depuis Velléda, depuis les femmes gauloises et
les femmes franques qui suivaient leurs époux et leurs frères
au combat, dans toutes les guerres où leurs foyers furent menacés
on vit des femmes françaises se lever pour les défendre.
On en vit chevaucher sur les routes interminables qui menaient en Palestine
à la suite des chevaliers croisés. On en vit, pendant
la guerre de Cent Ans, qui prenaient la place de l'époux mort
ou prisonnier, et défendaient leur castel ou menacent leurs troupes
au combat. Les guerres de religion, la Fronde suscitèrent un
nombre incalculable d'héroïnes. Quant aux guerres de la
Révolution, elles précipitèrent aux armées
des familles entières, hommes, femmes, enfants, tous volontaires
prêts à mourir pour le salut de la République.
Au mois de juillet dernier huit jours avant qu'éclatât
la guerre, nous inaugurions à Mortagne du Nord, sur cette frontière
franco-belge, témoin des luttes les plus glorieuses et les plus
acharnées, un monument aux soeurs Fernig, les héroïnes
de Jemappes. Ce fut une cérémonie modeste - trop modeste
car le gouvernement français n'avait pas cru devoir s'y associer
- mais où Français et Belges communièrent dans
l'admiration des deux filles glorieuses qui avaient si vaillamment combattu
pour l'honneur de la France et pour l'indépendance de la Belgique.
Quelques jours plus tard, comme au temps de Jemappes, Belges et Français
se retrouvaient côte à côte devant la Meuse unis
pour la cause de la civilisation et du droit.
Dans les guerres du premier et du second empire, que de dévouements
féminins se manifestèrent ! On sait quel fut le rôle
de toutes ces vivandières, qui, tantôt faisaient le coup
de feu comme de braves soldats, tantôt, transformées en
soeurs de charité, soignaient les blessés à l'ambulance
ou leur portaient secours sous le feu de l'ennemi.
On ne célébrera jamais assez l'héroïsme et
l'abnégation des femmes de l'Année Terrible, volontaires
engagées dans les corps francs, receveuses des postes assurant
leur service sous le feu de l'ennemi, ou même simples ménagères
parisiennes qui souffrirent sans se plaindre toutes les horreurs du
siège, et dont Victor Hugo disait :
Sous l'étreinte inhumaine,
L'homme n'est que français mais la femme est romaine,
***
Les enthousiasmes guerriers sont aujourd'hui interdits aux femmes, mais
il leur reste le droit au dévouement et à la pitié
et c'est un droit qu'elles exercent mieux que jamais.
Les sociétés de la Croix-Rouge, les y ont admirablement
préparées. Sait-on que ces sociétés, depuis
une vingtaine d'années, ont fait l'éducation de quarante-mille
Françaises environ. Elles leur ont appris, dans leurs dispensaires,
les règles de l'hygiène et la science des pansements.
Bien avant cette guerre, nombre d'entre elles étaient allées
au Maroc exercer leur mission de pitié ; et elles y avaient servi
doublement la cause française, en soignant non seulement les
soldats de France, mais encore des indigènes, dont elles éveillèrent
ainsi la sympathie et la reconnaissance pour notre pays.
Le rôle de ces femmes qui luttent obscurément dans les
hôpitaux et les ambulances, contre la souffrance et la mort, n'est
pas moins héroïque que celui des combattants. Songe-t-on
à tout ce qu'il faut de courage et de sang-froid pour vivre jour
et nuit au milieu des horreurs que la guerre a causées, pour
voir sans cesse couler le sang, pour entendre les plaintes et trouver,
avec les soins qui soulagent, les paroles qui consolent.
Les femmes de France ont toujours excellé dans ce rôle
qui exige de la vaillance, de la bonté, du dévouement.
En 1871, après la guerre, au moment où les troupes allemandes
allaient regagner leur pays, le médecin en chef d'un corps allemand,
vint trouver la directrice d'une ambulance française où
des blessés ennemis avaient été admirablement soignés
et guéris.
- Madame, lui dit-il, nous ne voulons pas quitter le sol de France sans
venir vous remercier, non seulement au nom de la nation allemande, mais
au nom de l'humanité ; vous nous avez forcés à
nous incliner également devant la charité et devant le
patriotisme des femmes françaises.
Les blessés allemands soignés aujourd'hui dans nos ambulances
pourront, s'ils ont quelque sentiment de la reconnaissance, rendre pareil
témoignage aux ambulancières françaises. C est
encore une des vertus de ces femmes admirables. Elles ne font point
de catégories entre ceux qui souffrant, et elles soignent avec
le même dévouement amis et ennemis.
Pouvons-nous espérer qu'il en est de même de l'autre côté
de la frontière ?...
***
Mais les énergies féminines ne se seront pas seulement
manifestées, dans cette guerre, au chevet des blessés.
La guerre finie, nous saurons sans doute combien elles ont empêché
de pillages et de déprédations. Il est plus d'une de nous
villes envahies où, les hommes ayant dû fuir pour éviter
d'être emmenés en Allemagne, ce sont les femmes qui défendirent
seules leur foyer et leurs biens contre les convoitises de l'envahisseur.
Combien d'entre elles furent victimes de ses brutalités !
On vit même parfois des femmes prendre la place de magistrats
municipaux défaillants et sauver leur cité du pillage
et de la destruction.
Tel fut le rôle rempli par Mme Maclerez, à Soissons
Cette ville avait été abandonnée par les autorités
locales. Quand les Allemands s'y présentèrent, Mme Macherez,
veuve d'un ancien sénateur de l'Aisne, eut le courage d'aller
au devant d'eux et d'assumer la mission périlleuse que les représentants
de la ville avaient abandonnée.
- Où est le maire ? demanda le major allemand.
- Je n'en sais rien. Mais si le maire n'est pas là, je n'offre
à le remplacer, et je réponds de tout.
- Il me faut le maire, reprit le Prussien. Trouvez-le ou je vous fusille.
- Eh bien, fusillez-moi, répondit Mme Macherez.
Surpris par l'énergie de cette noble femme, l'Allemand s'adoucit
et consentit à traiter avec elle. Mme Macherez discuta pied à
pied les conditions de l'occupation et tint tête à l'ennemi.
Elle parvint par son attitude à en imposer à la soldatesque
teutonne et à préserver la ville des déprédations
dont elle n'eût pas manqué d'être victime si les
envahisseurs n'avaient pas trouvé à qui parler.
Combien d'hommes n'eûssent pas montré, en pareille circonstance,
l'énergie virile de cette femme !
***
Si la guerre avait été retardée de quelques années,
nous aurions peut-être vu les femmes allemandes y prendre leur
part.
Le service militaire féminin est, en effet, un problème
qui passionne nos ennemis. Préoccupés de mettre en ligne
le plus grand nombre possible de combattants, ils pensent depuis longtemps
déjà à confier aux femmes tous les services administratifs
de l'armée, afin de réserver uniquement aux hommes le
rôle actif de combattants.
Dès 1905, un projet avait été soumis dans ce but
au gouvernement allemand.
L'auteur de ce projet disait :
« L'homme paie sa dette à la patrie ; puisque la femme
veut être son égale, que ne paie-t-elle pas la sienne ?
»
Ce principe posé, il réclamait le service obligatoire
pour les femmes. A l'âge de la conscription, elles eussent passé
devant un conseil de révision chargé de choisir les sujets
normaux de corps et d'esprit. Voici la soldate (excusez ce féminin
) à la caserne. On l'instruit dans les services auxiliaires,
on la dresse à la discipline, à l'ordre, à l'exactitude.
On l'initie, en même temps, à toutes les obligations de
la femme dans le mariage, afin, que, sortie du régiment, elle
soit une ménagère parfaite et ne manque pas d'apporter
dans son ménage toutes les vertus.
Bien entendu, elle porte un uniforme. En Allemagne, où les moindres
fonctionnaires ont une tenue, cela va sans dire.
Ce rêve du caporalisme appliqué à la plus belle
moitié du genre humain ne manqua pas d'être repris par
les suffragettes d'outre-Rhin. Celles-ci, l'an dernier, renouvelèrent
le projet. Elles demandaient à passer deux années à
la caserne, et à y exercer les fonctions réservées
à leur sexe. Magasins d'habillement, buanderies, infirmeries
eussent été leur domaine.
C'est le plus sérieusement du monde qu'on agitait ces questions
en Allemagne.
Et, peu de temps avant la guerre, l' « Union des femmes patriotes
du Rhin inférieur » décidait de faire des démarches
auprès du gouvernement pour que les femmes allemandes fussent
enrôlées en temps de paix comme en temps de guerre.
Rendons cette justice aux femmes de France : elles n'ont jamais pensé
qu'il fùt pour elles nécessaire d'aller à la caserne
pour apprendre leur devoir vis-à-vis du pays. Au temps, des Croisades,
déjà, elles le pratiquaient sans avoir eu besoin de l'apprendre.
Les historiens nous montrent les femmes nobles suivant l'armée,
et parcourant les champs de bataille après la mêlée,
un vase d'eau fraîche sur l'épaule pour étancher
la soif des blessés et panser leurs plaies.
Aujourd'hui, sans qu'il ait fallu les enrégimenter, les femmes
de notre pays continuent à se consacrer à cette pieuse
et, héroïque mission.
Et, pour qu'elles accourent quand l'intérêt du pays l'exige,
point n'est besoin qu'on les appelle à la caserne. Elles ont
pour se dévouer spontanément à l'oeuvre d'héroïsme
et de pitié deux raisons suffisantes : le sentiment du devoir
et l'amour du pays.
Ernest LAUT.
Le Petit Journal illustré du 15 novembre 1914
Conseils Pratiques
Pour des raisons trop longues à développer ici, il a été
décidé que le deuil des Morts pour la Patrie, ne serait
pas porté avec l'austérité des deuils ordinaires.
Pas de longs voiles, pas de grands châles, pas d'exagération
de crêpe. Ceci est un hommage et une manifestation dont il faut
comprendre, le sens. La Famille française donne ses fils à
la Patrie... Ceux-ci sont des « Héros » qu'on ne
doit pleurer que dans le secret de son coeur. Leur fin est un sacrifice
glorieux dont nous avons, le droit de souffrir, mais que notre devoir
est d'accepter.
Par conséquent, toutes celles d'entre nous qui seraient empêchées
pour des causes quelconques de se faire la « toilette de deuil
» habituelle, sauront qu'elles se maintiennent dans la «
note juste »...
Les robes noires, les robes teintes avec un peu de crêpe, ce qu'il
en faut pour consacrer le caractère de la mise, seront utilisées
sans frais. Entre deux dépenses, mieux vaut restreindre celle
qui profiterait à un commerce, hélas ! trop prospère
en ce moment, et reporter l'économie réalisée sur
les industries et les gens qui souffrent.
Cousine JEANNE.