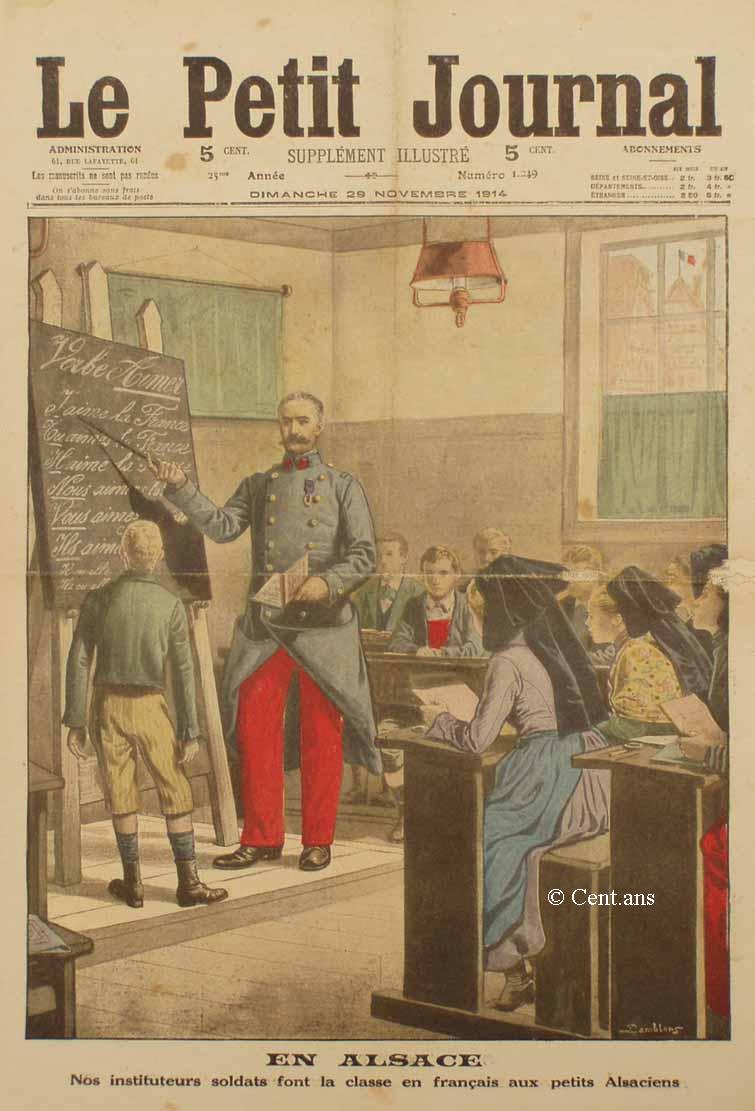EN ALSACE
Nos instituteurs soldats font la classe
en français aux Petits Alsaciens
Vous vous rappelez l'émouvant récit
d'Alphonse Daudet et : La dernière classe, que, naguère,
nos maîtres nous lisaient , au collège.
C'est dans une école d'Alsace, en 1871. L'instituteur annonce
aux écoliers :
« Mes enfants, c'est la dernière fois que vous fais la
classe. L'ordre est venu de Berlin de ne plus enseigner que l'Allemand
dans les écoles de l'Alsace et de la Lorraine. Le nouveau maître
arrive demain. aujourd'hui c'est votre dernière leçon
de français... »
Et le vieux maître termine sa leçon en pleurant, après
avoir écrit au tableau noir : « vive la France ! »
Pauvre vieux maître, pourquoi n'est-il plus là pour voir
la France rentrer triomphante dans les écoles d'Alsace.
Un de confrère a assisté à la première leçon
faite par un de nos instituteurs en costume militaire, dans une de ces
écoles :
« Dans la Schul und Gemeinhaus (maison d'école
et mairie ) dit-il, les petit Alsaciens, en leurs beaux habits du dimanche,
venaient de se réunir. Ils s'installèrent aux pupitres.
Quelques parents restaient debout dans le fond de la salle. Un brouhaha
fait de surprise et d'impatience accueillit le professeur.
« Où est-il ce vieux magister allemand, à barbe
rousse et à lunettes, rogue, pédant, la schlague en main,
image caricaturale de la kultur germanique, dont Hansi s'est
fait l'historiographe cruel ?
C'était un sous-officier, un sous-officier en tenue qui grimpait
dans la haute chaire.
« Clair visage rayonnant, trapu, décidé, blond,
les prunelles bleues : un vrai fils d'Alsace, pardieu ! Il s'adressa
en patois à ses élèves et aux parents ; tous éclatèrent
de rire. Et cette première leçon n'eut qu'un thème
une phrase d'abord parlée, qu'à tour de rôle sur
le tableau noir, puis sur les cahiers les enfants inscrivaient : «
La France est notre patrie.Vive la France ! »
VARIÉTÉ
La Fidélité de l'Alsace
Le drapeau de 1870. - L'Alsace terre français. --- Comment les Allemands s'y firent haïr. - Vive la France ! - Espoir de délivrance et de Liberté.
Le drapeau tricolore flotte en Haute Alsace.
On nous a conté ce trait admirable de la fidélité
alsacienne : à Thann, la jolie petite ville qu'arrose la Thur,
deux habitants avaient conservé pieusement depuis 1870 le drapeau
français qui était arboré alors sur l'Hôtel
de ville. Pendant quarante-quatre ans, avec une confiance et une ferveur
inlassables, ils l'avaient gardé, soigneusement caché
aux regards de l'envahisseurs, et certains qu'un jour viendrait où
ils pourraient l'arborer de nouveau au fronton de leur maison communale.
Et ce Jour est venu. Dès que les Français occupèrent
Thann, les deux Alsaciens sortirent de sa cachette le drapeau d'autrefois,
et l'apportèrent au commandant de nos troupes ; les couleurs
en étaient bien un peu fanées, mais on l'arbore, au rathaus
redevenu l'Hôtel de Ville, de préférence à
un drapeau neuf. Et tous les habitants de la petite ville, demeurée
si française de coeur, éprouvèrent la plus douce
émotion en voyant flotter sur leur cité ce drapeau de
l'Alsace de jadis, symbole de leur fidélité à la
France.
***
Or, cette fidélité qui se manifestait à Thann d'une
façon si touchante, on la retrouve dans toutes les autres villes
aussi bien que dans les campagnes de l'Alsace.
Loin d'effacer les souvenirs du passé, les quarante-quatre années
de l'occupation étrangère n'ont fait que les affermir
dans tous les coeurs alsaciens.
Un de nos confrères qui y fit, il y a quelques années
une longue enquête, en donnait au retour maintes preuves:
« J'ai fréquenté, disait-il, des Alsaciens de toutes
les classes, dont plusieurs étaient de paysans, et j'ai constaté
avec le plus grand bonheur, que l'Alaciens est resté le même
jusque dans le plus petit village, les traditions françaises
se sont conservées.. »
Ces traditions, l'Alsace y fut de tout temps fidèle. Elle fut,
au début de la Révolution, l'une des provinces qui vinrent
avec la plus d'enthousiasme aux idées de liberté.
C'est à Strasbourg, chez le maire Dietrich, que Rouget de Lisle
chanta pour la première fois « La Marseillaise ».
Plus tard, l'Alsase fut la terre d'héroïsme qui produisit
les plus glorieux soldats de la République et de l'Empire : Kléber
et Kellermann, Rapp, et ce type accompli de la probité, du courage,
de la modestie : François Joseph Lefebvre, duc de Dantzig.
Aux Allemands qui prétendaient que l'âme de l'Alsace est
d'essence germanique, un Alsacien répondit :
- Voici la preuve qu'elle est d'essence française : l'Alsace
a donné à la France un nombre incalculable de grands hommes
et de soldats illustres. Aux contraire, durant près d'un demi-siècle
d'occupation, elle n'a pas donné un grand homme à l'Allemagne.
C'est que, comme l'observe justement Emile Hinzelin, dans ses Images
d'Alsace-Lorraine, « en Allemagne, les Alsaciens et les Lorrains
n'ont rien à faire. Ils le sentent avec tristesse, mais non sans
fierté. »
Tandis que toutes les traditions, tous les liens de l'histoire, les
rattachaient à la France.
« Le sang alsacien et le sang français, dit encore Hinzelin
ont coulé ensemble pour la défense de droits de l'homme,
pour la protection du sol, pour la gloire de la patrie. Si le mot inoubliable
a un sens, c'est quand il s'applique à de tels souvenirs.
« On peut imaginer l'émotion qu'éprouvent les Strasbourgeois
qui vont si nombreux à Nancy, les Mulhousiens qui vont si nombreux
à Belfort, quand nous célébrons quelque fête
nationale. Ce peuple qui a pris la Bastille, ils en sont. Ce drapeau
, c'est le leur. Les Alsaciens et les Lorrains regrettent nos traditions
qui sont leurs traditions, nos gloires qui s'ont leurs gloires. La France
est leur noblesse à tous . »
On conçoit par là avec quel enthousiasme furent accueillies
nos troupes apportant aux Alsaciens l'espoir prochain du retour dans
le giron français.
***
Et pourtant, Dieu sait si les Allemands mirent
tout en oeuvre pour germaniser l'Alsace. Ils usèrent tour à
tour de la persuasion cauteleuse ou de la brutalité. Mais ils
ne réussirent ni dans un genre ni dans l'autre.
D'abord, ils enseignèrent aux petits Alsaciens qu'en reprenant
leur pays ils n'avait fait que de reprendre leur bien. L'Alsace, leur
disaient-ils dans les livres classiques, a été allemande
avant de devenir française « par la force ou par la russe
» ; Les Alsacien appartiennent à la grande famille allemande
qui a salué leur retour avec joie.
Mais les petits Alsaciens ne prirent pas, au sérieux cette façon
d'interpréter l'histoire.
« En prenant l'Alsace, dit Paul Acker, les Allemands prétendaient
ramener à la vieille patrie des frères perdus. Or, quand
les Alsaciens les virent, fonctionnaires, officier, sous-officier, employés,
qui envahissaient l'Alsace et s'y installaient, ils les considérèrent
à la fois comme des barbares et des grotesques... Une continuelle
comparaison entre la civilisation française et la civilisation
allemande s'imposait à l'Alsacien et tournait le plus souvent
au désavantage de l'Allemands....»
Des Barbares ! ... hélas ! ce ne sont plus seulement les Alsaciens
qui voient les Allemands sous cet aspect, c'est l'Europe, c'est l univers
civilisé qui sont aujourd'hui témoins de la barbarie tudesque.
Mais leurs ridicules, plus encore que leurs brutalités, les desservirent
en Alsace.
Il semble que ce soit le privilège des Allemands de susciter
la moquerie des peuples qu'ils prétendent asservir. Voyez plutôt
ce qui se passe en ce moment à Bruxelles, où les «
Ketjes », les gavroches du quartier de Marolles ne tarissent pas
de railleries sur les envahisseurs.
Ainsi en fut-il en Alsace. Ce qui prouve bien que ce pays est vraiment
français, c'est que le ridicule y tue, tout comme en France.
Les Allemands en savent quelque chose ; et les caricatures de Hansi,
de Zislin, qui les montrent sous toutes les formes du grotesque ont
plus fait pour éloigner l'Alsacien de l'Allemand que tous les
abus de pouvoir des fonctionnaires et toutes les brutalités des
officiers teutons.
« On nous craint, on ne nous aime pas « disait naguère
un écrivain allemand.
Toute l'histoire de l'Alsace, depuis quarante-quatre ans, illustre cette
vérité. Et rien n'a mieux servi la cause française
en ce pays que cette crainte inspirée par l'arbitraire allemand.
Un sentiment qu'il faut dissimuler et enfermer en soi-même acquiert
de ce fait plus de force et d'intensité. L'amour de la france
grandit dans l'âme alsacienne en conséquence des persécutions
allemandes.
J'étais allé, il y a quelques années faire une
conférence dans une ville d Alsace.
- Surtout, m'avait dit les organisateurs, ne faites pas la moindre allusion
à la France : il y a dans la salle deux commissaires de police
qui vous expulseraient incontinent.
Mais la causerie terminée, en intimité, quelle revanche
: toute la table du souper était ornée de rubans tricolores,
et l'on ne parlait que de la France toute la soirée.
Hansi, il y a quelques mois, nous citait, dans un dîner à
la société des Gens de Lettres, un trait de cet esprit
frondeur des Alsaciens, de ce besoin impérieux qu'ils ont témoigner
à la barbe des Allemands de leur amour pour la France.
Il y avait à Colmar un festival de musique. Comme bien vous pensez,
on n'avait pas permis aux fanfares française d'y prendre part,
mais on avait pourtant fait exception pour une musique composée
d'élèves d'une école située de l'autre côté
de la frontière. Des enfants, cela n'était pas dangereux.
Des enfant cela n'était pas dangereux.
Les petits musiciens français remplirent leur programme et furent
très applaudis.
Le soir, quand ils regagnèrent la gare, tous les enfants de Colmar
les accompagnaient.
Hansi les regardait passer de sa fenêtre, et il entendait comme
un murmure rythmique qui scandait leurs pas. Que disaient-ils donc ?...
Le dessinateur sortit, s'approcha, et il entendit nettement alors ce
refrain qu'à voix basse les enfants répétaient
en marchant, sur l'air des Lampions:
« Vive La France ! Vive La France ! Vive La France ! ..»
Voilà comment, dans la servitude, les Alsaciennes se vengeaient
de la tyrannie des vainqueurs.
***
Je me rappelle une belle page d'Alphonse Daudet, dans laquelle le maître
a noté d'un trait vigoureux la force d'âme de la race alsacienne.
C'est le récit d'une promenade à travers les champs de
la province perdue.
Sur le chemin de Dannemarie, à un tournant de la haie, un champ
de blé lui apparaît tout un coup, fauché, raviné
par la pluie et par la grêle, croisant par terre, en tous sens,
ses tiges brisées.
« Les épis lourds et mûrs, dit-il, s'égrenaient
dans la boue, des volées de petits moineaux s'abattaient sur
cette moisson perdue, sautant dans ces ravins de paille humide et faisait
voler le blé tout autour.
En plein soleil sous le ciel pur, c'était sinistre, ce pillage...
Debout, devant son champ ruiné, un grand paysan, long, voûter,
vêtu à la mode de la vieille Alsace, regardait cela silencieusement.
IL y avait une vraie douleur sur sa figure, mais en même temps
quelque chose de résigné et de calme, je ne sais quel
espoir vague
comme s'il s'était dit que, sous les épis couchés,
sa terre lui restait toujours vivante, fertile, fidèle, et que
tant que la terre est là, il ne faut pas désespérer...»
Ce paysan résigné, confiant en sa terre, n'est-ce pas
l'image même de l'énergique Alsace que les malheurs n'ont
point abattue... Aujourd'hui l'Alsacien peut se féliciter de
cette confiance et de cette résignation. L'espoir que le maître
écrivain lisait sur les traits de ce paysan, anime à présent
tous les coeurs d'Alsace : espoir dans le retour à la patrie
aimée, espoir de délivrance et de liberté.
Ernest Laut
Le Petit Journal illustré du 29 novembre 1914