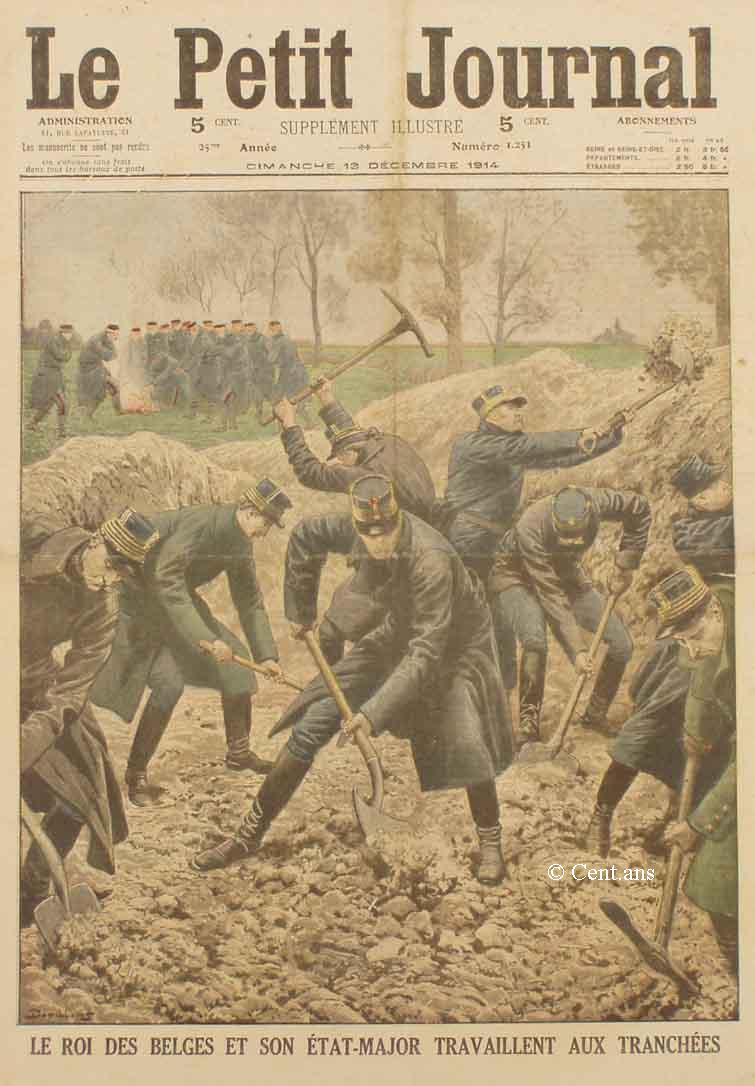LE ROI DES BELGES ET SON ÉTAT-MAJOR TRAVAILLENT DANS LES TRANCHÉES
Il faisait très froid ce jour-là,
et les troupes sur l'Yser souffraient terriblement.
En dépit de la température, le roi Albert resta longtemps
près des tranchées. A un moment, il rencontra quelques
soldats qui, après avoir creusé la terre, laissaient là
leurs pelles et soufflaient dans leurs mains pour les réchauffer.
Le roi leur dit :
- Il fait joliment froid, n'est ce pas ?
Les soldats, reconnaissant le souverain n'osèrent protester que
faiblement ; mais le roi, avec un sourire charmant, se tournant vers
les officiers de l'état-major, dit :
- Messieurs, je propose de relever ces braves garçons et de creuser
des tranchées à leur place jusqu'à ce qu'ils aient
plus chaud.
Un quinzaine d'officiers supérieurs se proposèrent comme
volontaires et s'emparèrent des pelles. Le roi fit de même
et pendant quelque temps, au milieu d'une grande gaîté,
le jeune et héroïque roi-soldat et ses conseillers militaires
remuèrent la terre.
Tous les actes et, jusqu'aux moindres gestes de cet admirable souverain
sont inspires par l'âme la plus généreuse et reflètent
la plus noble simplicité.
VARIÉTÉ
La fin du pantalon rouge
La tenue invisible. - L' uniforme autrefois et aujourd'hui. -Origine du pantalon rouge. - Tenue de guerre et tenue de paix. - Tout passe.
Cette fois, c'est fait de lui. La grande guerre
de 1914 n'aura pas fait que des victimes humaines : elle aura tué
ce symbole : le pantalon rouge.
Depuis quelques années déjà, le pantalon rouge
semblait condamné. Les leçons des guerres récentes
avaient révélé le danger de tout ce qui brille
et rutile dans l'uniforme. Éclair d'acier, couleurs brillantes
étaient destinés à disparaître. La guerre
d'à présent est un terrible jeu de cache-cache. Comme
disait plaisamment un de nos troupiers : « C'est le moment de
nous montres cachons-nous ! » On se dissimule dans des trous ;
on s'habille de teintes neutres ; on supprime les boutons, les galons,
tout ce qui peut servir de point de mire à l'ennemi.
On conçoit que, dans de telles conditions, le pantalon rouge
soit un anachronisme. Il est d'un autre siècle, du siècle
des pompons, des plumets, des panaches, des épaulettes, des aiguillettes,
toutes choses que la guerre moderne a remisées dans le bric-à-brac
du passé.
Au surplus, nous sommes, une fois de plus, les derniers à sacrifier
au progrès inéluctable l'uniforme traditionnel de nos
soldats. De toutes les grandes puissances la France était la
seule dont l'armée fut dépourvue d'une tenue de guerre
de couleur neutre.
L'armée anglaise est habillée de kaki depuis 1900 ; l'armée
japonaise de khaki jaune clair depuis 1900 ; l'armée des État-Unis
de kaki depuis 1904 ; l'armée russe de gris vert depuis 1909
; l'armée allemande de gris clair depuis 1909 ; l'armée
autrichienne de gris bleu brochet depuis 1908 ; l'armée italienne
de gris verdâtre depuis 1908 ; l'armée turque de gris verdâtre
de puis 1909. Les armées de tous les autres États, Serbie,
Grèce, Norvège, Chine même, ont des uniformes de
guerre.
Ce n'est pas que, chez nous, on ait tenu la question pour négligeable
: on s'en préoccupait fort au contraire, et, comme le principe
de nos administrations est d'ignorer de parti-pris ce qui se passe au
dehors, on multipliait les essais inutiles alors qu'il eût été
si simple de s'inspirer de l'exemple de l'étranger et de prendre
parti sans tarder... Mais, que voulez-vous, il faut bien dépenser
l'argent du budget !
En 1903, on essaya d'une tenue dite boër, gris fer bleuté
; et nous vîmes quelque temps des soldats revêtus de cet
uniforme, avec le chef coiffé d'un feutre aux larges ailes qui
leur donnait l'air de bons bourgeois hollandais du temps passé.
La tenue boër ne fut pas adoptée. L'année suivante
on essaya le beige mêlé au bleu et trois ans plus tard
le marron. Toutes ces tenues n'eurent pas plus de chance que la tenue
boër.
En 1903, enfin, nous eûmes la tenue réséda, laquelle
n'eut pas plus l'heur de plaire que les précédentes. Finalement,
on s'en tint à la vieille capote bleue et au pantalon rouge de
nos pères.
Tous ces essais n'avaient eu pour résultat que de coûter
très cher : c'est généralement ainsi que se traduisent
en France toutes les tentatives de réformes administratives.
Cette année enfin, la nécessité aidant, sans qu'il
fût besoin d'essais coûteux et sans qu'on eût réuni
de commissions compétentes, nous avons vu naître l'uniforme
bleu pâle, couleur de nos canons ; et ce sera l'uniforme de l'avenir.
**
Nous ne tenterons pas, en ce rapide article, de résumer l'histoire
de la tenue militaire à travers les âges : il y faudrait
un volume.
La pratique de l'uniforme est de date relativement moderne ; elle ne
remonte guère qu'à deux siècles et demi. Auparavant,
sauf quelques corps de la garde du souverain, pour les Suisses et les
Écossais notamment, l'uniforme n'existait pas.
Les soldats des compagnies de reîtres ou de lansquenets qui s'engageaient
au service de nos rois étaient généralement vêtus
de façon la plus hétéroclite du monde. C'étaient,
disait Brantôme, « de vrais traîneurs de guenilles,
plus habillés à la pendarde qu'à la propreté.
»
C'est seulement sous Louis XIII qu'on commence à voir les soldats
des troupes de la même arme uniformément habillés.
Mais l'uniforme n'est obligatoire dans toute l'armée qu'à
partir de 1670. Une ordonnance de Louvrois règle tous les détails
de cette réforme militaire.
A la fin du règne de Louis XIV, le soldats est enfin équipé
pratiquement pour la guerre. Regardez au au musée de l'armée
les uniformes de ce temps-là : ils vous apparaîtront plus
modernes, mieux conçus peut-être que les uniformes d'aujourd'hui.
La Révolution adopta la couleur bleue pour les habits des soldats.
On vit courir sur tous les champs de bataille de l'Europe « ces
habits bleus par la victoire usé ». Mais sous l'Empire,
le bleu fut un instant abandonné. L'indigo qui servait à
la teinture des draps militaire venait d'Angleterre, et l'Empereur ne
voulait employer aucun des produits de l'industrie anglaise.
Il essaya de habit blanc. Essai malheureux dont il ne tarda pas à
se repentir.
C'était, en effet, une idée singulière que d'habiller
de blanc des soldats destinés à passer leur vie au bivouac.
Au bout de quelques jours les habits étaient d'une saleté
repoussantes. On mit l'habit blanc au rancart et 1'on revint à
l'habit bleu teint avec du pastel au lieu d'indigo.
Les soldats d'alors devaient porter la culotte, mais en campagne ils
la portaient le moins possible. Bien qu'elle leur fût gratis,
ils préféraient revêtir des pantalons qu'ils payaient
de leurs deniers. Un officier, qui fit, le récit de la guerre
de Prusse de 1806, raconte que, dès le premier jour de l'entrée
en campagne, les soldats jetèrent leurs culottes.
« Le lendemain du premier bivouac, dit-il, celui qui eût
vu l'énorme quantité de culottes qui jonchaient la plaine
où nous avions couché, eût pu croire que l'ennemi
nous ayant surpris pendant la nuit, nous nous étions sauvés
en chemise. » C'est que les hommes préféraient le
pantalon qui laissait toute liberté aux mouvements de la jambe,
à la culotte qui, en serrant le jarret, paralysait les efforts
des plus intrépides marcheurs.
La Restauration garda le pantalon, mais elle le voulut blanc. L'inconvénient
qui avait fait rejeter cette couleur sous l'Empire ne tarda pas à
apparaître de nouveau. On chercha quelle couleur adapter. Or,
à cette époque, on cultivait la garance entre le Rhône
et la Durance , et cette culture menaçait de péricliter
faute de débouchés. Pour la sauver, le gouvernement de
Charles X résolut de teindre en rouge les pantalons des soldats.
Telle fut l'origine du pantalon rouge : son adoption eut pour cause
un intérêt économique. Il est vrai qu'on déclara
pour la justifier qu'on avait voulu surtout prendre une teinte sur laquelle
les taches de sang seraient moins apparentes que sur le pantalon blanc.
Depuis lors, le pantalon rouge a été, en quelque sorte,
le vêtement symbolique du troupier français.
On l'a vu en Algérie, en Italie, en Crimée, au Mexique,
partout où s'est dépensé l'héroïsme
de nos soldats ; l'héroïsme de nos soldats ; on l'a vu sur
les champs de bataille de la guerre funeste ; on l'aura vu encore sur
ceux de la guerre de revanche ; et, tous ceux qui l'ont porté
dans les heures de gloire ou de détresse ne verront pas disparaître
sans un serrement de coeur.
Le pantalon rouge était bien une spécialité française.
Seule, l'Autriche l'a employé jusqu'ici, et seulement pour sa
cavalerie.
La raison pour laquelle il fut adopté par les cavaliers autrichiens
est, d'ailleurs, curieuse, peu connue, et vaut d'être rapportée.
Il y a tout juste un demi-siècle, Maximilien d'Autriche venait
d'être nommé empereur du Mexique. Grand admirateur de l'armée
française, il voulait avoir des troupes à l'image des
nôtres. A cet effet, il avait commandé aux fabriques de
Brünn et de Reichenberg des quantités considérables
de drap rouge. Les industriels autrichiens se méfiaient de aventure
mexicaine ... Ils déclarèrent ne consentir à exécuter
les commandes Maximilien que si l'Empereur, son père, voulaient
bien en garantir le paiement.
La condition fut acceptée. Quand survint la catastrophe de Queretaro,
les fabricants informèrent donc cabinet de Vienne qu'ils tenaient
à sa disposition les laissés pour compte de Maximilien.
Justement les troupes autrichiennes étaient revenues des campagnes
de Bohème et d'Italie en assez mauvais état. Le besoin
de les habiller de neuf se faisait sentir. Si l'on utilisait les draps
du Mexique ?
Ce qui fut fait. Et voilà comment notre pantalon rouge est devenu
le pantalon des cavaliers d'Autriche.
***
Nous aurons donc désormais une tenue de guerre, une tenue invisible.
Mais sera-ce une raison pour ne pas avoir aussi une tenue de paix qui
conserve l'uniforme un peu son prestige d'autrefois ? Les autres peuples
ne l'ont pas pensé. Tous ont gardé au soldats en temps
de paix quelques-uns de ces ornements qui rehaussent la sévérité
de l' uniforme.
Chez nous, depuis quelques années, on a sacrifié sans
pitié tous ces attributs militaires ; la tenue, peu-à-peu,
a été réduite a sa plus simple expression. On a
supprimé successivement le shako, les gants, les guêtres
blanches, la tunique, le pompon, l'épaulette. Tout ce qui donnait
au soldats l'air martial, tout ce qui suscitait en lui quelques instinct
d'élégance, tout cela a disparu.
Pourquoi ne lui rendrait-on pas un peu de tout cela quand la guerre
sera finie ?
« Il faut, dit un officier, laisser à chaque arme les détails
de la tenue qui lui donnent son air particulier, sous peine de détruire
cet esprit de corps qui fait faire des prodigues. Gardez à l'armée,
en temps de paix, ce qui brille, ne dites pas qu'elle a un aspect théâtral.
Il lui faut du panache pour avoir conscience d'elle-même, pour
puiser dans les applaudissements de la foule le courage dans la victoire
ou dans le malheur.»
Pour le moment. approuvons tous les efforts faits pour rendre nos soldats
invisibles, puisqu'il y a va de leur vie. Acceptons donc sans trop de
regrets la suppression du pantalon rouge. Mais il est bien permis de
lui dédier à l'heure où il disparaît un hommage
ému. Il était l'attribut par excellence de nos troupes
; parler du pantalon rouge c'était parler de l'armée même
; et je me rappelle que, du temps de ma jeunesse, en rhétorique,
on nous donnait comme exemple de « métonymie » :
« Aime le pantalon rouge, c'est-à-dire aimer les militaires.
»
Hélas ! C'est la loi inéluctable : tout passe, tout s'efface.
Le temps n'est plus des crâneries guerrières. On se bat
sans se voir ; et l'uniforme éclatant devient un danger. Il faut
donc abolir ce que J.-J. Weiss appelait « les pétillements
du pantalon rouge », et dire adieu à ce bon vieux vêtement
si français qui disparaît, enseveli à jamais dans
un siècle de gloire militaire.
Ernest LAUT.
Le Petit Journal illustré du 13 décembre 1914