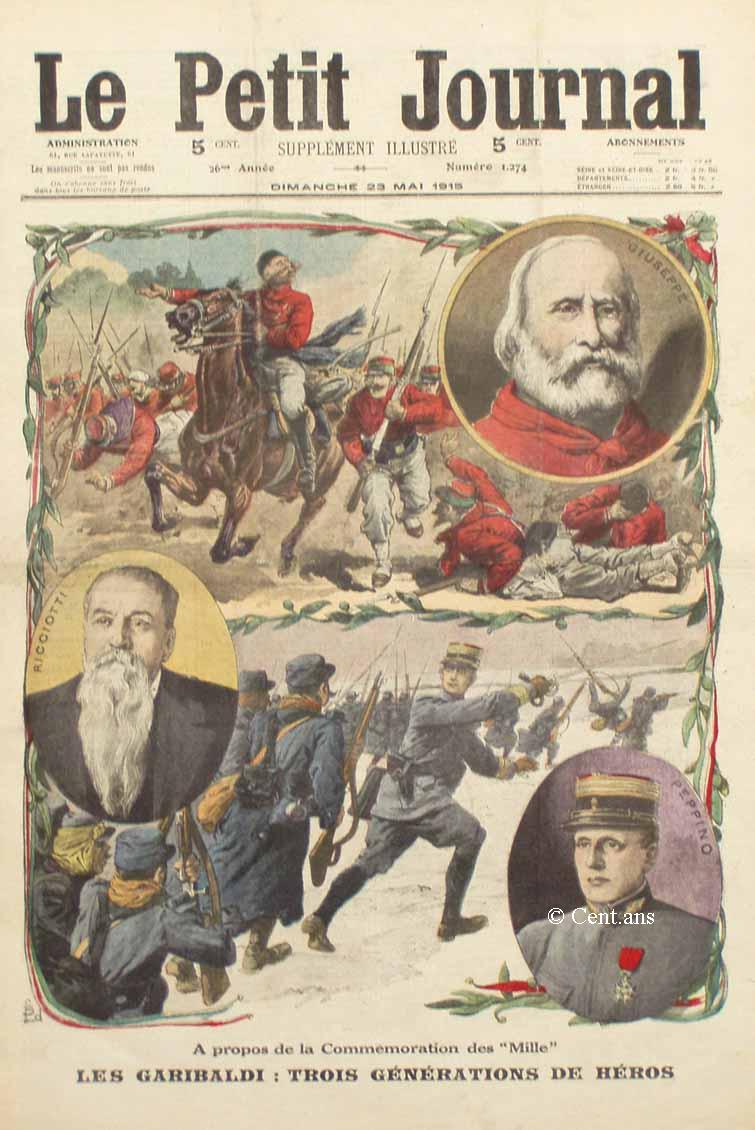A propos de la commémoration des « Mille »
LES GARIBALDI :
TROIS GÉNÉRATIONS DE HÉROS
L'inauguration du monument élevé
sur le rocher de Quarto, en commémoration de l'expédition
des « Mille », qui, partit de là pour la conquête
des Deux Siciles, nous a donné l'occasion de faire revivre dans
notre « Variété » la grande et noble figure
de Giuseppe Garibaldi, le héros de l'indépendance italienne.
Mais en célébrant le souvenir de l'ancêtre, comment
ne rendrait-on pas hommage à ses descendants ?
Admirable famille que celle-ci. Trois générations de héros
l'ont illustrée. Tous ceux qui portent ce nom glorieux de Garibaldi
sont toujours prêts à prendre les armes pour la défense
du droit et de la liberté. C'est ainsi qu'en 1870, Garibaldi
et ses fils sont venus mettre leur vaillance au service de la France.
C'est ainsi que, dans la présente guerre, Ricciotti Garibaldi
a envoyé ses fils combattre pour notre pays, et que deux d'entre
eux sont tombés en luttant pour la cause française.
Aussi la France s'est-elle associée unanimement à l'hommage
rendu au grand patriote italien dont la mémoire n'est pas moins
honorée chez nous que dans le pays qui lui doit son indépendance
et son unité.
VARIÉTÈ
Les Chemises rouges
A propos d'une commémoration. - L'expédition des Mille. - Garibaldi et les Garibaldiens. - Pour la gloire et pour la liberté.
Nous étions au nombre de mille,
Venus d'Italie et d'ailleurs;
Garibaldi, dans la Sicile,
Nous conduisait en tirailleurs.
Ces vers d'une célèbre chanson
de Nadaud nous reviennent en mémoire à propos de la fête
par laquelle l'Italie vient de glorifier le souvenir des Garibaldiens
qui firent, en 1860, l'expédition des Deux-Siciles
Les mille, en réalité, étaient plus de mille :
ils étaient exactement 1.085. Il y avait des Italiens de toutes
les provinces ; il y avait même un corps de Français que
commandait un ancien officier de marine nommé de Flotte, et sous
lequel servaient Ulric de Fonvielle, Édouard Lockroy, Maxime
du Camp, sans compter Alexandre Dumas, le père des Mousquetaires,
quelque peu mousquetaire lui-même, qui suivit l'expédition
à bord de sa goélette l'Emma.
Il y avait même une cantinière jeune et jolie, nommé
Colomba, qui s'était engagée afin de ne pas quitter un
frère pour lequel elle avait le plus vif attachement.
Garibaldi, l'homme de toutes les causes généreuses, l'apôtre
de la liberté, avait réuni cette phalange d'aventuriers
héroïques pour achever l'unité italienne que la campagne
franco-piémontaise de l'année précédente
avait commencée.
Il partit de Gênes avec sa troupe dans la nuit du 5 au 6 mai 1860.
Trois mois plus tard, les Bourbons de Naples étaient vaincus
et l'Italie méridionale était libre.
Cette commémoration des Mille, c'est aussi, c'est surtout celle
de leur chef, ce type d'épopée, ce condottière
du XVIe siècle égaré en plein XIXe.
Nice, ville alors italienne, vit naître Giusteppe Garibaldi en
1807. Le père, Dominique Garibaldi, était marin ; l'enfant
fut bercé sur le bateau paternel. Avant l'âge d'homme,
il s'engageait dans la marine sarde. Déjà, le projet de
délivrer son pays, courbé sous le joug étranger,
hantait ses veilles. Affilié au parti de la Jeune Italie fondé
par Mazzini, accusé d'avoir pris part à un complot contre
le gouvernement, il dut fuir et passer en Afrique.
Après avoir été quelque temps officier dans la
flotte du bey de Tunis, il partit pour l'Amérique du Sud guerroyer
contre Rosas et le gouvernement de Buenos-Ayres, C'est là que
naquit la première légion garibaldienne. Quelques centaines
d'Italiens habitant Montevideo vinrent se ranger sous ses ordres. Il
accomplit avec eux de véritables prodiges militaires dignes d'inspirer
une épopée.
En 1848, les événements le ramènent en Italie.
Ses hommes le suivent. Successivement les troupes de Charles-Albert
et celles du roi de Naples sont taillées en pièces par
des volontaires indomptables.
Quelle singulière armée, pourtant !
« Représentez-vous, écrit l'un de ces aventuriers,
un assemblage hétérogène d'individus de toutes
sortes : des enfants de douze ou quatorze ans ; de vieux soldats attirés
par la renommée du célèbre capitaine de Montevideo
quelques-uns stimulés par une noble ambition ; d'autres désireux
de trouver l'impunité et la licence dans la confusion de la guerre,
retenus cependant par l'inflexible sévérité de
leur chef, près duquel le courage et la hardiesse pouvaient seuls
se donner carrière, tandis que les passions les plus effrénées
étaient courbées sous sa volonté de fer.
« Le général et son état-major sont à
cheval sur des selles américaines, vêtus de blouses écarlates,
avec des chapeaux de toutes les formes possibles. Sans distinction d'aucun
genre, sans prétention à un ornement militaire quelconque,
ils semblent s'enorgueillir de leur dédain des règles
prescrites aux troupes régulières... »
Au milieu de cet état-major se détache une noble et touchante
figure guerrière, celle d'Anita, l'épouse de Garibaldi.
C'est une Brésilienne. Elle a rencontré l'aventurier à
Laguna, lors de ses campagnes en faveur de la république de Rio
Grande ; elle s'est éprise de lui et l'a épousé.
Dès lors, elle n'a cessé de le suivre à travers
sa vertigineuse épopée.
Épouse modèle, digne femme d'un héros, Anita voulut
combattre aux côtés de son mari, partager entièrement
sa vie jusque dans ses dangers.
Jusqu'à la fin de la guerre, elle fut tantôt l'héroïne,
tantôt la consolatrice, luttant sur le champ de bataille ou veillant
au chevet des blessés.
Puis, quand intervint la paix, elle devint la ménagère
attentive, le soutien du héros dont elle portait le nom. Garibaldi
l'amena avec lui en Italie. Dans la campagne de 1849, elle reprit le
fusil et combattit de nouveau auprès de son mari. Mais, épuisée
par les fatigues, elle devait mourir avant la fin de la lutte.
Presque seul, poursuivi par les ennemis victorieux. Garibaldi se réfugia
un jour dans une ferme auprès de Ravenne. Il portait Anita mourante
dans sas bras.
Le malheureux chef de partisans n'eut pas même la consolation
suprême de rendre les derniers devoirs à sa femme, à
la compagne de ses dangers et de sa gloire. Il lui fallut fuir. Le fermier
enterra le corps dans un bois voisin.
Plus tard, les habitants de Ravenne élevèrent une chapelle
sur le tombeau de l'héroïque, pour répondre à
l'appel que Garibaldi leur avait adressé de loin :
« Habitants de Ravenne, leur disait-il, recueillez les cendres
de la guerrière américaine, de la martyre de votre rédemption.
Je les place sous votre sauvegarde. Vous accomplirez ainsi une oeuvre
pie. Tous ceux qui la connurent, tous les patriotes vous béniront...
Terre des Ravennais, terre des coeurs généreux, sois légère
à mon Anita !..»
Aujourd'hui, le corps d'Anita Garibaldi repose auprès de celui
de son mari dans le mausolée de Caprera.
***
Anita morte, l'Italie retombée sous le joug autrichien, Garibaldi
va chercher au loin l'oubli de ses tristesses et de ses déceptions.
De nouveau, il part pour l'Amérique, va d'abord à San
Francisco, puis, de là, en Chine, et revient dans l'Amérique
du Sud. Au Pérou, on lui offre le commandement militaire du pays
; mais la nostalgie le prend : il veut revoir l'Italie ; il aime mieux
être capitaine de navire marchand à Gênes que général
dans le Nouveau Monde. Il repasse l'Océan, rentre dans sa patrie
et s'en va coloniser une petite île de la Sardaigne : Caprera,
attendant, dans la retraite l'heure où l'Italie se réveillera.
Cette heure sonne enfin. La guerre éclate en 1859. Garibaldi
se met à la tête d'une légion de 6.000 hommes déterminés
et recommence sa campagne de partisans.
- Mais, lui dit quelqu'un, vous n'avez pas de canon ; comment attaquerez-vous
les Autrichiens ?
- N'en ont-ils pas, eux ? répondit-il ; je leur en prendrai.
Dans cette campagne, raconte un de ses historiens, Garibaldi eut aussi
ses Thermopyles seulement il s'en tira avec plus de bonheur que Léonidas.
Un jour, dans le Tyrol, il se voit cerné, lui et les siens, par
des régiments ennemis.
- Mes amis, s'écria-t-il, s'il faut mourir, vendons cher notre
vie.
Aussitôt, il se penche sur son cheval, lui enfonce les éperons
dans le ventre, se jette, tête baissée, au milieu de la
colonne autrichienne, y fait une trouée, la coupe en deux, lui
passe sur le corps et disparaît.
Quand l'ennemi fait volte face pour le poursuivre, il n'est plus là
: On a vu quelque chose comme la foudre, l'ouragan, l'avalanche, traverser
les rangs et se dissiper.
La gloire de Garibaldi attire à lui les volontaires par milliers.
Le chef toise son homme :
- Je ne puis, dit-il, t'offrir que la soif et la chaleur pendant le
jour, le froid et la faim pendant la nuit, le danger toujours ; mais,
au bout de toutes ces souffrances, la liberté de l'Italie. Je
fais fusiller sans pitié les voleurs ; je punis sévèrement
les désobéissances. Maintenant, fais comme les autres
et ne te laisse pas prendre, car on ne te ferait pas quartier...
Mais l'honneur de porter la chemise rouge et de servir sous les ordres
d'un tel chef compense pour les volontaires les dangers et les privations.
Nul ne recule.
L'année suivante, quand Garibaldi prépare cette expédition
de Sicile dont l'Italie célébrait ces jours derniers le
souvenir, les soldats accourent en foule. Le général est
obligé de refuser des milliers d'engagements, par ses ressources
sont restreintes et ne lui permettent pas d'entretenir une armée.
Il part avec sa poignée d'hommes ; il part pour l'épopée.
Édouard Loclroy qui fit partie de l'expédition en a conté
quelques traits pittoresques :
« Nous marchions, raconte-t-il, sur Palerme, et Garibaldi ne savait
pas du tout si les populations se soulèveraient sur son passage.
» Il avait contre lui le haut clergé, tandis que le bas
clergé lui était plutôt favorable. Vous savez quelles
étaient les opinions religieuses de Garibaldi ; mais, avoir pour
lui le petit clergé, c'était un atout de plus dans son
jeu. C'était un homme supérieur qui ne négligeait
rien et se servait de tout pour arriver au but.
» Sur notre route, se trouvait un village très important....
Nous approchons, personne dans les rues, les maisons fermées.
Les habitants étaient tous dans l'église. L'arrivée
de Garibaldi, cependant, se sut immédiatement, et, quand nous
passâmes devant l'église, tous les assistants étaient
sous le porche et le curé se tenait à la tête de
ses fidèles.
» dès qu'il aperçut Garibaldi, ce bon curé
l'apostropha :
» - Descends de ton cheval !
» Garibaldi descendit.
» - Approche, maintenant, reprit le curé.
» Et, saisissant un immense crucifix, il ajouta :
» - Incline-toi !
» Garibaldi obéit.
» - Regardez, s'écria le curé, celui qui marche
de succès en succès, qui gagne batailles sur batailles,
vient de se courber devant celui qui donne la victoire !
» Et, crucifix sur l'épaule, il se mêla à
notre troupe, suivi de tous ses fidèles. Il se battit comme un
lion, à Palerme, ce bon curé, frappant avec son crucifix,
et couchant plus d'un ennemi à terre.
» Je les assomme, répétait-il parce que ma religion
me défend de verser du sang ! »
Quel aspect avaient ces soldats improvisés « venus d'Italie
et d'ailleurs » qui composaient la petite armée du condottière
? C'est encore Lockroy qui va nous le dire :
« C'étaient des hommes jeunes, portant. la moustache ou
la barbe. Ils avaient sur le tête un chapeau mou, de feutre gris,
à larges bords relevés ; sur le dos, des vareuses de toile
rouge foncé, salies par la poussière et la poudre. Tous
portaient en bandoulière, comme les officiers portent leur manteau
en compagne un foulard lie-de-vin dont, les deux bouts, négligemment
noués sur leur poitrine, tombaient jusqu'au ceinturon, à
plaque de cuivre, où pendait le coupe-choux. La fantaisie éclatait
seulement dans les pantalons. Les uns étaient noirs, les autres
blancs ; les autres plus irréguliers encore, à carreaux
ou à damiers. Ceux-ci se perdaient dans des guêtres de
cuir ; ceux-là couvraient presque entièrement des pieds
nus chaussé d'espadrilles. Soldats par le haut, les volontaires
se terminaient en pékins. On eût dit que ces hommes, encore
bourgeois la veille, n'avaient eu que le temps de passer une moitié
d'uniforme. Une révolution les avait jetés, à demi-habillés
dans l'Histoire.
» Au milieu d'eux marchait, le sabre de cavalerie au côté,
un homme petit, carré, robuste torse de lutteur, bras de marin,
qu'on devinait taillé pour les grandes fatigues de la guerre.
» Il était vécu comme les soldats. Comme eux, il
portait un feutre gris sur la tête et, autour du corps, un foulard
lie-de-vin orné de dessins blancs imprimés. Aucun signe
distinctif sur la vareuse rouge, ni galons, ni étoiles. Pourtant,
rien qu'à le voir, on devinait le chef. Mieux qu'à une
manche ou à un collet brodé, son grade se connaissait
à l'expression de son visage.
» Outre l'uniforme des volontaires, cet homme portait, attaché
sur ses épaules, un petit burnous blanc dont le vent agitait
les plis. Une paire de pistolets était passée à
sa ceinture. De temps en temps, il sarrêtait pour saluer. Sa main
gauche, gantée, caressait le pommeau de son sabre.
» Sur le passage de la troupe, une foule accourait de toutes parts,
composée d'hommes du peuple, de femmes et d'enfants déguenillés
qui sautaient pieds nus dans les décombres encore chauds et d'où
s'élevaient de longues fumées bleues. Les fenêtres
et les portes grinçaient sur leurs charnières et des têtes
apparaissaient à toutes les ouvertures des maisons. Et de ces
fenêtres, de ces portes, du milieu de cette foule grouillante,
un cri séchappait, immense que répercutait l'écho
: Garibaldi !... »
***
Tel était l'homme. Toujours debout pour la liberté ; et
non point seulement pour la liberté de son pays, mais pour la
liberté de toutes les nations opprimées.
De 1860 à 1867, maintes fois encore il se leva pour l'indépendance
de l'Italie. Il faillit même, en 1866, chasser les Autrichiens
du Trentin et rendre à l'Italie sa frontière naturelle.
Un armistice signé prématurément l'en empêcha.
La France fut le théâtre de ses derniers exploits. Quoique
malade, en 1870, il vint mettre son épée au service du
gouvernement de la Défense nationale. On sait quel fut l'héroïsme
des « Chemises rouges » aux trois journées de Dijon.
C'est là que la brigade de Ricciotti Garibaldi, fils du grand
condottière, et père des jeunes héros qui sont
venus cette fois encore se battre pour la France - prit un drapeau poméranien,
le seul qui fut conquis sur l'ennemi au cours de cette néfaste
campagne.
Ainsi, la tradition est demeurée dans la famille Garibaldi, la
tradition d'héroïsme et de dévouement à la
cause du droit et de l'indépendance. Les Garibaldiens d'aujourd'hui
n'ont plus la chemise rouge ; ils portent l'uniforme de couleur neutre
; mais sous la vareuse sombre comme sous la chemise écarlate,
c'est toujours le même coeur qui bat pour la gloire et pour la
liberté.
Ernest LAUT.
Le Petit Journal illustré du 23 mai 1915