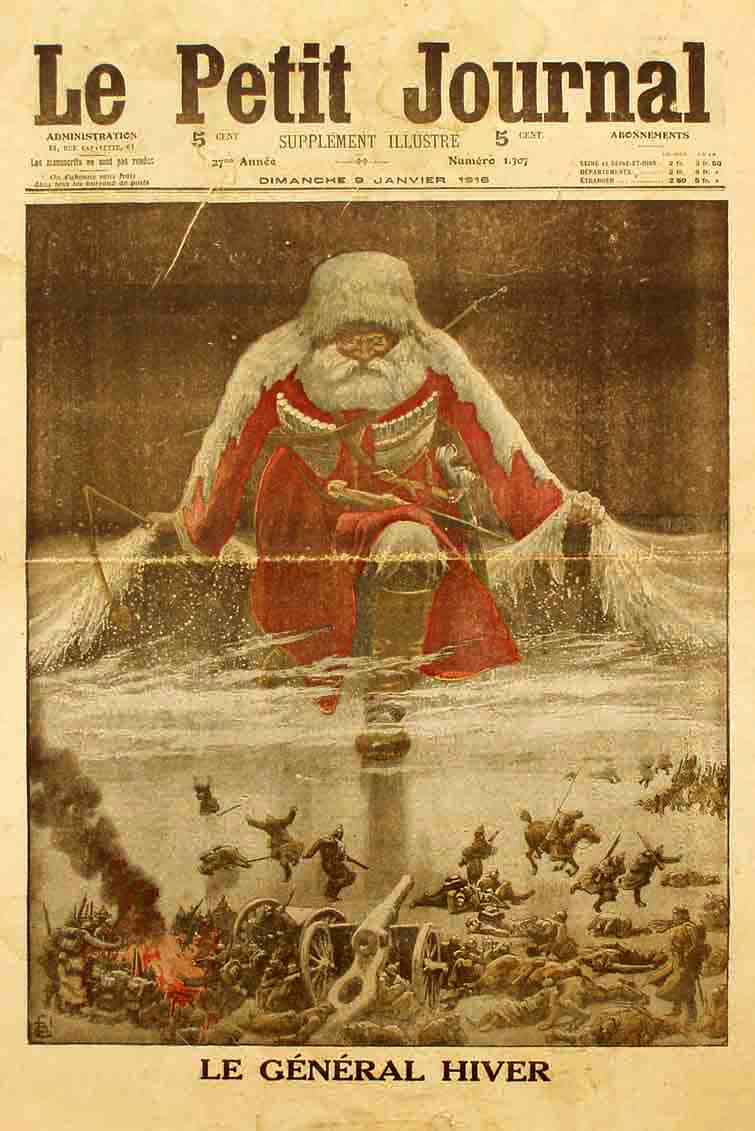LE GÉNÉRAL HIVER
Le général Hiver est un personnage
symbolique ; mais ce n'en est pas moins un terrible personnage. Les
Allemands en Russie sont en train d'en faire l'expérience.
Le général Hiver est un stratège dont les combinaisons
sont irrésistibles. A toutes les époques où la
Russie fut envahie, le général Hiver a été
son sauveur. Les Russes ont toujours eu en lui une confiance qui ne
s'est jamais démentie et que les événements ont
justifiée. Quand Napoléon, il y a cent trois ans, jeta
sur leur pays les innombrables bataillons de la Grande-Armée,
ils se contentèrent, comme ils le firent l'an dernier devant
les hordes allemandes, de se retirer et de faire le vide autour de l'envahisseur.
Puis ils attendirent l'entrée en ligne du général
Hiver. Et celle-ci se produisit à époque fixe et fut terrible.
Le vrai vainqueur de la Bérézina, ce fut le redoutable
Morozoff, comme on l'appelle familièrement en Russie, ce fut
le général Hiver.
Les Allemands le savent bien. La hantise de l'armée de Napoléon
fuyant de Moscou, dévorée par le froid, ensevelie sous
la neige, mourant dans les glaces, a dû empoisonner les nuits
du Kaiser et de ses lieutenants.
Aussi, dés le début de la campagne en Russie, le commandement
prussien a-t-il reçu l'ordre absolu depuis le général
jusqu'au sergent de défendre les hommes contre le froid. On cite
ces mots de Hindenburg dits aux chefs d'armée :
« Si dans les tranchées, près d'un commandant, officier
ou sous-officier, on trouve des soldats troués de balles, le
commandant aura la croix de fer pour avoir été dans un
endroit dangereux. Mais si on trouve près de lui un seul soldat
mort de froid, il sera fusillé pour n'avoir pas pris les mesures
nécessaires. »
Guillaume lui-même a donné des ordres à ce sujet.
« Quels que soient les froids de Russie, ils ne doivent pas exister
pour mes soldats dans les tranchées. Chez nous chaque homme est
compté. Assez tombent dans les batailles. Il serait criminel
de les perdre pour rien... J'abolis le gel russe. »
« Aussi, dit un correspondant des Débats, les
mesures ont été prises. - A travers toute l'Allemagne,
dans les villes, villages et hameaux, la cueillette des objets de laine
a été ordonnée.
« Des cuisines de campagne, des chaudrons gigantesques ont été
fixés sur des traîneaux. Des mitrailleuses, des pièces
légères sont montées sur des skis. Les ingénieurs
ont prévu les tempêtes terribles qui interrompent les communications
: ils ont préparé des locomotives spéciales avec
des chasse-neiges appropriés et, pour aplanir les routes, des
rouleaux compresseurs d'une formidables puissances.
Mais tout cela est-il suffisant pour résister aux attaques du
général Hiver ?
Les événements nous le diront. Mais d'ores et déjà,
il semble que ces attaques apparaissent terribles et que les Allemands
en souffrent cruellement.
Au milieu de décembre, des réfugiés arrivés
de Volhynie à Kiew racontaient que, dans les récents combats,
il y avait eu de nombreux Austro-Allemands trouvés gelés
dans les marais de la Polésie. On en trouve beaucoup dans les
tranchées abandonnées.
Le froid, disaient-ils, a surpris les Austro-Allemands à l'improviste.
Des envois importants de vêtements et chaussures pour l'hiver
sont restés embourbés, on ne sait où. Les soldats,
peu habitués à l'hiver russe, les Bavarois particulièrement,
en sont victimes.
Et cela ne fait que commencer. Allons, le général Hiver
accomplit de la bonne besogne. Il en fera de meilleur encore au fur
et à mesure que s'avancera la saison des frimas.
Le général Hiver est un bon allié des Alliés.
Salut et gloire au général Hiver !
VARIÉTÉ
L'hiver allié des Russes
Le froid en Russie. - 1812 et 1915. - Comment périt la Grande Armée. - Carnets de soldats allemands. - La présomption du Kaiser.
Nous décrivons plus haut, à propos
de notre gravure le Général Hiver, les précautions
prises par les Allemands pour lutter contre le froid en Russie.
Ces précautions auront-elles l'efficacité qu'escomptent
les généraux du Kaiser ? C'est douteux. On a préparé
l'opinion allemande, on a tenté de calmer les familles en répandant
dans les masses allemandes cette idée que la situation en 1915
n'est plus la même qu'en 1812, et que les armées allemandes
disposent, pour lutter contre le froid, de moyens que ne possédaient
pas celles de Napoléon.
Mais l'hiver est l'hiver ; et la nature est plus forte que la science,
cette science fût-elle allemande.
Les Boches d'ailleurs, n'en ont-ils pas fait déjà la cruelle
expérience en Russie ? Avant de connaître les rigueurs
de l'hiver russe, ils ont eu à souffrir celles de l'automne ;
et ils auront éprouvé l'horreur d'être enlisés
dans les marécages, avant de supporter le froid dans les solitudes
glacées.
Un soldat allemand tué en octobre dernier avait noté sur
son carnet les souffrances que l'armée boche commençait
déjà à subir à cette époque.
« Nous suivons maintenant nos ennemis, écrivait-il, à
travers un pays effroyable. Tantôt nous sommes embourbés
derrière eux à travers des marécages dans lesquels
de nombreux soldats tombent sans pouvoir se relever. Puis, nous pénétrons
dans de vastes forêts, presque vierges, et nous avançons
alors lentement, dans la crainte des pièges, car les Russes sont
inlassables et nous tendent embuscades sur embuscades. Puis ce sont
comme des steppes, que nous traversons sur des chemins sablonneux, si
l'on peut appeler ainsi des pistes à peine praticables, larges
de cinq à vingt mètres.
» Nous sommes enchevêtrés au milieu des convois,
qui n'avancent qu'avec difficulté, au milieu de batteries d'artillerie
qui, à tout instant, se trouvent enlisées. Nous sommes
alors obligés d'aider les artilleurs et de pousser aux roues
des canons ou des avant-trains, car les chevaux, fourbus, refusent souvent
de tirer plus longtemps les lourdes pièces. Et tout cela se passe
au milieu des cris des officiers et le sous-officiers, qui, dans le
brouhaha, sont obligés de hurler leurs ordres, au milieux des
jurons des conducteurs, dont les chevaux essoufflés, tirent en
vain sur les traits.
Tout cela n'est pas pour nous donner des idées gaies. La pensée
de passer l'hiver dans une telle région nous donne à tous
le frisson.
» Nous nous demandons tous, avec angoisse, ce que nous allons
devenir quand la neige commencera à tomber et que nous serons
là dans ce pays désert, sans abris. Aussi un camarade,
découragé et furieux, lance-t-il cette phrase que nous
approuvons tous : Tous ceux qui sont la cause de cette guerre maudite,
il faut les jeter dans la gueule d'un 420, avec une bonne charge de
poudre et faire feu. »
Voilà ce qu'ils écrivaient il y a trois mois, alors que
le froid ne sévissait pas encore. Et, depuis, l'hiver est venu
; la neige est tombée. Quelles souffrances doivent être
les leurs !
Beaucoup d'Allemands ne savaient pas ce qu'est l'hiver russe. Or l'hiver
russe, pour qui n'est pas Russe, est une chose effroyable.
Un de nos amis, qui a longtemps habité la Russie. nous disait
qu'une année où il se trouvait dans une ville au bord
de la Volga, il avait constaté que du mois de novembre au mois
d'avril, le thermomètre s'était maintenu entre 30 et 33
degrés au dessous de zéro. Un matin, il était descendu
à 41 degrés.
« De pareilles températures, nous disait-il, produisent
des effets bizarres. A l'étal des bouchers, on débite
la viande à la hache et l'on vous casse un filet de boeuf ou
une rouelle de veau.
» Devant les poissonneries, les magnifiques esturgeons de la Volga,
qui atteignent jusqu'à trois mètres de longueur, sont
appuyés contre les murs comme des pièces de bois, debout
sur leurs queues raidies par la gelée.
» Le froid est tellement intense que le vin du Caucase, vin fort
chargé en tannin et en alcool, gèle avec une rapidité
étonnante. Il me souvient qu'un jour j'envoyai chercher du vin
par le domestique chez un marchand de la ville; il avait pris pour rapporter
les bouteilles un panier rempli de foin et recouvert d'un feutre pour
les préserver de la gelée.
» La distance qui séparait la maison du magasin était
à peine d'un quart d'heure. Malheureusement, quand le domestique
rentra, la porte de service était fermée ; il déposa
son panier près de la porte et fit le tour de la maison pour
aller ouvrir la porte de l'intérieur. Quand il revint prendre
son panier, les bouteilles étaient autant de glaçons.
» Il est clair qu'avec des températures aussi rigoureuses
il faut prendre quelques précautions : les nez, les oreilles
et les joues gèlent avec une déplorable facilité,
et le plus désagréable, c'est que vous ne vous en apercevez
pas, vous n'éprouvez aucune douleur ; il faut qu'un voisin complaisant
vous avertisse que, votre nez. vos oreilles ou vos joues blanchissent.
On se rend du reste très obligeamment ce petit service. Une forte
friction avec de la neige suffit pour rétablir la circulation
et conjurer le mal. Les indigènes sont presque tous exempts de
ces petits accidents. Leur peau est sans doute à l'abri du gel,
car j'ai vu de braves moujiks assister tête nue, pendant près
d'une heure, à la bénédiction des eaux, qui a lieu
le jour des Rois, c'est-à-dire le 6/19 janvier, sans en éprouver
le moindre désagrément, tandis que mes oreilles étaient
réduites à l'état de chiffon et auraient certainement
subi de graves avaries, si un brave ouvrier ne m'eût averti à
temps. »
Les Russes sont à l'épreuve de ces températures
excessives. Mais il n'en saurait être de même des Allemands.
Et, quelques précautions qu'ait pu prendre leur grand état-major,
ils en souffriront comme en souffrit l'armée de Napoléon
et le froid les décimera comme fut décimée en 1812
la grande armée.
***
Lisez les mémoires des généraux et des soldats
qui firent la retraite de Russie. les Ségur, les Marbot, Boulard,
Piou, Lahaume, Griois, le sergent Bourgogne. Vous verrez quel rôle
terrible le froid a joué dans la défaite.
Dès le 6 novembre 1812, des masses de neige couvraient les chemins
les détachements s'égaraient ; les soldats, roidis par
le froid, abandonnaient leurs armes et tombaient entre les mains des
Cosaques.
Le 6 novembre, Cesare de Laugier, officier de la garde du Prince Eugène,
écrit :
« Un nouvel ennemi, plus terrible que le froid, a fait son apparition
: c'est le vent du Nord. Le ciel est sombre, la neige tombe à
flocons, poussée par un vent impétueux ; l'armée
en est enveloppée. Nous ne voyons plus rien autour de nous. Un
chacun se couvre de ce qu'il peut. Allons-nous mourir ainsi obscurément,
sans gloire ? »
La nuit qui précéda le passage de la Bérézina,
fut, à ce que raconte Ségur, une les plus cruelles depuis
le départ de Moscou. Le froid redoublait de violence : le vent
du Nord, plus âpre, fouettait une neige épaisse sur les
hommes sans abri. Et le froid allait toujours augmentant. Le 7 décembre,
le thermomètre descendit à 28 degrés au dessous
de zéro. Le froid. raconte un témoin, saisissait d'abord
les extrémités ; le soldat se laissait aller à
une torpeur que suivait bientôt la mort. Les plus jeunes mouraient
par milliers ; un grand nombre de ceux dont le corps endurci aux fatigues
pouvait résister plus longtemps, trouvant plus facile de mourir
que de vivre, se couchaient sur la neige et refusaient de se relever.
Le feu des bivouacs, dont ces malheureux s'approchaient sans précaution,
communiquait la gangrène aux parties gelées, et l'influence
d'une chaleur extrême, comme celle d'un froid excessif avait des
résultats non moins funestes.
Et les Cosaques, insensibles aux rigueurs de la saison, harcelaient
constamment ces soldats déprimés, ces troupes en déroute.
En deux mois la grande armée avait perdu les trois quarts de
ses effectifs.
***
Supposez que toutes les précautions prises par les Allemands
réduisent pour eux au minimum les effets de l'hiver russe, ces
effets n'en resteront pas moins redoutables encore.
Guillaume II ne se le dissimule, d'ailleurs pas.
« La Russie, déclarait-il au mois de novembre à
ses troupes, ne veut pas conclure la paix et base ses espérances
sur la venue des grands froids. Nous devons donc nous préparer
à la guerre en hiver. Je sais que vous êtes fatigués.
Nous avons cru à une guerre de quelques mois ; elle s'est prolongée.
il est donc impossible de ne pas être fatigué. Mais rappelez-vous
que tout cela n'est pas en vain. Votre effort de l'été
a eu de très brillants résultats. Ne nous laissons pas
aller à la fatigue l'hiver non plus. Nous opposerons aux rigueurs
du froid notre farouche énergie, de même que nous avons
opposé jusqu'ici notre gant de fer à la patte de l'ours
russe. »
Reste à savoir si la farouche énergie que préconise
le Kaiser résistera à 23 degrés de froid.
Les tranchées allemandes ont été approvisionnées
de braseros, fourneaux portatifs, réchauds ; on les chauffe avec
du bois ou des briquettes, et un couvercle ingénieusement adapté
empêche les flammes d'être vues par l'ennemi. Et cependant:
si l'on en croit les carnets trouvés sur les morts, les soldats
ont froid.
Les Boches ont aussi imaginé des traîneaux et des chariots
à patins, pour faciliter le ravitaillement en temps de neige
et de gelée ; et cependant les soldats ont faim.
Dès le 19 octobre un soldat allemand écrivait sur un carnet,
dont le journal russe Rietch a publié la traduction
:
« Il fait tellement froid, dans nos abris, cette nuit qu'il m'a
été impossible de fermer l'oeil. »
Et le Boche, dégoûté d'une si rude campagne ajoutait
:
« Oh ! que je voudrais pouvoir retourner auprès de ma femme
et de mes enfants ! Mon Dieu ! Quand donc cette guerre finira-t-elle
?... »
Le Rousskoié Slovo a publié d'autres carnets
de route de soldats allemand où se retrouvent les mêmes
terreurs et mêmes plaintes.
Voici un passage de l'un de ces carnets. Il montre les souffrances des
soldats teutons et le découragement qui s'empare d'eux :
« Nous avons à marcher près de six kilomètres
dans des conditions épouvantables ; il n'est donc pas étonnant
que très souvent je tombai et faillis mourir.
» Les nuits sont froides, à peine puis-je dormir.
» Nous réussissons à nous mettre à l'abri,
mais nous tremblons de froid, nous dormons mal. Je prie et je pense
aux miens.
» Je souffre de la faim ; je reste en sentinelle auprès
de la tranchée et je songe comme toujours à ma femme et
à mes enfants. Si Dvinsk pouvait être pris ! Malheureusement
les Russes ont beaucoup de munitions et ils tirent si bien !
» Mon coeur tremble ! les nerfs ne peuvent pas supporter tout
ce fracas, on ne sait pas où se mettre, il vaudrait mieux être
mort ou blessé que de rester dans la boue. Quand la nuit arrive,
nous avons peur du lendemain. Les Russes sont un ennemi terrible ; ils
dirigent sur nous un feu inouï de mitrailleuses, ils nous couvrent
de grenades et ils attaquent à chaque instant. Oh ! que je voudrais
qu'on dise :
« Repose-toi, guerrier, la guerre est finie dors et que personne
ne te réveille !... »
Ainsi, l'hiver reste le grand, le puissant allié de la Russie
; et la science et l'organisation allemande n'y pourront rien.
Ajouter à cette force de la nature cette autre force, d'un pays
inépuisable en hommes, d'un pays où l'armée peut
reculer s'il le faut indéfiniment en ruinant tout derrière
elle, et sans jamais atteindre les bornes, et sans jamais se laisser
entamer.
Napoléon, dans le Mémorial de Sainte-Hélène,
a médité sur cette force dont il fut la victime, sur cette
force qu'il n'avait pas soupçonné et qu'il éprouva
pour son malheur :
« On ne peut s'empêcher, écrit-il, de frémir
à l'idée d'une telle masse qu'on ne saurait attaquer ni
par les côtés ni sur les derrières ; qui déborde
impunément sur vous, inondant tout, si elle triomphe, ou se retirant
au milieu des glaces, au sein de la désolation, de la mort, devenues
ses réserves, si elle est défaite ; le tout avec la facilité
de reparaître aussitôt si le cas le requiert. N'est-ce pas
la tête de l'hydre, l'Antée de la fable, dont on ne saurait
venir à bout qu'en le saisissant au corps et l'étouffant
dans ses bras... Mais où trouver l'Hercule ?...»
Cet Hercule que ne fut pas Napoléon, le Kaiser Guillaume II a
cru l'être... Ah ! le pauvre homme ! ...
Ernest Laut.
Le Petit Journal illustré du 9 janvier 1916