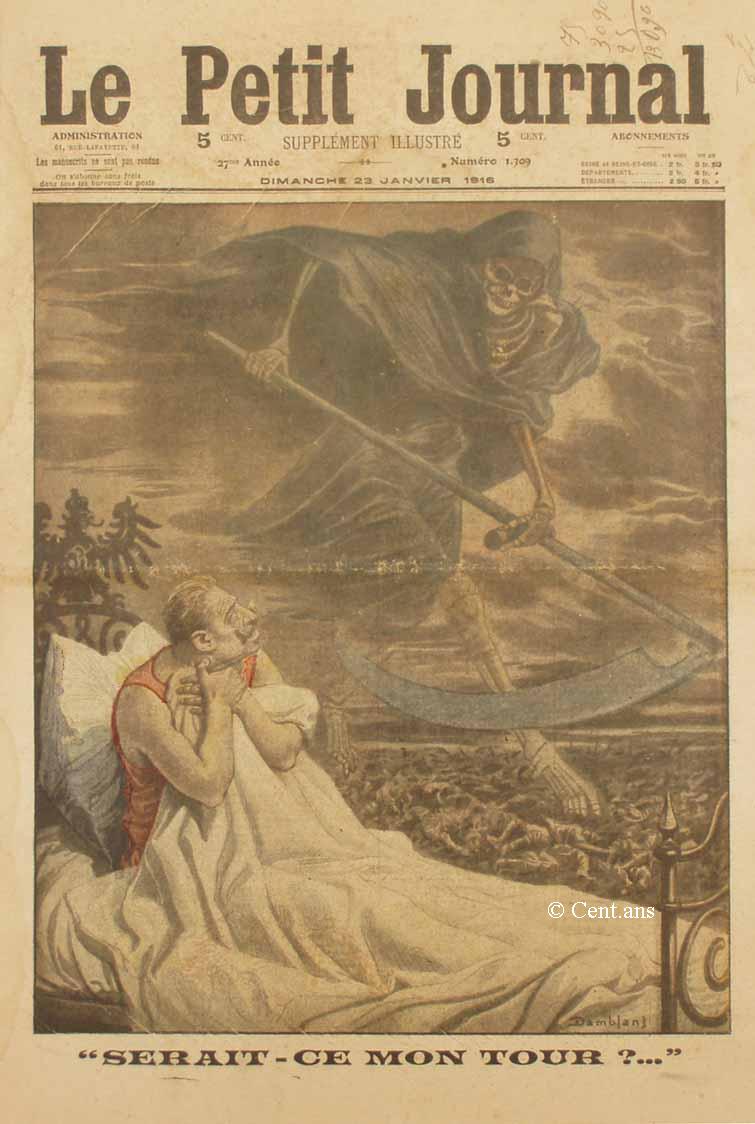“ SERAIT-CE MON TOUR ?... ”
« Serait-ce mon tour ?... » telle
est la pensée qui doit hanter le cerveau du Kaiser. La Mort est
avide ; elle est insatiable. Se contentera-t-elle de l'abondante pâture
qu'il lui a donnée ? Ne le prendra-t-elle pas lui-même,
à son tour ? Après avoir sacrifié tant d'hommes
à son incommensurable orgueil ne va-t-il pas être sacrifié,
lui aussi ?
Et ne croyez pas que cette terreur de la mort que nous attribuons au
kaiser soit purement hypothétique et gratuite. La pensée
que nous lui prêtons est d'une absolue vraisemblance si nous nous
en rapportons à la mentalité de Guillaume II.
En effet, même en pleine santé, le kaiser a une véritable
phobie des malades et de la maladie. Comment ne serait-il pas assailli
par les pires craintes alors que le mal s'abat sur lui ?
Jugez-en plutôt par ce passage des Kaizeriana, de Paul-Louis
Hervier.
« Guillaume II, dit Paul-Louis Hervier, tient peu à la
vie de ses sujets. Il tient énormément à la sienne.
Il redoute les malaises qui peuvent être les prodromes de maladies
graves, il a peur des contagions et des épidémies. Il
appréhende que les maux dont il souffre empirent soudain.
» Quand Guillaume vient sur un des fronts de la guerre, il est
non seulement accompagné de son état-major, mais aussi
l'une troupe de médecins, un véritable corps sanitaire,
dont la mission est de rechercher s'il n'y a pas d'épidémie
dans la région, si l'air est bon pour les poumons de Sa Majesté,
si l'humidité du climat ne peut pas engendrer des douleurs. Dès
que Guillaume croit qu'il a un rhume, il se met au lit, annule toute
ses audiences, boit de la tisane, accepte tous les cataplasmes, les
gargarismes, les potions, les pilules et les cachets, on l'entoure de
mille soins, on nettoie tout autour de l'habitation, on désinfecte
à l'extérieur et à l'intérieur, on assainit
par des procédés chimiques la chambre de l'auguste malade
et on en éloigne tous ceux qui ont éternué pendant
la semaine précédente, qui toussent pour avoir respiré
de travers ou qui se mouchent pour cacher leur émotion. Ces gens-là
peuvent avoir des rhumes de cerveau ou des bronchites, ils sont dangereux,
on les chasse, on les exile. »
Dans ces conditions, on conçoit quelles doivent être les
craintes du kaiser atteint par le mal héréditaire auquel
son père a succombé.
Déjà, il y a cinq ans, il fut question d'opérer
l'empereur et de l'ablation du larynx. Guillaume recula.
Pourra-t-il encore reculer cette fois ? Le cancer a fait des progrès.
Cette voix qui a proféré tant de mensonges est-elle condamnée
à s'éteindre ? Cet homme qui a sacrifié à
ses ambitions tant de vies humaines va-t-i1 périr à son
tour ?
Sans doute sa disparition jetterait le désarroi dans le camp
ennemi et hâterait peut-être la fin de la guerre. Mais comme
on voudrait que l'homme responsable de tant de deuils et de tant d'horreurs
pût voir, avant de succomber, l'effondrement de toutes ses ambitions,
la chute de sa dynastie, l'abaissement définitif de son peuple,
et qu'il connût ainsi, avant de mourir, le châtiment.
VARIÉTÉ
Le recrutement en Angleterre
Le service obligatoire il y a mille ans. - Plaintes de Wellington. -
La publicité du recrutement, par les journaux et par le cinéma.
- Affiches parlantes. - La volonté de l'Angleterre.
Lorsqu'au début de cette guerre, la question
du service militaire obligatoire fut agitée pour la première
fois en Angleterre, les adversaires du système opposèrent
à ses partisans leur argument ordinaire, à savoir que
le service obligatoire est incompatible avec le caractère anglais.
« Il n'est pas douteux, pourtant, écrivit alors le Daily
Mail que le service obligatoire a déjà existé
en Grande-Bretagne.
« Il était en vigueur dès les premières années
de l'histoire de l'Angleterre, après l'occupation romaine. Le
fait de porter les armes était même un honneur dévolu
seulement aux hommes libres.
» Cette armée nationale portait le nom de « Fyrd
» et chaque comté était tenu de contribuer à
sa formation par le recrutement d'un contingent déterminé.
» Alfred le Grand réorganisa la « Fyrd » et
décida que tous les hommes âgés de seize a soixante
ans étaient tenus d'en faire partie ».
Il y aurait de cela dix ou onze siècles. C'est assez loin, comme
vous voyez. Et les Anglais d'aujourd'hui ont de bonnes raisons de ne
s'en point souvenir.
J'ignore jusqu'à quelle époque le système du «
Fyrd » subsista en Angleterre, mais il est certain qu'après
l'invasion normande il avait cessé d'exister, et qu'en aucun
temps, depuis lors, même aux époques où l'Angleterre
eut le plus besoin de soldats, notamment pendant la période des
guerres napoléoniennes, il ne fut jamais question de le rétablir.
Le recrutement des armées anglaises était alors extrêmement
difficile. Wellington s'en plaignait constamment.
Bien que la prime d'engagement fût alors d'une livre, il était
presque impossible de trouver des soldats. Le gouvernement anglais fut
parfois réduit à faire aux condamnés remise de
leur peine pour les enrôler dans l'armée.
« Il n'y a que la vile classe qui entre au service », écrivait
Wellington en 1811 ; et, un autre général anglais, disait
: « Si nous n'avions point de pauvres, nous n'aurions point de
soldats ».
Le recrutement ne se faisait aisément que dans les années
de misère. Dans les années plantureuses, quand les jeunes
gens trouvaient leur nourriture dans le travail, la besogne devenait
extrêmement ardue.
Les sergents recruteurs étaient alors sur les dents ; il leur
fallait parcourir les provinces et prendre tout ce qu'ils trouvaient
sans examen. Leur génie consistait en ce cas à enrôler
les gens en dépit d'eux-mêmes.
- A quelle classe appartient la majorité des recrues que vous
enrôlez, demandait-on un jour a l'un de ces racoleurs.
- A la classe des idiots, répondait le facétieux sergent.
***
Cependant, les Anglais surent toujours trouver
des soldats quand ils en eurent besoin. Et si l'empereur Guillaume II
eût connu un peu son histoire, il se fût gardé peut-être
de parler avec tant de dédain, au début de la guerre de
« la misérable petite armée du maréchal French
». Il se fût dit qu'il ne tenait qu'a la volonté
du gouvernement anglais de la transformer rapidement en une grande et
redoutable armée.
C'est là ce qui s'était produit il y a un peu plus d'un
siècle. En 1792, l'armée anglaise n'était que de
56.000 hommes. En quelques années elle fit plus que quadrupler.
La prime d'engagement fut alors portée à 25, livres (625
francs) et la solde minima à un shilling.
En 1808, l'Angleterre avait 230.000 hommes de troupes de ligne, sans
compter 78.000 miliciens et 300.000 volontaires.
Instruite par de tels résultats, forte de son insularité
et confiante dans la puissance de sa flotte, on conçoit très
bien que l'Angleterre n'ait jamais songé a modifier son système
de recrutement.
Jusqu'en ces dernières années, le sergent racoleur en
était resté le facteur unique.
C'était là le procédé classique, le procédé
primitif tel qu'il était en usage dans presque tous les pays
d'Europe au XVIlle siècle. Les Anglais seuls l'avaient conservé
tel. Mais depuis le commencement de cette guerre, ils l'ont singulièrement
amélioré ; et c'est merveille de voir avec quelle ingéniosité
ils ont appliqué au recrutement des méthodes nouvelles
et en particulier les méthodes de publicité, dans lesquelles
ils excellent.
Avant la guerre, dès le début de 1914, le War Office avait
déjà recouru à la publicité des journaux.
Le 15 janvier, les feuilles à un demi-penny donnèrent
une page d'annonces dans laquelle étaient exposés tous
les avantages réservés aux soldats anglais ; la paie,
d'abord : 8 shillings 9 pence par semaine pour l'infanterie ; 14 shillings
pour les gardes à cheval et pour les autres armes, artillerie,
cavalerie, etc., de 9 à 11 shillings. Et. cela, dès l'entrée
au corps.
Au bout de deux ans, la paie varie, suivant les armes, de 10 shillings,
6 à 17. 6. En sept ans, disait le prospectus, un soldat peut
avoir mis de côté de 2 à 3.000 francs.
Et ce n'était pas tout : belle tenue, vêtements chauds
l'hiver, vêtements légers l'été, nourriture
substantielle et variée, confiture, chocolat, salles de billards,
fumoirs, plaisirs sportifs etc. Quoi de plus alléchant ?
Il paraît, pourtant, que tout cela ne suffisait pas encore à
assurer le recrutement, car bientôt le War office, non content
de la publicité des journaux, recourait au cinéma.
Par ses soins, des films furent pris de toutes les phases de l'existence
du soldat. La vie entière de Tommy Atkins (le piou-piou
anglais) y était reproduite... Mais comme il eût été
peut-être monotone pour le public de ne voir que des scènes
militaires et pour vaincre le préjugé qui, dans les milieux
ouvriers anglais, attachait une défaveur au métier de
soldat, une intrigue fût mêlée fort habilement au
film... Un jeune homme, employé aux docks de Londres, aime une
jeune nurse. Il lui demande sa main, elle refuse. Il s'engage. On le
voit dans toutes ses occupations militaires. Il prend goût à
son métier, oublie ses chagrins, se comporte brillamment aux
manoeuvres, fait campagne, y est blessé, est soigné par
la nurse, est nommé colour sergeant et épouse
sa bien aimée.
Et ce film fut donné en sus du programme dans tous les cinémas
populaires.
***
Puis, quand éclata la guerre, l'ingéniosité des
Anglais pour recruter des soldats prit un nouvel essor.
Une profusion d'affiches furent apposées partout, sur les murs,
sur les façades, aux devantures des boutiques.
« Elles couvrent tout, disait un de nos confrères, les
omnibus, les taxicabs, les tapissières, jusqu'aux voitures de
maîtres. Elles sont de tout format et de couleur et l'on est stupéfait
du nombre de variations que leurs auteurs ont su tirer de ce thème
unique : « La patrie est en danger ; courez sous les drapeaux.
»
« Un soldat en kaki, le fusil à la main, la pipe aux lèvres,
pose cette question :
« Cela vous est indifférent que je me fasse tuer pendant
que vous restez chez vous ? »
« Si vous ne pouvez vous engager, dit une autre affiche, tâchez
de trouver une recrue ! » Un paysage sombre et tourmenté
vous montre au fond des ruines fumantes et au premier plan un soldat
avec cette légende : « Souvenez-vous de la Belgique ! »
« Voici maintenant, sur une pancarte, le buste fort ressemblant
et de grandeur naturelle de lord Kitchener ; le bras allongé,
l'index tendu vers le spectateur, il s'écrie en le fixant dans
les yeux : « J'ai besoin de VOUS ! » Plus loin, c'est le
portrait de lord Roberts ; au-dessous l'épée du maréchal
et son chapeau à plumes avec les mots : « Il a fait son
devoir ; ne ferez-vous pas le vôtre ? »
« Autre chose. Un rang de soldats au port d'armes. Entre le premier
et le troisième, un vide dans lequel est écrit «
Cette place vous est réservée ; venez la prendre ! »
. Il y a aussi l'affiche qui s'adresse à l'amour-propre du passant
et lui fait honte de rester chez lui au lieu de prendre un fusil. En
voici un exemple : « Vous êtes fier de votre copain qui
est sous les drapeaux ; que pense-t-il de vous, lui ? Réfléchissez
! »
En dehors des affiches, il y a encore les annonces dans les journaux,
tels que l'appel aux gens riches gardant à leur service des valets
de chambre ou des laquais qui devraient porter le fusil et non le plateau,
ou des chauffeurs qui devraient conduire fourgons et ambulances au lieu
de mener des autos de luxe ; une annonce invite les femmes à
ne pas retenir les hommes et à leur conseiller de s'enrôler
; un appel s'adresse aux chefs d'industrie, un autre aux commerçants
qui emploient beaucoup d'hommes en âge de servir.
» Après cela viennent les questionnaires et examens de
conscience.. « 1. Si vous êtes solide, entre dix-huit ans
et trente-huit ans, êtes-vous satisfait de ce que vous faites
en ce moment ? - 2. Vous sentez-vous heureux, en passant dans les rues,
de voir d'autres hommes porter l'uniforme du roi ? - 3. Que direz-vous
quand on vous demandera plus tard : Où avez-vous servi ? - 4.
Si vous avez des employés ne pouvez-vous les remplacer par des
femmes pendant la durée de la guerre ? »
Nous avons vu, même dans les vitrines des magasins anglais de
Paris ces appels à l'enrôlement volontaire. En voici quelque
uns :
Des soldats anglais, le pied sur une carte de France, vers Calais, se
tournent vers l'Angleterre et crient cet appel :
Boys come over here, you are wanted.
(Amis, venez ici. On a besoin de vous).
Deux soldats anglais, le fusil à la main, marchent à l'ennemi
; au-dessous, on lit :
Don't stand looking at this. Go and help.
(Ne vous contentez pas de les regarder. Allez les aider).
Et voici quelques simples recommandations, non accompagnées d'images
Wy aren't you in kaki ?
(Pourquoi n'êtes-vous pas en kaki ?)
Don't lay follow your flag.
(Ne restez pas en arrière, suivez votre drapeau).
Les journaux allemands eux-mêmes s'émerveillaient de l'intensité
du mouvement patriotique, créé par la guerre en Angleterre.
Voici un tableau du recrutement anglais publié par l'un d'eux
en décembre dernier, et dont l'auteur est le docteur Vorst.
« Sur l'îlot formé par le terre-plein devant la Bourse
de Londres, une musique de régiment a formé le cercle.
Au centre se trouve un gamin de neuf ans portant l'uniforme kaki réglementaire.
C'est l'espoir militaire de l'Angleterre. En un clin d'oeil, la foule
s'est rassemblée ; un jeune soldat grimpe les marches du perron
de la Bourse et lorsque la musique cesse, il retire sa casquette et
s'exprime d'une voix forte en ces termes: « Mesdames et messieurs,
l'Angleterre compte que tout le monde fera son devoir ». Ce sont
les paroles de Nelson avant la bataille de Trafalgar. Le soldat continue
: « L'Angleterre n'a pas voulu décréter le service
militaire obligatoire parce qu'elle est convaincue et parce qu'elle
pensé qu'à l'heure du danger l'idée du devoir remplacerait
la loi. L'heure du danger est venue : il faut s'opposer de toutes nos
forces à l'envahissement de l'Europe par la vague teutonne. Je
fais appel à votre patriotisme, à la conscience que vous
avez de l'honneur de votre pays qu'il faut sauvegarder. Il ne faut pas
croire que le soldat soit malheureux... »
« Une fois convaincu et encouragé des sous-officiers revenus
du front circulant dans la foule, un jeune homme monte les marches,
échange quelques mots avec un officier chargé de recevoir
les adhésion : c'est le premier pacte qui vient de se conclure.
« L'Angleterre a su rajeunir le vieux systéme de recrutement
et employer tout espèce de moyens nouveaux pour stimule les engagements
volontaires et provoque par toutes sortes de stratagèmes l'enrôlement.
Toute la ville est remplie de pancartes. Des femmes, autrefois sans
doute des suffragettes, ayant renoncé à lacérer
les tableaux, se font propagandistes et orateurs. Tous les moyens sont
mis en oeuvre pour recruter le plus d'engagements possible. Le système
de la réclame parla vue, par les paroles, est pratiqué
avec une perfection vraiment inouïe. »
Le résultat de cette propagande, on 1a connaît, c'est la
superbe armée qui combat, vaillamment à côté
de la nôtre.
Mais ce résultat ne suffit pas encore aux Anglais ; ils veulent
plus. Et, bouleversant toutes leurs traditions, ils en viennent au service
obligatoire.
Les Boches, après cela, ne pourront plus douter de leur volonté
formelle, inébranlable, d'aller jusqu'au bout.
Ernest LAUT
Le Petit Journal illustré du 23 janvier 1916