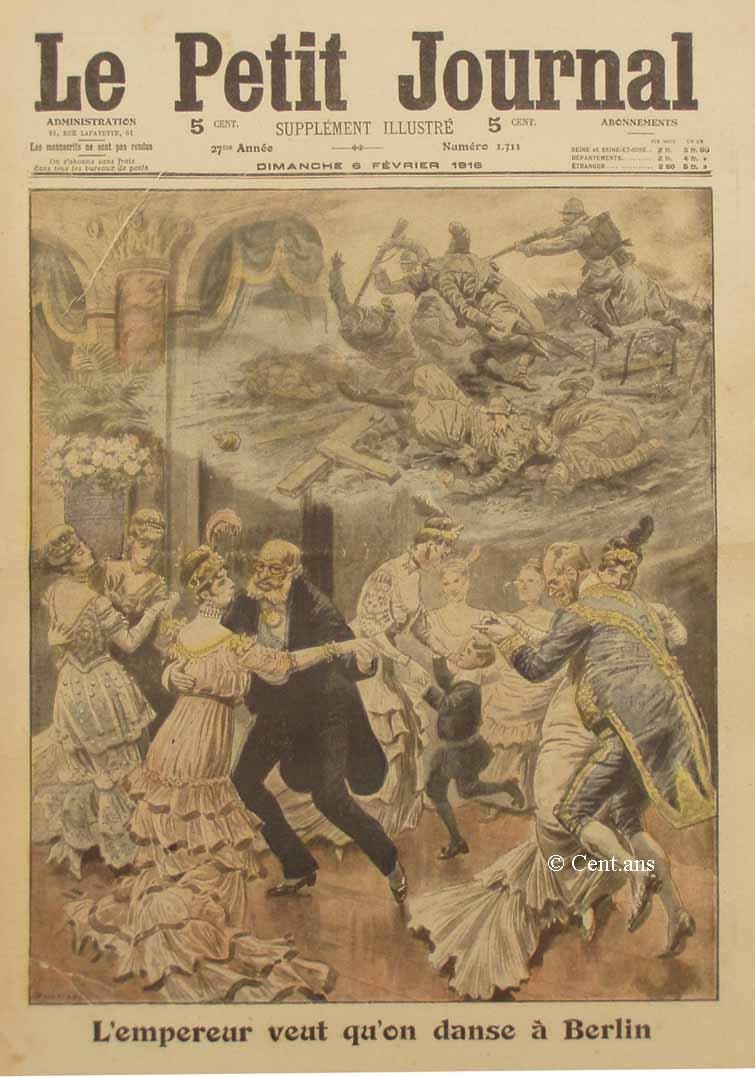L'empereur veut qu'on danse à Berlin
La grande préoccupation des dirigeants
de l'Allemagne c'est de continuer à illusionner le peuple, à
le tromper sur la véritable situation du pays.
Le peuple, cependant, commence à savoir, mais on s'acharne toujours
à lui cacher la vérité, à lui faire croire
que rien n'est changé dans la vie nationale, On l'amuse et on
l'abuse.
Tous les voyageurs qui ont parcouru l'Allemagne depuis le début
de la guerre s'accordent à signaler l'animation factice des grandes
villes allemandes où tout commerce est mort, mais où la
vie du soir s'efforcé cependant de rester brillante. Tous ont
parlé de ces restaurants luxueux où bâfrent copieusement
les gens riches et les beaux officiers, pour faire croire au peuple
qui les regarde et qui crève de faim, que l'Allemagne a tout
en abondance ; tous ont parlé de l'affluence aux théâtres,
aux cinémas, dans tous les lieux de distraction ; tous ont dépeint
« cette foule abusée, néanmoins lentement avertie,
lasse, anxieuse, affectant cependant par ordre une douloureuse sérénité,
terrorisée, n'osant rien dire, se sachant menacée à
la moindre velléité de plainte ou de franchise ».
« Par quels moyens, dit un de ces voyageurs, a-t-on réussi
à mystifier ainsi le peuple allemand ?
» Est-il nécessaire de rappeler le rôle qu'ont joué
dès le début la fameuse agence Wolff, les intellectuels,
les ecclésiastiques de toutes confessions, la pressé des
« reptiles » comme disait Bismarck, l'empereur enfin et
sa parole impériale ?... Puis les « grandes victoires »
en Belgique, - la criminelle Belgique, - les non moins « grandes
victoires » remportées en France fortifièrent si
possible et surexcitèrent l'orgueil du peuple. Vinrent ensuite
le bluff des Zeppelins, les « exploits. » des sous-marins.
Et quand l'Italie se rangea du côté de l'Entente, on répéta
la phrase si ressassée déjà : « Plus nous
avons d'ennemis, plus nous aurons d'honneur à les vaincre. »
Les rodomontades « en veux-tu en voilà » ne coûtant
rien, on en usa et on en abusa... Les « colossales victoires »
sur le front oriental vinrent à point, plus tard, pour ranimer
un instant les plus folles espérances d'une paix avantageuse
et prochaine. Enfin, la campagne dans les Balkans, entreprise pour retremper
par de faciles victoires les énergies défaillantes ...»
Mais tout ce bluff ne suffisant plus pour galvanisation les enthousiasmes
et la population commençant à se laisser aller à
la tristesse, au découragement, au doute, on décréta
en haut lieu que la gaîté serait à l'ordre du jour.
Les Allemands n'étant plus d'humeur à s'amuser de gaîté
de coeur durent s'amuser par ordre. Et l'empereur donna cet ordre inouï,
cet ordre invraisemblable aux dames de la société berlinoise
:
« Mesdames, rouvrez vos salons, je veux qu'on danse à Berlin
! »
Et les dames rouvrirent leurs salons, car un ordre de l'empereur ne
se discute pas. Et elles lancèrent les invitations pour leurs
bals.
Or, l'une d'elles, qui avait l'habitude d'inviter à ses sauteries
les beaux officiers de la garde, s'inquiéta, avant d'envoyer
ses invitations, de ce qu'étaient devenus ses danseurs ordinaires.
Sur, deux cents, cent quatre-vingts étaient morts, ensevelis
dans les boues de l'Artois ou dans les marais de Saint-Gond.
On dansera cependant à Berlin, pour obéir à l'empereur
; les dames danseront entre elles ou avec les enfants, ou avec les vieux
chambellans cacochymes. Ah ! les jolis danseurs qu'il leur a laissés,
l'empereur.
On dansera pendant que les hommes se feront tuer et que leur familles
mourront de faim.
Mais combien de temps dansera-t-on ?
VARIÉTÉ
LES ALBANAIS
Un peuple réfractaire à l'influence occidentale. - Moeurs albanaises. - Scutari l'héroïque. - Gendarmes et brigands. - Qu'adviendra-t-il de l'Albanie.
Va-t-il se passer de grandes choses en Albanie
? Serbes et Monténégrins s'y sont réfugiés.
Les armées de l'Autriche les y poursuivront-elles ? Oseront-elles
s'aventurer dans ces montagnes inaccessibles ?
Quoi qu'il advienne, l'Albanie est à l'ordre du jour. Parlons
donc de l'Albanie et des Albanais.
Parmi ces peuples balkaniques auxquels l'influence occidentale s'imposa
si lentement, le peuple albanais est à coup sûr celui qui
y resta le plus résolument réfractaire.
Dans son excellent livre sur l'Europe et la Jeune Turquie,
M. René Pinon l'a constaté :
« Seul peut-être de tous les peuples d'Europe, dit-il, l'Albanais
a traversé l'histoire et est resté semblable à
lui-même... Des plaines du Vardar à l'Adriatique, de la
Thessalie au Monténégro, l'Albanais est maître par
le droit du premier occupant, par le droit du plus fort. Par la race,
par la langue, par les croyances, par les moeurs, il se distingue et
se sépare des autres peuples de la péninsule : il a son
individualité bien tranchée. Il confine vers le sud aux
hellènes, vers le nord et l'est aux Slaves, mais nulle part il
ne se confond avec les uns ni avec les autres ; il lui arrive d'assimiler
de gré ou de force ses voisins, mais il ne se laisse pas assimiler
par eux : il les méprise. »
Et cependant, l'Albanie ne connut guère les jours d'indépendance.
Successivement elle fut soumise à tous les peuple voisins.
Les Serbes, les Bulgares, les turcs y régnèrent. Elle
fut même, - qui le croirait ? - soumise à un prince français.
Ce prince s'appelait Henri de Bourgogne ; il était le petit-fils
de Robert II, roi de France et descendait directement de Hugues Capet.
Au milieu du XVe siècle, il lutta, à la tête de
quarante mille Albanais chrétiens, contre Mohammed II, le conquérant
de Constantinople, et l'ayant battu, se proclama roi du pays d'Albanie,
sous le nom de Henri 1er.
Royaume éphémère. A la mort de Henri 1er, les Turcs
reprirent la lutte ; et l'Albanie, en 1496, retomba sous le joug ottoman.
Mais comme les Serbes, comme les Bulgares, les Albanais subirent ce
joug sans rien sacrifier de leurs traditions, de leurs moeurs, de leur
sentiment national.
Ces moeurs sont celles des peuples primitifs. L'esprit patriarcal les
domine. Les Albanais vivent en tribus, comme les premiers Gaulois, comme
les Arabes d'avant l'Islam. Un écrivain albanais, M. Anastas
Dako nous donne sur cette organisation sociale de curieux détails.
« Chaque tribu a son bairakdar, c'est-à-dire une
sorte de chef de clan qui représente l'autorité suprême,
mais n'exerce pas cependant un pouvoir absolu. Il n'a le droit de prendre
aucune résolution importante sans avoir consulté le Conseil
des Anciens. Cette assemblée n'est pas seulement investie d'attributions
administratives, elle est par-dessus tout un corps judiciaire dont la
compétence s'étend à toutes les contestations qui
peuvent s'élever dans la tribu. Qu'il s'agisse d'un procès
civil ou d'une affaire criminelle, d'un démêlé entre
proches parents ou d'une vieille querelle entre deux familles, le Conseil,
des Anciens statue en dernier ressort.
Le Bairakdar est le chef de la tribu ; mais chacune des familles constituant
la tribu a également son chef.
» La famille albanaise, dit encore M. Dako, ne se compose pas
seulement du père, de la mère et d'un ou de plusieurs
enfants, comme c'est l'usage dans l'Europe occidentale, mais les frères
et leur descendance continuent de vivre en commun, et il n'est pas rare
que cinquante et parfois même cent personnes soient réunies
sous le même toit. Ce n'est pas comme dans l'ancienne organisation
féodale des nations de l'Occident, le chef de la branche aînée
de la maison, qui a la prééminence sur des oncles et des
cousins parfois plus âgés que lui, c'est celui qui compte
le plus grand nombre d'années, qui est présumé
le plus sage et qui, à ce titre, exerce sur ses proches un pouvoir
à peu près illimité. »
Cette organisation n'est-elle- pas la plus belle et la plus sage qu'on
puisse rêver ?
***
Il ne faudrait pas en déduire, cependant, que ce sentiment patriarcal
exclue toute rudesse dans les moeurs. Il n'en est rien. Comme tous les
peuples chez lesquels l'esprit de famille est prépondérant,
l'Albanais pratique la vendetta avec une véritable frénésie.
En Corse, au temps jadis, on regardait avec mépris l'homme qui
n'avait point combattu contre les ennemis de sa famille et n'avait pas
au moins « une peau » sur la conscience. En Albanie, il
n'y a pas de plus sanglante injure pour un homme que de s'entendre dire
: « Tu mourras sans avoir déchargé tes pistolets.
»
Comme au Monténégro où se retrouvent à peu
près les mêmes moeurs, plus adoucies, cependant, la vengeance
du sang est admise par la loi.
Un Albanais a-t-il été tué traîtreusement,
ses parents peuvent exercer leur vengeance, non seulement sur le coupable,
mais sur tous les hommes de sa famille. Chose inouïe, si l'on répugne
à exécuter soi-même la vengeance, on peut faire
tuer son ennemi par un meurtrier à gages. Le vieux code de Dukaschin
a prévu le cas ;
il dit :
« Le mercenaire n'encourt aucune responsabilité au sujet
du meurtre commis par lui au nom d'un autre. »
Le mari trompé, lorsqu'il est sûr de son infortune, prévient
la famille de sa femme. Celle-ci examine le cas. Si l'adultère
m'est pas douteux, c'est le chef même de la famille qui remet
au mari une cartouche avec laquelle celui-ci n'a plus qu'à fusiller
l'infidèle.
Une injure ne doit jamais être laissée sans vengeance.
Celui qui négligerait de se venger serait l'objet du mépris
de tous et ne pourrait vivre en paix qu'après s'être décidé
à répandre le sang de son ennemi ou de quelque homme de
sa famille.
On cite le cas d'un Albanais qui avait tué un homme dans sa jeunesse
et avait quitté le pays avant que les parents de sa victime pûssent
tenter d'exercer leur vengeance. Pendant de longues années, il
courut le monde, puis, croyant l'histoire oubliée, il revint
au pays. Quelques jours après, il tombait assassiné.
On n'oublie jamais, en Albanie. La vengeance y est-un devoir. Elle va
jusqu'à s'exercer contre quiconque a tué non seulement
un membre d'une famille, mais même un étranger qui a été
l'hôte de cette famille.
M. Fernand Mysor, qui a noté ces singuliers détails de
moeurs, conte à ce propos une anecdote qui montre jusqu'à
quel point l'hospitalité est chose sacrée pour les Albanais
:
« Un jour, un homme ayant commis un meurtre se réfugia
dans une maison. En la quittant, à l'aube, il rencontra deux
montagnards, se prit de querelle avec eux et fut tué. Ses agresseurs
lui ravirent son fusil et son revolver. En apprenant cela, les hôtes
du défunt firent savoir aux meurtriers qu'ils les avaient triplement
insultés, d'après la loi de la montagne. D'abord en tuant
leur protégé. Ensuite en lui volant ses armes. Ils les
sommèrent de les leur restituer, faute de quoi ils prendraient
trois sangs dans leurs familles. Les autres refusèrent. Un an
après, ils furent abattus à coups de fusil en se rendant
à l'église. »
Notez que ces pratiques ne sont pas uniquement en faveur chez les Albanais
musulmans ; ce sont aussi celles des Mirdites, Albanais catholiques,
qui, en dépit de la religion du Christ, ne pratiquent guère,
vous 1e voyez, la douce loi du pardon.
***
La rudesse de ces moeurs démontre suffisamment que l'Albanais
est, avant tout un guerrier. « La nation tout entière est
armée, dit un voyageur : le laboureur qui pousse sa charrue,
le pâtre qui mène son troupeau, le conducteur de chevaux,
tous ne sortent qu'avec le fusil en bandoulière et la ceinture
abondamment pourvue de cartouches. »
A maintes reprises, au cours de leur histoire, les Albanais se montrèrent
d'indomptables soldats.
Lors de l'invasion ottomane dans la presqu'île des Balkans, ce
sont eux qui opposèrent aux Turcs la plus farouche résistance.
Maître de la Serbie, Mohammed II envahit l'Albanie et voulut s'emparer
de Scutari que possédait alors la République de Venise.
Son principal lieutenant, Suleiman Pacha, vint mettre une première
fois le siège devant la ville en 1474. Scutari résista
si bien que les Turcs durent lever le siège.
Trois ans plus tard, Mohammed revint en personne à la tête
d'une armée immense et avec un matériel de siège
considérable. C'est là que les Turcs, pour la première
fois, firent usage d'obus incendiaires et de pièces d'artillerie
à double canon.
Mais ce déploiement de forces ne fit qu'exalter le courage des
Albanais. Deux grands assauts, menés par Mahommed lui même,
n'eurent aucun résultat. Les femmes albanaises elles-mêmes
couraient aux remparts. « Elles s'exposaient à toutes sortes
de périls, dit l'historien grec Chalcondylas, et combattaient
à l'envi des hommes : de sorte que quelques unes furent tuées
par l'artillerie. »
Ne pouvant prendre la ville de force, les Turcs essayèrent alors
de la réduire par la famine. Malgré les horreurs d'une
effroyable disette, le courage des Scutariens ne faiblit pas un seul
instant. Le siège dura quinze mois ; et les Turcs ne seraient
jamais entrés dans Scutari, si Venise, épuisée
par ailleurs, n'avait demandé la paix.
La ville héroïque tomba sous le joug musulman. Les Albanais
chrétiens refusèrent de se soumettre et quittèrent
le pays.
Ils y revinrent plus tard, cependant et formèrent dans les montagnes
de la haute Albanie ces tribus de Mirdites, de Guèghes catholiques
dont nous avons dépeint les moeurs plus haut, et qui, depuis
des siècles n'ont guère cessé de lutter contre
les Arnaoutes ou Begs, Albanais qui s'étaient laissé imposer
la loi musulmane.
Malheureusement, par défaut d'organisation sociale, ce peuple
guerrier et dont les instincts généreux eussent pu faire
un grand peuple, s'ils avaient été cultivés, ce
peuple, sous la domination musulmane, a presque constamment vécu
de brigandage.
Jusqu'à la dernière guerre balkanique, il a pressuré
ses voisins de Macédoine. Dès le mois de janvier de chaque
année, les Albanais descendaient de leurs montagnes et s'en venaient
chez les fermiers macédoniens. Là, ils fixaient la contribution
qu'ils viendraient toucher six mois plus tard. Cette contribution n'avait,
bien entendu, d'autre base que leur appréciation et leur bon
plaisir. Tel petit fermier était taxé à quinze
ou vingt livres turques : tel autre, dont l'exploitation leur paraissait
plus florissante était condamné à en verser cent.
Au mois de juin, les chefs albanais revenaient en force toucher la taxe;
et tout fermier qui se refusait à la payer ou qui seulement,
se permettait de discuter était abattu à coups de fusil.
Ces coquins mettaient même de l'humour dans leur coquinerie. Lorsqu'un
chef albanais, après s'être installé quinze jours
ou trois semaines avec sa suite chez quelque fermier macédonien,
se décidait à regagner ses montagnes, il avait encore
l'audace d'exiger du malheureux qu'il avait ruiné un impôt
ultime que ces brigands facétieux désignaient d'un mot
qui signifie le « denier de la dent », et qui devait les
indemniser de l'usure de leurs mâchoires, pendant tout le temps
que le chef et ses hommes avaient mangé au râtelier du
pauvre fermier.
Celui-ci, d'ailleurs, payait, payait toujours et tout ce qu'on voulait,
car alors les Albanais le protégeaient. Ils le protégeaient
contre un ennemi plus terrible qu'eux mêmes, contre les Zaptiés,
gendarmes turcs, voleurs, pillards, assassins, véritable terreur
des paysans macédoniens.
Extraordinaire pays que celui-là, où les gendarmes étaient
plus brigands que les brigands !
Telles sont les moeurs du pays albanais.
Qu'en adviendra-t-il après cette guerre ?
Sous l'impulsion d'Essad pacha, le chef aimé des « Skipetars
» ( c'est ainsi que se désignent les Albanais ) , les cinquante
ou soixante mille guerriers de ce pays joindront-ils leur effort à
celui des Alliés ; et verront-nous, la guerre finie, dans l'Albanie
rénovée, fleurir enfin le progrès européen
et la civilisation ?
Ernest Laut.
Le Petit Journal illustré du 6 février 1916