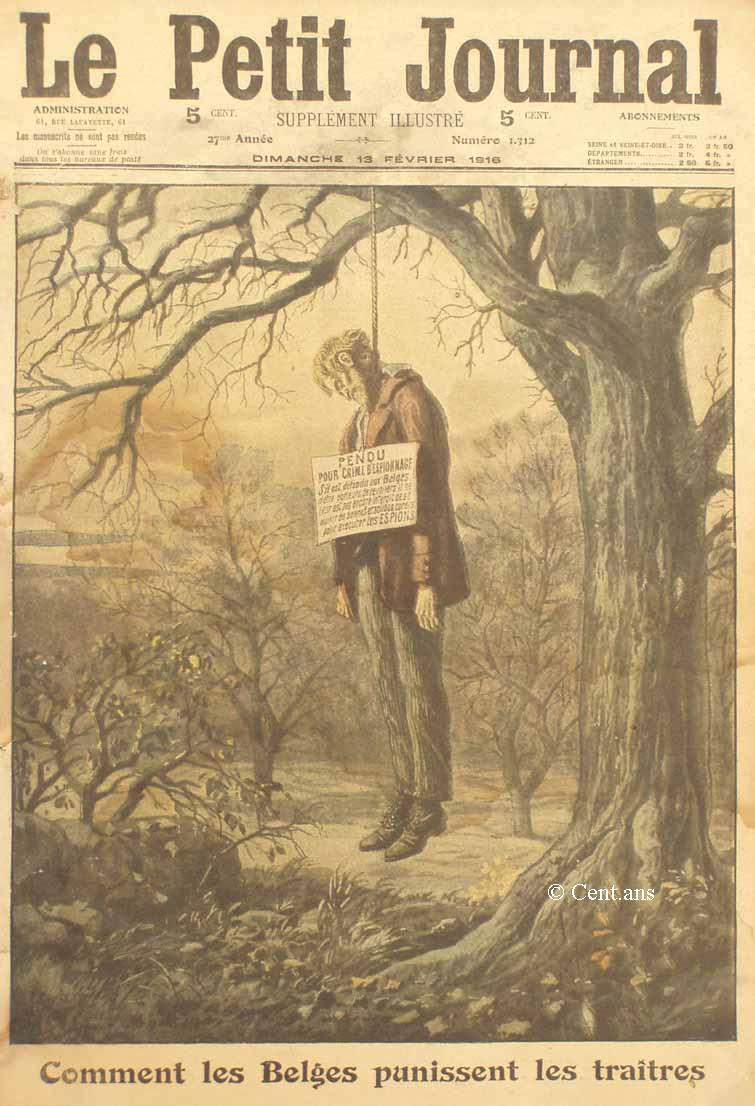Comment les Belges punissent les traîtres
A la suite de la trahison qui entraîna la
condamnation et l'exécution de Miss Cavell, de l'architecte Philippe
Bancq et des autres patriotes indignement assassinés par Von
Bissing, il s'est formé en Belgique une mystérieuse «
Main Noire » qui s'est donnée pour mission de les venger.
On sait comment Nels de Rode, le dénonciateur de Miss Cavell
fut trouvé tué de deux coups de revolver dans une rue
de Schaerbeek.
Cet individu, qui avait appartenu à l'armée belge avant
la guerre, faisait profession d'aider les jeunes Belges désireux
de rejoindre l'armée du roi Albert, à franchir la frontière
hollandaise. Il les dénonçait ensuite et les faisait arrêter
au moment où ils allaient atteindre la frontière. C'est
ainsi qu'il eut connaissance des efforts de Miss Edith Cavell pour aider
les patriotes, et qu'en septembre dernier, il la dénonça.
La « Main Noires » belge lui fit payer de la vie sa trahison.
Un autre traître, complice de Nets de Rode, fut, la même
nuit, abattu d'un coup poignard en plein coeur.
Après ces exécutions, les Allemands, afin d'en éviter
d'autres, firent de nouvelles perquisitions pour saisir toutes les armes
que possédaient les particuliers.
Mais cela n'empêcha pas la « Main Noire » belge de
poursuivre ses actes de justice.
Quelques jours plus tard, deux espions allemands étaient encore
exécutés par elle. On les a trouvés pendus, avec
sur la poitrine, cette inscription :
PENDU POUR CRIME D'ESPIONNAGE
S'il est défendu aux Belges d'être porteurs de revolvers, il ne leur est pas encore interdit de se munir de bonnes et solides cordes pour exécuter les espions.
VARIÉTÉ
La guerre aérienne
Les ballons aux armées. - Coutelle et les aérostiers de Sambre-et-Meuse. - Quelques rêveurs. - La poudre silencieuse et le fusil sans bruit. - Une gloire qu'on n'enviera pas aux Allemands.
A peine l'homme eut-il découvert le moyen
de monter dans les airs qu'il médita de s'en servir dans un but
homicide.
Le 6 mai 1792 - il avait tout juste neuf ans que les frères Montgolfier
avaient, pour la première fois, lancé dans le ciel un
globe de papier gonflé d'air chaud - un physicien aéronaute,
dont on ne nous a malheureusement pas conservé, le nom, écrivait
à l'Assemblée Nationale pour lui proposer de construire
« des ballons qui contiendraient deux cents hommes et porteraient
des pièces de 48 avec leurs munitions. »
Ce physicien aéronaute ne doutait de rien. L'Assemblée
se contenta d'envoyer sa proposition au « bureau des Arts »
lequel, apparemment, l'enfouit dans un carton, suivant l'usage.
La Convention, cependant, n'était point opposée à
l'utilisation des ballons à la guerre. Elle le prouvait l'année
suivante, en décidant, sur la proposition de Guyton de Morveau
d'employer les ballons « pour surprendre les mouvements des armées
étrangères ». II s'agissait, vous le voyez, pour
l'aérostat, non point de jouer, comme le voulait l'audacieux
inventeur de 1792, un rôle de combattant, mais de remplir l'emploi
plus modeste d'éclaireur.
Comme suite à cette décision, un corps d'aérostiers
fut créé et envoyé à l'armée de Jourdan,
qui opérait alors sur la Sambre.
Le capitaine Coutelle en reçut le commandement.
Coutelle était l'ami et le collaborateur du physicien Charles,
le savant qui, après la découverte des Montgolfier, avait
trouvé presque tous les détails scientifiques de l'aérostat
: filet, soupape, lest, enduit de caoutchouc pour éviter la déperdition
du gaz, appendice pour le gonflement et même l'emploi du baromètre
indiquant la hauteur du ballon dans l'air. Coutelle était l'auteur,
avec Charles, de nombreuses expériences sur l'emploi du gaz.
Après quelques expériences à Meudon, il partit
pour Maubeuge, où il fit ses premières ascensions.
« Chaque jour, dit-il, dans ses Mémoires, nous
trouvions des différences sensibles, soit dans les travaux que
l'ennemi avait faits pendant la nuit, soit dans ses forces apparentes.
Le cinquième jour, une pièce de 17, embusquée dans
un ravin à demi portée de canon, tira sur le ballon aussitôt
qu'il fut aperçu au-dessus des remparts : le boulet passa par-dessus
; un second coup fut bientôt préparé ; je voyais
charger et mettre le feu à la pièce : le boulet, cette
fois, passa si près que je crus l'aérostat percé.
Au troisième coup, le boulet passa dessous. Tous traversaient
la ville et allaient tomber au milieu du camp retranché...»
Coutelle et ses aérostiers rendirent encore d'éminents
services à Fleurus et devant Mayence, et leurs ballons eurent
l'extraordinaire fortune d'échapper toujours aux coups de l'ennemi.
« Plusieurs officiers autrichiens, qui étaient à
la bataille de Fleurus, rapporte encore Coutelle, m'ont assuré,
lorsqu'ils étaient en France, que, outre les coups de canon,
il fut tiré sur nous, à Maubeuge, plusieurs coups de carabine.
Les généraux autrichiens et les officiers de leur armée
ne cessaient d'ailleurs pas d'admirer notre manière de les observer,
qu'ils appelaient aussi savante que hardie. J'en ai reçu les
témoignages les plus honorables, chaque fois que je me suis trouvé
avec eux. « Il n'y a que les Français capables d'imaginer
et d'exécuter une pareille surprise ? », m'ont-ils répété
lorsque je leur ai dit qu'ils pouvaient en faire autant. »
L'aérostation militaire avait dès lors fait ses preuves.
Bonaparte voulut l'employeur en Égypte. Il emmena avec lui Coutelle
et ses aérostiers, mais le matériel aérostatique
fut coulé par les Anglais pendant la traversée. On a dit
à tort que Coutelle était mort sur la terre des Pharaons.
Il n'en est rien. Le premier organisateur du corps des aérostiers
militaires servit jusqu'en 1816 dans le génie, et il mourut à
Paris le 20 mars 1835, après avoir consacré ses dernières
années à écrire l'histoire de l'aérostation
aux armées de Sambre-et-Meuse.
***
Cependant, les rêveurs continuaient leurs rêves. En 1797,
un certain citoyen Thirolier, physicien non moins audacieux que son
confrère de 1792, proposait de construire un camp portatif et
une Montgolfière assez vaste « pour enlever et transporter
au sein de l'Angleterre l'armée qui doit en faire la conquête
». Malheureusement, la proposition du citoyen Thirolier n'arrivait
pas à une heure opportune. Il n'était pas question à
ce moment de guerre, mais de paix. Bonaparte arrivait à Rastadt
pour y ouvrir le congrès. L'idée du camp portatif et de
la montgolfière transportant une armée ne rencontra que
l'indifférence et sombra dans l'oubli.
Ces rêveries n'occupaient pas, d'ailleurs, que les cerveaux français.
On a exhumé il y a quelques années un roman allemand publié
à Francfort en 1791, et dans lequel l'auteur imaginait la guerre
aérienne à peu près comme elle se passe aujourd'hui.
Ce roman, qui s'appelle Die Schwarzen Brueder. les Frères
noirs est une sorte d'anticipation, comme en fit plus tard Jules
Verne ou comme en fait de nos jours le célèbre écrivain
anglais, Wells.
L'auteur imagine que son roman se passe en l'an 2222. Son héros
est, de son état gondolier de l'air. La guerre éclate
; il est enrégimenté dans le corps des gondoliers de l'air.
Un matin, dit-il, ma gondole est désignée pour aller reconnaître
le camp ennemi. J'avais auprès de moi le général
et quelques autres officiers. Deux gondoles m'étaient adjointes
pour protéger notre opération... Le temps nous favorisait
; aussi, pûmes-nous facilement observer ce qui se passait dans
le camp. Mais tout à coup, à notre grand effroi, nous
apercevons dans les régions supérieures des gondoles ennemies
en grand nombre. A peine avons-nous fait nos réflexions, à
ce sujet que déjà nous sommes entourés de toutes
parts..» Le combat s'engage et le narrateur le décrit avec
mille détails. Finalement, il est vaincu. La lutte a été
rapide et s'est passée sans fracas, car les adversaires sont
armés de fusils sans bruit.
« Je vous dirai donc, monsieur, que pour les expéditions
secrètes, les reconnaissances, les attaques par surprise et le
reste, nos cartouches sont chargées avec une poudre silencieuse
et qui ne donne pas de fumée. Le coup de fusil n'occasionne
pas le moindre bruit et n'est pas visible de jour. Autrefois, à
l'époque où l'art de la guerre était encore dans
l'enfance, on n'avait pas la moindre notion des effets terribles et
des avantages de cette poudre silencieuse. Mais revenons à mon
affaire. Touchée par les projectiles ennemis, ma gondole perdit
l'air. Le général, utilisant un parachute, réussit
à se sauver, de même les officiers qui l'accompagnaient.
Quant à moi, je fus contraint de me rendre. »
Ce romancier, on l'avouera, était un précurseur. Mais
il ne se doutait pas que presque tout ce qu'il rêvait, serait
réalisé plus de trois cents ans avant la date qu'il fixait
dans son roman. Nous sommes loin de 2222, et nous avons déjà
les « gondoles aériennes » et la poudre sans fumée.
Il est vrai que nous n'avons pas encore les fusils sans bruit.
Mais ce sera probablement pour la prochaine guerre.
***
L'utilisation des ballons à la guerre continuait de préoccuper
les esprits. Si Napoléon ne semble pas avoir songé à
créer l'arme aérienne, il n'en est pas de même de
son adversaire l'empereur de Russie.
Au chapitre IV de la Campagne de Russie, le comte de Ségur
note ceci :
« Non loin de Moscou et par l'ordre d'Alexandre,
on faisait diriger par un artificier allemand la construction d'un ballon
monstrueux. La première destination de cet aérostat ailé
avait été de planer sur l'armée française,
d'y choisir son chef et de l'écraser par une pluie de fer et
de feu : on en fit plusieurs essais qui échouèrent, les
ressorts des ailes s'étant toujours brisés. »
Les échecs des recherches tentées dans la direction des
ballons en feront, pendant plus d'un siècle négliger l'utilisation
à la guerre. Mais les théoriciens ne cessent pas pour
cela d'en décrire les avantages, et les inventeurs ne se montrent
pas moins ardents à la recherche du problème.
Notre collaborateur Jean Lecoq exhumait l'autre jour, à ce propos,
dans le Petit Journal quelques lignes bien curieuses extraites
du recueil des Guêpes, d'Alphonse Karr, de janvier 1844.
Le spirituel pamphlétaire parlait dans cet article, d'un inventeur,
nommé Pierre Gire, qui méditait de bombarder les villes
du haut des airs, tout comme le font aujourd'hui les Boches du comte
Zeppelin.
« M. Pierre Gire, disait-il, trouvant que le ballon a terminé
sa carrière pacifique, le destine à être une machine
de guerre. Il est évident que, si l'on arrivait sérieusement
à diriger les ballons, il n'y aurait pas à plaisanter
avec les aéronautes. En effet, le ballon, monté par deux
ou trois hommes, arrivé sur les lieux à une hauteur inaccessible
aux boulets, l'aéronaute précipiterait, suivant son désir,
des bombes et divers autres projectiles et, en peu d'instants une cité
serait plongée dans le chaos éternel sans qu'on eût
pu opposer la moindre résistance. »
Ces réflexions étaient inspirées à Alphonse
Karr par la lecture qu'il venait de faire du « Mémoire
de M. Gire, concernant les ballons comme machines de guerre avec le
moyen de les diriger » .
Or, ce mémoire ayant été soumis aux autorités
dites compétentes, le fonctionnaire chargé de l'examiner
avait, paraî-til, déclaré : « Ceci est grotesque
».
Et Alphonse Karr de s'indigner.
« Ceci est grotesque s'écriait-il ; eh bien ! si j'étais
ministre, je me serais rendu compte de l'invention de M. Gire. L'histoire
de la vapeur devrait apprendre à ne pas rire sans examen des
découvertes qui paraissent absurdes. »
Au lendemain du raid d'un Zeppelin sur Paris, concluait Jean Lecoq,
il m'a paru curieux d'exhumer ces lignes où sont prophétisées
en quelque sorte les méthodes actuelles de la guerre aérienne
; est d'où il ressort une fois de plus que M. Lebureau ne fut
jamais perspicace.
Cependant si l'administration trouvait grotesques les projets d'utilisation
des aérostats à la guerre, il n'en était pas de
même des savants. A peu près à la même époque,
vers 1850, l'un d'eux, Marey-Monge entrevoyait nettement les résultats
qu'on pourrait tirer au point de vue guerrier de l'invention des ballons
dirigerables.
« Que l'on juge, écrivait-il, de la force d'argument d'une
puissance quelconque qui arriverait en peu de jours à l'extrémité
du globe, au dessus de la capitale de son ennemie, à Pékin,
par exemple, avec un énorme ballon transatlantique de 500 chevaux
rempli de bombes monstres et remorquant plusieurs aérostats pleins
de gaz détonants, qui pourraient, au milieu d'une nuit calme,
être amenés au-dessus d'une ville, puis lâchés
pour tomber, à l'aide de poids, sur un point désigné
et détoner au moyen d'une mèche enflammée, pendant
que le transatlantique allégé s'éloignerait dans
les airs. Comment résister à cette sommation d'un amiral
faite à un empereur ! « Il me faut telle condition, sinon
je fais sauter, vous, votre capitale, votre armée, les principales
villes de votre empire et cela en peu de jours et sans qu'il m'en coût
un seul homme . »
Marey-Monge ajoutait, il est vrai :
« Mais nous aimons à croire que cette épée
de Damoclès, continuellement suspendue au-dessus des plus grands
empires, servira d'aiguillon puissant pour les amener, par des voies
harmoniques, à une politique conciliatrice, à la formation
de ces Congrès supérieurs si désirés, qui
jugeront, sans guerre, les griefs des peuples entre eux, comme le jury
ceux des citoyens... »
Quelle désillusion aurait le bon Marey Monge, s'il vivait encore,
en comparant aujourd'hui la puissance criminelle du zeppelin à
l'impuissance du tribunal de La Haye et de ces congrès conciliateurs
dont il souhaitait la création dans son rêve pacifiste
!
***
A la vérité, après la campagne de Sambre-et-Meuse,
ou naquit l'aérostation militaire, il faut franchir presque un
siècle avant de trouver de nouvelles applications du ballon à
la guerre.
C'est seulement en 1884 que le gouvernement constitua une école
d'aérostiers dans le but d'assurer en cas de guerre le service
de la poste par ballons et l'emploi des ballons captifs destinés
à renseigner l'état-major sur les mouvements de l'ennemi.
Le capitaine Renard, décédé il y a quelques années
avec le grade de colonel, en fut nommé directeur.
Dès son arrivée au parc de Chalais-Meudon, le brillant
officier du génie songea à appliquer à l'aérostation
militaire ses recherches sur la direction des ballons.
On n'a pas oublié le succès des expériences qu'il
fit en 1885 avec son ballon la France, le premier aérostat
qui ai réussi à faire une traversée aller et retour.
Puis ce furent les recherches des Santos Dumont, des Lebaudy. L'aérostation
dirigeable, entrée enfin dans la voie des réalisations,
apportait de nouvelles ressources à l'art militaire.
Mais, bientôt, les succès du plus lourd que l'air faisaient
négliger, chez nous, 1e dirigeable pour l'aéroplane.
Les Allemands cependant, ne sacrifiaient pas le premier au second, et
sans cesser de soutenir les efforts de leurs constructeurs d'avions,
ils mettaient surtout leurs espoirs dans la puissance de leur dirigeable
national : le Zeppelin.
Nous avons naguère conté ici (voir Supplément
du Petit Journal du 4 avril 1915) les étapes de l'invention
du comte Zeppelin ; nous avons même démontré que
cette invention n'était que le démarquage des plans d'un
inventeur français nommé Spiess qui, dès l'année
1873, avait imaginé un aérostat rigide ayant toutes les
caractéristiques du Zeppelin actuel. Rien d'étonnant à
cela, d'ailleurs : les Allemands ne se sont-ils pas de tout temps distingués
dans le pillage et l'exploitation des idées d'autrui ?
L'histoire dira quelle fut l'oeuvre des zeppelins dans cette guerre
; elle dira que leur rôle a consisté surtout dans le bombardement
des villes ouvertes. De deux ou trois mille mètres de haut, ces
montres aériens ont laissé tomber des bombes, la nuit,
sur des maisons où reposaient des êtres sans défense.
Et chaque fois que nos avions ont pu les découvrir, ces hideux
oiseaux de nuit se sont enfuis sans accepter le combat.
Quelques centaines de victimes innocentes : voilà le bilan des
zeppelins dans la guerre. Les Allemands peuvent être fiers de
ces massacres accomplis lâchement dans les ténèbres
; aucun peuple civilisé ne leur enviera cette gloire-là.
Ernest LAUT.
Le Petit Journal illustré du 13 février 1916