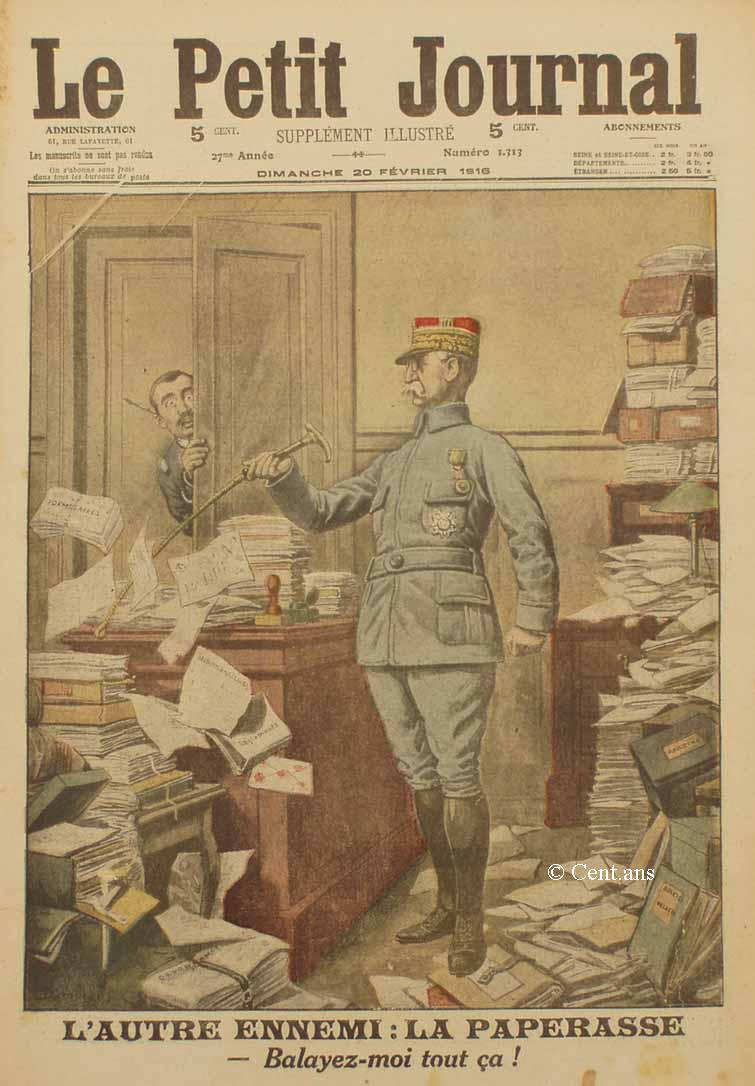L'autre ennemi : La paperasse
Cette composition est mieux qu'un symbole. On
sait, en effet, que, dès son arrivée au ministère
de la Guerre, le général Galliéni a commencé
à dresser ses batteries contre cet autre ennemi : la paperasse.
Mais cet ennemi-là est non moins tenace que l'autre. La volonté
d'un ministre, si énergique qu'il soit, ne suffit pas toujours
pour vaincre des traditions bureaucratiques qui se perdent dans la nuit
des temps. Il faut donc que chacun encourage et soutienne de son mieux
le ministre réformateur qui n'a pas craint de s'attaquer à
la paperasseries administrative.
Il est grand temps, en effet, d'en finir avec des mœurs déplorables
qui entraînent des complications inutiles, des pertes de temps,
des vexations, et annihilent, à une époque où la
France a besoin de toutes ses ressources, les bonnes volontés
d'une foule d'officiers qui préféreraient se battre que
de croupir dans des bureaux.
Depuis que la guerre est officiellement déclarée à
la paperasse, que de traits n'a-t-on pas citer de son influence malveillante.
C'est à cause des complications bureaucratiques que nos soldats
reçurent au printemps les vêtements chauds qui leur étaient
destinés pour l'hiver : c'est à cause des complications
bureaucratiques que parfois des hôpitaux manquèrent des
remèdes nécessaires pour les soins à donner à
nos blessés.
On signalait l'autre jour un état de 93 questions, dont quelques-unes
véritablement effarantes, posées à l'administration
de tous les hôpitaux de France par les bureaux du service de santé
sur les blessés soignés depuis le début de la guerre.
A ce premier questionnaire en était joint un second comportant
105 autres questions sur le matériel des hôpitaux. Pendant
que les médecins répondent à toutes ces interrogations
oiseuses, ils ne soignent pas leurs malades. Mais qu'importe à
l'administration ?... L'essentiel pour elle est de faire des statistiques.
Un ancien, officier, libéré de toute obligation militaire,
veut reprendre du service au commencement de la guerre. Il écrit
au ministère pour demander à être rappelé
sous les drapeaux.
Inquiet de ne pas recevoir de réponse il va s'informer.
- Votre demande, lui répond-on, n'était pas recevable
parce qu'elle n'était pas écrite sur papier « du
format réglementaire ».
Et voilà pour qu'elles chinoiseries paperassières on prive
le pays des meilleurs concours.
Un de nos confrères publiait dernièrement le fac-similé
d'un formidable grimoire de paperasserie administrative. A l'origine,
c'était une simple question posée par un sous-secrétaire
d'État au commandant d'un bataillon d'infanterie territoriale.
Eh bien ! le grimoire s'était promené pendant plus de
six semaines, du grand quartier général d'une armée
à tous les régiments de ladite armée ; et il rentrait
enfin au bercail, orné d'innombrables cachets, de non moins innombrables
signatures et annotations. Jugez par là du temps que cette sotte
paperasse avait fait perdre à des officiers qui avaient pourtant
bien autre chose à faire.
De telles pratiques exigent un nombre incalculable de bureaucrates occupés
tout le jour à faire des « états ». Pierre
Mille, avec son esprit incisif, montre jusqu'où est poussée
cette manie de l'état :
« Deux cent mille Bouvards et deux cent mille Pécuchets,
dit-il, écrivaient en ronde et faisaient des états. Les
sergents-fouriers faisaient des états, les capitaines faisaient
des états, ils le transmettaient au commandant qui faisait d'autres
états ; et du commandant au colonel, du colonel aux généraux,
des généraux aux chefs de corps, la même demande
d'autorisation pour l'achat de douze brosses à cirage passait,
passait encore, sur autant de feuilles de papier, puis redescendait
la filière et la remontait, sans forme d'état.. La méditation,
la composition, la rédaction des états absorbaient les
esprits. Il ne s'agissait pas que la chose fût faite, il s'agissait
qu'elle fût écrite. Et quand elle était écrite,
nul ne savait plus si elle avait été faite ; il n'est
pas bien certain que nul s'en inquiétât. L'état
devenait une passion, une manie absorbante et formidable, une raison
d'être et une nécessité vitale. »
Eh bien ! il faut que cette manie absorbante et formidable disparaisse
; il faut que le formalisme militaire soit simplifié et que la
paperasserie soit vaincue. La France, pour cela, compte fermement sur
l'énergie du général Galliéni. S'il y réussit,
il aura bien mérité d'elle une fois de plus.
VARIÉTÉ
Bataillons d'amazones
Autrefois et aujourd'hui. - Les amazones de la Révolution. -- Une mercuriale. - Comment les femmes françaises servent leur pays.
Des dames se sont réunies et veulent
être militarisées. Elles forment le « Corps volontaire
de Défense nationale des femmes françaises et belges ».
Elles sont, paraît-il, cinq mille déjà qui ont répondu
à l'appel des organisatrices.
Le corps se composera de cinq sections : celle de l'habillement avec
couturières, lingères, ravaudeuses et lavandières
; celle du ravitaillement (cuisinières et cantinières)
; celle des bureaux (secrétaires, sténodactylographes,
interprètes, téléphonistes, télégraphistes)
; celle des ouvrières des industries de la guerre, (obusières
employées dans les usines de l'État). Enfin le Régiment
de Jeanne composé de femmes sportives sachant nager, monter
à cheval, à bicyclette, donner des soins aux blessés
et pouvant sertir dans les services de liaison.
Voilà le programme du corps volontaire des femmes. On ne peut
en somme qu'y applaudir. Ces dames se préoccupent surtout de
remplir des emplois qui sont bien ceux de leur sexe ; et sauf celles
qui se proposent de servir au front comme agents de liaison, on ne saurait
leur reprocher de prétendre à remplacer les hommes.
Leurs devancières de l'époque révolutionnaire étaient
moins modestes, assurément, car celles-ici ne méditaient
rien de moins que d'être de véritables guerrières
et de courir la chance des champs de bataille.
***
La création de ce corps volontaire de
femmes évoque tout naturellement à l'esprit le souvenir
légendaire des amazones.
Ont-elles vraiment existé, ces femmes belliqueuses qui, pour
mieux tirer de l'arc, se mutilaient le sein droit ; ou ce mythe n'est-il
que le fruit de l'inépuisable imagination des Anciens ?
Quoi qu'il en soit, la fable des amazones tient une large place dans
la mythologie et dans l'art de la Grèce antique. Les sculpteurs
nous les ont représentées, ces farouches guerrières,
aussi belles qu'indomptables, et leurs luttes contre les héros
et les hommes ont inspiré les plus grands artistes.
Nous les retrouvons aussi dans les mythologies orientales, dans les
traditions de l'Inde ancienne, dans celles du Siam où, de nos
jour encore, le roi possède un bataillon sacré d'amazones.
Les Scythes eurent leurs amazones ; et les Walkyries des mythologies
scandinaves sont leurs soeurs.
Enfin, dans les temps modernes, tout près de nous, nos soldats
n'ont-il pas trouvé au Dahomey, les amazones de Behanzin défendant
leur pays et leur maître avec une énergie désespérée.
C'est pour défendre leur foi qu'au temps des Croisades, suivant
ce que rapporte l'historien byzantin Cinname, les femmes nobles de France
partirent en Palestine et formèrent un corps spécial sous
le commandement de la plus intrépide d'entre elles. Quels étaient
les noms de ces femmes ? Nul ne le sut. Elles étaient toutes
bardées de fer comme les chevaliers ; celle qui les conduisait
avait une armure éclatante et les soldats l'appelaient «
la dame aux jambes d'or ».
Combien d'autres après elles prirent les armes pour le saint
de leur patrie !
Ce sont les femmes de Bohème qui combattent sous Vlasto pour
la liberté de leur pays ; ce sont les amazones de la Floride
qui se dressent, en 1540, contre l'invasion espagnole ; ce sont les
guerrières du Nizam qui défendent le Deccan contre les
Anglais.
En France même, sans parler des femmes qui, depuis la bonne Lorraine
ont isolément pris les armes aux heures où leur foyer
était menacé, nous eûmes aussi des légions
d'amazones. Mais il est vrai que celles-ci n'ont jamais pu arriver à
se faire admettre dans les armées.
***
C'est à la faveur du mouvement révolution
que les premiers corps militaires féminins tentèrent de
se constituer. M. le baron de Villiers, dans sa curieuse Histoire
des clubs de femmes et des légions d'Amazones, nous a donné
là dessus, maints détails. Il raconte que Théroigne
de Méricourt, qui se flattait de mériter le titre de générale
des Amazones révolutionnaires, avait, dès le commencement
de l'année 1792, essayé d'organiser un bataillon féminin.
Le 25 mars, sur la place Louis XIII, elle assembla les femmes du Faubourg
Saint-Antoine, leur remit un drapeau et les harangua en ces termes :
« ...Armons-nous, nous en avons le droit par la nature et même
par la loi. Montrons aux hommes que nous ne leurs sommes inférieures,
ni en vertu, ni en courage.. On va essayer de nous retenir en employant
les armes du ridicule... Mais, nous nous armerons parce qu'il est raisonnable
que nous nous préparions à défendre nos droits,
nos foyers, et que nous serions injustes à notre égard
et responsables à la Patrie, si la pusillanimité que nous
avons contractée dans l'esclavage, avait encore assez d'empire
pour nous empêcher de doubler nos forces... Il est temps que les
femmes sortent de leur honteuse nullité.
Les hommes, ajoutait-elle, prétendait-ils seuls avoir des droits
à la gloire ? Nous aussi nous voulons briguer une couronne civique
et briguer l'honneur de mourir pour une liberté qui nous est
peut-être plus chère qu'à eux, puisque les effets
du despotisme s'appesantissent encore plus durement sur nos têtes
que sur les leurs. Armons-nous ! Allons nous exercer trois fois par
semaine aux Champs-Elysées, ouvrons une liste d'Amazones ! »
Quinze jours plus tard, le conseil général de la Commune,
offrit à l'amazone une superbe épée d'honneur et,
comme quelques spectateurs osaient protester, le président leur
cria : « Taisez-vous, elle saura mieux s'en servir que vous. »
Une autre meneuse d'Amazones, Pauline Léon vint, le 6 mars 1792,
déposer à la barre de l'Assemblée une pétition
au nom de trois cents citoyennes qui réclamaient le droit de
« pourvoir elles-mêmes à la défense de leur
vie, et de la liberté ».
« Ne croyez pas, disaient-elles que notre dessein soit d'abandonner
les soins toujours chers à nos coeurs, de notre famille et de
notre maison pour courir à l'ennemi. Non, messieurs, nous voulons
seulement être à même de nous défendre...
»
Ces dames ne projetaient de se battre que si, par malheur les armées
d'hommes étaient vaincues. En ce cas, disaient-elles, nous ferons
voir « que les femmes aussi ont du sang à répandre
pour le service de la patrie en danger ».
En conséquence, ces dames réclamaient « des piques,
des pistolets, des sabres, même des fusils pour celles qui auraient
la force de s'en servir ». Elles demandaient, en outre, l'autorisation
de s'assembler tous les dimanches au Champ de la Fédération,
afin de s'exercer au maniement des armes, sous la direction de ci-devant
gardes-françaises désignés par l'Assemblée.
Le président de l'Assemblée les félicita et exprima
le voeu que leur exemple fît rougir « ces hommes faibles,
plus jaloux d'un honteux repos que de la liberté ». Et
l'initiative de Pauline Léon et de ses amazones servit du moins
à faire conspuer les embusqués du temps.
Mais les amazones n'étaient pas toujours aussi bien accueillies
par les pouvoirs publics.
Le 27 brumaire An II, les femmes du Club des Citoyennes républicaines
révolutionnaires, conduites par Rose Lacombe, pénètrent
en uniforme - jupon court, grandes bottes, bonnet rouge - à l'Hôtel
de Ville. Elles y sont fort mal reçues. Anaxagoras Chaumette,
le procureur de la Commune, les apostrophe en ces termes :
« Depuis quand est-il d'usage de voir des femmes abandonner les
soins pieux de leur ménage, le berceau de leurs enfants, pour
venir sur la place publique, dans la tribune aux harangues, à
la barre du Sénat, dans les rangs de nos armées, remplir
les devoirs que la nature a départis aux hommes seuls ?... Femmes
imprudentes, qui voulez devenir des hommes, n'êtes vous pas assez
bien partagées ? Vous dominez sur tous nos sens, votre despotisme
est le seul que nos forces ne puissent abattre, parce qu'il est celui
de l'amour et par conséquent celui de la nature. Au nom de cette
même nature, restez ce que vous êtes. ( Les femmes ôtent
leur bonnet rouge. )
» Autant nous vénérons la mère de famille,
qui met son bonheur à élever, à soigner ses enfants,
à filer les habits de son mari, autant nous devons mépriser
la femme sans vergogne qui endosse la tunique virile et fait le dégoûtant
échange des charmes que lui donne la nature contre une pique
et une culotte. Passez-moi ce tableau : il peint l'idée que je
me fais des femmes-hommes. »
Ces dames empochèrent la mercuriale et s'en furent toutes marries.
Les autres légions féminines qui tentèrent de se
constituer ne furent guère plus heureuses Comme l'avait prévu
Théroigne de Méricourt, on employa contre elles l'arme
du ridicule. Et c'est une arme terrible en France. Jamais, à
Paris, les légions d'amazones ne furent prises au sérieux.
***
Il est vrai que les dames qui forment aujourd'hui le « Corps volontaire
de Défense nationale des femmes françaises et belges »
sont infiniment plus modestes et plus raisonnables que leurs devancières.
Ce qu'elles réclament, en somme, les femmes allemandes l'ont
demandé avant elles. Il y a pas mal d'années déjà
que le projet de la femme à la caserne est discuté chez
nos ennemis. Ses partisans demandaient que les femmes fîssent
deux ans de service dans les cuisines, les magasins d'habillement, les
buanderies, les infirmeries. Service exempt de gloire évidemment.
Mais quoi ! faire la popote des guerriers, repriser leurs chaussettes
et raccommoder leurs culottes ne serait-ce pas encore une façon
de servir la patrie.
Une suffragette allemande, fraulein Werner, qui soutenait ce projet
de toute son éloquence, voyait dans cette éducation de
la femme à la caserne l'occasion de renforcer l'institution du
mariage. Comment en effet, les soldats lui les auraient vues à
l'oeuvre ne s'empresseraient-ils pas d'épouser ces soldates admirablement
rompues à la discipline ménagère ?
En Autriche même, peu de temps avant la guerre, on affirmait que
le gouvernement était décidé à confier à
un personnel féminin plusieurs services administratifs de l'armée,
tels que les services de santé, lingerie, de dépôts
d'uniformes et d'équipement.
On envisageait même le service des femmes dans des compagnies
ouvrières, lesquelles seraient affectées à des
dépôts dont le personnel serait exclusivement féminin.
On devait les employer également dans les stations d'approvisionnement
des chemins de fer. Seuls les bureaux de D'état-major restaient
fermés aux femmes. Les grands chefs autrichiens n'avaient sans
doute pas une confiance absolue dans la discrétion du beau sexe.
Un premier essai, portant sur un nombre restreint d'employées
devait être fait.
Si les résultats étaient jugés satisfaisants l'emploi
des femmes serait généralisé dans l'armée
autrichienne.
Mais la guerre éclata. Qu'est-il advenu du projet ?...
Il n'en demeure pas moins qu'un peu partout le concours de l'élément
féminin s'est montré précieux en temps de guère.
Sans qu'il soit besoin de les enregimenter et de les faire passer à
la caserne. Les femmes françaises ont su rendre à la défense
nationale les meilleurs services. On sait l'oeuvre magnifique des infirmières
volontaires. On sait aussi combien d'ouvrières sont employées
à la fabrication des munitions ; on sait encore que les femmes
de toutes les classes ont travaillé au foyer pour que nos soldats
soient vêtus chaudement en hiver ; on sait enfin, que les femmes
des campagnes françaises ont suppléer au manque de bras
dans les travaux des champs. Si nous mangeons du pain, c'est aux femmes
de France que nous le devons.
Voilà ce qu'ont fait les femmes de France depuis le début
de la guerre. Pouvaient-elles servir plus utilement et plus noblement
leur pays ?
Ernest LAUT
Le Petit Journal illustré du 20 février 1916