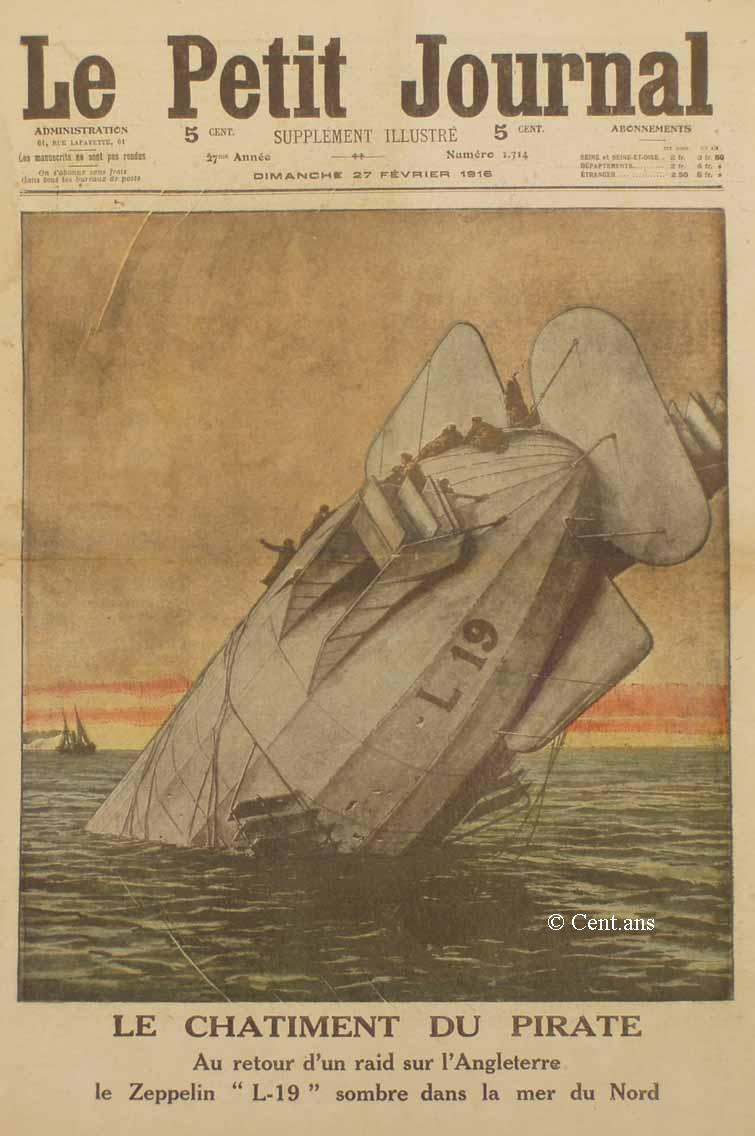LE CHÂTIMENT DU PIRATE
UN ZEPPELIN SOMBRE DANS LA MER, DU NORD.
Il revenait d'un raid sur d'Angleterre, il revenait tout guilleret,
car il avait tué nombre de femmes, d'enfants et de vieillards.
Même, en route, par dessus la mer, il se débarrassait joyeusement
des bombes qui lui restaient, et les jetait indistinctement sur tous
les navires qu'il rencontrait, sans même s'inquiéter de
leur nationalité.
Il s'en allait donc tout guilleret vers les côtes d'Allemagne.
Mais que lui advint-il soudain ?,.. Est-il vrai que passant à
faible hauteur au-dessus d'une île hollandaise, il ait reçu
quelques pruneaux des soldats qui gardaient cette île. Ou bien
une avarie inattendue se produisit-elle spontanément dans son
énorme carcasse ?
Toujours est-il qu'il se mit à descendre, à descendre
et que bientôt il rasa les flots. Les hommes qui le montaient
essayèrent de retenir avec des cordes les flancs métalliques
du géant qui menaçait de s'entr'ouvrir. Peine perdue !
Les ballonnets intérieurs se vidaient; le Zeppelin descendait
toujours. Bientôt, ses nacelles furent submergées. L'équipage
se réfugia sur la plate-forme supérieure du ballon.
Alors, au lointain apparut un tout petit navire, un modeste chalutier
anglais du genre de ceux que le Zeppelin s'était amusé
à envoyer au fond de l'eau à coups de bombes, au cours
de sa croisière nocturne.
Le jour s'était levé ; on fit des signaux, on cria. Le
chalutier s'était approché ; c'était le King
Stephen du port de Grimsby.
Le patron du chalutier anglais, M. William Martin, raconte que, lors
de la rencontre, une quarantaine de mètres de la carcasse flottaient
encore, dominant l'eau d'une hauteur de dix mètres. Une quinzaine
d'hommes se voyaient dans la nacelle du haut de l'appareil mais l'équipage
était plus nombreux.
- « Envoyez-nous une embarcation, cria un des naufragés,
qui paraissait être une officier de marine : je vous donnerai
cinq livres !
M. William Martin réfléchit que les Allemands étaient
une trentaine, qu'ils étaient armés et que lui n'avait
à son bord que neuf hommes et un seul pistolet. Le sauvetage
lui parut dangereux.
- A supposer que je vous prenne, dit-il que vous nous jetiez par-dessus
bord et que vous dirigiez le chalutier vers l'Allemagne, cela vous ferait
beaucoup d'honneur, mais cela ne mous rapporterait guère à
nous !
L'officier protesta que ni lui ni ses hommes ne feraient rien de semblable.
Mais le patron anglais se souvint de ce qu'avaient fait les Huns et
de ce qu'ils pourraient faire encore. Il ne se laissa pas convaincre
d'exposer son équipage et lui-même à un tel danger.
« Je m'écartai donc du Zeppelin vers neuf heures trente
du matin, déclara-t-il. Le capitaine me dit qu'ils coulaient.
Quelques Allemands de l'équipage me crièrent tout d'abord
: « Sauvez-nous ! » Puis ils montrèrent leurs poings
dès qu'ils s'aperçurent que cela n'avait aucun effet.
Je les aurais bien sauvés, n'eût été la raison
que j'ai dite.
« Je partie à la recherche d'une canonnière ou d'un
vaisseau patrouilleur mieux aménagé pour surveiller un
équipage ennemi. En temps de paix, évidemment, j'aurais
pris tous les Allemands à mon bord en deux temps et deux mouvements...»
De cette aventure, le peuple boche pourra tirer une moralité.
C'est à savoir que si le patron du chalutier anglais a refusé
de sauver l'équipage du Zeppelin, la faute en est à la
réputation de cruauté et de félonie que les Allemands
se sont créée depuis le début de la guerre.
Et les Boches, cette fois, furent punis par où ils avaient péché.
VARIÉTÉ
Leurs chants nationaux
Les Boches cherchent un chant national . - Le « Heil dir im Siegerkranz » . - « Deutschland über alles » . - Schneckenburger et la Garde du Rhin. - « Nous l'avons eu votre Rhin allemand ».
Les Allemands ne sont pas satisfaits de leur
air national. Ils veulent le changer... Dame ! ça se conçoit.
C'est le même - au point de vue musical - que celui de l'Angleterre
et celui de la Suisse.
Quoi d'étonnant ? L'Allemagne, pays du plagiat et de la contrefaçon,
a plagié jusqu'à son chant national.
Et l'histoire en est fort curieuse.
Au début du XVIIIe siècle, dit la légende, Mme
de Maintenom voulut avoir un joli cantique afin de le faire exécuter
par les demoiselles de Saint-Cyr quand Louis XIV venait leur rendre
visite.
Elle prit un air de Lulli, sur lequel furent mises les paroles suivantes
:
Grand Dieu, sauvez le roi !
Grand Dieu. vengez le roi !
Vive le roi !
Que toujours glorieux,
Louis victorieux,
Voie ses ennemis
Toujours soumis.
A quelque temps de là - c'est toujours
la légende qui parle - l'illustre musicien Haendel entendit à
Versailles ce cantique.
Il en fut ravi et demanda à la supérieure l'autorisation
de copier cette oeuvre musicale. De retour en Angleterre, il l'offrit
au roi George Ier. Et celui-ci, trouvant le chant fort beau, en fit
l'air national de l'Angleterre, le God save the King.
Mais, je l'ai dit, ceci n'est qu'une légende.
Les Anglais d'une part, les Suisses de l'autre, se sont efforcés
d'en démontrer l'inexactitude.
Ceux-ci affirment que dès l'année 1603, c'est-à-dire
cent ans avant que fût conçu l'hymne en l'honneur du roi
Soleil, la mélodie avait été composée par
un musicien de leur pays, dont la postérité n'a pas gardé
le nom, et mise sur des paroles en patoise genèvois pour commémorer
la victoire remportée par les Suisses sur les troupes du duc
de Savoie l'année précédente.
Or, ce chant aurait été entendu par des Anglais à
Genève, et l'un d'eux, s'en emparant l'aurait importé
dans son pays et en aurait fait un hymne en l'honneur du roi Jacques
1er.
Mais les Anglais, à leur tour, combattent cette version et réclament
pour un des leurs, la paternité de leur chant national.
Ce serait, suivant eux, un vieil air populaire de leur pays sur lequel,
en 1741, un de leurs musiciens, nommé Henry Carey, aurait composé
un chant en l'honneur de George II, à l'occasion de la victoire
remportée à Portobello sur les Espagnols, par l'amiral
Vernon.
Ce chant fut imprimé pour la première fois dans le
Gentleman's Magazine en 1745, sous le nom, de son auteur et dans
sa forme à la fois initiale et définitive.
Vous voyez que les versions ne manquent pas sur l'histoire de ce chant
triplement national, et qu'il est difficile de se faire une opinion
précise sur son origine.
Est-il né en France, en Suisse ou en Angleterre ? Voilà
ce que personne ne saurait affirmer.
Mais ce qui est bien certain, c'est que ce chant, quoique chant national
allemand, n'est pas né en Allemagne.
Comment donc, me direz-vous, les Allemands s'en sont-ils emparés
?
Voici :
Avant d'arriver chez les Boches, l'air attribué successivement
à Lulli, à Haendel et à Carey devait faire encore
un petit détour.
En 1790, un Danois nommé Harries entendit cet air et le trouva
à son goût. Il y appliqua des paroles quelconques et fit
imprimer la chanson.
Une quinzaine d'années plus tard, un Boche du nom de Balthazar-Gerhard
Schumacher, dépourvu de scrupules, comme le sont généralement
les Boches, découvrit dans un recueil la chanson de Harries et
composa sur cette musique une plate louange en l'honneur du roi de Prusse
d'alors, Frédéric-Guillaume : « Heil dir im Sieger
kranz. » Salut à toi que la victoire couronne.
Or, il faut vous dire ce qu'était ce souverain couronné
par la victoire. Ce n'était autre que le vaincu d'Iéna,
le misérable dont les victoires de Napoléon avaient fait
un roi sans terre et sens couronne. En tout autre pays. l'hymne de Schumacher
eut semblé pure ironie. En Allemagne, où l'on n'a pas
le sens du grotesque et du ridicule, ces paroles qui glorifiaient un
souverain quasiment détrôné, un fantoche royal,
furent accueillies avec enthousiasme ; et c'est ainsi que le «
Heil dir im Siegerkranz » devint l'hymne national de
la Bocherie.
Mais depuis lors, la haine de l'Angleterre aidant, les Allemands ont
supporté malaisément l'inconvénient d'avoir, au
point de vue musical, le même hymne national que les Anglais.
Aussi, bien que le Heil dir im Siegerkranz soit demeuré
l'hymne officiel ; se sont-ils efforcés de se créer d'autres
chants plus en rapport avec leur âme guerrière et dont
les mélodies fûssent d'origine allemande.
***
Il en est un que les populations de nos régions envahies ont
beaucoup entendu depuis dix-huit mois, qu'elles ont entendu. surtout
dans les premiers jours de l'invasion , car c'est généralement
au son de cet hymne que les troupes boches entraient dans les villes.
C'est le Deutschland über alles.
Empruntons-en la traduction à un éminent historien qui
connaît mieux que personne la langue et la littérature
allemandes, M. Arthur Chuquet :
L'Allemagne, l'Allemagne par-dessus tout,
Par-dessus tout le monde,
Si elle ne cesse pour défensive et offensive
De tenir fraternellement !
De la Meuse à la Memel,
De l'Adige au Belt,
L'Allemagne, l'Allemagne par-dessus tout,
Par-dessus tout le monde !
Femmes allemandes et foi allemande.
Vin allemand et chant allemand,
Doivent dans le monde garder
Leur vieil et bon renom,
Nous animer à de nobles actions
Durant, toute notre vie.
Femmes allemandes et foi allemande,
Vin allemand et chant allemand !
Union et droit et liberté
Pour la patrie allemande !
Voilà où nous devons tous tendre
Fraternellement et du coeur et des mains.
Union et droit et liberté
Sont le gage du bonheur.
Fleuris dans l'éclat de ce bonheur,
Fleuris, patrie allemande !
Ces vers, où s'exprime à souhait
la grossière vanité teutonne, se chantent, mon point sur
un air guerrier, mais sur le rythme d'un vieux cantique dont le dessin
est de Haydn, et que, je ne sais quel plagiaire boche a retapé
pour la circonstance.
Mais le véritable hymne populaire allemand ce m'est ni le Heil
dir im Siegerkranz, ni le Deutschland über alles,
c'est la Wacht am Rhein, la Garde du Rhin.
Ici s'expriment réellement dans la musique aussi bien que dans
les paroles la fièvre guerrière en même temps que
la prétention politique de ce peuple et ethnographique, le Rhin
comme un fleuve allemand.
Empruntons encore à M. Chuquet la traduction de la Garde
du Rhin.
Un appel retentit comme le bruit du tonnerre.
Comme le cliquetis des épées et le bondissement des vagues
:
Au Rhin, au Rhin, au Rhin allemand !
Qui veut du fleuve être le gardien !
Chère patrie, tu peux être en repos
!
Elle est debout, ferme et fidèle, la garde du Rhin !
Cent mille hommes aussitôt ont tressailli,
Et les yeux de tous lancent un vif éclair.
Le jeune Allemand, pieux et fort,
Protège la Marche sacrée du pays !
Chère patrie, etc.
Il lève le regard vers les célestes
prairies,
D'où le contemplent les esprits des héros,
Et il jure avec un fier désir de combattre :
« Le Rhin est allemand comme mon âme ! »
Chère patrie, etc
« Oui, quand mon coeur se briserait dans
la mort.
« Tu ne seras pas Welche pour cela »
Comme ton courant est riche d'eau,
L'Allemagne n'est-elle pas riche de sang héroïque ?
Chère patrie, etc.
Tant que s'enflamme une goutte de sang,
Tant qu'une main peut tirer l'épée,
Tant qu'un bras peut armer le fusil.
Nul ennemi ne foule ici ta rive,
Chère patrie, etc.
Le serment retentit, le flot coude.
Les drapeaux volent et flottent au vent
Au Rhin, au Rhin, au Rhin allemand !
Tous nous voulons être ses gardiens !
Chère patrie, etc.
***
L'homme qui composa ce poème n'était pas un grand poète,
mais c'était un véritable Allemand. Il était, dit
M. Chuquet « foncièrement, passionnément Allemand,
Allemand de la tête aux pieds ».
Il s'appelait Max Schneikenburger. Fils d'un modeste commerçant
de Thalheim, il était né dans ce petit village du Wurtemberg
en 1819. Tout jeune collégien, à l'école d'Herrenberg,
il faisait déjà, des vers en songeait à la gloire
littéraire. Mais son père n'entendait pas de cette oreille.
A quinze ans, il retirait le jeune rimeur de l'école et le mettait
en apprentissage chez un droguiste.
La droguerie ne réussit guère, à ce qu'il semble,
au jeune Max. Peu de temps après son patron le flanquait à
la porte. Ce que voyant, le père Schneckenburger mit son fils
chez des marchands de fer de Burgdorf dans a le canton de Berne.
Cette fois, le jeune homme mordit au métier. Il y mordit même
si bien que, moins d'un an plus tard, il devenait gérant de la
maison.
Mais le démon poétique ne l'avait pas abandonné.
La ferraille lui laissait quelques loisirs ; il les employait à
s'instruire, à lire les poètes, à écrire
des vers. Il apprenait par coeur les pièces des poètes
allemands de la revanche, des Arndt, des Jahn, des Gorres et s'efforçait
de les imiter. A seize ans, âge où tous les poètes
ne songent qu'à célébrer la nature et l'amour,
il ne célèbre lui, que l'orgueil allemand.
« A seize ans, dit M. Chuquet, lorsqu'il cherche une courte devise
qui le dirige à travers la vie, il ne trouve qu'un mot, le mot
Deutsch ou Allemand : « Oui, je suis Allemand, je vivrai
Allemand, c'est-à-dire loyal et fidèle, simple, pieux,
gai, fort et courageux dans le danger, enragé contre le vice
et l'iniquité, un vrai patriote ! »
Que de qualités, que de vertus, et qui de nous, Français
légers et frivoles s'imaginerait que le seul vocable Deutsch
les contient, les résume toutes !
» La même année, il déclare que la nation
allemande est admirable, qu'elle a la force physique et la force de
l'esprit, qu'il lui suffirait d'être guidée et unie pour
régner sur L'Europe. »
A l'exemple des pangermanistes d'aujourd'hui, des Boches frénétiques
qui sont responsables de la guerre actuelle, il est persuadé
que l'Allemagne a, dans le monde, une mission à remplir. En 1840,
il prêche la guerre contre la France ; et il voit dans cette guerre
l'occasion, pour l'Allemagne de reconquérir toutes les provinces,
tous les pays qu'il considère comme étant d'essence germanique
: la Suisse allemand, l'Alsace, la Belgique, la Hollande, leDanemark,
les provinces balkaniques. C'est bien, vous le voyez, un pangermaniste
avant le pangermanisme.
***
C'est alors qu'il composa ce chant de Garde du Rhin que les
Allemands comparent volontiers à notre Marseillaise.
Deux musiciens, nommés Spiess et Mendel unirent leurs talents
pour le mettre en musique. Le premier fit le couplet, le second refrain.
Mais cette musique n'eut aucun succès. En 1854 seulement, un
autre compositeur, Charles Wilhelm adorna le poème de Max Schneckenburger
de la musique définitive, celle que nos pères ont entendue
1870, celle que nos pays envahis ont entendue cette fois encore, musique
qui n'est point sans valeur mais qui reste bien loin de notre Marseillaise
quoi qu'en disent les orgueilleux Teutons.
Il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'à la même
époque où parut le chant du Sshneckenburger, un autre
poète allemand composa et publia un autre poème dont le
sujet était à peu près le même. Je veux parler
de la célèbre chanson de Becker :
Le Rhin allemand .
Ils ne l'auront pas notre Rhin allemand
disait Becker. Or, l'on sait quelle triomphante
réponse Musset fit à ce chant.
Paul de Musset a raconté comment son glorieux frère composa
ses strophes vengeresses.
« Le 1er juin 1841, dit-il, nous déjeunions en famille,
quand on apporta la Revue des deux mondes qui contenait la
Chanson de Becker. En lisant les six couplets dans lesquels, en si peu
de mots, se trouvaient tant d'insultes à la France, Alfred de
Musset fronça le sourcil... A mesure que nous en causions, tout
en déjeunant, son visage s'animait, le feu lui montait aux oreilles
enfin ; il donna un coup de poing sur la table, rentra dans sa chambre
et s'y enferma. Deux heures après, il en sortit poux nous réciter
le Rhin allemand. »
Nous l'avons eu votre Rhin allemand !
Nous l'avons eu, et nous espérons bien qu'en dépit de vos rodomontades, nous l'aurons encore, et qu'il redeviendra le Rhin français.
Ernest LAUT.
Le Petit Journal illustré du 27 février 1916