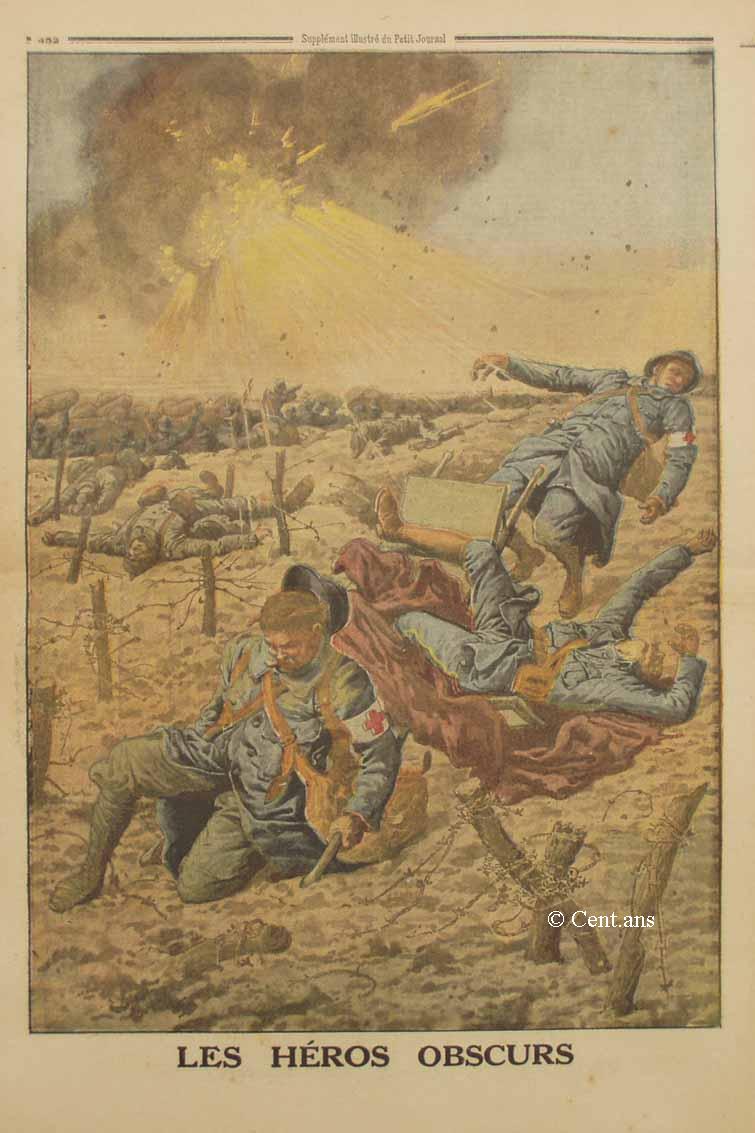Les héros obscurs
Les héros obscurs ce sont les ambulanciers,
les infirmiers, tous les soldats de l'hôpital et de l'ambulance.
Nous célébrons dans notre « Variété
» leur courage, leur abnégation, en taisant un rapide historique
du service de santé aux armées.
Ces jours derniers encore, un major revenant du front d'Artois contait
l'histoire héroïque d'un ambulancier qui sauva dix de ses
camarades ensevelis par une mine.
Des traits de ce genre sont innombrables. Rendons hommage à ce
héros : l'ambulancier du champ de bataille, que les marmites
boches n'épargnent guère, et qui mérite sa place
au livre d'or de la vaillance française.
VARIÉTÉ
Du champ de bataille
a l'ambulance
Ceux qu'on oublie. - La service de santé au temps jadis. - L'ambulance d'aujourd'hui. - Les victoires sur la mort.
Ceux-là aussi méritent qu'on les
associe à la gloire des armes, ceux qui relèvent les blessés
dans l'horreur du champ de bataille, les emportent aux postes de secours,
aux ambulances, les soignent, les sauvent, les rendent à la vie.
Leur accorde-t-on toujours la justice qu'on doit à leur dévouement
?
Dans la conclusion d'un beau livre que nous aurons l'occasion de citer
plus loin : Feuilles de route d'un ambulancier, notre confrère
Charles Leleux, déplore, d'ailleurs sans rancoeur, que cette
oeuvre du service de santé, toute belle et méritoire qu'elle
soit, demeure obscure et sans gloire.
« Demain, dit-il à ses camarades les ambulanciers, demain,
à l'heure du triomphe, on vous oubliera sans doute une fois de
plus. Vous ne figurerez point aux revues solennelles. Vous n'aurez point
de drapeaux que l'on puisse décorer. Et jamais les historiens
ne parleront de vous, - pas plus que des infirmiers de nos hôpitaux,
ni du personnel des trains sanitaires et de son dur labeur, ni même
des héroïques brancardiers qui s'en vont à la recherche
des blessés le jour et la nuit, par tous les temps, dans les
bois et dans les tranchées, et que les balles allemandes ne respectent
même pas... Demain on exaltera les victoires qui s'évaluent
au chiffre des victimes, - et l'on ignorera les victoires remportées
par vous sur la mort, le sang épargné, les souffrances
taries, les vies innombrables sauvées par vous...
« Mais qu'importe ! ajoute-t-il. Si l'ivresse du succès
rend les combattants un peu ingrats, n'êtes-vous pas suffisamment
récompensés de savoir votre oeuvre comprise et bénie
par ces millions d'êtres à qui vous avez su conserver un
fils, un fiancé, un époux ou un frère ? »
Et n'est-ce pas en somme, pour les combattants de l'ambulance et de
l'hôpital une forme de la gloire, que cette gratitude dont ils
se sentent entourés ?
***
De quelle époque date l'organisation du service de santé
en temps de guerre ? Les armées, grecques comptaient dans leurs
rangs des chirurgiens et des médecins qui portaient secours aux
blessés sur le champ de bataille, mais on ne trouve dans les
historiens de la Grèce ancienne aucune mention de ce qui pouvait
constituer l'hôpital ou l'ambulance militaires.
La chose, au contraire existait indubitablement chez les Romains. Les
légions étaient pourvues de chirurgiens et même
d'infirmiers. Et Végèce rapporte qu'en temps de guerre
elles avaient une sorte d'hôpital mobile appelé Valetudinarium.
Avant la bataille, les chefs désignaient, à l'arrière,
des endroits où les blessés étaient transportés
et pansés avant d'être évacués sur cet hôpital.
C'étaient là des postes de secours comparables à
ceux des armées modernes.
L'organisation du service de santé dans les armées romaines,
sombra, comme tant d'autres progrès de la civilisation antique,
dans les ténèbres du Moyen Age.
Avant le XVIe siècle, l'ambulance n'existe pas. On abandonne
les blessés sur le champ de bataille ; à eux de se sauver
comme ils peuvent ou de se résigner à se voir achever
sur place par l'ennemi vainqueur. Seuls les nobles chevaliers reçoivent
les secours de médecins spécialement attachés à
leur personne et qu'ils emmènent avec eux à la guerre.
Cependant, Percy, le célèbre chirurgien du premier empire,
qui fit de savantes recherches sur l'organisation du service de santé
dans le passé, rapporte qu'à la fin IXe siècle
dans l'armée de l'empereur Léon VI, chaque cohorte comptait
une douzaine d'hommes qui marchaient à l'avant-garde et qui étaient
désignés pour emmener les blessés et relever les
hommes tombés de cheval. On sait que les guerriers d'alors étaient
couverts d'une tunique de mailles si lourde qu'il leur était
impossible de se relever seuls lorsqu'ils étaient à, terre.
Ces ancêtres des brancardiers militaires étaient les despotats,
milites despotati. Pourvus d'un cheval qui portait au côté
gauche deux petites échelles pour faciliter l'ascension des blessés
et tenus eux-mêmes d'avoir toujours à la disposition de
ceux-ci un vase rempli d'eau, ils recevaient une rétribution
pour chaque guerrier sauvé.
Percy estime que l'institution des despotats, probablement
antérieure au règne de Léon VI, ne dura guère
au delà de son temps.
En France, ce n'est qu'au siège d'Amiens, en 1590 qu'on voit
apparaître les premières ambulances, en même temps
que sont créés à l'arrière de véritables
hôpitaux sur lesquels sont évacués les blessés
transportables.
Sully fut l'auteur de cette double création humanitaire.
Richelieu développa l'oeuvre de son prédécesseur,
multiplia les ambulances et les plaça sous la direction d'un
chef médical unique.
M. Léon Mention, dans son intéressant ouvrage sur l'Armée
de l'Ancien Régime, note qu'à cette époque,
le service des ambulances se confondait avec celui de l'aumônerie.
Et il cite le passage d'une ordonnance du Cardinal relative à
ce service :
« Il y aura, dans chaque armée, des jésuites et
des cuisinières donneront des bouillons et des potages à
tous les malades, et, de plus, un chirurgien et un apothicaire pour
saigner et secourir ceux qui en auront besoin. »
Sous Louis XIII et sous Louis XIV, le chirurgien et l'apothicaire qui
soignent les blessés dans les ambulances ne sont pas plus militaires
que les jésuites et les cuisinières qui leur portent le
potage. Hôpitaux ambulants des armées en campagne et hôpitaux
fixes des villes de garnison sont, comme tous les organismes administratifs
en ce temps-là, affermés à des entrepreneurs, à
des traitants ou à des sous-traitants. Le chirurgien n'est que
l'employé de cet entrepreneur. On conçoit qu'il soit plus
attaché à sa place qu'à la conservation du soldat.
De ce fait, les progrés dans l'organisation des hôpitaux,
dans l'hygiène, dans les pratiques médicales sont plutôt
rares. C'est l'époque où l'on couche, à l'hôpital,
trois ou quatre soldats dans le même lit, et où l'on fait
sans scrupule voisiner sur la même couche le blessé avec
le typhique ou le varioleux.
Il faut aller jusqu'au début du XVIII e siècle pour voir
enfin le service de santé aux armées pourvu d'un personnel
stable. L'édit royal du 17 janvier 1708 porte création
de conseillers de Sa Majesté, médecins et chirurgiens,
inspecteurs, généraux et majors. Chaque régiment
d'infanterie a son chirurgien aux appointements de 180 livres, traitement
qui, sous le ministère Choiseul, fut porté à 500
livres.
« Ce chirurgien, observe M. Léon Mention, est déjà
un militaire, mais ce n'est pas encore un officier. S'il entre aux Invalides,
c'est confondu dans les rangs des bas-officiers. »
Comment, en ce temps-là. enlève-t-on les blessés
du champ de bataille pour les conduire à l'ambulance ? Point
de brancards et point de brancardiers. Sur des fusils entrecroisés,
sur une planche, sur un manteau tenu aux quatre coins, les hommes indemnes
transportent ceux de leurs camarades qui ont été gravement
atteints et qui ne peuvent se traîner seuls jusqu'aux ambulances
volantes.
Pour remédier à cette insuffisance de moyens de transport
l'ordonnance du 20 juillet 1788 prescrit, à la suite de l'hôpital
ambulant l'emploi de chariots à quatre roues pour le transport
des malades et des blessés. Mais ce matériel encombrant
et lourd s'embourbe dans les terrains détrempés des champs
de bataille, et porte le désordre au milieu des troupes. Il faut
bientôt y renoncer.
En 1792 seulement le transport des blessés fait un réel
progrès. Larrey crée son ambulance volante dirigée
par des chirurgiens à cheval allant sous le feu de l'ennemi porter
les premiers secours aux blessés ; Percy, prenant pour modèles
les voitures de course allemandes mises à la mode quelques années
auparavant et connues sous le nom de wourts, crée ses
chars de chirurgie, voitures étroites, allongées,
bien suspendues, qui, attelées de quatre chevaux montés
par des infirmiers et portant des chirurgiens munis d'objets de pansement
et de brancards, vont jusqu'aux premières lignes, sous le feu
de l'ennemi, recueillir les blessés.
Un personnel de brancardiers absolument spécialisé est
créé. « On a besoin, dit Percy, d'une certaine habitude
pour remuer un blessé, pour le charger sur un brancard et pour
le transporter. C'est moins par la force que par l'adresse que l'on
y réussit, et celle-ci ne s'acquiert que par l'habitude. Des
porteurs de brancards, marchant à pas inégaux, secouent
douloureusement le blessé. L'usage seul donne cet ensemble et
cette mollesse de mouvements sans lesquels le transport devient un supplice...On
ne saurait trop le répéter, le premier secours et la première
consolation que doit recevoir un blessé, c'est d'être enlevé
promptement et commodément, ce qui ne pourra s'effectuer qu'autant
qu'il y aura derrière lui de bons brancards pour le recevoir,
et des hommes bien exercés pour le porter. »
Ces principes établis par les chirurgiens de la Grande Armée
n'ont .pas cessé d'être appliqués depuis lors. Pendant
toutes les guerres du I er empire, les ambulances volantes de Larrey,
les brancardiers de Percy rendirent les plus grands services.
Le système fut adopté par toutes les armées de
l'Europe. La Prusse surtout appliqua à le développer et
à le perfectionner. Dès l'année 1855 l'armée
prussienne avait des compagnies de brancardiers parfaitement entraînées
; elle possédait des hôpitaux mobiles et avait imaginé
déjà l'organisation des postes de secours.
Un progrès restait à accomplir. Il vit le jour en 1864.
La Convention de Genève, décida alors que le matériel
et le personnel sanitaires seraient neutralisés que les blessés
seraient relevés et soignés quelle que soit leur nationalité.
C'était là une décision inspirée par le
plus noble esprit d'humanité, et que dans toutes les guerres
les peuples réellement civilisés ont respectés
et appliquée.
On sait hélas ! comment en 1870 aussi bien qu'aujourd'hui, les
Allemands l'ont foulée aux pieds !
***
Voilà comment fonctionnait naguère, le service de santé
du champ de bataille à l'ambulance. Comment fonctionne-t-il aujourd'hui
? Demandons-le à M. Charles Leleux. Nous ne saurions être
mieux renseignés.
« Dès le champ de bataille, écrit-il, tout soldat
blessé peut lui-même, ou avec l'aide d'un camarade appliquer
sur sa plaie le « pansement individuel » qu'il porte dans
la poche de sa capote. Souvent même un major ou l'un des Infirmiers
régimentaires sera là, comme lui sur la ligne ou dans
la tranchée, pour lui donner les premier soins. Puis ces mêmes
infirmiers, profitant de la première accalmie et mettant leur
fusil « à la bretelle », deviennent « brancardiers
régimentaires » et, passant le long de la ligne, y ramassent
tous les blessés qu'ils transportent au « poste de secours
». Là aussi arrivent peu à peu tous les blessés
qui ont pu, d'eux-mêmes, se mettre à l'abri d'un bois ou
d'une meule, tous ceux au contraire qu'un projectile immobilisa sur
place et qu'on releva, l'action terminée, et enfin tous les «
isolés » que les brancardiers retrouvent, parfois au bout
de deux ou trois jours, évanouis dans un fossé ou endormis
d'épuisement dans quelque grange déserte.
« Du poste de secours, souvent même directement du champ
de bataille, les blessés - soit à pied, soit dans des
voitures, soit encore sur des brancards, - sont amenés par les
«brancardiers divisionnaires » à l'une de nos ambulances
: là nous faisons de vrais pansements, des interventions urgentes,
rarement de grandes opérations. Après quoi, nos malades
classés en « assis, » « debout » et «
couchés », sont dirigés par voitures sur les hôpitaux
d'évacuations » Nous voilà déjà loin
de la ligne de feu et l'on devine qu'un « hôpital »
peut se permettre une chirurgie un peu plus sérieuse que la nôtre.
Au bout d'un délai, qui naturellement varie suivant le genre
de blessures, l'hopital (qui est presque toujours situé dans
une gare) fait transporter ses malades dans les « trains sanitaires
» qui se trouvent en la gare même et où les blessés,
installés en « assis ou en « couchés ».
seront surveillés par des majors et des infirmiers.
« A certaines stations du voyage, de nouveaux « tris »
s'opèrent, les blessés de la tête, par exemple,
ne devant pas voyager trop longtemps sans pansements nouveaux tandis
que les autres continuent leurs route pour être enfin admis dans
les hôpitaux militaires du territoire, suppléés
par ces innombrables « hôpitaux auxiliaires » et ambulances
que la guerre a fait surgir sur tous les points de notre pays... »
Et voici, pour finir, emprunté au même auteur, un tableau
pittoresque de l'ambulance :
« Entrez dans notre grande ambulance de
Suippes et regardez ce défilé de gens boueux et minables...
Avant de les panser, il nous faut d'abord enlever la glaise, couper
les hardes humides et repoussantes. Là encore, nos dévoués
infirmiers se montrent admirables, et c'est plaisir que de les voir
travailler, avec un ordre absolu.
Chacun est à son poste : un arrivant est étendu sur la
table de pansement. Pendant que les aides du major préparent
les instruments et découvrent la plaie, un « écrivain
» s'approche du soldat, cherche sa médaille d'identité,
le questionne sur son régiment, sa compagnie, son grade et note
tout cela sur le « carnet des entrées ». Puis quand
le pauvre gars a été nettoyé, soigné, enveloppé
de linge blanc, un autre « scribouillard » - comme disent
les troupiers lui épingle sur la poitrine une fiche de diagnostic»,
qui réglera le mode de son évacuation. Après quoi
deux porteurs déploient un brancard, puis méthodiquement
l'y placent et l'emmènent. Et dans ces salles, ainsi remplies
peu à peu, d'autres ambulanciers circulent encore, celui-ci classent
les armes et les munitions des arrivants, celui-là distribuant
les portions, un troisième donnant à boire tands que agenouillé
près des blessés, un aumônier écrit
quelque lettre, sèche des larmes, parle d'espoir... »
Ainsi s'accomplit la belle et bonne oeuvre de ces soldats de l'hôpital
et de l'ambulance au dévouement desquels tous les cœurs
français ne sauraient trop rendre hommage.
Ernest Laut.
Le Petit Journal illustré du 26 mars 1916