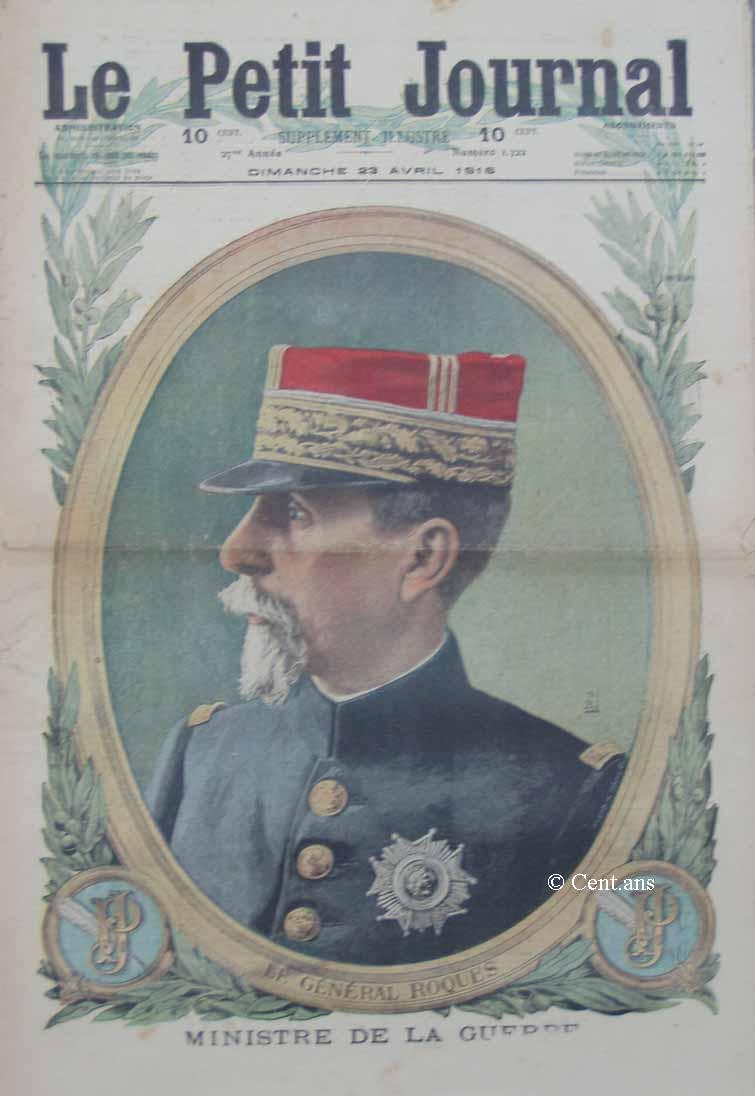LE GÉNÉRAL ROQUES
Ministre de la Guerre
Le général Roques qui vient de
remplacer, au Ministère de la Guerre, le général
Galliéni, forcé par son état de santé de
prendre un repos bien gagné, est né à Marseillan
(Hérault), le 28 décembre 1856.
Sorti le premier de Polytechnique en 1875, il entra dans l'arme du génie,
et servit d'abord en Algérie.
En 1888, il sert au Tonkin avec le grade le capitaine sous les ordres
de l'amiral Courbet.
Quatre ans plus tard, le capitaine Roques est de retour en Afrique ;
il fait partie de l'expédition du général Dodds
au Dahomey. Dans une rencontre avec les farouches soldats de Béhanzin
il reçoit sa première blessure, blessure heureusement
sans gravité : une balle qui vient s'aplatir sur le ceinturon
de son sabre, et qui sans cet heureux hasard eût peut-être
brisé une carrière qui devait être glorieuse et
utile au pays.
Roques revint du Dahomey, chef de bataillon et tint quelque temps garnison
à Versailles. Mais ce colonial, accoutumé à l'action
et aux aventures périlleuses des campagnes, ne pouvait demeurer
longtemps en France.
C'était l'époque où le général Galliéni
achevait la conquête et la pacification de Madagascar. Roques
demanda à servir sous ses ordres. Il fut envoyé dans la
grande île et bientôt, il y rendait d'éminents services
qui lui valurent la citation à l'ordre du jour que voici :
« Le chef de bataillon Roques, directeur du génie et des
travaux publics, après avoir dirigé et mené à
bonne fin les études de chemins de fer de Tamatave à Tananarive,
a donné la plus heureuse impulsion à tous les travaux
publics, qui ont pour but de faciliter le développement industriel
et commercial de notre nouvelle colonie. »
Roques gagna à Madagascar son cinquième galon.
Rentré en France, il fut en 1906, avec le grade de colonel puis
de général de brigade le successeur du général
Joffre comme directeur du génie au ministère de la Guerre.
La direction de l'aéronautique militaire fut jointe alors à
celle du génie ; et c'est le général Roques qui
fut le créateur et l'organisateur de nos services d'aviation.
Là encore, il rendit les plus précieux services.
Avant la guerre, il commandait le 12° corps à Limoges.
Le 1er janvier 1915, il succéda comme chef d'une armée,
au général Dubail, promu commandant d'un groupe d'armées.
Cette armée occupait alors un secteur très étendu
où se passent aujourd'hui de grandes choses. Le général
Roques veilla à ce que toutes les positions fussent très
fortifiées.
C'est lui qui entreprit et qui mena à bien l'attaque des Éparges
où les Allemands avaient accumulé les défenses.
Roques avait jugé que la possession de ce point qui domine la
Woëvre était nécessaire pour la sécurité
de Verdun. Ses troupes s'en emparèrent après des combats
héroïques. On se rend compte aujourd'hui combien le général
voyait juste quand il voulait nous assurer cette position.
Les services rendus par le général Roques depuis le début
de la guerre lui valurent, en janvier dernier, la dignité de
grand-croix de la Légion d'honneur ; le décret lui conférant
cette dignité portait le motif suivant, qui nous dispense de
tout commentaire :
« A obtenu du corps d'armée qu'il commandait au début
de la campagne les actions les plus brillantes, tant par sa bravoure
personnelle que par sa maîtrise du commandement placé à
la tête d'une armée, a continué à faire preuve
des plus hautes qualités d'activité et d'intelligence
et a su imposer à ses subordonnés le sentiment du devoir
dont il est animé. »
VARIÉTÉ
PEUPLE D'ESPIONS
A propos d'une espionne. - Le Boche est espion par nature. - Avant 1870. - Avant 1914. - Nous souviendrons-nous, cette fois ?
Frieda Lipmann, Allemande convaincue d'espionnage,
et le nommé Tribout, son époux, un Français traître
à son pays, viennent d'être condamnés à deux
ans de prison. Leur cas, avait-on dit d'abord, était passible
de la peine de mort. Mais nous sommes indulgents. Et les Allemands,
qui n'ont pas hésité à exécuter avec la
cruauté que l'on sait - miss Cavell, coupable, non point d'espionnage,
mais seulement d'un geste de patriotisme et de pitié, les Allemands
doivent bien rire de notre longanimité.
Voilà donc comment on s'y prend, chez nous, pour décourager
les espions allemands.
Mais, au fait, n'est-ce pas ainsi qu'on s'y est pris de tout temps ?
***
Ce n'est un secret pour personne que, tandis que le Français
n'a aucun goût pour les pratiques de l'espionnage, l'Allemand,
au contraire, s'y adonne avec une sorte de plaisir. Il est infiniment
rare qu'un Allemand établi à l'étranger ne soit
pas un espion. Même riche, même considéré,
le Boche espionne pour son pays. D'abord, la conscience allemande n'est
pas faite comme la nôtre ; les procédés de traîtrise
et de déloyauté ne la révoltent pas. L'Allemand
considère comme un devoir de trahir au profit de sa patrie d'origine
le pays qui lui donne l'hospitalité, même parfois quand
ce pays lui a accordé la naturalisation. Un Boche n'est jamais
déraciné. Naturalisé Français, enrichi en
France, après vingt ans de séjour à Paris, il reste
le plus souvent tout aussi Boche que le jour de son arrivée.
Vienne l'occasion de servir le « Vaterland », il le sert
de toutes les façons, et sans scrupules. Il le sert d'autant
plus volontiers que l'espionnage est bien payé en Allemagne.
Alors que, chez nous, on a toujours lésiné pour le service
des renseignements et qu'en 1870, notamment, des émissaires qui
risquèrent leur vie pour porter des dépêches à
travers les lignes ennemies, ne reçurent que de ridicules gratifications
de cinquante ou cent francs, les Allemands, de tout temps, se montrèrent
généreux pour leurs espions.
Ils ont, il est vrai, d'importants crédits consacrés à
cet objet, crédit budgétaire annuel, fonds spécial
dont l'état-major dispose à son gré pour l'espionnage.
En outre, les biens confisqués jadis par la Prusse à la
dynastie de Hanovre, et qui produisent plus de huit millions par an
d'intérêts ont été consacrés au service
des renseignements et de la propagande allemande à l'étranger.
On conçoit par là que les Boches aient pu de tout temps
inonder la France, l'Angleterre, la Russie de leurs espions, qu'ils
aient pu acheter, en pays neutres, maints journaux pour soutenir leur
cause, et que, rien qu'à Athènes, le baron Schenck ait
pu dépenser des centaines de mille francs par mois pour la propagande
allemande.
Au XVIIIe siècle déjà, alors que le service des
renseignements existait à peine chez les autres peuples, il avait
chez les Prussiens une importance capitale. On se rappelle le mot de
Frédéric II : « Soubise à cent cuisiniers
et un espion ; moi j'ai cent espions et un cuisinier. »
Les traditions du grand Frédéric se sont perpétuées
chez ses successeurs. Ce n'est plus par centaines, mais par milliers
que les Boches, au siècle suivant, employèrent les espions
avant et pendant les campagnes entreprises par eux. On pourrait même
dire que c'est par centaines de mille qu'on eût pu compter leurs
espions avant cette guerre, car il y avait en France, avant le mois
d'août 1914, cinq à six cent mille Allemands, naturalisés
ou non ; et rien qu'à Paris, s'il faut en croire les journaux
allemands, qui, d'ailleurs, en tiraient vanité, il ne s'en trouvait
pas moins de cent mille.
Jugez si nous étions bien espionnés !
Au surplus, les Allemands, avec nous, eurent toujours la partie belle.
On ne sait en vérité ce qu'il faut le plus admirer, ou
de leur audacieuse habileté dans l'espionnage, ou de l'indifférence
sereine avec laquelle on leur permettait de nous espionner.
Plusieurs années avant 1870, nous aurions dû savoir à
quoi nous en tenir sur les projets des Prussiens, car notre frontière
de l'Est était littéralement inondée de leurs officiers
voyageant en bourgeois.« On en surprit, raconte le lieutenant
Froment, dans son livre sur l'Espionnage militaire - on en
surprit qui, sous prétexte de pêcher à la ligne,
sondaient la Marne d'autres qui, se disant artistes, prenaient des croquis
des forts aux environs de Langres et de Belfort... » On ne songea
pas même à les arrêter.
Bismarck et de Moltke vinrent eux-mêmes étudier les passages
de la frontière. Un officier, le capitaine Samuel, signala, en
avril 1868, au ministère de la Guerre, la présence du
général de Moltke à Sarrebruck, à Sarrelouis.
« Le général, disait-il, a visité les hauteurs
de Vaudevange, de Berus. Je l'ai suivi, dois-je continuer à la
suivre ?... » On pria le capitaine de se tenir tranquille et de
laisser voyager le général allemand à sa guise.
L'année suivante, le futur maréchal von Haeseler, le conseiller
du kronprinz, l'homme qui a décidé l'attaque sur Verdun,
et qui était alors attaché au grand état-major
prussien, vint aussi faire sa petite tournée d'espionnage en
France.
C'était au mois de mai. Von Haeseler, se disant « marchand
de vins appelé en Champagne pour son commerce », visitait
à petites journées les vallées de la Marne et de
la Meuse. Or, des gendarmes avant remarqué que ce paisible négociant
faisait des levés topographiques tout le long de la route, le
prièrent de les suivre et l'amenèrent à leur commandant.
Celui-ci l'interrogea :
- Votre nom ?
L'officier allemand ne se donna même pas la peine de dissimuler.
- Von Haeseler, répondit-il.
- Votre profession ?
- Major au grand état-major prussien.
- Pourquoi voyagez-vous en France ?
- Pour m'instruire. J'étudie le terrain où se rencontrèrent
en 1792 les armées française et prussienne.
Vous vous imaginez peut-être qu'après un tel aveu l'espion
fut arrêté ? Pas du tout !
Le commandant de gendarmerie le remit en liberté.
- Allez, lui dit-il, mais abstenez-vous à l'avenir de faire des
levés de terrains.
Et le Moniteur de l'Armée, organe du ministère
de la Guerre, racontant l'incident, ajoutait ces lignes prudhommesques
:
« Lorsque M. le comte Haeseler rentrera à Berlin, il pourra
témoigner des égards que nous avons en France pour tout
officier étranger, alors même qu'il s'y livre à
des travaux dont on peut tout au moins suspecter le but et la destination.
»
***
Dans de pareilles conditions, les espions allemands auraient eu bien
tort de se gêner.
Aussi ne se gênaient-ils pas. Dès l'année 1866,
Ducrot, qui commandait à Strasbourg, signalait la présence
de nombreux agents teutons entre la Moselle et les Vosges ; il signalait
également les armements considérables de l'Allemagne,
son hostilité croissante contre la France et le désir
qu'avaient les Prussiens de nous faire la guerre. Le colonel Stoffel,
notre attaché à Berlin, poussait les mêmes cris
d'alarmes. On ne voulait rien entendre.
Il est vrai qu'en dépit de tous leurs préparatifs et de
cette organisation d'espionnage qu'ils dissimulaient à peine,
les Boches jouaient alors, comme ils le firent avant 1914, la comédie
du pacifisme. Mais, entre eux, ils parlaient librement de leurs projets.
Mme de Pourtalès qui, habitant Berlin, avait pu surprendre leurs
desseins secrets, le disait, en 1868, à Ducrot:
- Oh ! général, ce qu'il y a d'affreux, c'est que ces
gens-là nous trompent indignement et comptent bien nous surprendre
désarmés... Oui, le mot d'ordre est donné ; en
public, on parle de paix, du désir de vivre en bonnes relations
avec nous ; mais lorsque, dans l'intimité, on cause avec tous
ces gens de l'entourage du roi, ils prennent un air narquois, vous disant
« Est-ce que vous croyez à tout cela ? Ne voyez-vous pas
que les événements marchent à grands pas, que rien,
désormais, ne saurait conjurer le dénouement ?... »
Ils se moquent indignement de notre gouvernement, de notre armée,
de notre garde mobile, de nos ministres, de l'empereur, de l'impératrice,
prétendent qu'avant peu la France sera une seconde Espagne !
Enfin, croiriez-vous que le ministre de la maison du roi, M. de Schleinitz
a osé me dire qu'avant dix-huit mois notre Alsace serait
à la Prusse !... Et si vous saviez quels énormes
préparatifs se font de tous côtés, avec quelle ardeur
ils travaillent pour transformer et fusionner les armées des
États récemment annexés, quelle confiance dans
tous les rangs de la société et de l'armée !...
Oh ! en vérité, général, je reviens navrée,
pleine de trouble et de craintes. Oui, j'en suis certaine maintenant,
rien, non rien ne peut conjurer la guerre, et quelle guerre !... »
Cette femme voyait juste, alors que les diplomates, les gouvernants
se laissaient aveugler par les mensonges allemands. Et l'on continua
à vivre dans la quiétude, on laissa les Allemands organiser
l'invasion et multiplier leurs espions sur nos frontières, jusqu'à
ce que le cataclysme se produisit.
Si seulement, plus tard, on s'était souvenu ! Mais on oublia...
Ce que Mme de Paurtalès disait à Ducrot en 1868, n'est-ce
pas exactement ce qui se renouvela pendant les années qui précédèrent
l'agression de 1914 ? Les Boches ne varient pas leurs procédés.
C'est toujours la même hypocrisie, les mêmes mensonges.
Il est vrai que, de notre côté, c'est toujours l'a même
confiance folle, la même indifférence coupable.
Depuis quatre ou cinq ans, que de fois n'a-t-on pas signalé le
développement de l'espionnage allemand chez nous ? Déjà,
en 1908, un préfet de l'Est écrivait au ministre «
Je ramasse les espions à la pelle.»
Bon an mal an, à cette époque, on arrêtait en France,
environ huit cents espions. Sur ce chiffre, près de sept cents
étaient de nationalité allemande. On se montrait, d'ailleurs,
à leur égard, d'une indulgence, dont la tradition s'est
perpétuée, même en temps de guerre. Quelques mois
de prison, après quoi on les ramenait à la frontière...
et ils s'empressaient de rentrer sur un autre point.
A proximité de tous les ponts ou de toutes les lignes stratégiques,
des usines allemandes s'élevaient, dirigées par des ingénieurs
allemands. Dans l'Est, chaque fois qu'une ferme était à
vendre, des Allemands arrivaient qui l'achetaient et s'y installaient.
Aux environs de Verdun, de Pont-à-Mousson, une foule de fermes
appartenaient ainsi à des Allemands.
Au début de 1913, un de nos confrères faisant une enquête
à ce sujet dans ces régions, écrivait :
« Le souci d'occuper des points stratégiques est évident
dans la région de la Haye et de la Woëvre, où toutes
les fermes situées aux bons endroits deviennent petit à
petit la propriété de familles allemandes... »
Et il ajoutait :
« Le critérium qui nous permet, en règle générale,
d'affirmer que ces fermiers sont des espions à la solde de l'Allemagne
est très simple : ces fermes sont presque toujours improductives,
mal cultivées, et dès lors qu'elles ne peuvent pas nourrir
leur homme, de quoi peuvent bien vivre ces gens-là ?... »
A certains endroits, les Allemands étaient si nombreux qu'on
ne s'y serait pas cru en France. Un habitant d'un petit hameau situé
vers les bois de Rappes et de Vollers disait à notre confrère
:
« Je n'ose plus sortir de chez moi : On me regarde ni plus ni
moins comme un étranger, et je ne trouve plus personne à
qui parler français. Et cette singulière situation devient
tous les jours pire, car chaque fois qu'il y a un coin de terre et une
baraque à vendre, un Allemand s'abat dessus et la fait sienne
à n'importe quel prix. Si cela continue, il faudra que j'apprenne
l'allemand pour vivre dans cette petite Silésie »
Jugez par là si les Boches devaient la connaître, cette
terre sur laquelle s'acharnent aujourd'hui leurs efforts et s'amoncellent
leurs cadavres.
Ainsi leur espionnage étendait ses innombrables tentacules sur
notre pays. Et nous étions. comme avant 1870, indifférents
et confiants.
Quand nous serons sortis vainqueurs de la rude épreuve que nous
subissons, prendrons-nous enfin la ferme résolution de ne plus
oublier et de fermer à tout jamais nos portes à l'espionnage
allemand ?
Le Petit Journal illustré du 23 avril 1916