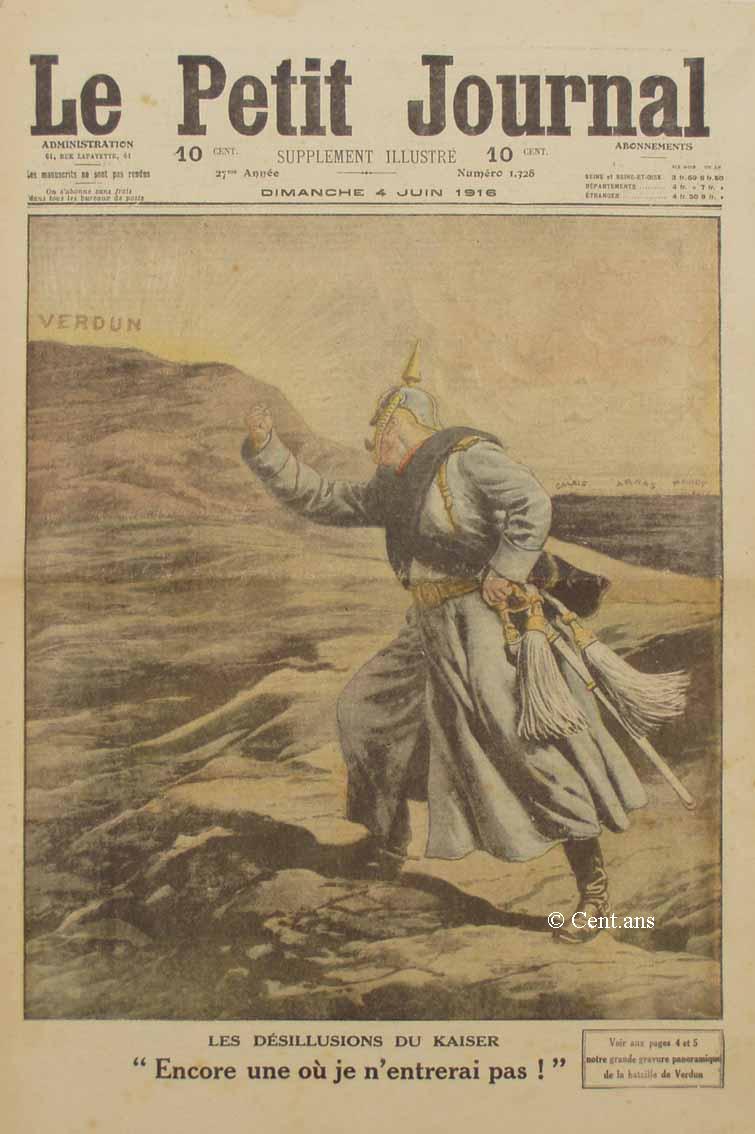LES DESILLUSIONS DU KAISER
“ ENCORE UNE OU JE N'ENTRERAI PAS”
Que de désillusion ! ... Au mois
de septembre 1914, le dîner du Kaiser était commandé
à l'« Astoria », le kolossal hôtel
Boche Geissler. Et Guillaume II, avant de se mettre à table,
devait passer sous l'Arc de Triomphe. Depuis la victoire de la Marne,
Le dîner a eu le temps de se refroidir ; et l'arc de Triomphe
de la Grande Armée n'a pas subi l'injure que l'empereur des Barbares
méditait de lui infliger.
Alors le Kaiser dit : « J'entrerai à Nancy ! » Et
on le vit, à cheval, dans son costume de maréchal prussien,
entouré d'un état-major, attendre que l'accès de
la noble cité des ducs de Lorraine lui fût ouvert. Mais
les poilus de Castelnau lui barraient la route. Et Nancy demeura inviolée.
Parmi les ruines d'Arras, il eût voulu aussi parader. Arras fut
écrasé sous les bombes, mais ses portes ne s'ouvrirent
pas. « Calais, alors, dit le Kaiser. Il me faut Calais ! J'y ferai
une entrée triomphale, et, de la côte, je narguerai l'Angleterre
. »
Mais sur l'Yser, ses bataillons furent décimé, et la route
de Calais lui demeura fermée.
Aujourd'hui, c'est Verdun qu'il convoite, Verdun, cette menace dressée
contre la Lorraine annexée. Mais, pas plus que Paris, que Nancy,
qu'Arras, que Calais, Verdun ne se laisse approcher.
En vain, depuis trois mois les assauts se multiplient ; en vain les
cadavres allemands s'amoncellent, Verdun est toujours là-bas,
inabordable ; le Kaiser doit se dire dans sa suprême désillusion
:
« Encore une où je n'entrerai pas ! »
VARIÉTÉ
La pêche aux trésors
Quinze cents millions au fond de la mer. - Histoire des trésors engloutis. - L'Armada, les galions de Vigo. - Que de richesses anéanties ! - L'impuissance de l'industrie humaine
La pensée des innombrables objets de valeur
engloutie avec les navires torpillés par les Allemands a commencé
d'exciter la convoitise humaine.
On signale qu'une société américaine va tenter
le sauvetage du numéraire se trouvant à bord des bâtiments
coulés depuis de début de la guerre.
On estime à quinze cents millions environ l'or, l'argent, les
valeurs, les bijoux qui se trouvent dans les navires que les sous-marins
allemands ont coulés. La récolte en perspective est tentante,
assurément. Mais l'opération de sauvetage de ces richesses
sera, par contre, impossible dans la plupart des cas, et, dans les autres,
toujours dangereuse et hérissée de difficultés.
***
L'homme, en tous les temps, a été
tenté par l'exploration du fond de la mer.
Les Anciens connurent la cloche à plongeur. Bien mieux, on trouve
dans Aristote la description succincte d'un casque de plongeur, sorte
de chaudron renversé fort comparable au casque des scaphandriers
d'aujourd'hui.
Inconnue au moyen âge, la cloche à plongeur reparut au
XVIe siècle. En 1588, l'année où l'Invincible Armada
de Philippe II d'Espagne se perdit dans les mers du Nord, l'appareil,
nouvellement inventé, fut expérimenté sur les côtes
d'Ecosse, afin de retrouver les épaves de la flotte anéantie.
Mais ce procédé primitif ne permettait ni de se mouvoir
sous l'eau ni d'y travailler, pas même d'y entrer ou d'en sortir
à volonté.
On cherchait mieux, en Angleterre surtout. Dans la baie de Tobermory,
où s'était englouti le navire amiral de l'Armada, il y
eut notamment une expérience qui prouve combien les lois de la
nature étaient alors ignorées.
Cette expériences consistait à submerger le corps d'un
vaisseau imperméable, dont les flancs et le tillac devaient être
étayés avec force, et l'entrée, composée
d'une seule porte hermétiquement fermée ; de sorte qu'en
lâchant le lest destiné à produire l'immersion,
le bâtiment devait de lui-même revenir à la surface.
Pour rendre l'essai plus sûr et le résultat plus frappant,
l'inventeur voulut lui-même diriger la première épreuve.
On convint qu'il plongerait à la profondeur de 20 brasses (environ
38 mètres), et que, vingt-quatre heures révolues, il reparaîtra
sans secours à la surface. Il fit ses apprêts, se pourvut
de subsistances, des moyens nécessaires pour signaler sa position
et l'expérience commença. Mais rien ne décelait
ses phases ; le temps fixé était écoulé
; une foule immense attendait avec angoisse que celui qui l'avait tentée
se montrât. Ni homme ni bâtiment ne reparurent. On n'avait
pas tenu compte de la pression que l'eau exerce à une aussi grande
profondeur ; le vaisseau n'avait pu résister, et le malheureux
qu'il renfermait n'avait pas même eu le temps de faire le signal
convenu pour indiquer sa détresse.
L'histoire des explorations sous-marines compte bien d'autres échecs
du même genre. Bref, la mer garda ses secrets jusqu'au jour où
le scaphandre apparut.
Tout, le monde connaît aujourd'hui l'ingénieux appareil,
dû à deux Français, le lieutenant de vaisseau Denayrouse
et l'ingénieur Rouquayrol ; et point n'est besoin. de le décrire.
Mais, seuls ceux qui ont vu les scaphandriers à l'oeuvre savent
combien est dur, déprimant et dangereux leur métier, et
quelle somme d'énergie, l'abnégation, d'héroïsme
même il faut posséder en soi pour l'exercer.
A dix ou quinze mètres, la pression de l'eau est déjà
telle, que nous la supporterions malaisément, nous autres terriens,
affaiblie par l'existence énervante des villes ; pour le scaphandrier
de profession, longuement entraîné, c'est un jeu. Mais
à vingt-cinq ou trente mètres de profondeur, si vigoureux
que soit le plongeur, il commence à éprouver des maux
de tête et divers troubles physiologiques. S'il va plus avant,
ou sil remonte trop rapidement, il risque, par la compression trop forte
ou la décompression trop brusque, d'être victime d'une
maladie spéciale qu'on appelle « mal des caissons ou des
scaphandriers », et qui peut entraîner pour le moins d'irrémédiables
infirmités.
Avec l'ancien scaphandre, les plongeurs ne pouvaient guère dépasser
trente mètres, et encore ne devaient-ils demeurer qu'un laps
de temps limité à une telle profondeur.
Mais il existe aujourd'hui des scaphandres renforcés et perfectionnés
qui permettent de descendre plus bas. C'est probablement sur l'emploi
de ces appareils que compte la société américaine
dont il est question plus haut pour opérer le sauvetage des richesses
englouties par les mines ou les torpilles des Allemands.
***
Les épaves sous-marines qui, jusqu'à présent, avaient
suscité le plus de convoitises sont celles de l'Armada et des
galions de Vigo.
On sait qu'au mois de mai 1588, la fameuse armada de Philippe II ayant
été dispersée et détruite par la flotte
anglaise, son navire amiral, la Florida, parvint à peu
près seul, sur cent trente navires de guerre, à s'échapper,
et tenta de regagner l'océan en contournant l'Ecosse. Mais des
avaries subies le forcèrent à faire relâche dans
la baie de Tobermory. C'est là qu'un Ecossais, s'étant
introduit à fond de cale, mit le feu à la soute aux poudres
et fit sauter le navire.
Or, la Florida portait le trésor de la flotte, qui se
montait, parait-il, à 750 millions de francs. Je vous laisse
à penser si ces richesses englouties ont depuis trois siècles
excité des convoitises.
J'ai parlé plus haut d'une expérience malheureuse qui
eut lieu peu de temps après la perte du navire. Vers 1665, d'autres
tentatives furent renouvelées qui ne donnèrent pas de
meilleurs résultats. En 1740, deux plongeurs parvinrent jusqu'à
l'épave et remontèrent quelques pièces d'or espagnoles.
Enfin, en ces derrières années, un syndicat s'est formé
pour l'exploration de la Florida et on a commencé à
débarrasser l'épave des des énormes masses de sable
qui la recouvrent. Mais la guerre a interrompu ces travaux ; et les
millions de Philippe II dorment toujours, intacts, au fond de la baie
de Tobermory.
Il en est à peu près de même pour les fameux galions
espagnols qui furent, en 1702, coulés dans la baie de Vigo par
une flotte anglo-hollandaise. Ils contiennent, dit la légende,
d'immenses richesses extraites des mines d'or et d'argent de l'Amérique
du Sud soit environ 700 millions.
D'innombrables tentatives ont été faites, depuis deux
siècles pour retrouver ces trésors. Quelques lingots furent
retirés de temps à autre. En 1904, un ingénieur
italien muni de puissants hydroscopes, repéra exactement l'emplacement
des galions. Mais il semble que l'organisateur de l'entreprise s'en
soit tenu là. Les galions dormant toujours dans la baie de Vigo
avec leurs richesses à peu près intactes.
L'exploration sous-marine qui semble avoir donné jusqu'à
présent le plus de résultats, c'est celle de la Lutine,
une frégate anglaise qui, en 1799, sombra dans le Zuiderzée,
entraînant dans le fond de la mer trente millions d'or et d'argent
en barre que l'Angleterre envoyait à Hambourg pour remédier
à une crise financière des villes de la Hanse.
Une compagnie anglaise en retira, en 1820, pour deux millions et demi
de lingots. Puis, l'épave fut abandonnée pendant près
d'un siècle. En 1909, les travaux reprirent. On commença
à la débarrasser des apports de sable qui la recouvraient
Quelques mois avant la guerre, on annonçait que les plongeurs
n'étaient plus qu'à quelques mètres du fond où
repose la carcasse du navire.
***
Qui dira le chiffre des trésors ainsi engloutis dans la mer et
dont les emplacements sont connus et ont même été
explorés ?...
Il y a dans les eaux hollandaises, un navire qui, en 1808, apportait
cent millions d'or envoyés par Napoléon. On à pu
déjà en retirer cinquante-six en trois explorations.
Il y a au large d'Anglesey, le Royal-Charter, qui sombra en
1839 avec 375 millions. Non loin de Sibastopol le Prince Noir
dort sur le fond de la mer Noire avec 150 millions dans ses flancs.
Sur les côtes du Zoulouland, la Dorothée gît
à cent trente mètres de profondeur, contenant plus de
16 millions de francs en or que le président Kruger envoyait
en Amérique au moment de la guerre sud-africaine.
Diverses tentatives ont été faites déjà
pour atteindre ces richesses, de même que pour rechercher, dans
la baie de Navarin, les trésors enfouis avec les soixante-trois
navires turcs et égyptiens coulés là, en 1827,
par les flottes réunies de la France et de l' Angleterre ; de
même également pour les navires engloutis dans le combat
de la Hougue, en 1692, de même pour le Jeune Henri, un
navire qui sombra en 1820 prés de l'île d'Oléron,
avec la fortune colossale d'un colon français, le comte de Saint-Paul,
lequel rapportait à bord de ce vaisseau des millions en lingots
et en pierreries.
Il se produisit même, il y a quelques années, à
propos de ce dernier navire, un fait singulier. Un entrepreneur, chargé
de renflouer, afin d'en extraire les trésors qu'il contient,
fit appel à la baguette divinatoire pour situer exactement l'emplacement
de l'épave. Et c'est ainsi que tout le long du pertuis d'Antioche,
on vit, i1 a un plus plus de deux ans un « sourcier » qui,
monté sur un bateau, et la baguette de coudrier à la main,
parcourait le détroit et remplissait gravement son office, comme
s'il se fût agi de découvrir quelque fontaine au milieu
des flots.
***
Combien d'autres épaves contenant des trésors dorment
encore au fond des océans !
Rien que dans les parages du cap de Bonne-Espérance, on sait
d'une façon absolument certaine qu'il s'est perdu depuis deux
siècles une quarantaine de navires, qui transportaient des cargaisons
représentant un total de plus de 2 milliards et demi. L'un d'eux,
le Grosvenor, contient à lui seul près de 400
millions.
Nous n'en finirions pas s'il fallait énumère toutes ces
richesses englouties dont la guerre actuelle vient encore grossir considérablement
le nombre.
Le désir de récupérer tous les trésors enfouis
au fond des eaux par la barbarie allemande va enfanter sans nul doute
de grandes initiatives et suscitera peut-être d'importants progrès
dans l'exploration sous-marine.
Pour le moment, les chercheurs de trésors engloutis ne disposent
que d'assez minces moyens d'action. « Les travaux entrepris jusqu'à
ce jour, dit le Temps, on montré que par temps favorable,
sur des fonds relativement stables et dans des eaux claires, on peut
sauver un bateau jusqu'à 28 mètres de profondeur, les
scaphandriers pouvant descendre à 30 mètres. Des expériences
faites à Génes ont même permis d'envoyer une cloche
à plongeur jusqu'à 180 mètres, mais sans travail
utile.
» Quant au renflouement, il s'effectue de deux manières
: par émersion lorsque l'épave gît sur de grands
fonds, par relèvement si elle repose par des fonds de 12 à
15 mètres. Dans le premier cas, on aveugle les trous faits à
sa coque, on ferme les ouvertures après avoir délestée
la coque de toute la cargaison que l'on a pu enlever et, l'on vide l'intérieur
au moyen de pompes très puissantes. Dans le second cas on procède
par soulèvement de l'épave en amenant au-dessus d'elle
des pontons ou des chalands. Des chaînes, passées sous
la coque immergée, sont raidies au moyen de vérins et
lorsque la marée monte, l'attelage des allèges et de la
coque qu'elles soutiennent est remorqué peu à peu sur
des fonds plus élevée jusqu'à la terre ferme. Si
l'on ne peut utiliser le puissant concours de la marée, on coule
des chalands aux côtés de l'épave, on les relie
à celle-ci par des chaînes et on les vide ensuite au moyen
de pompes après les avoir déchargés et en avoir
aveuglé toutes les ouvertures.
» Dans certains cas, enfin où le renflouement de la coque
est considéré comme impossible, les scaphandriers se mettent
seuls à l'oeuvre en essayant d'atteindre les parties du navire
où sont enfermées les valeurs... »
Ce sont là des travaux difficiles, lents, coûteux, et qui
ne peuvent plus s'effectuer dès que le navire se trouve sur des
fonds de plus de trente mètres. Or, combien d'épaves sont
englouties à des profondeurs beaucoup plus considérables
!
En dépit de toute sa puissance scientifique et industrielle,
l'homme n'est qu'un pygmée en face de telles difficultés.
Il ne pourra jamais arracher à la mer qu'une infime partit des
trésors qu'elle recèle.
Ernest LAUT.
Le Petit Journal illustré du 4 juin 1916