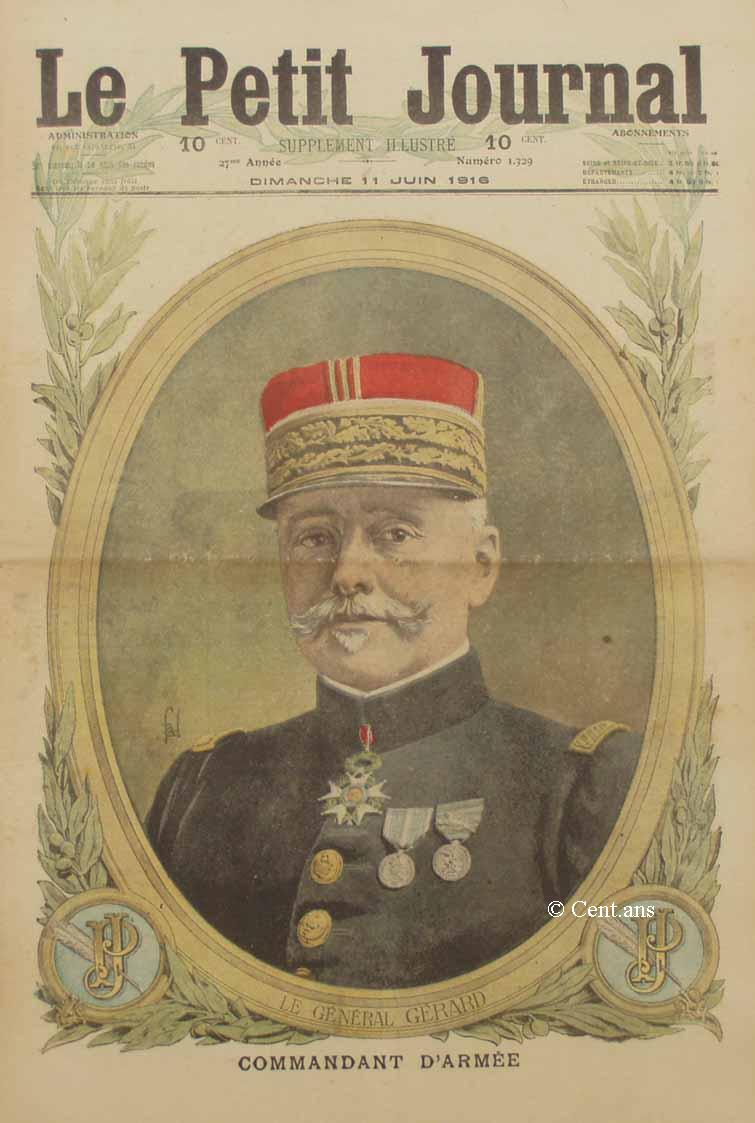LE GÉNÉRAL GÉRARD
commandant d'armée
Notre collection de portraits en couleurs les
chefs de notre armée s'enrichit chaque semaine d'une oeuvre nouvelle
et constituera l'ensemble le plus complet des grandes figures guerrières
de ce temps.
Déjà, dans maintes maisons de nos provinces, cette collection
de superbes portraits est conservée pieusement et piquée
aux murailles à côté des cartes du front. Nos lecteurs
seront heureux plus tard de revoir les physionomies de tous les chefs
illustres dont le génie militaire nous aura assuré la
victoire.
Nous donnons aujourd'hui encore le portrait d'un des principaux lieutenants
de notre généralissime, celui du général
Gérard, qui commande une armée.
Le général Gérard est né à Dunkerque
le 2 novembre 1857. Sorti de Saint-Cyr en 1875, Il était colonel
en 1905, général de brigade en 1909 et général
de division en 1912.
Il commandait le 2e corps à Amiens, quand la guerre éclata
et ses mérites, ainsi que les services rendus au pays lui ont
valu l'honneur d'être appelé au commandement d'une armée.
VARIÉTÉ
Billets de banque
A propos du nouveau billet de dix francs. - Billets noirs, bleus et multicolores. - La fabrication. - Un faussaire discret. - Le billet de banque inventé par les Chinois.
Nous avons un nouveau billet de banque : le
billet de dix francs. La guerre nous a valu l'émission de ces
petites coupures de cinq, de vingt et enfin de dix francs.
Il fallait les circonstances tragiques que nous traversons pour qu'on
en vint là. La Banque, en effet, ne voulut d'abord émettre
que des billets de grande valeur : mille francs et cinq cents francs.
L'emploi du billet de banque en France ne remonte pas à beaucoup
plus d'un siècle. le premier type est de 1803. En 1814 en 1817,
des types nouveaux furent créés. C'étaient toujours
des billets de mille et de cinq cents francs. Ils étaient imprimés
en noir.
C'était un jeu pour les falsificateurs de les imiter, et MM.
les régents de la Banque se désespéraient de voir
tant de faux billets dans la circulation. Aussi prirent-ils des précautions
toutes spéciales lorsqu'en 1831 ils créèrent un
type nouveau.
Ce billet fut fait de deux clichés, l'un au recto, l'autre au
verso : tous deux exactement pareils. C'était ce qu'on appelait
la gravure à l'identique. Le perfectionnement accompli
consistait au tirage, dans le repérage absolument parfait des
deux clichés ; et cela devait suffire pour rendre impossible
toute imitation.
Mais MM. les régents avaient compté sans l'invention de
la photographie. Dès que fut vulgarisée l'invention de
Niepce et de Daguerre, le premier soin des faussaires fut de l'appliquer
à l'imitation des billets de banque. Et rien ne leur fut plus
facile, en dépit des clichés doubles et des repérages
savants.
C'est pourquoi, le bleu étant réfractaire à la
photographie, on décida de faire le billet bleu.
M. Ducray raconte à ce propos une amusante anecdote.
Un jour, dit-il, que l'impératrice visitait les divers services
de la Banque de France, le gouverneur, qui l'accompagnait, lui présenta
un billet de mille francs oeuvre d'un émetteur de faux billets.
La souveraine manifesta le désir de le garder et dès son
retour aux Tuileries, le plaça, parmi d'autres, dans un tiroir
de la table de travail de l'empereur. Le lendemain un solliciteur, auquel
Napoléon III avait accordé audience, reçut le billet
et fut arrêté chez le premier changeur auquel il le présenta.
« L'aventure eut un certain retentissement et l'innocente victime
fut amplement dédommagée ; mais le billet imprimé
en noir, si facilement imitable par les nouveaux procédés
photographiques avait vécu, le billet bleu le remplaça.
»
Mais un jour vint où, par un système combiné de
plaques spéciales et d'écrans, on parvint à photographier
le bleu lui- même. Alors - c'était en 1889 - on continua
à faire les billets bleus, mais on y ajouta un fond rose qui
devait en rendre l'imitation impossible.
Impossible ?.. Les faussaires sont gens infatigables, pleins de ressources
et toujours prêt à mettre en pratique les perfectionnements
de la science. Les premiers essais de la photographie des couleurs émurent
de nouveau les régents de la Banque ; et, de leurs craintes naquit
l'idée du nouveau type de billet mis en circulation au début
de l'année 1910, et tiré en quatre couleurs.
Ce procédé ne fut appliqué qu'aux billet de quelque
importance. Pour les petites coupures créées depuis la
guerre, la Banque est revenue vu billet uniformément bleu.
Le type le plus répandu de nos billets, avant que la guerre n'eût
mis tant de petits papiers dans la circulation, était le billet
de cent francs.
Sa création date de 1848. Il était alors tiré en
vert. Il fut ensuite imprimé en noir, « à l'identique
». En 1862, la première année du tirage en bleu,
création d'un nouveau modèle imaginé par Brisset,
dessiné par Cabasson et gravé par Pennemaker. Vingt ans
plus tard ce modèle est remplacé par celui de Paul Baudry
qui, tiré en bleu d'abord, puis en bleu et rose, demeura dans
la circulation jusqu'en 1910, époque où apparurent les
billets multicolores dessinés par M. Luc-Olivier Merson. On trouve
encore assez souvent dans la circulation des exemplaires de ce billet
de Paul Baudry.
La création du billet de cinquante francs ne date que de 1857.
En 1847 on avait créé un billet de deux cents francs qui,
peu après fut retiré de la circulation. En 1846, on avait
émis un gros billet, le plus gros qui fut jamais émis
chez nous, un billet de cinq mille francs, qui était tiré
en rouge.
Comme le billet de deux cents francs, on voulut le retirer de la circulation
un ou deux ans après. Mais il arriva cette chose singulière
: tous les billets revinrent, sauf un. Ce billet fut-il anéanti
dans un incendie ? C'est fort probable. Car il serait invraisemblable
qu'un billet de cinq mille francs pût rester si longtemps enfoui
dans quelque coffre ou quelque tiroir.
En tous cas si le fameux billet rouge existe encore, celui qui mettra
la main dessus pourra se vanter de faire une profitable trouvaille.
***
La grande préoccupation de la Banque, nous l'avons vu, est de
sauvegarder ses billets contre les imitations des faussaires. Elle prend
pour cela les plus infinies précautions : papiers spécialement
fabriqués pour elle, mystérieux filigranes, rien n'est
négligé. La gravure, l'impression, le tirage
des billets, tout est fait à la Banque même, afin d'éviter
les fuites.
« Ce n'est point une mince besogne, dit encore M. Ducray, que
celle qui consiste à fabriquer ces billets. Le papier sur lequel
ils sont tirés est préparé dans l'Aisne : une à
une, les feuilles sont fabriquées à la main, avec un soin
minutieux, la plus petite imperfection, le moindre défaut dans
le grain de l'une d'elles, la font mettre immédiatement à
l'écart et retourner sous le pilon. Puis, avec des moules spéciaux,
le papier est alors filigrané. C'est dans cet état qu'il
arrive à l'imprimerie de la Banque. Là des machines perfectionnées
et d'une extrême précision, impriment les feuillets ; il
va sans dire que les précautions les plus minutieuses sont prises
pour obvier aux fuites qui pourraient se produire. Chaque soir, un coffre-fort.
dont seul le chef de l'imprimerie possède la clé, reçoit
les planches, feuilles de papier, encres et tous les accessoires que
nécessite l'impression. Quand celle-ci est terminée, les
signatures autographe du secrétaire général et
du contrôleur général sont apposées sur les
billets au moyen d'une griffe. Seulement, au moment d'entrer en circulation,
ce qui ne se produit guère qu'un an environ après la sortie
de l'imprimerie, les nouveaux billets sont revêtus de la signature
du caissier général de la Banque..»
Or, toutes ces précautions, si multipliées qu'elles soient,
n'ont jamais désarmé les faussaires. La Banque s'est constitué
un petit musée de leurs oeuvres. On peut voir rue de La-Vrillière
toute la série des falsifications tentées depuis qu'existe
le billet de banque. Et cela donne une haute idée de l'ingéniosité
humaine.
On voit là, entre autres pièces curieuses, un billet de
cinquante francs qu'un calligraphe dessina à la plume, il y a
une cinquantaine d'années. Ce chef-d'oeuvre coûta à
son auteur un travail considérables ; ce fut, à coup sûr,
une véritable besogne de bénédictin. Et cet homme
fit cela dans la modeste espoir de gagner cinquante francs... sans compter
la perspective possible d'être envoyé au bagne. Réellement,
l'âme des escrocs est parfois insondable.
On raconte à la Banque un autre trait bien singulier de modération
dans l'escroquerie. Il y a quinze ou seize ans, on voyait rentrer tous
les mois, régulièrement, cinq billet de cent francs faux.
Ces billets, admirablement imités d'ailleurs, portaient cependant
tous la même marque de fabrique, quelques imperfections légères
qui les faisaient reconnaître.. Le doute n'était pas possible
: ils provenaient tous du même faussaire.
On fit des recherches ; on parvint, en reconstituant l'itinéraire
parcouru par les billets à savoir de quelle région ils
venaient. Mais on ne découvrit pas leur auteur.
De guerre lasse, la Banque cessa les recherches. Au surplus, le faussaire
se contentait d'émettre tous les mois ses cinq billets de cent
francs, jamais plus : cette modestie valait d'étre récompensée.
Or, un beau jour, les billets cessèrent d'arriver. Et l'on constata
cette coïncidente : dans la ville considérée comme
le lieu d'origine des billets, venait de mourir un fonctionnaire retraité,
estimé et honoré de tous ; et ce fonctionnaire était,
paraît-il, un ancien graveur très habile en son art.
Tirez vous-mêmes la morale de cette petite histoire. Si l'homme
au lieu de prélever six mille francs par an sur la Banque, avait
tenté d'en prélever soixante mille, il est probable qu'on
eût poussé les recherches plus loin et qu'il se fût
fait pincer. Ses goûts modestes le préservèrent
du bagne.
Comme quoi il est parfois bon de savoir se contenter de peu.
C'est pour s'être écartés de ce principe que le
plus grand nombre des faussaires virent interrompre le cours de leurs
lucratifs travaux.
On ferait un gros livre de l'histoire de la falsification des billets
de banque. Nous n'en avons pas le loisir. Mais nous ne pouvons passer
sous silence, l'aventure du fameux Gâtebourse, - un nom qui eût
réjoui Balzac.
Ce Gâtebourse opéra pendant huit ans, de 1853 à
1861. Très lancé dans le monde élégant,
il offrait de grandes chasses dans son château de la Charente-Inférieure,
et chacun se disputait l'honneur d'être son hôte.
Parmi ses meilleurs amis, figurait un gros fonctionnaire de la Banque,
qui n'avait pas de secrets pour lui.
- Nous recevons beaucoup de faux billets en ce moment, disait-il à
Gâtebourse, mais nous allons modifier le type de nos billets,
et le faussaire sera bien attrappé.
Et le bon fonctionnaire décrivait à son ami les modifications
proposées, les projets à l'étude ; si bien que
Gâtebourse, admirablement renseigné, avait tout loisir
pour préparer ses falsifications.
Il fut pincé tout de même, à la fin et envoyé
au bagne de Cayenne. Il trouva, en essayant de s'échapper, la
mort la plus effroyable. A la frontière de la Guyane hollandaise,
Il s'égara au bord de la mer dans des sables mouvants, s'y enliza
; et son corps fut retrouvé à demi-rongé par les
crabes.
***
En terminant, notons qu'il en est du billet de banque comme de presque
toutes les inventions dont nous nous enorgueillissons : les Chinois
l'avaient inventé des milliers d'années avant nous.
Une banque chinoise aurait, assure-ton, on, émis les premiers
billets en l'an 2.600 avant Jésus-Christ. Ces billets portaient
le nom de la banque, la date, le numéro du billet, l'indication
de la valeur en lettres et au moyen d'une figure représentant
un tas de pièces de monnaie d'une valeur équivalente.
Rien n'y manquait, pas même, comme dans nos billets si actuels,
la signature des fonctionnaires et l'indication des pénalités
infligées par la loi aux contrefacteurs. Enfin, pour couronner
le tout, une maxime qui est un bon conseil : « Produis tout ce
que tu peux et dépense avec économie ».
Nos billets d'aujourd'hui ne sont pas mieux conçus. Et notre civilisation
a mis quatre mille ans à retrouver cela.
Le Petit Journal illustré du 11 juin 1916