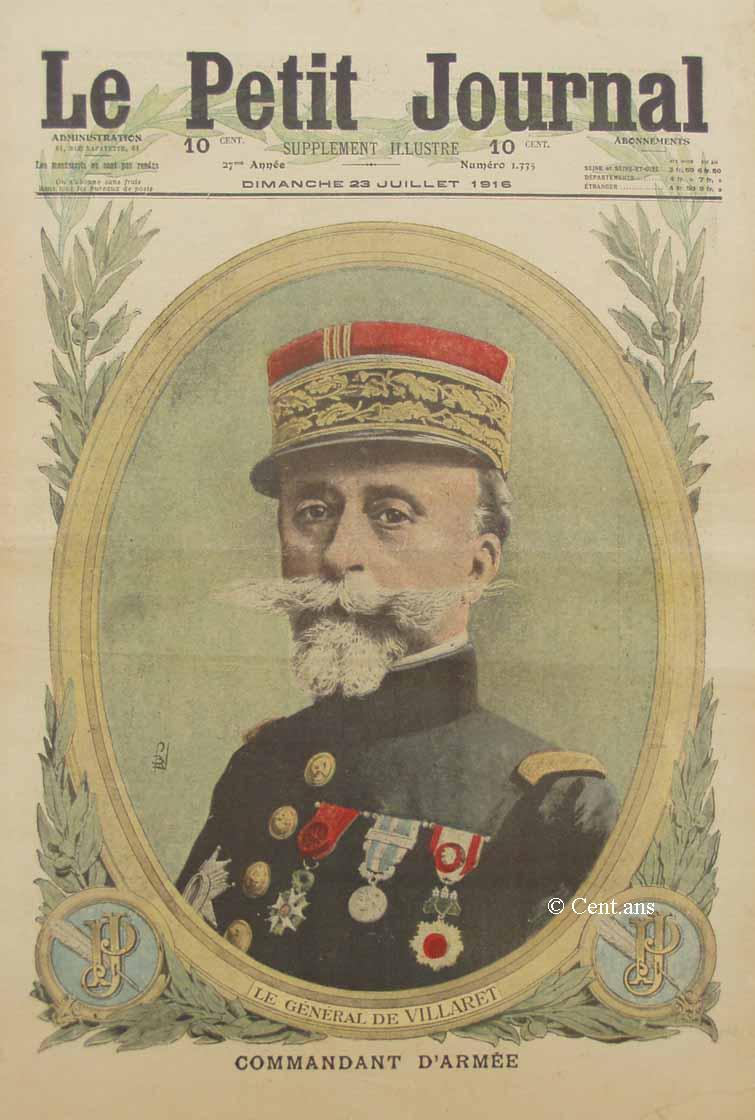LE GÉNÉRAL DE VILLARET
Commandant d'armée.
Le général de Villaret dont nous
donnons aujourd'hui le portrait, est un de nos plus jeunes commandants
d'armée.
Avant la guerre, il commanda la mission militaire en Grèce, à
la suite du retour en France du général Eydoux, appelé
à la tête du du 10e corps, C'était au commencement
de 1914 ; il était tout nouvellement brigadier. Il rendit alors
de grands services à la cause française en Grèce.
Les rapports de notre attaché militaire à Athènes
ont signalé à diverses reprises que, dès les premières
semaines de son arrivée en Grèce, le général
de Villaret avait su conquérir toutes les sympathies.
En avril 1914, il fut nommé au commandement effectif du ler corps
de l'armée grecque, et, au commencement de juillet, ses troupes
avaient acquis un entraînement qui leur valait les félicitations
officielles du roi Constantin.
Rentré en France dès les premiers jours de la mobilisation,
il fut mis à là tête d'une brigade. En octobre 1914,
il était promu divisionnaire. En janvier 1915, il recevait le
commandement en chef d'un des corps de l'armée du général
Maunoury.
On se rappelle qu'au mois de mars suivant, les deux généraux
inspectant les tranchées de première ligne furent tous
deux atteints à la tête, par la même balle allemande.
Le projectile atteignit le général de Villaret en plein
front. Le blessé subit l'opération du trépan.
Peu de temps après, il reparaissait à la tête de
ses troupes et recevait le commandement d'une armée.
VARIÉTÉ
Les Cosaques
La légende et la vérité.
- Comment ils mangeaient les chandelles. - Un peuple de cavaliers. -
La cruauté des Boches et
la douceur des Cosaques.
Les Allemands les appellent « les diables
à cheval ». Cela dit toute la terreur que les Cosaques
leur inspirent. Quand les diables à cheval apparaissent, la lance
en arrêt ou le sabre à la main, c'est la déroute
: les Boches, et plus encore leurs indignes alliés les Autrichiens,
s'enfuient ou se terrent. Car rien ne résiste au flot des Cosaques
qui passent.
Ce fut de tout temps le privilège des cavaliers de la steppe
de semer ainsi la terreur sur les pas de leurs chevaux. La légende
remonte loin du cosaque impitoyable. Peut-être fut-elle juste
en des temps très lointains. Mais déjà elle ne
l'était plus il y a un siècle. Les malheureux débris
de la Grande Armée, vaincus par le froid plus que par les armes
de l'adversaire, avaient aussi la frayeur du cosaque. Mais ce qu'ils
craignaient en lui c'était le combattant et non l'ennemi cruel.
Les Cosaques ne leur laissaient pas, dans la retraite, un instant de
répit : de là leur épouvante de la cavalerie russe.
Mais on chercherait vainement dans les rapports des soldats de Napoléon
un trait de cruauté commis par les Cosaques.
La légende n'en subsistait pas moins. Elle arriva jusqu'à
Paris en 1814 sur les ailes de la défaite. On frémit à
la pensée que ces cavaliers terribles allaient venir. On s'effraya
plus encore quand on les vit, car ils étaient effroyables, en
effet, avec leurs figures barbues et leurs grands bonnets de fourrure.
Et puis on s'aperçut bien vite qu'ils n'étaient pas méchants
et qu'ils ne mangeaient pas les petits enfants comme on l'avait dit.
Tout au plus mangeaient-ils les chandelles. Et cela n'était pas
bien grave. D'ailleurs, les chandelles, en ce temps-là, étaient
faites en France avec la meilleure graisse de boeuf, de porc et de mouton.
Or les Cosaques aimaient beaucoup la graisse. C'est un goût tout
naturel chez les habitants des pays froids. La consommation de la graisse
est nécessaire à leur organisme. Il faut ajouter, au surplus,
que les Cosaques ne mangeaient pas les chandelles en y mordant à
pleines dents comme on le supposait. Ils les faisaient fondre dans l'eau
bouillante, les additionnaient d'épices, et cela constituait
un potage très appréciable. Ils en usaient, en somme,
comme nous faisons aujourd'hui de certaines tablettes de bouillon condensé.
***
Les Cosaques ne sont pas des soldats ordinaires, c'est une nation de
soldats.
Combien sont-ils ?
Au début du conflit, on comptait, pour toute la Russie, 727 sotnias
de cavalerie cosaque, ce qui représentait approximativement,
à raison de deux cents hommes environ par sotnia, un effectif
de 145.000 à 150.000 hommes. Depuis lors ce chiffre s'est encore
augmenté par d'appel d'un certain nombre de sotnias indépendantes.
On peut évaluer à deux cent mille le nombre des cavaliers
qui traquent le Boche et l'Austro-Boche dans les plaines de la Bukovine
et de la Volhynie.
Naguère, le service des Cosaques n'était fixé par
aucun règlement légal : le Cosaque accourait à
l'appel du tsar, tout simplement, et rentrait chez lui, la guerre finie.
Depuis 1875, une loi détermine exactement les devoirs du cosaque.
De dix-huit à vingt-et-un ans, il fait son apprentissage militaire
; de vingt-et-un à trente-trois ans, il est dans la période
active ; à trente-six ans, dans la milice territoriale. Il se
monte et s'équipe à ses frais. Le gouvernement ne lui
fournit que les armes et les munitions.
Le pays des Cosaques s'étend du Caucase jusqu'au delà
du Don. Ils y vivent d'une vie patriarcale et conservent maintes particularités
de meurs qui les distinguent absolument de la masse de la population
russe.
Un voyageur qui vécut longtemps parmi eux, écrit :
« Certes, ils ne sont plus des nomades belliqueux qui passent
leur vie à faire la guerre à tort et à travers.
Ils sont devenus agriculteurs. et la vie tranquille, pacifique du paysan
est loin de leur déplaire. Mais les traditions sont vives, appuyées
qu'elles sont, fort habilement, par l'organisation spéciale et
privilégiée que les tsars leur ont donnée, et le
métier militaire, ou plutôt le métier de prétorien,
d'une caste militaire au service purement personnel du tsar, est toujours
la base de leur existence. Ils sont un véritable peuple de soldats.
Leurs chefs militaires sont en même temps leurs chefs administratifs
: à peu près comme si chez nous chaque maire de village
était de droit le capitaine de la compagnie formée par
les conscrits de la localité, et comme si, à toute occasion,
les habitants soumis au service militaire étaient à l'ordre
du maire, du sous-préfet ou du préfet pour accomplir des
exercices.
» Existence curieuse, et singulièrement déplacée
au milieu d'un État qui vit de la vie moderne. Le cosaque, dès
sa plus tendre enfance est habitué par ses parents à l'art
du cavalier et au maniement des armes. On sait que beaucoup de «Jockeys
» ou de « voltigeurs » qui s'exhibent dans les cirques
feraient piteuse figure à côté de ces gamins qui
font sur leurs petits chevaux rapides des tours d'acrobatie stupéfiants.
» L'art de jouer de leur redoutable lance n'a déjà
plus de secrets pour eux, à un âge où nos garçons
apprennent encore par coeur les départements de la France. A
seize ans, ils ne savent généralement pas lire, mais en
revanche, ils remporteraient tous les premiers prix du monde au tir
aux pigeons. Enfin, ils arrivent à une adresse stupéfiante
à user de leur terrible fouet, que nous appelons faussement knout
et qu'ils appellent « nagaika ». Cette lanière de
cuir fonctionne tour à tour au gré de la main qui la dirige,
comme un couteau, comme une hache ou comme une main caressante. Et cela
sans que le spectateur puisse s'en apercevoir. J'ai vu briser la colonne
vertébrale d'un mouton d'un seul coup. J'ai vu décapiter
des oies avec une maëstria que M. Deibler lui-même admirerait.
Et ensuite, j'ai mis ma main sur une planche et on lui porta un coup
d'apparence formidable qui me toucha comme un léger souffle froid...
»
Le cosaque n'use pas avec moins de maestria de la chachka,
le sabre courbe sans garde qui lui est particulier. Avec cette arme
terrible, il fait voler les têtes comme on fauche l'avoine.
***
On savait, avant cette guerre, ce qu'était la valeur militaire
des cosaques : les événements qui se déroulent
depuis deux ans en Russie, en Pologne, en Prusse orientale, au Caucase
et jusqu'en Mésopotamie, l'ont encore affirmée s'il est
possible.
Au début de la guerre, les Autrichiens disaient : « Les
Cosaques ont peur à peine arrivés sur nous, ils rebroussent
chemin ! » Cette erreur tenait à la façon de combattre
des cosaques. Un correspondant d'un journal italien qui les a suivis
dans la campagne de Galicie, écrit :
« Les cosaques se lancent contre le flanc ennemi. A une certaine
distance, ils sautent à terre, se retranchent derrière
leurs chevaux, tirent, remontent et disparaissent. Mais cela seulement
quand ils ne veulent pas forcer une ligne. Sans quoi ils s'élancent
au contraire à fond et sont terribles. Hommes et chevaux ont
un seul rythme, sont portés par le même souffle. Les chevaux
sont petits, très minces, d'une étrange couleur noisette
; ils sont ferrés seulement aux pieds de devant. Les Autrichiens
en ont pris plusieurs. Mais ils ne peuvent pas s'en servir. instruments
dociles aux mains de leurs cavaliers, ils ne font plus un pas s'ils
ne reconnaissent pas la voix qui les commande...»
Mais la peur est un sentiment que les Cosaques ignorent. Ils l'ont maintes
fois prouvé dans cette guerre.
Rappelez-vous notamment le raid accompli par les Cosaques qui quittèrent
les troupes du général Baratof en Perse, pour rejoindre
les forces du général sir Percy Lake en Mésopotamie.
Ils traversèrent des passes à 8.000 pieds de hauteur,
où ils couraient le risque de rencontrer les troupes ennemies
à chaque instant, car les montagnes sont infestées de
tribus guerrières. Leur guide fit naître des soupçons
par ses tentatives constantes de les égarer. Il dut parfois leur
indiquer la route la corde au cou.
Leur dernière étape fut de 48 kilomètres, au cours
de laquelle cinq chevaux périrent de soif et de fatigue au milieu
q'un désert brûlant.
La résistance de ces hommes est extraordinaire. Ce qu'ils supportèrent
dans les Karpathes pendant l'hiver de 1914-1915 est inimaginable.
« Nos cosaques firent merveille, écrit un de leurs officiers
; mais quel froid ! Ce fut horrible. Malgré nos pieds enduits
de graisse, nos énormes bottes de feutre passées sur nos
bottes de cuir, nos lourdes pelisses de fourrure, nous trouvions à
grand' peine l'énergie nécessaire pour réagir contre
cette sorte de torpeur toute spéciale et très douce que
donne le froid. J'ai éprouvé moi-même cet engourdissement
et ce fut le grand souci de ma responsabilité qui seul me donna
le courage de réagir. »
L'officier raconte alors qu'étant parti en reconnaissance avec
une centaine de cavaliers il fut cerné par des forces considérables.
Malgré le froid, malgré la marche pénible sur les
flancs glacés des montagnes, lui et ses hommes combattirent sans
relâche et parvinrent à percer le cercle des ennemis.
Mais la petite troupe s'était égarée.
« A partir de ce moment, dit-il, le vrai martyre commença.
Pendant 48 heures, mes pauvres soldats n'eurent, comme moi, pour toute
nourriture, que du pain fait avec de l'avoine. Nous devions le mâcher
avec de la neige pour arriver à l'avaler. Ma boussole seule nous
guidait. J'étais obligé de soutenir mes hommes par la
parole, par l'exemple. J'entonnais par moments quelques-uns de leurs
chants favoris, leur donnant ainsi un peu de surexcitation factice.
Mais ce froid ! ce froid terrible ! il pénétrait en nous,
doucement, insidieusement et, peu à peu, gagnait nos âmes.
J'étais brisé, exténué, et jamais l'idée
de la mort ne m'apparut plus calme et plus reposante qu'à cet
instant. »
Cependant, à force de volonté, cette poignée de
héros parvint à échapper à l'étreinte
de l'ennemi.
Voilà pour l'énergie et le courage. Pour l'entraînement,
jugez-en par ce trait que rapporte la comtesse Rostopchine :
« Certain général autrichien ordonna de lui amener
à tout prix un cosaque vivant, non blessé, ni coupé
en petits morceaux, comme on le fait ordinairement. Cette chose invraisemblable
(un prisonnier cosaque vivant) fut amenée devant le général
qui était à cheval, entouré d'officiers et de soldats.
Délié, nourri, abreuvé, le cosaque dut faire le
signe de la croix, montrer celle qu'il portait et servit à la
démonstration du général qui disait qu'un cosaque
était un homme comme les autres et qu'il n'y avait nulle raison
de le craindre. Puis, il lui fit donner un sabre et montrer comment
il coupait les têtes à la volée. On s'amusait, lorsque
le cosaque, sautant subitement derrière le général,
l'enlaça des deux bras et, donnant du talon lança le coursier
à travers les groupes. Décontenancés, les Autrichiens
n'osèrent tirer, de peur de tuer leur chef. Saisissant les brides,
le cosaque volait, tandis que son prisonnier était paralysé
et comme hébété. Les soldats qu'on rencontrait
étonnés, ne comprenant rien à ce groupe fantastique
livraient passage. Il y eut bien quelques coups de fusil, mais timides,
ils ne portaient pas.
« Au reste le cheval était excellent et il ramena triomphalement
dans les lignes russes le cosaque et son général. »
Comment ne rappellerait-on pas encore l'exploit extraordinaire et tout
récent de ces cosaques du Don qui, lors du passage du Dniester,
près de Snovidouvo, passèrent le fleuve tout nus, ne portant
que leurs fusils, et, après la traversée à la nage
du fleuve, attaquèrent à la baïonnette l'ennemi,
en tuant une partie, capturant l'autre et se maintenant sur la position
conquise jusqu'au passage des renforts.
***
Quant aux sentiments d'humanité, les cosaques, en dépit
de la vieille légende de sauvagerie qui s'attache à leur
nom, en ont, depuis le début de la guerre, donné tant
de témoignages que les ennemis eux-mêmes en ont été
impressionnés.
Le correspondant de la Tribune de Genève en Galicie
rapporte que la population se plaisait à rendre hommage aux sentiments
pieux et humains des cavaliers russes.
« Eh bien, oui, ils sont humains, ces cosaques, a déclaré
un habitant d'Homonna. Le jour où quelques centaines de ces cosaques,
après avoir passé par notre ville, furent refoulés
par nos soldats, ils prirent dans leur fuite précipitée
le temps de panser les blessures des soldats autrichiens étendus
sans soins sur la route. Ces cosaques, ayant perdu leur camp de concentration
et ne pouvant pas se ravitailler étaient pour ainsi dire dévorés
de faim, mais ils avaient toujours un morceau de sucre, un bout de biscuit
à tendre au blesse, ennemi.
» J'ai vu arrêter deux cosaques au moment où après
avoir relevé sur la route des blessés pour leur épargner
les coups de sabots des chevaux, ils les faisaient boire à leur
gourde. L'un d'eux tenait la tête d'un blessé sur ses genoux
pendant qu'il buvait, c'est alors qu'il fut fait prisonnier.
» A Uszok, les Russes, en se retirant, ont déposé
les blessés autrichiens dans des maisons où ils ont laissé
du pain, de l'eau (détail très délicat : le cosaque
a lavé et rincé la marmite dans laquelle il servait l'eau
) et quelques fruits secs. Ailleurs, un cosaque, blessé à
la jambe, se pencher sur un blessé autrichien qui a le bras arraché
et s'efforce d'arrêter l'hémorragie, pendant que le sang
coule en abondance de sa jambe blessée. Et, comme pour l'encourager,
il lui offre deux pastilles de menthe.
» Plus loin, à Bartfeld, on entend des coups de fouet.
C'est un officier cosaque qui fait administrer une dure leçon
à son maréchal des logis pour avoir volé chez des
particuliers... A part quelques gamineries, sans conséquences,
ces cosaques sont vraiment de braves gens. »
Voilà ce que disent les habitants des pays envahis par ces farouches
cosaques. Ils se plaisent à proclamer l'honnêteté,
la douceur, l'humanité de ces soldats.
Quelle différence entre la conduite de ces hommes, pourtant primitifs,
et la cruauté dont usèrent chez nous et en Belgique, les
Boches, pourtant si fiers de leur Kultur !
Ernest LAUT
Le Petit Journal illustré du 23 juillet 1916